Hémosidérose : Symptômes, Diagnostic et Traitements 2025 | Guide Complet
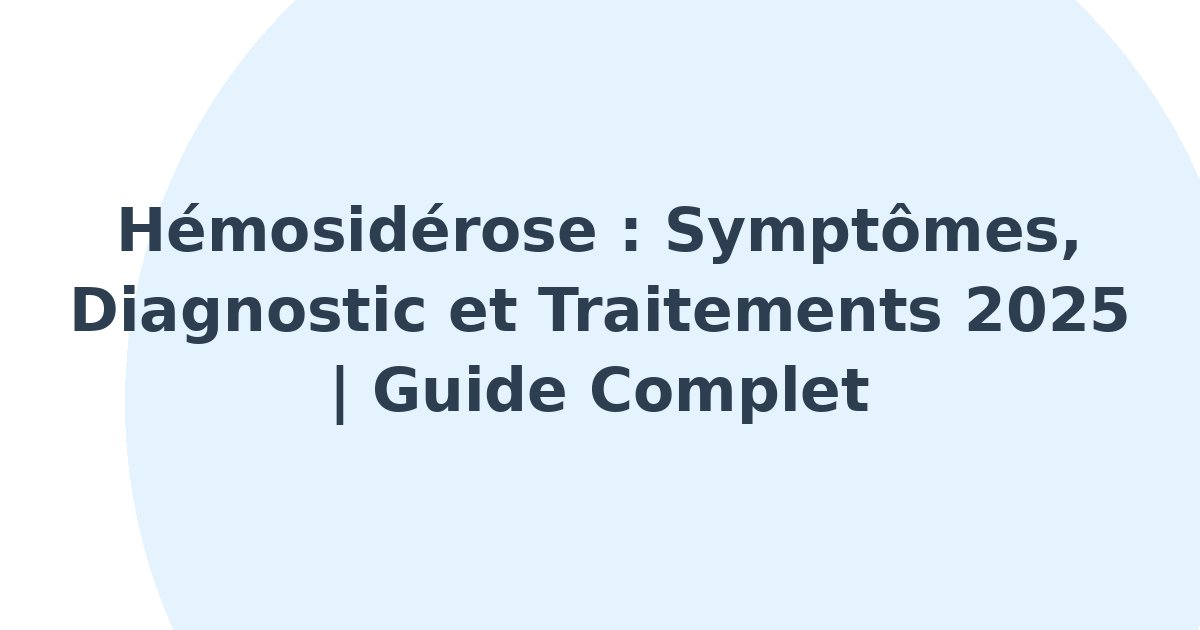
L'hémosidérose correspond à une accumulation anormale de fer dans les tissus de l'organisme. Cette pathologie, souvent méconnue, peut toucher différents organes comme les poumons, le foie ou le cerveau. Contrairement à l'hémochromatose héréditaire, l'hémosidérose résulte généralement d'un apport excessif de fer ou d'une inflammation chronique. Comprendre cette maladie permet une prise en charge adaptée et améliore significativement la qualité de vie des patients.
Téléconsultation et Hémosidérose
Téléconsultation non recommandéeL'hémosidérose nécessite généralement des examens complémentaires spécialisés (IRM, biopsie tissulaire, dosages sanguins spécifiques) pour confirmer le diagnostic et évaluer l'étendue des dépôts de fer dans les organes. La complexité de cette pathologie et ses implications potentiellement graves sur différents organes (foie, cœur, pancréas) rendent indispensable une prise en charge en présentiel avec accès direct aux examens diagnostiques.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique des expositions professionnelles ou environnementales au fer, analyse des antécédents familiaux de surcharge ferrique, évaluation des symptômes généraux comme la fatigue chronique ou les douleurs articulaires, orientation diagnostique initiale en cas de suspicion, suivi de l'observance thérapeutique chez les patients déjà diagnostiqués.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examens complémentaires indispensables (IRM hépatique et cardiaque, biopsie tissulaire si nécessaire), dosages biologiques spécialisés (ferritine, coefficient de saturation de la transferrine), évaluation clinique des complications organiques, mise en place du traitement chélateur du fer nécessitant une surveillance rapprochée.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Diagnostic initial nécessitant des examens d'imagerie spécialisés et des biopsies tissulaires, évaluation des complications organiques multiples (hépatiques, cardiaques, endocriniennes), initiation d'un traitement chélateur nécessitant une surveillance biologique rapprochée, suspicion de complications graves comme l'insuffisance cardiaque ou la cirrhose.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Signes d'insuffisance cardiaque aiguë liée aux dépôts ferriques cardiaques, troubles du rythme cardiaque graves, décompensation hépatique avec signes de cirrhose, acidocétose diabétique chez un patient avec atteinte pancréatique.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Essoufflement au repos, œdèmes des membres inférieurs ou douleurs thoraciques évoquant une insuffisance cardiaque
- Palpitations importantes, malaises ou syncopes suggérant des troubles du rythme cardiaque graves
- Jaunisse, ascite ou confusion mentale évoquant une décompensation hépatique
- Soif intense, urines abondantes avec altération de l'état général suggérant une décompensation diabétique
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Hématologue — consultation en présentiel indispensable
L'hématologue possède l'expertise nécessaire pour diagnostiquer et traiter les surcharges ferriques complexes, avec accès aux examens spécialisés et aux traitements chélateurs. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'évaluation initiale complète et le suivi des complications organiques multiples.
Hémosidérose : Définition et Vue d'Ensemble
L'hémosidérose désigne l'accumulation pathologique d'hémosidérine, un pigment contenant du fer, dans les tissus de l'organisme [8,9]. Cette maladie se distingue de l'hémochromatose par son mécanisme d'apparition et sa localisation préférentielle.
Concrètement, quand votre corps ne parvient plus à éliminer correctement le fer, celui-ci s'accumule sous forme d'hémosidérine. Cette substance, normalement présente en petites quantités, devient problématique lorsqu'elle s'accumule massivement [10]. L'important à retenir : l'hémosidérose peut être localisée (touchant un seul organe) ou généralisée (affectant plusieurs systèmes).
Mais alors, quels organes sont le plus souvent concernés ? Les poumons représentent la localisation la plus fréquente, notamment chez l'enfant avec l'hémosidérose pulmonaire idiopathique [2]. Le système nerveux central peut également être touché, provoquant des troubles neurologiques progressifs [3]. D'autres organes comme le foie, la rate ou les reins peuvent aussi être affectés selon le type d'hémosidérose.
Épidémiologie en France et dans le Monde
L'hémosidérose présente une épidémiologie complexe qui varie selon sa forme et sa localisation. En France, l'hémosidérose pulmonaire idiopathique touche principalement les enfants avec une incidence estimée à 1 cas pour 1 million d'enfants par an [2]. Cette pathologie représente une cause rare mais importante d'hémoptysie chez l'enfant [5].
Les données récentes montrent une prévalence plus élevée de l'hémosidérose cérébrale chez les patients ayant des antécédents neurochirurgicaux. D'ailleurs, une série française de 2025 rapporte 6 cas d'angiopathie amyloïde cérébrale iatrogène avec hémosidérose associée . Cette forme particulière semble en augmentation, probablement liée à l'amélioration des techniques diagnostiques.
Au niveau international, l'hémosidérose pulmonaire montre des variations géographiques importantes. Les pays nordiques rapportent des cas de saignements pulmonaires spontanés avec hémosidérose secondaire [6]. En Tunisie, l'hémosidérose figure parmi les étiologies identifiées de pneumopathie interstitielle diffuse chez l'enfant [7].
Bon à savoir : les enfants porteurs de trisomie 21 présentent un risque accru de développer une hémosidérose pulmonaire, selon les données de suivi en pneumologie pédiatrique francilienne [4]. Cette association nécessite une surveillance particulière dans cette population vulnérable.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de l'hémosidérose sont multiples et dépendent largement de sa localisation. Pour l'hémosidérose pulmonaire, plusieurs mécanismes peuvent être en jeu. L'hémosidérose pulmonaire idiopathique reste de cause inconnue, d'où son qualificatif "idiopathique" [2]. Cependant, certains facteurs de risque ont été identifiés pour les récidives [1].
L'hémosidérose peut aussi résulter de transfusions sanguines répétées. Chaque transfusion apporte environ 200 à 250 mg de fer, et l'organisme ne peut en éliminer que 1 à 2 mg par jour naturellement [10]. Cette accumulation progressive explique pourquoi les patients polytransfusés développent une surcharge en fer.
D'autres causes incluent les saignements chroniques avec réabsorption du fer, comme dans certaines pathologies pulmonaires. Les antécédents de chirurgie neurologique constituent également un facteur de risque pour l'hémosidérose cérébrale . En fait, l'exposition à des matériaux contenant du fer ou certaines infections chroniques peuvent aussi favoriser cette accumulation pathologique.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'hémosidérose varient considérablement selon l'organe touché et l'étendue de l'accumulation de fer. Pour l'hémosidérose pulmonaire, le symptôme le plus caractéristique reste l'hémoptysie, c'est-à-dire les crachats de sang [5]. Chez l'enfant, ce symptôme doit toujours alerter et conduire à des explorations approfondies.
Vous pourriez également ressentir une dyspnée (essoufflement) progressive, d'abord à l'effort puis au repos dans les formes avancées. Une toux chronique, parfois accompagnée d'expectorations brunâtres, peut aussi être présente. L'important à retenir : ces symptômes respiratoires peuvent s'installer insidieusement sur plusieurs mois.
Quand l'hémosidérose touche le système nerveux, les manifestations sont différentes. L'ataxie (troubles de l'équilibre) représente un symptôme fréquent, particulièrement dans la sidérose superficielle infratentorielle [3]. Des troubles cognitifs progressifs, des céphalées chroniques ou des troubles de l'audition peuvent également survenir.
Dans les formes généralisées, vous pourriez observer une fatigue chronique, une coloration brunâtre de la peau ou des douleurs articulaires. Rassurez-vous, tous ces symptômes ne sont pas forcément présents simultanément, et leur intensité varie d'une personne à l'autre.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'hémosidérose nécessite une approche méthodique combinant examens cliniques et paracliniques. La première étape consiste en un interrogatoire approfondi recherchant les antécédents de transfusions, les symptômes respiratoires ou neurologiques, et les facteurs de risque identifiés [8].
L'imagerie médicale joue un rôle central dans le diagnostic. Pour l'hémosidérose pulmonaire, le scanner thoracique haute résolution révèle des opacités en verre dépoli et des nodules centrolobulaires [2]. L'IRM cérébrale avec séquences spécifiques permet de détecter les dépôts d'hémosidérine dans le système nerveux, apparaissant en hyposignal caractéristique [3].
Les examens biologiques complètent le bilan diagnostique. Le dosage de la ferritine sérique, bien qu'élevé, n'est pas spécifique de l'hémosidérose. Le coefficient de saturation de la transferrine et le fer sérique apportent des informations complémentaires [9]. Dans certains cas, une biopsie tissulaire peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic et évaluer l'étendue des lésions.
Concrètement, votre médecin pourra également demander des explorations fonctionnelles respiratoires si vos poumons sont concernés, ou des tests neurologiques spécialisés en cas d'atteinte cérébrale. L'important est d'adapter les examens à votre situation particulière.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'hémosidérose repose principalement sur la chélation du fer, c'est-à-dire l'utilisation de médicaments qui captent le fer en excès pour l'éliminer de l'organisme [10]. Les chélateurs du fer les plus utilisés incluent la déféroxamine, administrée par voie sous-cutanée ou intraveineuse, et les chélateurs oraux comme le déférasirox.
Pour l'hémosidérose pulmonaire, le traitement peut également inclure des corticostéroïdes lors des poussées inflammatoires aiguës [2]. Ces médicaments aident à réduire l'inflammation pulmonaire et peuvent limiter les épisodes d'hémoptysie. Cependant, leur utilisation doit être prudente et limitée dans le temps.
Dans les cas sévères d'hémosidérose pulmonaire, des immunosuppresseurs peuvent être envisagés. L'azathioprine ou le cyclophosphamide ont montré une certaine efficacité dans la prévention des récidives [1]. Néanmoins, ces traitements nécessitent une surveillance étroite en raison de leurs effets secondaires potentiels.
Bon à savoir : le traitement de l'hémosidérose neurologique reste plus complexe. La chélation du fer peut ralentir la progression, mais les dommages neurologiques déjà constitués sont souvent irréversibles [3]. C'est pourquoi un diagnostic précoce est crucial pour préserver les fonctions neurologiques.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques récentes ouvrent de nouvelles perspectives pour le traitement de l'hémosidérose. Le bulletin de recherche ERS 2024 met en évidence plusieurs avancées prometteuses dans la prise en charge des pathologies liées à l'accumulation de fer . Ces innovations concernent notamment l'amélioration des techniques de chélation et le développement de nouveaux agents thérapeutiques.
Dans le domaine de la médecine personnalisée, les recherches 2024-2025 s'orientent vers une meilleure compréhension des mécanismes individuels de l'hémosidérose. L'identification de biomarqueurs spécifiques pourrait permettre d'adapter les traitements selon le profil de chaque patient . Cette approche personnalisée représente un espoir majeur pour optimiser l'efficacité thérapeutique.
Les thérapies innovantes incluent également le développement de nouveaux chélateurs du fer plus efficaces et mieux tolérés. Certaines molécules en cours d'évaluation montrent une capacité supérieure à traverser la barrière hémato-encéphalique, ouvrant des perspectives pour le traitement de l'hémosidérose cérébrale .
D'ailleurs, les techniques d'imagerie avancée permettent désormais un suivi plus précis de l'évolution de la maladie. L'IRM quantitative du fer offre une mesure non invasive de la charge en fer tissulaire, facilitant l'adaptation thérapeutique en temps réel.
Vivre au Quotidien avec Hémosidérose
Vivre avec une hémosidérose nécessite certains ajustements dans votre quotidien, mais rassurez-vous, une vie normale reste tout à fait possible avec une prise en charge adaptée. L'important est d'établir une routine de soins régulière et de maintenir un suivi médical approprié.
Sur le plan alimentaire, il est recommandé de limiter les aliments riches en fer, particulièrement la viande rouge et les abats. Évitez également de consommer de la vitamine C en excès avec les repas, car elle favorise l'absorption du fer [9]. En revanche, le thé et le café peuvent être bénéfiques car ils contiennent des tanins qui réduisent l'absorption du fer.
L'activité physique adaptée reste importante pour maintenir votre maladie générale. Cependant, si vous souffrez d'hémosidérose pulmonaire, évitez les efforts intenses qui pourraient déclencher des épisodes d'hémoptysie. Privilégiez des activités douces comme la marche, la natation modérée ou le yoga.
Concrètement, organisez votre environnement pour faciliter la prise de vos traitements. Si vous utilisez un chélateur injectable, préparez un espace dédié et stérile. Tenez un carnet de suivi pour noter vos symptômes, vos traitements et vos rendez-vous médicaux. Cette organisation vous aidera à mieux communiquer avec votre équipe soignante.
Les Complications Possibles
L'hémosidérose peut entraîner diverses complications selon l'organe touché et l'évolution de la maladie. Les complications pulmonaires incluent la fibrose progressive, qui peut conduire à une insuffisance respiratoire chronique [2]. Les épisodes d'hémoptysie massive représentent une urgence médicale nécessitant une prise en charge immédiate.
Au niveau neurologique, l'accumulation d'hémosidérine peut provoquer des lésions irréversibles. L'ataxie progressive, les troubles cognitifs et la surdité neurosensorielle figurent parmi les complications les plus redoutées [3]. Ces atteintes neurologiques soulignent l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoces.
Les complications cardiaques peuvent survenir dans les formes généralisées d'hémosidérose. L'accumulation de fer dans le myocarde peut conduire à une cardiomyopathie dilatée et à des troubles du rythme cardiaque [10]. Cette complication nécessite un suivi cardiologique régulier et adapté.
D'autres complications incluent les atteintes hépatiques avec risque de cirrhose, les troubles endocriniens par atteinte des glandes, et les complications infectieuses liées aux traitements immunosuppresseurs. Heureusement, un suivi médical régulier permet de dépister et de prévenir la plupart de ces complications.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'hémosidérose varie considérablement selon plusieurs facteurs : la localisation de la maladie, la précocité du diagnostic, l'efficacité du traitement et la réponse individuelle du patient. Pour l'hémosidérose pulmonaire idiopathique, le pronostic s'est nettement amélioré avec les traitements actuels [2].
Les facteurs de risque de récidive ont été mieux identifiés grâce aux études récentes, permettant une prise en charge plus ciblée [1]. Concrètement, les patients diagnostiqués précocement et traités de manière appropriée peuvent espérer une stabilisation de leur maladie et une amélioration de leur qualité de vie.
Pour les formes neurologiques, le pronostic dépend largement du stade au moment du diagnostic. L'hémosidérose cérébrale diagnostiquée à un stade précoce peut voir sa progression ralentie par le traitement [3]. Cependant, les lésions neurologiques déjà constituées sont généralement irréversibles, d'où l'importance cruciale d'un diagnostic précoce.
Il faut savoir que chaque patient évolue différemment. Certains connaissent une évolution favorable avec une stabilisation rapide, tandis que d'autres nécessitent des ajustements thérapeutiques réguliers. L'important est de maintenir un suivi médical régulier et d'adapter le traitement selon l'évolution de votre maladie.
Peut-on Prévenir Hémosidérose ?
La prévention de l'hémosidérose repose principalement sur l'identification et la gestion des facteurs de risque modifiables. Pour les patients nécessitant des transfusions répétées, une surveillance régulière du bilan martial permet de détecter précocement une surcharge en fer [10].
Chez les enfants à risque, notamment ceux porteurs de trisomie 21, une surveillance pneumologique régulière peut permettre un diagnostic précoce d'hémosidérose pulmonaire [4]. Cette surveillance préventive est particulièrement importante car ces enfants présentent un risque accru de développer des complications respiratoires.
La prévention secondaire, c'est-à-dire la prévention des complications chez les patients déjà atteints, passe par un suivi médical régulier et l'observance thérapeutique. Le respect des recommandations alimentaires et la prise régulière des chélateurs du fer constituent des éléments clés de cette prévention.
En fait, certaines mesures générales peuvent également contribuer à la prévention : éviter l'exposition excessive au fer, maintenir une alimentation équilibrée, et consulter rapidement en cas de symptômes évocateurs. Pour les professionnels de santé exposés à des risques particuliers, des protocoles de surveillance spécifiques peuvent être mis en place.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises ont établi des recommandations spécifiques pour la prise en charge de l'hémosidérose, particulièrement dans le contexte des transfusions répétées [10]. Ces guidelines soulignent l'importance d'une surveillance systématique du bilan martial chez les patients polytransfusés.
L'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) a publié des fiches techniques détaillées sur la prévention et le traitement de l'hémosidérose transfusionnelle. Ces documents précisent les seuils d'intervention thérapeutique et les modalités de surveillance biologique [10]. Concrètement, un traitement chélateur doit être envisagé dès que la ferritine sérique dépasse certains seuils définis.
Pour l'hémosidérose pulmonaire pédiatrique, les sociétés savantes recommandent une prise en charge multidisciplinaire associant pneumologues, pédiatres et radiologues [2]. Cette approche coordonnée permet d'optimiser le diagnostic et le suivi de ces jeunes patients.
Les recommandations insistent également sur l'importance de l'éducation thérapeutique des patients et de leurs familles. Cette éducation porte sur la reconnaissance des signes d'alerte, l'observance thérapeutique et les mesures préventives à adopter au quotidien.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations de patients peuvent vous accompagner dans votre parcours avec l'hémosidérose. Bien que cette pathologie soit rare, des organisations spécialisées dans les maladies du fer ou les maladies rares proposent soutien et information.
L'Alliance Maladies Rares fédère de nombreuses associations et peut vous orienter vers des ressources spécifiques. Cette organisation propose également des services d'accompagnement social et administratif pour les patients atteints de maladies rares comme l'hémosidérose.
Pour les familles d'enfants atteints d'hémosidérose pulmonaire, des groupes de soutien spécialisés en pneumologie pédiatrique peuvent offrir un accompagnement précieux. Ces groupes permettent l'échange d'expériences entre familles confrontées aux mêmes défis.
Les centres de référence pour les maladies rares constituent également des ressources importantes. Ces centres, répartis sur le territoire français, proposent une expertise spécialisée et peuvent coordonner votre prise en charge avec les équipes locales. N'hésitez pas à demander à votre médecin de vous orienter vers le centre le plus proche de votre domicile.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec une hémosidérose au quotidien. Tout d'abord, organisez votre suivi médical en tenant un carnet de santé détaillé. Notez-y vos symptômes, vos traitements, vos résultats d'examens et vos questions pour les consultations.
Concernant l'alimentation, privilégiez les aliments pauvres en fer et évitez les suppléments vitaminiques contenant du fer. Consommez du thé ou du café pendant les repas pour réduire l'absorption du fer alimentaire. Évitez de cuire dans des ustensiles en fonte qui peuvent libérer du fer supplémentaire.
Pour la gestion des traitements, établissez une routine quotidienne pour ne pas oublier vos médicaments. Si vous utilisez des chélateurs injectables, préparez votre matériel à l'avance et respectez scrupuleusement les règles d'hygiène. En cas d'effets secondaires, contactez immédiatement votre équipe médicale.
Adaptez votre environnement professionnel si nécessaire. Informez votre employeur de votre maladie si cela peut impacter votre travail, et n'hésitez pas à demander des aménagements d'horaires pour vos soins. Maintenez une activité physique régulière mais adaptée à vos capacités respiratoires ou neurologiques.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alerte doivent vous amener à consulter rapidement votre médecin ou à vous rendre aux urgences. En cas d'hémoptysie importante ou d'aggravation brutale de votre essoufflement, une consultation en urgence s'impose [5]. Ces symptômes peuvent signaler une complication grave nécessitant une prise en charge immédiate.
Pour les patients suivis pour hémosidérose neurologique, toute aggravation des troubles de l'équilibre, l'apparition de nouveaux symptômes neurologiques ou une altération de l'état général doivent motiver une consultation rapide [3]. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent pour consulter.
En dehors des urgences, un suivi médical régulier est indispensable. La fréquence des consultations dépend de votre forme d'hémosidérose et de votre réponse au traitement. Généralement, un suivi trimestriel est recommandé en phase d'équilibration, puis semestriel une fois la maladie stabilisée.
N'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale en cas de doute ou d'inquiétude. Il vaut mieux une consultation "pour rien" qu'une complication non détectée. Votre médecin préfère être sollicité pour des questions légitimes plutôt que de découvrir tardivement une aggravation de votre état.
Questions Fréquentes
L'hémosidérose est-elle héréditaire ?
Non, contrairement à l'hémochromatose, l'hémosidérose n'est généralement pas héréditaire. Elle résulte d'une accumulation acquise de fer dans les tissus.
Peut-on guérir complètement de l'hémosidérose ?
La guérison dépend de la cause et de la précocité du traitement. Les formes liées aux transfusions peuvent être contrôlées efficacement par la chélation du fer. Les formes idiopathiques nécessitent souvent un traitement au long cours.
Les enfants peuvent-ils développer une hémosidérose ?
Oui, l'hémosidérose pulmonaire idiopathique touche principalement les enfants. Les enfants trisomiques présentent un risque particulièrement élevé.
Le traitement est-il contraignant ?
Les chélateurs du fer nécessitent une prise régulière et un suivi biologique. Les formes injectables peuvent être contraignantes mais des alternatives orales existent.
Peut-on avoir une vie normale avec une hémosidérose ?
Oui, avec un traitement adapté et un suivi régulier, la plupart des patients peuvent maintenir une qualité de vie satisfaisante. Certains ajustements du mode de vie peuvent être nécessaires selon la localisation de la maladie.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Bulletin de recherche ERS 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Lecanemab in clinical practice: real-world outcomes. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Lilly's Kisunla (donanemab) receives marketing authorization. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Clinical features and risk factors for recurrence of idiopathic pulmonary hemosiderosis. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Nathan N, Taytard J. Hémosidérose pulmonaire idiopathique de l'enfantLien
- [6] Bogdan T, Wirth T. Ataxie et sidérose superficielle infratentorielle: une cause peut en cacher une autre. 2024Lien
- [7] Riondet P, Gourrin K. Quand les souvenirs neurochirurgicaux saignent... une série de 6 cas d'angiopathie amyloïde cérébrale iatrogène. 2025Lien
- [8] Mesbahi Y, Masson E. Atteintes respiratoires basses infectieuses et non infectieuses chez les enfants porteurs de trisomie 21. 2025Lien
- [9] El Athmani O. Hémoptysie chez l'enfant. Perfectionnement en Pédiatrie, 2025Lien
- [10] de Bengy Puyvallee IH, Svenne IS. Spontan blødning i lungene. Tidsskrift for Den norske legeforening, 2022Lien
- [11] Courret T, Blyau S. Angiopathie amyloïde du sujet jeune et exposition à une dure-mère cadavérique dans l'enfance. 2024Lien
- [12] Chaabi K, Louhaichi S. Les étiologies de pneumopathie interstitielle diffuse chez les enfants tunisiens. 2023Lien
- [13] Hémosidérose : causes, symptômes et traitement. Medicover HospitalsLien
- [14] Hémosidérose - Troubles du sang. MSD ManualsLien
- [15] Hémosidérose. Fiche technique ANSM - CNCRHLien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] HEMOSIDEROSE PULMONAIRE IDIOPATHIQUE DE L'ENFANT [PDF]
- Ataxie et sidérose superficielle infratentorielle: une cause peut en cacher une autre (2024)
- Quand les souvenirs neurochirurgicaux saignent... une série de 6 cas d'angiopathie amyloïde cérébrale iatrogène (2025)
- Atteintes respiratoires basses infectieuses et non infectieuses chez les enfants porteurs de trisomie 21 suivis en consultation de pneumologie pédiatrique en Île-de … (2025)
- Hémoptysie chez l'enfant (2025)
Ressources web
- Hémosidérose : causes, symptômes et traitement (medicoverhospitals.in)
Diagnostic de l'hémosidérose. Le diagnostic de l'hémosidérose implique une combinaison d'évaluation clinique, d'études d'imagerie et de tests de laboratoire.
- Hémosidérose - Troubles du sang (msdmanuals.com)
L'hémosidérose provoquée par le saignement et la dégradation des globules rouges ne nécessite généralement aucun traitement.
- Hémosidérose (hemovigilance-cncrh.fr)
L'hémochromatose ou hémosidérose est une surcharge en fer de l'organisme. Elle se traduit dans ses formes les plus importantes par une coloration grise de la ...
- Hémosidérose pulmonaire idiopathique (msdmanuals.com)
Chez l'adulte, les symptômes les plus courants sont l'essoufflement pendant l'activité et les symptômes d'une anémie ferriprive. Diagnostic de l'hémosidérose ...
- Hémosidérose pulmonaire idiopathique (merckmanuals.com)
Les symptômes les plus fréquents chez les adultes sont une dyspnée et une fatigue d'effort due à une hémorragie pulmonaire et à une anémie ferriprive.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
