Hémorragie : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Innovations
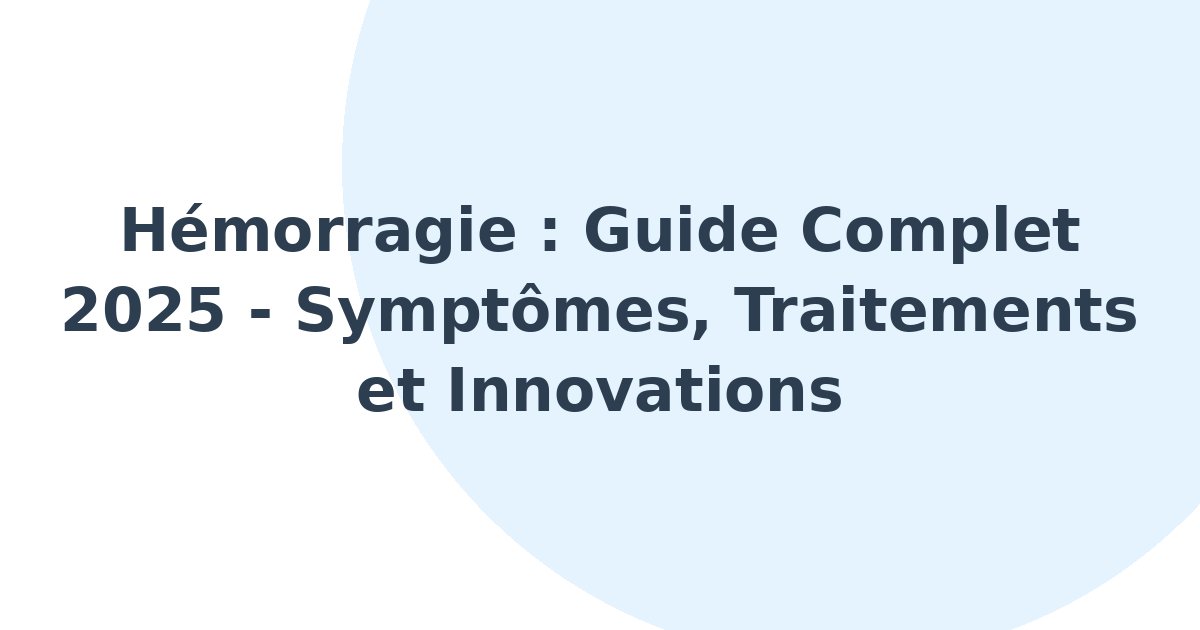
L'hémorragie représente une urgence médicale majeure qui touche des milliers de personnes chaque année en France. Cette pathologie, caractérisée par une perte de sang anormale, peut survenir dans différents organes et nécessite une prise en charge rapide. Grâce aux avancées médicales récentes et aux nouvelles approches thérapeutiques développées en 2024-2025, le pronostic s'améliore considérablement pour les patients.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Hémorragie : Définition et Vue d'Ensemble
Une hémorragie correspond à un écoulement de sang hors des vaisseaux sanguins, qu'il soit visible ou non. Cette pathologie peut affecter n'importe quelle partie du corps et présente des degrés de gravité très variables.
Concrètement, on distingue plusieurs types d'hémorragies selon leur localisation. Les hémorragies externes sont visibles, comme lors d'une blessure cutanée. Mais les hémorragies internes restent cachées et peuvent être particulièrement dangereuses car elles passent souvent inaperçues [19,20].
L'important à retenir, c'est que toute hémorragie importante constitue une urgence médicale. En effet, la perte de sang peut rapidement compromettre l'oxygénation des organes vitaux. D'ailleurs, les mécanismes de coagulation naturels de notre organisme tentent toujours de stopper spontanément le saignement [21].
Bon à savoir : une hémorragie peut être aiguë (soudaine et massive) ou chronique (lente et prolongée). Chaque situation nécessite une approche thérapeutique spécifique adaptée à l'urgence et à la cause sous-jacente.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes révèlent l'ampleur de cette pathologie en France. Selon Santé Publique France, les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques représentent environ 15% de l'ensemble des AVC, soit près de 22 500 cas annuels [1,2,3].
L'incidence hospitalière des hémorragies cérébrales montre des variations régionales significatives. Les régions du Nord et de l'Est de la France présentent des taux plus élevés, probablement liés aux facteurs socio-économiques et aux habitudes de vie [5]. Et ces chiffres ne cessent d'évoluer avec le vieillissement de la population.
Concernant les hémorragies obstétricales, une étude récente de 2024 révèle qu'elles constituent la première cause de mortalité maternelle en France entre 2016 et 2018. Cette pathologie touche environ 1,2% des accouchements, avec un taux de mortalité de 0,8 pour 100 000 naissances vivantes [11].
Au niveau international, l'épidémiologie des hémorragies cérébrales spontanées a considérablement évolué ces 40 dernières années. Yannick Béjot souligne dans ses travaux de 2025 une diminution de l'incidence chez les sujets jeunes, mais une augmentation chez les personnes âgées de plus de 75 ans [14].
Les projections pour 2030 suggèrent une augmentation de 25% des cas d'hémorragies cérébrales, principalement due au vieillissement démographique. Cette évolution représente un défi majeur pour notre système de santé, nécessitant une adaptation des structures de soins.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes d'hémorragie sont multiples et varient selon la localisation. Pour les hémorragies cérébrales, l'hypertension artérielle reste le facteur de risque principal, impliquée dans 60% des cas. Mais d'autres causes peuvent être en jeu : malformations vasculaires, troubles de la coagulation, ou encore prise d'anticoagulants [13,14].
Les facteurs de risque cardiovasculaires jouent un rôle déterminant. Le diabète, l'hypercholestérolémie et le tabagisme augmentent significativement le risque hémorragique. D'ailleurs, l'âge constitue également un facteur majeur, avec une incidence qui double tous les 10 ans après 55 ans.
Concernant les hémorragies digestives, les causes diffèrent. Les ulcères gastro-duodénaux, les varices œsophagiennes chez les patients cirrhotiques, ou encore les tumeurs digestives représentent les étiologies les plus fréquentes. Il faut savoir que certains médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens augmentent considérablement ce risque.
Les troubles de la coagulation constituent une catégorie particulière. Qu'ils soient héréditaires (hémophilie) ou acquis (traitement anticoagulant), ils prédisposent à des hémorragies parfois spontanées. Heureusement, des protocoles de surveillance permettent aujourd'hui de mieux prévenir ces complications [21].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les signes d'une hémorragie peut sauver des vies. Les symptômes varient considérablement selon la localisation et l'importance du saignement. Pour une hémorragie cérébrale, vous pourriez observer une céphalée brutale et intense, des troubles de la conscience, ou encore des déficits neurologiques soudains [19].
Les hémorragies digestives se manifestent différemment. Des vomissements de sang (hématémèse), des selles noires (méléna), ou encore une pâleur soudaine avec fatigue intense doivent alerter. Mais attention, certaines hémorragies digestives peuvent être silencieuses au début [20].
Concrètement, les signes généraux d'une hémorragie importante incluent : accélération du rythme cardiaque, chute de la tension artérielle, soif intense, et sensation de malaise. Ces symptômes traduisent la réaction de l'organisme face à la perte de sang.
Il est normal de s'inquiéter face à ces symptômes. D'ailleurs, certains signes nécessitent un appel immédiat au 15 : perte de connaissance, difficultés respiratoires, douleur thoracique intense, ou saignement abondant impossible à contrôler. Chaque minute compte dans ces situations d'urgence.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'une hémorragie repose sur une démarche méthodique et souvent urgente. L'examen clinique initial permet d'évaluer la gravité et d'orienter les investigations. Votre médecin recherchera les signes de choc hémorragique et localisera la source du saignement [12].
Les examens biologiques constituent la première étape. Une numération formule sanguine révèle l'importance de l'anémie, tandis que les tests de coagulation (TP, TCA) évaluent les troubles hémostatiques. Ces analyses permettent d'adapter rapidement la prise en charge thérapeutique.
L'imagerie médicale joue un rôle crucial selon la localisation suspectée. Pour une hémorragie cérébrale, le scanner cérébral sans injection reste l'examen de référence en urgence. Il permet de confirmer le diagnostic et d'évaluer le volume de l'hématome [13]. L'IRM peut compléter le bilan dans un second temps.
Bon à savoir : les nouvelles techniques d'imagerie développées en 2024-2025 permettent une détection plus précoce des hémorragies. La spectrophotométrie du liquide céphalo-rachidien, par exemple, améliore significativement le diagnostic des hémorragies sous-arachnoïdiennes [18]. Ces innovations changent la donne pour les patients.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge d'une hémorragie nécessite une approche multidisciplinaire adaptée à chaque situation. Le traitement initial vise toujours à contrôler le saignement et à stabiliser l'état hémodynamique du patient. Cette phase critique détermine souvent le pronostic [12].
Pour les hémorragies cérébrales, la prise en charge a considérablement évolué. La chirurgie n'est plus systématique et dépend de critères précis : volume de l'hématome, localisation, état neurologique du patient. Thomas Gaberel souligne en 2025 que seuls 10 à 15% des patients bénéficient désormais d'une intervention chirurgicale [13].
Le traitement médical occupe une place centrale. Il comprend le contrôle tensionnel, la correction des troubles de coagulation, et la prévention des complications. Les agents hémostatiques comme l'acide tranexamique montrent une efficacité croissante dans certaines situations spécifiques.
Concernant les hémorragies digestives, l'endoscopie thérapeutique révolutionne la prise en charge. Cette technique permet à la fois le diagnostic et le traitement, avec des taux de succès dépassant 90% pour les ulcères hémorragiques. Et quand l'endoscopie échoue, la radiologie interventionnelle offre des alternatives efficaces.
La transfusion sanguine reste parfois nécessaire en cas d'anémie sévère. Mais les indications se sont affinées : on privilégie désormais une approche restrictive, transfusant uniquement si l'hémoglobine descend sous 7-8 g/dL chez la plupart des patients.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2025 marque un tournant dans la prise en charge des hémorragies. Les innovations thérapeutiques se multiplient, offrant de nouveaux espoirs aux patients et à leurs familles. BeOne Medicines a présenté à l'ASCO 2025 des résultats prometteurs concernant de nouvelles molécules hémostatiques [6].
L'essai clinique EXPECTS a révolutionné le traitement des AVC du territoire postérieur. L'alteplase, utilisée dans des maladies spécifiques, améliore significativement la récupération à 90 jours chez ces patients particulièrement difficiles à traiter [10]. Cette avancée change la donne pour des milliers de personnes chaque année.
La recherche sur les agents neuroprotecteurs progresse rapidement. Cinq bonnes nouvelles ont marqué 2024 dans ce domaine, avec des molécules capables de limiter les dégâts cérébraux secondaires aux hémorragies. Ces traitements pourraient réduire considérablement les séquelles neurologiques [7].
Les techniques chirurgicales évoluent également. La chirurgie mini-invasive guidée par imagerie permet désormais d'évacuer certains hématomes cérébraux avec moins de complications. Cette approche, testée dans plusieurs centres français, montre des résultats encourageants [9]. L'avenir de la chirurgie des hémorragies intracérébrales se dessine autour de ces innovations technologiques.
Côté diagnostic, les nouveaux biomarqueurs sanguins permettent une détection plus précoce des hémorragies. Ces tests, développés par l'Institut Curie et d'autres centres de recherche, pourraient révolutionner la prise en charge d'urgence [8].
Vivre au Quotidien avec Hémorragie
Vivre après une hémorragie importante nécessite souvent des adaptations significatives. Chaque personne réagit différemment, mais certains défis sont communs à la plupart des patients. La fatigue constitue souvent le symptôme le plus persistant et le plus handicapant au quotidien.
La rééducation joue un rôle central dans la récupération. Qu'il s'agisse de kinésithérapie après une hémorragie cérébrale ou de rééducation digestive après une hémorragie gastro-intestinale, ces programmes personnalisés améliorent considérablement la qualité de vie. Il faut savoir que la récupération peut prendre plusieurs mois, voire années.
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. Beaucoup de patients développent une anxiété liée à la peur de récidive. Un suivi psychologique peut s'avérer nécessaire pour retrouver confiance en soi et reprendre une vie normale. D'ailleurs, les groupes de parole entre patients offrent un soutien précieux.
Concrètement, certaines précautions deviennent indispensables. Éviter les sports de contact, adapter son domicile pour prévenir les chutes, ou encore surveiller attentivement ses traitements anticoagulants. Ces mesures, bien qu'contraignantes, permettent de réduire significativement le risque de récidive.
Les Complications Possibles
Les complications d'une hémorragie peuvent survenir à court ou long terme. Comprendre ces risques permet une meilleure surveillance et une prise en charge adaptée. Les complications immédiates incluent le choc hémorragique, l'anémie aiguë, et les troubles de la coagulation [21].
Pour les hémorragies cérébrales, l'œdème cérébral constitue la complication la plus redoutée. Il peut survenir dans les 24 à 48 heures suivant l'accident et nécessite parfois une intervention neurochirurgicale d'urgence. L'hydrocéphalie représente également un risque, particulièrement en cas d'hémorragie intraventriculaire.
Les complications infectieuses ne sont pas rares, surtout chez les patients hospitalisés longtemps. Pneumonies, infections urinaires, ou encore méningites peuvent compliquer l'évolution. Une surveillance attentive et des mesures préventives permettent de limiter ces risques.
À long terme, les séquelles neurologiques préoccupent souvent les patients et leurs familles. Troubles de la parole, déficits moteurs, ou encore troubles cognitifs peuvent persister. Heureusement, la plasticité cérébrale permet souvent une récupération partielle, même plusieurs mois après l'accident.
Certaines complications sont spécifiques au type d'hémorragie. Les hémorragies rétiniennes, par exemple, peuvent entraîner des troubles visuels permanents, comme le rapporte une étude récente sur les hémangiomes capillaires péripapillaires [15]. Ces cas particuliers nécessitent une prise en charge ophtalmologique spécialisée.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic d'une hémorragie dépend de nombreux facteurs : localisation, volume, âge du patient, et rapidité de la prise en charge. Il est important de savoir que les statistiques générales ne s'appliquent pas forcément à votre situation personnelle. Chaque cas reste unique.
Pour les hémorragies cérébrales, la mortalité à 30 jours varie entre 35 et 50% selon les études récentes. Mais ces chiffres s'améliorent grâce aux progrès thérapeutiques. Les patients qui survivent à la phase aiguë ont souvent un potentiel de récupération important, surtout s'ils sont jeunes [14].
L'évolution épidémiologique sur 40 ans montre des tendances encourageantes. Yannick Béjot souligne une amélioration du pronostic fonctionnel, particulièrement chez les patients de moins de 65 ans. Cette amélioration résulte des progrès dans la prise en charge précoce et la rééducation [14].
Concernant les hémorragies digestives, le pronostic est généralement plus favorable. La mortalité reste inférieure à 10% dans la plupart des cas, grâce notamment aux techniques endoscopiques modernes. Cependant, le risque de récidive nécessite une surveillance prolongée.
Les facteurs pronostiques les plus importants incluent : l'âge, l'état général initial, la rapidité de prise en charge, et la présence de comorbidités. Rassurez-vous, même dans les situations difficiles, des récupérations surprenantes restent possibles. L'important est de ne jamais perdre espoir.
Peut-on Prévenir Hémorragie ?
La prévention des hémorragies repose sur le contrôle des facteurs de risque modifiables. Bien sûr, certains éléments comme l'âge ou les prédispositions génétiques échappent à notre contrôle. Mais beaucoup d'actions préventives restent à notre portée.
Le contrôle tensionnel constitue la mesure préventive la plus efficace pour les hémorragies cérébrales. Une tension artérielle bien équilibrée réduit de 40% le risque d'accident vasculaire hémorragique. Concrètement, cela passe par un traitement médicamenteux adapté, une alimentation pauvre en sel, et une activité physique régulière.
Pour les hémorragies digestives, la prévention vise principalement les facteurs de risque gastro-intestinaux. Éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens, traiter l'infection à Helicobacter pylori, et limiter la consommation d'alcool constituent des mesures essentielles. Les patients sous anticoagulants nécessitent une surveillance particulière.
L'hygiène de vie joue un rôle crucial. Arrêter le tabac, maintenir un poids normal, et pratiquer une activité physique adaptée réduisent significativement les risques. D'ailleurs, une alimentation riche en fruits et légumes apporte des antioxydants protecteurs pour les vaisseaux sanguins.
Chez les patients à haut risque, des traitements préventifs spécifiques peuvent être proposés. Antiagrégants plaquettaires, statines, ou encore inhibiteurs de la pompe à protons selon les situations. Ces traitements nécessitent un suivi médical régulier pour optimiser le rapport bénéfice-risque.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié des recommandations actualisées concernant la prise en charge des hémorragies. La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste sur l'importance d'une filière de soins coordonnée, de l'urgence jusqu'à la rééducation.
Santé Publique France souligne dans ses dernières publications l'importance de la prévention primaire. Les campagnes de sensibilisation sur l'hypertension artérielle et les facteurs de risque cardiovasculaires constituent des priorités de santé publique [1,2,3]. Ces actions visent à réduire l'incidence des hémorragies cérébrales.
L'INSERM recommande une approche multidisciplinaire dès la phase aiguë. Les unités neurovasculaires doivent être accessibles 24h/24 et disposer de plateaux techniques complets : imagerie, laboratoire, et possibilité d'intervention chirurgicale si nécessaire. Cette organisation améliore significativement le pronostic des patients.
Concernant le suivi à long terme, les recommandations insistent sur la nécessité d'un parcours de soins personnalisé. Rééducation précoce, suivi psychologique, et adaptation du domicile constituent des éléments clés de la prise en charge globale.
Les indicateurs de qualité définis par les autorités incluent : délai de prise en charge, accès à l'imagerie, taux de complications, et satisfaction des patients. Ces critères permettent d'évaluer et d'améliorer continuellement la qualité des soins dispensés dans les établissements de santé.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses associations accompagnent les patients et leurs familles dans leur parcours de soins. Ces structures offrent un soutien précieux, tant sur le plan pratique qu'émotionnel. France AVC constitue l'association de référence pour les accidents vasculaires cérébraux, y compris hémorragiques.
L'Association France AVC propose des groupes de parole, des formations pour les aidants, et des informations actualisées sur les traitements. Leurs bénévoles, souvent d'anciens patients, comprennent parfaitement les difficultés rencontrées. Cette entraide entre pairs s'avère particulièrement bénéfique.
Pour les hémorragies digestives, l'Association François Aupetit (AFA) accompagne les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales. Bien que spécialisée dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, elle offre des ressources utiles pour tous les patients avec hémorragies digestives.
Les centres de ressources hospitaliers proposent également des services d'accompagnement. Assistantes sociales, psychologues, et ergothérapeutes travaillent ensemble pour faciliter le retour à domicile et l'adaptation du quotidien. Ces équipes connaissent parfaitement les démarches administratives et les aides disponibles.
N'hésitez pas à contacter ces associations dès le début de votre parcours. Elles peuvent vous orienter vers les professionnels compétents et vous mettre en relation avec d'autres patients ayant vécu des situations similaires. Cette solidarité fait souvent la différence dans les moments difficiles.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec une hémorragie ou prévenir sa survenue. Ces recommandations, issues de l'expérience clinique et des témoignages de patients, peuvent faire une réelle différence dans votre quotidien.
Surveillez vos médicaments : tenez un carnet de tous vos traitements, y compris les médicaments en vente libre. Certaines associations peuvent être dangereuses, particulièrement avec les anticoagulants. Montrez toujours cette liste à chaque nouveau médecin consulté.
Adaptez votre domicile pour prévenir les chutes. Retirez les tapis glissants, installez des barres d'appui dans la salle de bain, et améliorez l'éclairage des escaliers. Ces aménagements simples réduisent considérablement le risque de traumatisme et d'hémorragie secondaire.
Apprenez à reconnaître les signes d'alarme. Maux de tête inhabituels, troubles visuels soudains, ou saignements anormaux doivent vous amener à consulter rapidement. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une urgence.
Maintenez une activité physique adaptée. La marche, la natation, ou encore le vélo d'appartement renforcent le système cardiovasculaire sans risque excessif. Demandez conseil à votre médecin pour choisir les activités les plus appropriées à votre situation.
Constituez un dossier médical complet avec tous vos examens, comptes-rendus d'hospitalisation, et coordonnées de vos médecins. En cas d'urgence, ces informations peuvent s'avérer cruciales pour une prise en charge optimale.
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter peut sauver des vies. Certains signes nécessitent une consultation immédiate, d'autres peuvent attendre un rendez-vous programmé. Cette distinction est cruciale pour éviter les urgences inutiles tout en ne passant pas à côté d'une situation grave.
Consultez immédiatement (appelez le 15) en cas de : maux de tête brutaux et intenses, perte de connaissance, troubles de la parole ou de la vision, saignements abondants impossibles à contrôler, ou douleurs thoraciques avec essoufflement. Ces symptômes peuvent signaler une hémorragie grave.
Consultez dans les 24 heures si vous présentez : fatigue inhabituelle avec pâleur, saignements de nez répétés, ecchymoses spontanées multiples, ou troubles digestifs avec sang dans les selles. Ces signes peuvent révéler une hémorragie débutante ou des troubles de la coagulation.
Pour un suivi programmé, consultez votre médecin traitant en cas de : antécédents familiaux d'hémorragie, prise d'anticoagulants nécessitant une surveillance, ou facteurs de risque cardiovasculaires multiples. Un bilan préventif permet souvent d'éviter les complications.
N'hésitez jamais à contacter votre médecin en cas de doute. Il vaut mieux une consultation de trop qu'une urgence évitable. D'ailleurs, beaucoup de médecins proposent désormais des consultations téléphoniques pour évaluer l'urgence d'une situation.
Gardez toujours à portée de main les numéros d'urgence : 15 (SAMU), 18 (pompiers), ou 112 (numéro européen). En cas d'hémorragie grave, chaque minute compte pour limiter les séquelles et sauver des vies.
Questions Fréquentes
Quels sont les premiers signes d'une hémorragie cérébrale ?
Les premiers signes incluent une céphalée brutale et intense, des troubles de la conscience, des déficits neurologiques soudains, et parfois des nausées ou vomissements. Ces symptômes nécessitent un appel immédiat au 15.
Combien de temps dure la récupération après une hémorragie ?
La récupération varie selon l'importance de l'hémorragie et sa localisation. Elle peut prendre plusieurs mois à plusieurs années. La rééducation précoce et intensive améliore significativement les chances de récupération.
Peut-on prévenir une hémorragie cérébrale ?
Oui, en contrôlant les facteurs de risque : hypertension artérielle, diabète, tabagisme. Un contrôle tensionnel optimal réduit de 40% le risque d'hémorragie cérébrale.
Les anticoagulants augmentent-ils le risque d'hémorragie ?
Oui, les anticoagulants augmentent le risque hémorragique. Cependant, ce risque est généralement acceptable au regard des bénéfices. Une surveillance régulière permet d'optimiser le traitement.
Quand faut-il opérer une hémorragie cérébrale ?
La chirurgie n'est indiquée que dans 10 à 15% des cas, selon des critères précis : volume de l'hématome, localisation, état neurologique. La décision est prise par une équipe multidisciplinaire.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [5] Accident Vasculaire Cérébral : Incidence hospitalière. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [6] BeOne Medicines présente à l'ASCO 2025 les nouveaux résultats. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] 5 bonnes nouvelles pour la recherche sur Alzheimer en 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] NOS PROJETS DE RECHERCHE. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] Intracerebral Hemorrhage—Surgery and the Future of Trials. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [10] Phase III EXPECTS Trial Finds Alteplase Boosts 90-Day Recovery. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [11] E Verspyck, E Morau. Mortalité maternelle par hémorragie obstétricale en France 2016–2018. 2024.Lien
- [12] J Callum, CCD Evans. Prise en charge non chirurgicale de l'hémorragie majeure. 2023.Lien
- [13] T Gaberel. Place de la chirurgie dans la prise en charge des hémorragies intracérébrales spontanées en 2025. 2025.Lien
- [14] Y Béjot. Épidémiologie des hémorragies cérébrales spontanées: évolutions depuis 40 ans. 2025.Lien
- [15] J Burgot, M Kaddouri. Hémorragie intravitréenne et décollement de rétine exsudatif révélant un hémangiome capillaire péripapillaire sporadique. 2025.Lien
- [18] N Nowicki, S Allouche. Approches clinico-biologiques de la recherche spectrophotométrique d'oxyhémoglobine et de bilirubine dans le LCS. 2024.Lien
- [19] Hémorragie : Symptômes et traitements. www.elsan.care.Lien
- [20] Hémorragie : Définition, symptômes, diagnostic. www.sante-sur-le-net.com.Lien
- [21] Ecchymoses et hémorragies - Troubles du sang. www.msdmanuals.com.Lien
Publications scientifiques
- Mortalité maternelle par hémorragie obstétricale en France 2016–2018 (2024)4 citations
- Prise en charge non chirurgicale de l'hémorragie majeure (2023)[PDF]
- Place de la chirurgie dans la prise en charge des hémorragies intracérébrales spontanées en 2025 (2025)1 citations
- Épidémiologie des hémorragies cérébrales spontanées: évolutions depuis 40 ans (2025)
- Hémorragie intravitréenne et décollement de rétine exsudatif révélant un hémangiome capillaire péripapillaire sporadique (2025)
Ressources web
- Hémorragie : Symptômes et traitements (elsan.care)
9 janv. 2025 — Pour les hémorragies internes, les symptômes incluent sueurs froides, vertiges, évanouissements, pâleur, vomissements, soif, chute de tension, ...
- Hémorragie : Définition, symptômes, diagnostic et ... (sante-sur-le-net.com)
4 mai 2023 — Une hémorragie est un saignement abondant qui ne se stoppe pas spontanément et engage potentiellement le pronostic vital.
- Ecchymoses et hémorragies - Troubles du sang (msdmanuals.com)
Signes avant-coureurs · Symptômes de perte sanguine importante, comme transpiration, faiblesse, évanouissement ou étourdissement, nausées ou soif intense.
- Hémorragie : types, causes, symptômes, traitement et plus ... (apollohospitals.com)
18 févr. 2025 — Douleur thoracique aiguë · Hémoptysie (cracher du sang) · Miction excessive · Vision floue · Paralysie ou engourdissement grave · Lymphadénopathie ...
- Saignement excessif - Hématologie et oncologie (msdmanuals.com)
Un saignement inhabituel ou excessif peut être indiqué par différents symptômes. Les patients peuvent présenter initialement les troubles suivants.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
