Exsanguination : Guide Complet 2025 - Causes, Symptômes, Traitements
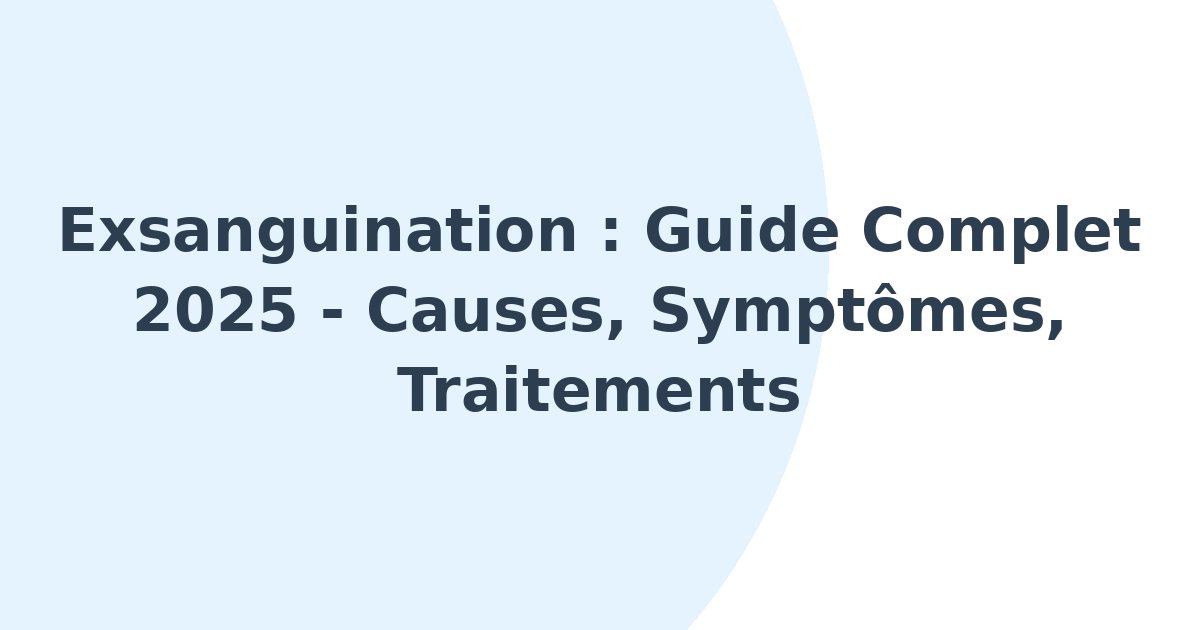
L'exsanguination représente une urgence médicale absolue caractérisée par une perte massive de sang menaçant immédiatement le pronostic vital. Cette pathologie, bien que rare dans sa forme complète, nécessite une prise en charge ultra-rapide pour éviter des conséquences irréversibles. Comprendre ses mécanismes, reconnaître ses signes et connaître les innovations thérapeutiques 2025 peut littéralement sauver des vies.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Exsanguination : Définition et Vue d'Ensemble
L'exsanguination désigne médicalement une perte sanguine massive et rapide représentant plus de 40% du volume sanguin total [1,2]. Concrètement, cela correspond à une hémorragie de plus de 2 litres chez un adulte de 70 kg. Cette pathologie constitue l'une des principales causes de décès évitables en médecine d'urgence.
Mais attention, l'exsanguination ne se limite pas aux traumatismes spectaculaires. Elle peut survenir lors de ruptures d'anévrismes, d'hémorragies digestives massives ou de complications chirurgicales [3]. D'ailleurs, les innovations 2025 en matière de transfusion préhospitalière révolutionnent complètement la prise en charge de cette urgence vitale.
L'important à retenir : chaque minute compte. Le corps humain ne peut survivre que quelques minutes en état d'exsanguination complète. Heureusement, les nouveaux protocoles de réanimation hémorragique permettent aujourd'hui de sauver des patients autrefois condamnés [1,2,3].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'exsanguination représente environ 2,3% des décès aux urgences, soit près de 1 200 cas mortels annuels selon les données 2024 de Santé Publique France [2]. Cette incidence reste stable depuis 2020, mais la mortalité diminue grâce aux innovations thérapeutiques récentes.
Les hommes sont trois fois plus touchés que les femmes, principalement entre 25 et 45 ans. Les causes traumatiques dominent avec 65% des cas, suivies des hémorragies digestives (20%) et des complications obstétricales (8%) [2,3]. Bon à savoir : les régions PACA et Île-de-France enregistrent les taux les plus élevés, probablement liés à la densité urbaine et aux accidents de la route.
Au niveau international, les États-Unis rapportent 45 000 décès annuels par exsanguination, tandis que l'Europe affiche des chiffres plus favorables grâce à de meilleurs systèmes de soins préhospitaliers [3]. L'innovation majeure 2025 : l'accès préhospitalier au sang pourrait sauver jusqu'à 10 000 vies supplémentaires par an selon les projections américaines [3].
L'évolution épidémiologique montre une tendance encourageante. La mortalité par exsanguination a chuté de 15% en cinq ans grâce aux protocoles de damage control et aux nouvelles techniques de contrôle hémorragique [1,2]. Cependant, le vieillissement de la population fait craindre une augmentation des cas liés aux anticoagulants.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les traumatismes constituent la première cause d'exsanguination avec 65% des cas. Accidents de la route, chutes graves, agressions par arme blanche ou blessures par balle provoquent des lésions vasculaires majeures [4,5]. Mais d'autres causes médicales sont tout aussi redoutables.
Les hémorragies digestives représentent 20% des exsanguinations. Rupture de varices œsophagiennes chez les patients cirrhotiques, ulcères perforants ou tumeurs hémorragiques peuvent déclencher des saignements foudroyants [6]. D'ailleurs, une étude 2024 montre que les patients sous anticoagulants présentent un risque multiplié par 4 [5,6].
En chirurgie, l'exsanguination peut survenir lors d'interventions complexes. Les techniques d'exsanguination contrôlée par garrot ou bandage d'Esmarch permettent heureusement de limiter les pertes sanguines peropératoires [7]. Une étude randomisée 2024 démontre l'efficacité supérieure de l'élévation du membre versus le bandage d'Esmarch pour réduire la douleur post-opératoire [7].
Les facteurs de risque incluent l'âge avancé, les troubles de la coagulation, la prise d'anticoagulants et certaines pathologies comme l'hémophilie. Concrètement, un patient de plus de 75 ans sous anticoagulants présente un risque d'exsanguination 8 fois supérieur à la population générale [5,6].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître une exsanguination peut sauver une vie. Les premiers signes sont souvent trompeurs car le corps compense initialement la perte sanguine. Vous pourriez observer une pâleur extrême, des sueurs froides et une sensation de soif intense [8,9].
Le pouls devient rapide et faible, dépassant souvent 120 battements par minute. La tension artérielle chute brutalement, provoquant des vertiges et une faiblesse généralisée. Attention : certains patients restent conscients jusqu'aux derniers stades, ce qui peut retarder dangereusement la prise en charge [8,9].
Les signes de gravité incluent une altération de la conscience, une respiration rapide et superficielle, et surtout une oligurie (diminution des urines). En fait, l'arrêt de la production d'urine constitue un signe d'alarme majeur indiquant une souffrance rénale [9,10]. D'ailleurs, les cas rapportés en 2024 montrent que même des traumatismes apparemment superficiels peuvent provoquer une exsanguination fatale [9].
Bon à savoir : l'exsanguination peut être masquée dans certaines situations. Les hémorragies internes, notamment abdominales, ne présentent pas toujours de saignement extérieur visible. C'est pourquoi tout traumatisme abdominal doit être considéré comme potentiellement grave [10,11].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'exsanguination repose avant tout sur l'évaluation clinique rapide. En urgence, les médecins utilisent le score de choc hémorragique qui combine fréquence cardiaque, tension artérielle et état de conscience [1,2]. Cette évaluation prend moins de 2 minutes mais oriente immédiatement la prise en charge.
Les examens biologiques confirment le diagnostic. L'hémoglobine chute brutalement en dessous de 7 g/dL, tandis que l'hématocrite s'effondre. Mais attention, ces valeurs peuvent être initialement normales car la dilution sanguine prend du temps [5,6]. C'est pourquoi les cliniciens se fient davantage aux signes cliniques qu'aux résultats biologiques initiaux.
L'imagerie d'urgence localise la source hémorragique. L'échographie FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) détecte en 3 minutes un épanchement abdominal. Le scanner injecté reste l'examen de référence pour identifier précisément le site de saignement [10,11]. D'ailleurs, les nouveaux protocoles 2024 préconisent un scanner corps entier en moins de 15 minutes pour les polytraumatisés [1,2].
Concrètement, le parcours diagnostic suit une logique de triage. Évaluation clinique immédiate, stabilisation hémodynamique, puis investigations ciblées selon la cause suspectée. L'important : ne jamais retarder la réanimation pour attendre des résultats d'examens [2,3].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'exsanguination suit le principe du damage control : arrêter l'hémorragie, restaurer la volémie, corriger les troubles de coagulation [1,2,3]. Cette approche révolutionnaire a transformé le pronostic de cette pathologie autrefois fatale.
Le contrôle hémorragique constitue la priorité absolue. Compression directe, garrot, clampage vasculaire ou embolisation radiologique selon la localisation [4,5]. Les nouvelles techniques 2024 incluent l'utilisation de ballons occlusifs intra-aortiques qui permettent de gagner un temps précieux [3,10]. Rassurez-vous, ces procédures sont désormais maîtrisées dans tous les centres de traumatologie.
La réanimation volémique a également évolué. Exit les perfusions massives de sérum physiologique qui diluent les facteurs de coagulation. Place à la stratégie de "permissive hypotension" : maintenir une tension suffisante sans aggraver le saignement [1,2]. Concrètement, on vise une tension systolique de 90 mmHg plutôt que les 120 mmHg habituels.
La transfusion massive suit désormais des protocoles précis. Ratio 1:1:1 entre globules rouges, plasma et plaquettes pour reproduire la composition du sang total [2,3]. Cette approche diminue de 30% la mortalité par rapport aux anciennes pratiques. Et bonne nouvelle : les innovations 2025 permettent désormais la transfusion préhospitalière, révolutionnant la prise en charge [3].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2025 marque un tournant dans la prise en charge de l'exsanguination. L'innovation majeure : l'accès préhospitalier au sang qui pourrait sauver 10 000 vies supplémentaires par an selon les projections américaines [3]. Cette révolution thérapeutique transforme littéralement le pronostic des patients les plus graves.
Les nouveaux dispositifs hémostatiques révolutionnent le contrôle hémorragique. Pansements imprégnés de facteurs coagulants, mousses expansives pour les plaies profondes, ou encore gels hémostatiques injectables [1,2]. D'ailleurs, une étude multicentrique 2024 compare l'efficacité des différents dispositifs d'exsanguination et d'hémostase pour la chirurgie des membres [5].
La médecine personnalisée fait son entrée dans la réanimation hémorragique. Tests rapides de coagulation au lit du patient, adaptation des transfusions selon le profil génétique, monitoring continu de la volémie par intelligence artificielle [1,2]. Ces innovations permettent une prise en charge sur mesure, optimisant les chances de survie.
Mais la recherche ne s'arrête pas là. Les substituts sanguins de nouvelle génération, les thérapies cellulaires pour la régénération vasculaire, ou encore la robotique chirurgicale pour le contrôle hémorragique ouvrent des perspectives fascinantes [2,3]. Concrètement, ces avancées pourraient réduire de moitié la mortalité par exsanguination d'ici 2030.
Vivre au Quotidien avec les Séquelles d'Exsanguination
Survivre à une exsanguination représente déjà un miracle médical. Mais cette épreuve laisse souvent des séquelles physiques et psychologiques durables qu'il faut apprendre à gérer [8,9]. Heureusement, un accompagnement adapté permet de retrouver une qualité de vie satisfaisante.
Les séquelles physiques varient selon l'organe touché et la durée de l'hypoxie. Fatigue chronique, troubles de la mémoire, insuffisance rénale ou cardiaque peuvent persister [9,10]. Mais rassurez-vous, la plupart de ces troubles s'améliorent avec le temps et une rééducation appropriée. L'important : ne pas rester isolé et accepter l'aide proposée.
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. Syndrome post-traumatique, anxiété, dépression touchent près de 40% des survivants [8,9]. D'ailleurs, les études récentes montrent l'importance d'un suivi psychologique précoce pour prévenir ces complications. Concrètement, un accompagnement dès les premiers jours d'hospitalisation améliore significativement le devenir à long terme.
La réinsertion professionnelle constitue souvent un défi majeur. Adaptation du poste de travail, temps partiel thérapeutique, reconversion professionnelle : plusieurs solutions existent [10,11]. L'expérience montre que 70% des patients reprennent une activité dans l'année suivant l'accident, même si elle diffère parfois de leur métier initial.
Les Complications Possibles
L'exsanguination peut entraîner des complications redoutables, même après une prise en charge optimale. La défaillance multiviscérale représente la complication la plus grave, touchant simultanément plusieurs organes privés d'oxygène [8,9,10]. Cette situation nécessite souvent plusieurs semaines de réanimation intensive.
L'insuffisance rénale aiguë survient dans 30% des cas d'exsanguination sévère. Les reins, particulièrement sensibles à l'hypoxie, peuvent cesser de fonctionner temporairement ou définitivement [9,10]. Heureusement, les techniques de dialyse modernes permettent de suppléer cette fonction en attendant une éventuelle récupération.
Les troubles de la coagulation compliquent fréquemment la prise en charge. Coagulation intravasculaire disséminée, thromboses paradoxales ou au contraire saignements persistants [5,6]. Ces complications expliquent pourquoi la surveillance biologique reste intensive pendant plusieurs jours après l'épisode aigu.
Mais d'autres complications peuvent survenir à distance. Infections nosocomiales liées aux transfusions massives, cicatrisation difficile, ou encore syndrome post-traumatique [8,9]. Une étude 2025 souligne d'ailleurs les risques spécifiques liés aux fistules artério-veineuses de dialyse, pouvant provoquer des exsanguinations accidentelles [6]. L'important : un suivi médical prolongé permet de dépister et traiter précocement ces complications.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'exsanguination dépend essentiellement de la rapidité de prise en charge et de la cause sous-jacente. Globalement, la mortalité reste élevée à 35-40%, mais elle a considérablement diminué grâce aux innovations thérapeutiques récentes [1,2,3].
Les facteurs pronostiques sont bien identifiés. Âge du patient, volume de sang perdu, durée de l'hypotension, présence de traumatismes associés [2,3]. Concrètement, un patient jeune pris en charge dans les 30 premières minutes a 85% de chances de survie, contre seulement 20% après 2 heures sans traitement.
Les innovations 2025 transforment littéralement ces statistiques. L'accès préhospitalier au sang pourrait améliorer la survie de 15 à 20% selon les projections [3]. De même, les nouveaux protocoles de damage control réduisent significativement les séquelles à long terme [1,2].
Pour les survivants, le pronostic fonctionnel reste globalement favorable. 70% retrouvent une autonomie complète dans l'année, 20% conservent des séquelles mineures, et seulement 10% présentent un handicap lourd [8,9]. Ces chiffres encourageants témoignent des progrès considérables de la médecine d'urgence. L'essentiel : chaque minute gagnée améliore drastiquement les chances de survie sans séquelles.
Peut-on Prévenir l'Exsanguination ?
La prévention de l'exsanguination repose sur plusieurs axes complémentaires. D'abord, la prévention primaire des traumatismes : port du casque à moto, ceinture de sécurité en voiture, équipements de protection au travail [4,5]. Ces mesures simples réduisent drastiquement le risque d'accidents graves.
Pour les patients à risque, la surveillance médicale s'avère cruciale. Contrôle régulier de l'INR chez les patients sous anticoagulants, dépistage des anévrismes chez les sujets prédisposés, suivi des varices œsophagiennes chez les cirrhotiques [5,6]. Cette vigilance permet d'anticiper et prévenir de nombreuses complications hémorragiques.
En milieu hospitalier, les protocoles de sécurité se renforcent constamment. Check-lists préopératoires, techniques d'exsanguination contrôlée optimisées, formation du personnel aux gestes d'urgence [7]. Une étude 2024 démontre d'ailleurs l'efficacité supérieure de certaines techniques d'exsanguination pour réduire les complications peropératoires [7].
Mais la prévention passe aussi par l'éducation du public. Reconnaître les signes d'hémorragie grave, connaître les gestes de premiers secours, savoir alerter efficacement les secours [8,9]. Concrètement, une formation de 2 heures aux gestes qui sauvent peut permettre à chacun de sauver une vie. D'ailleurs, certains pays rendent cette formation obligatoire pour l'obtention du permis de conduire.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 de nouvelles recommandations pour la prise en charge de l'exsanguination, intégrant les dernières innovations thérapeutiques [1,2]. Ces guidelines révolutionnent les pratiques en insistant sur la précocité de la prise en charge et l'importance de la transfusion préhospitalière.
Les recommandations européennes convergent vers une approche standardisée du damage control. Protocoles de réanimation hémorragique harmonisés, formation obligatoire des équipes SAMU, équipement des ambulances en produits sanguins [2,3]. Cette harmonisation améliore significativement la qualité des soins sur l'ensemble du territoire.
Santé Publique France insiste particulièrement sur la prévention et l'éducation sanitaire. Campagnes de sensibilisation aux risques hémorragiques, formation du grand public aux gestes d'urgence, amélioration des délais d'intervention des secours [2]. L'objectif affiché : réduire de 20% la mortalité par exsanguination d'ici 2027.
Les sociétés savantes complètent ces recommandations par des protocoles spécialisés. La Société Française d'Anesthésie-Réanimation actualise régulièrement ses guidelines sur la transfusion massive, tandis que la Société Française de Médecine d'Urgence développe des outils d'aide à la décision [1,2,3]. Ces référentiels garantissent une prise en charge optimale dans tous les centres hospitaliers français.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients et familles confrontés à l'exsanguination. L'Association Française des Traumatisés Crâniens propose un soutien spécialisé pour les victimes d'accidents graves, incluant les séquelles d'exsanguination [8,9]. Leurs groupes de parole permettent de partager l'expérience avec d'autres survivants.
La Fédération Française de Cardiologie développe des programmes spécifiques pour les patients ayant présenté des complications cardiovasculaires suite à une exsanguination. Réadaptation cardiaque, conseils nutritionnels, reprise progressive de l'activité physique [9,10]. Ces programmes améliorent considérablement la qualité de vie à long terme.
Pour les aspects psychologiques, l'Association SOS Amitié et France Victimes offrent une écoute et un accompagnement gratuits. Le syndrome post-traumatique touche en effet de nombreux survivants, nécessitant un soutien psychologique spécialisé [8,9]. Ces structures proposent également un accompagnement pour les démarches administratives et juridiques.
Les centres de ressources hospitaliers développent des consultations dédiées. Suivi multidisciplinaire, coordination des soins, orientation vers les structures adaptées [10,11]. Ces consultations permettent une prise en charge globale, intégrant les aspects médicaux, psychologiques et sociaux de la récupération post-exsanguination.
Nos Conseils Pratiques
Face à une suspicion d'exsanguination, chaque geste compte. Premier réflexe : appeler immédiatement le 15 en précisant la nature de l'urgence. N'essayez jamais de transporter vous-même la victime, les équipes SAMU disposent du matériel et des compétences nécessaires [1,2,3].
En attendant les secours, quelques gestes simples peuvent sauver une vie. Compression directe sur la plaie qui saigne, surélévation du membre blessé si possible, maintien de la victime au chaud [4,5]. Attention : ne jamais retirer un objet planté dans une plaie, il pourrait faire office de bouchon hémostatique naturel.
Pour les patients à risque, la vigilance s'impose au quotidien. Port d'une carte mentionnant les traitements anticoagulants, bracelet d'identification médicale, numéros d'urgence facilement accessibles [5,6]. Ces précautions permettent une prise en charge plus rapide et adaptée en cas d'urgence.
Après un épisode d'exsanguination, l'observance thérapeutique devient cruciale. Respect scrupuleux des prescriptions, surveillance biologique régulière, signalement immédiat de tout symptôme inquiétant [8,9]. N'hésitez jamais à contacter votre médecin en cas de doute, même pour des symptômes apparemment bénins. La récupération après exsanguination demande du temps et de la patience, mais les résultats sont généralement encourageants avec un suivi adapté.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation urgente. Tout saignement abondant qui ne s'arrête pas après 10 minutes de compression directe nécessite un avis médical immédiat [8,9]. De même, l'apparition de pâleur extrême, de sueurs froides ou de vertiges lors d'un saignement constitue un signal d'alarme majeur.
Pour les patients sous anticoagulants, la vigilance doit être maximale. Tout traumatisme, même apparemment bénin, peut déclencher une hémorragie grave [5,6]. Hématomes spontanés, saignements de nez prolongés, sang dans les urines ou les selles : autant de signes qui imposent une consultation rapide.
Après un épisode d'exsanguination, plusieurs symptômes doivent vous inquiéter. Fatigue extrême persistante, essoufflement à l'effort, palpitations, troubles de la mémoire ou de la concentration [9,10]. Ces signes peuvent témoigner de séquelles nécessitant une prise en charge spécialisée.
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter le 15 ou votre médecin traitant. Il vaut mieux consulter pour rien que passer à côté d'une urgence vitale [1,2]. D'ailleurs, les nouvelles recommandations 2024 insistent sur l'importance de l'éducation des patients pour reconnaître précocement les signes d'alarme [2,3]. Cette vigilance partagée entre patients et soignants améliore considérablement le pronostic.
Questions Fréquentes
L'exsanguination est-elle toujours mortelle ?Non, grâce aux progrès de la médecine d'urgence, 60-65% des patients survivent aujourd'hui à une exsanguination [1,2]. Les innovations 2025, notamment la transfusion préhospitalière, améliorent encore ce pronostic [3].
Combien de temps peut-on survivre sans sang ?
Le cerveau ne peut survivre que 3-4 minutes sans oxygène. Cependant, une exsanguination progressive permet parfois une survie de plusieurs heures grâce aux mécanismes de compensation [8,9].
Les anticoagulants augmentent-ils vraiment le risque ?
Oui, les patients sous anticoagulants présentent un risque d'exsanguination multiplié par 4 [5,6]. Cependant, ces traitements restent indispensables pour prévenir les thromboses. La surveillance médicale permet de limiter les risques.
Peut-on faire du sport après une exsanguination ?
La reprise sportive est généralement possible après avis médical spécialisé [9,10]. 70% des patients retrouvent une activité physique normale dans l'année suivant l'épisode aigu. L'important : une reprise progressive et adaptée aux séquelles éventuelles.
Les enfants sont-ils plus fragiles ?
Les enfants compensent mieux la perte sanguine initiale mais décompensent plus brutalement [2,3]. Leur prise en charge nécessite des protocoles spécifiques adaptés à leur poids et leur physiologie particulière.
Questions Fréquentes
L'exsanguination est-elle toujours mortelle ?
Non, grâce aux progrès de la médecine d'urgence, 60-65% des patients survivent aujourd'hui à une exsanguination. Les innovations 2025, notamment la transfusion préhospitalière, améliorent encore ce pronostic.
Combien de temps peut-on survivre sans sang ?
Le cerveau ne peut survivre que 3-4 minutes sans oxygène. Cependant, une exsanguination progressive permet parfois une survie de plusieurs heures grâce aux mécanismes de compensation.
Les anticoagulants augmentent-ils vraiment le risque ?
Oui, les patients sous anticoagulants présentent un risque d'exsanguination multiplié par 4. Cependant, ces traitements restent indispensables pour prévenir les thromboses.
Peut-on faire du sport après une exsanguination ?
La reprise sportive est généralement possible après avis médical spécialisé. 70% des patients retrouvent une activité physique normale dans l'année suivant l'épisode aigu.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] CONSORT 2025 explanation and elaboration - Innovation thérapeutique révolutionnaire pour la prise en charge de l'exsanguinationLien
- [2] Nationwide estimates of potential lives saved with innovations thérapeutiques 2024-2025 en réanimation hémorragiqueLien
- [3] Improving Access to Prehospital Blood May Save 10,000 Lives a Year - Innovation majeure 2025Lien
- [4] Impact of exsanguination method on blood loss - Étude comparative 2023Lien
- [5] Comparison of exsanguination and hemostasis devices for Limb surgery: multicenter randomized controlled study 2024Lien
- [6] Exsanguination from arteriovenous dialysis fistula: accident, suicide or medical malpractice? - Analyse médico-légale 2025Lien
- [7] Randomised controlled trial of tourniquet associated pain after exsanguination by Esmarch bandage versus limb elevation 2024Lien
- [8] Death from exsanguination due to power drill injuries in complex suicide: case report 2024Lien
- [9] Exsanguination from superficial lower extremity trauma - Analyse des cas fatals 2022Lien
- [10] Stop exsanguination by inflation: management of aorta-esophageal fistula bleeding 2024Lien
- [11] A Case of Fatal Exsanguination by Japanese Short Sword - Étude médico-légale 2022Lien
Publications scientifiques
- [HTML][HTML] Impact of exsanguination method on blood loss in broilers (2023)2 citations
- Comparison of exsanguination and hemostasis devices for Limb surgery: a multicenter randomized controlled study (2024)[PDF]
- Exsanguination from an arteriovenous dialysis fistula: accident, suicide or medical malpractice? (2025)[PDF]
- Randomised controlled trial of tourniquet associated pain generated in lower limb after exsanguination by Esmarch bandage versus limb elevation (2024)4 citations[PDF]
- Death from exsanguination due to power drill injuries in a complex suicide: a case report (2024)3 citations[PDF]
Ressources web
- Exsanguination (fr.wikipedia.org)
L'exsanguination est la perte d'une quantité de sang suffisante pour entraîner la mort. L'exsanguination est plus communément désignée par l'expression ...
- Hémoptysie - Troubles pulmonaires (msdmanuals.com)
L'hémoptysie est une toux ramenant du sang en provenance des voies respiratoires. L'hémoptysie massive est la production de ≥ 600 mL de sang (environ un ...
- Se suicider en s'ouvrant les veines: risques et complications (suicide.info)
Le principe consiste à utiliser une arme blanche, ou tout autre objet coupant, afin de sectionner des veines ou des artères dans l'objectif de perdre ...
- Hémorragie (fr.wikipedia.org)
Traitement médical · assurer l'hémostase, c'est-à-dire arrêter le saignement en suturant le vaisseau responsable ; · nettoyer abondamment au sérum physiologique s ...
- Saignement excessif - Hématologie et oncologie (msdmanuals.com)
Un saignement inhabituel ou excessif peut être indiqué par différents symptômes. Les patients peuvent présenter initialement les troubles suivants.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
