Hémorragie Intracrânienne Hypertensive : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
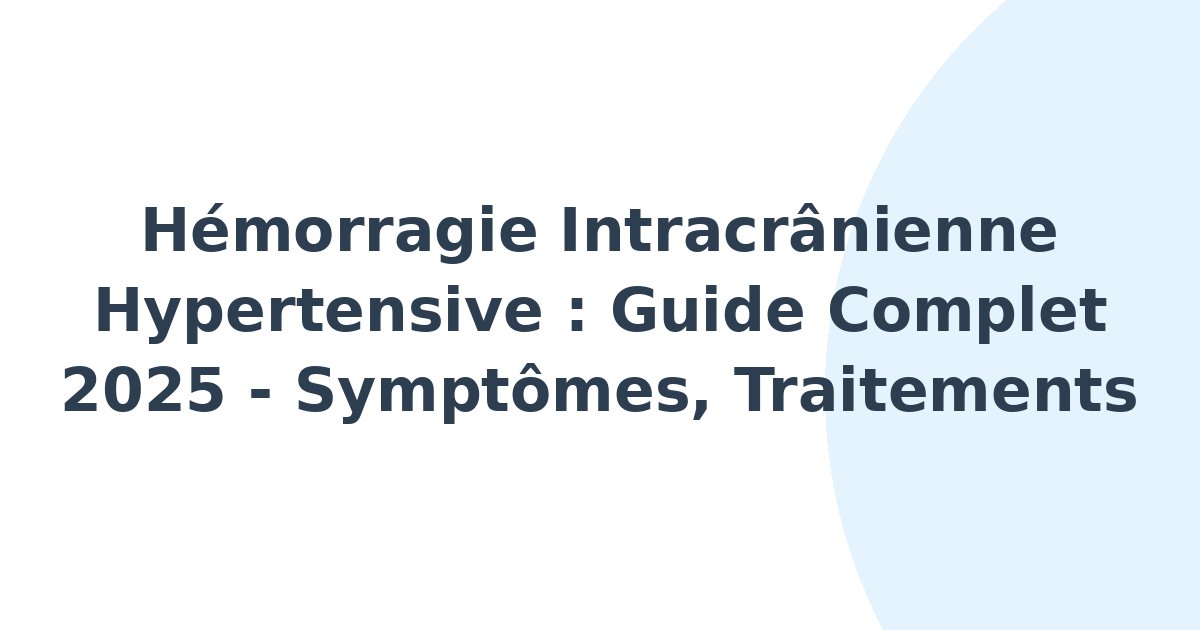
L'hémorragie intracrânienne hypertensive représente une urgence médicale majeure qui touche environ 15 000 personnes chaque année en France. Cette pathologie grave survient lorsque l'hypertension artérielle provoque la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau, entraînant un saignement à l'intérieur du crâne. Bien que redoutable, cette maladie bénéficie aujourd'hui d'avancées thérapeutiques significatives qui améliorent considérablement le pronostic des patients.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Hémorragie intracrânienne hypertensive : Définition et Vue d'Ensemble
L'hémorragie intracrânienne hypertensive désigne un saignement qui se produit à l'intérieur du cerveau suite à une rupture vasculaire causée par une pression artérielle élevée. Contrairement à l'accident vasculaire cérébral ischémique où un vaisseau se bouche, ici c'est l'inverse qui se produit : le vaisseau éclate littéralement sous la pression.
Cette pathologie représente environ 10 à 15% de tous les accidents vasculaires cérébraux, mais sa gravité en fait l'une des causes principales de mortalité neurologique [1,2]. L'hypertension artérielle chronique fragilise progressivement les petites artères cérébrales, créant des zones de faiblesse appelées microanévrismes de Charcot-Bouchard.
Quand la pression devient trop forte, ces zones fragiles cèdent. Le sang s'épanche alors dans le tissu cérébral, créant un hématome intracérébral qui comprime les structures avoisinantes. Cette compression peut rapidement devenir fatale si elle n'est pas prise en charge en urgence.
Il faut distinguer cette pathologie de l'hémorragie sous-arachnoïdienne, qui survient à la surface du cerveau, ou de l'hémorragie sous-durale, située entre les méninges. Chacune a ses spécificités, mais l'hémorragie intracrânienne hypertensive reste la plus fréquente des hémorragies cérébrales spontanées [16,17].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'hémorragie intracrânienne hypertensive touche environ 15 000 à 20 000 personnes chaque année, selon les dernières données de Santé Publique France [1,2,3]. Cette incidence représente 25 à 30 cas pour 100 000 habitants, avec une nette prédominance masculine (60% des cas) et un pic de fréquence entre 55 et 75 ans.
Les données épidémiologiques 2024-2025 révèlent des disparités régionales importantes. Les régions du Nord et de l'Est de la France présentent une incidence supérieure de 20% à la moyenne nationale, probablement liée à une prévalence plus élevée de l'hypertension artérielle dans ces territoires [1,4]. À l'inverse, les régions méditerranéennes affichent des taux légèrement inférieurs.
Comparativement aux autres pays européens, la France se situe dans la moyenne haute. L'Allemagne et le Royaume-Uni rapportent des incidences similaires, tandis que les pays scandinaves présentent des taux plus faibles, attribués à un meilleur contrôle de l'hypertension artérielle dans la population [2,3].
L'évolution temporelle sur les dix dernières années montre une stabilisation de l'incidence, voire une légère diminution chez les moins de 65 ans, grâce à l'amélioration de la prise en charge de l'hypertension. Cependant, le vieillissement de la population fait que le nombre absolu de cas continue d'augmenter [1,2].
L'impact économique est considérable : chaque épisode d'hémorragie intracrânienne hypertensive coûte en moyenne 45 000 euros au système de santé français, incluant l'hospitalisation initiale, la rééducation et les soins de suite. Au niveau national, cela représente un coût annuel estimé à 675 millions d'euros [3,4].
Les Causes et Facteurs de Risque
L'hypertension artérielle constitue la cause principale dans 85% des cas d'hémorragie intracrânienne spontanée [12]. Mais attention, il ne s'agit pas forcément d'une hypertension connue et traitée. Parfois, c'est l'hémorragie qui révèle une hypertension jusque-là silencieuse.
Les facteurs de risque se divisent en deux catégories. D'abord, les facteurs non modifiables : l'âge (risque multiplié par 2 après 55 ans), le sexe masculin, et les antécédents familiaux d'accidents vasculaires cérébraux. Ensuite, les facteurs sur lesquels vous pouvez agir : l'hypertension bien sûr, mais aussi le diabète, l'obésité, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool [8,12].
Certaines situations particulières augmentent drastiquement le risque. La grossesse, par exemple, multiplie par 5 le risque d'hémorragie cérébrale, notamment en cas de pré-éclampsie [10]. Les traitements anticoagulants, même bien surveillés, doublent le risque hémorragique.
D'autres causes, plus rares mais importantes à connaître, incluent les malformations vasculaires cérébrales (angiomes, fistules artério-veineuses), les tumeurs cérébrales hémorragiques, et certaines drogues comme la cocaïne ou les amphétamines qui provoquent des pics tensionnels brutaux [16,17].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes d'une hémorragie intracrânienne hypertensive apparaissent brutalement, souvent en quelques minutes. Le signe le plus caractéristique ? Une céphalée d'intensité maximale, décrite par les patients comme "la pire mal de tête de ma vie". Cette douleur diffère complètement des maux de tête habituels par son intensité et sa soudaineté.
Mais la céphalée n'est pas isolée. Elle s'accompagne rapidement de troubles neurologiques qui dépendent de la localisation de l'hémorragie. Une faiblesse brutale d'un côté du corps (hémiparésie), des troubles de la parole, une perte de vision, ou des difficultés à coordonner ses mouvements peuvent survenir [16,17].
Les troubles de la conscience constituent un signe de gravité majeur. Le patient peut devenir confus, somnolent, voire perdre connaissance. Ces symptômes traduisent souvent une augmentation dangereuse de la pression intracrânienne [18].
D'autres signes doivent alerter : des nausées et vomissements en jet (différents des nausées digestives), une raideur de la nuque, une intolérance à la lumière, ou encore des convulsions. Chez certains patients, l'hémorragie peut se manifester par des troubles du comportement ou de la mémoire, rendant le diagnostic plus difficile [9,13].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Face à une suspicion d'hémorragie intracrânienne, chaque minute compte. Le diagnostic repose avant tout sur l'imagerie cérébrale en urgence. Le scanner cérébral sans injection reste l'examen de première intention : rapide, disponible 24h/24, il permet de confirmer l'hémorragie en quelques minutes [15,16].
L'IRM cérébrale, plus précise, peut être réalisée dans un second temps pour mieux caractériser l'hémorragie et rechercher une cause sous-jacente comme une malformation vasculaire. Mais en urgence, le scanner suffit pour poser le diagnostic et orienter la prise en charge [17].
Parallèlement à l'imagerie, l'équipe médicale réalise un bilan biologique complet. Numération formule sanguine, bilan de coagulation, ionogramme, fonction rénale : tous ces examens permettent d'évaluer l'état général du patient et de dépister d'éventuelles complications [15].
L'évaluation neurologique clinique reste fondamentale. L'échelle de Glasgow permet de quantifier le niveau de conscience, tandis que l'examen neurologique recherche les déficits moteurs, sensitifs ou cognitifs. Cette évaluation initiale servira de référence pour suivre l'évolution [16,17].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge d'une hémorragie intracrânienne hypertensive nécessite une approche multidisciplinaire en unité de soins intensifs. Le premier objectif consiste à contrôler la pression artérielle sans la faire chuter brutalement, ce qui pourrait aggraver les lésions cérébrales. L'objectif tensionnel se situe généralement entre 140 et 160 mmHg de systolique [12,15].
Le contrôle de la pression intracrânienne représente un enjeu majeur. Différentes mesures peuvent être mises en œuvre : surélévation de la tête du lit, sédation adaptée, et parfois drainage ventriculaire externe si une hydrocéphalie se développe [11,15].
La chirurgie peut être nécessaire dans certains cas. L'évacuation de l'hématome par craniotomie reste débattue, mais elle peut sauver des vies quand l'hématome est volumineux et accessible. Les techniques mini-invasives se développent, offrant de nouvelles perspectives [5].
Le traitement médical associe plusieurs approches : prévention des complications (infections, thromboses veineuses), maintien des fonctions vitales, et rééducation précoce dès que l'état neurologique se stabilise. L'utilisation du propofol pour la sédation fait l'objet de protocoles stricts pour éviter les complications [7,11].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge des hémorragies intracérébrales avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses. La neurochirurgie endoscopique révolutionne le traitement chirurgical : moins invasive que la craniotomie traditionnelle, elle permet d'évacuer l'hématome par de petites incisions, réduisant significativement les complications post-opératoires [5].
Les innovations en matière de monitoring représentent également une avancée majeure. Les nouveaux dispositifs de surveillance de la pression intracrânienne, plus précis et moins invasifs, permettent un ajustement thérapeutique en temps réel. Ces technologies, référencées dans les derniers guides MedTech, améliorent considérablement la prise en charge [6].
Du côté pharmacologique, les protocoles de sédation évoluent. L'utilisation optimisée du propofol, avec de nouveaux schémas posologiques, permet de mieux contrôler la pression intracrânienne tout en réduisant les effets secondaires. Les recherches 2024 ont permis d'affiner les indications et de prévenir le syndrome de perfusion du propofol [7,11].
La recherche fondamentale explore aussi de nouvelles pistes. Les neuroprotecteurs, les thérapies anti-inflammatoires ciblées, et même les approches de médecine régénérative font l'objet d'essais cliniques prometteurs. Bien que ces traitements ne soient pas encore disponibles en routine, ils ouvrent des perspectives d'espoir pour les années à venir [5,6].
Vivre au Quotidien avec les Séquelles
Après une hémorragie intracrânienne hypertensive, la vie ne reprend jamais exactement comme avant. Mais cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas être riche et épanouissante. Les séquelles varient énormément d'une personne à l'autre, selon la localisation et l'étendue de l'hémorragie.
Les troubles moteurs figurent parmi les séquelles les plus fréquentes. Une faiblesse d'un côté du corps, des difficultés de coordination, ou des troubles de l'équilibre peuvent persister. Heureusement, la rééducation permet souvent de récupérer une partie des fonctions perdues, parfois de façon spectaculaire [13].
Les troubles cognitifs sont plus subtils mais tout aussi impactants. Difficultés de concentration, troubles de la mémoire, fatigue mentale : ces symptômes peuvent compliquer la reprise du travail ou des activités habituelles. L'important est de ne pas se décourager et d'adapter son rythme de vie [9,13].
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. Beaucoup de patients traversent une période de dépression ou d'anxiété après l'accident. C'est normal et cela fait partie du processus de récupération. Un soutien psychologique professionnel peut s'avérer précieux pour traverser cette étape difficile.
Les Complications Possibles
Les complications d'une hémorragie intracrânienne peuvent survenir à différents moments de l'évolution. Dans les premières heures, l'extension de l'hématome constitue la complication la plus redoutée. Le saignement peut reprendre, aggravant brutalement l'état neurologique [15,16].
L'œdème cérébral se développe généralement dans les 24 à 48 heures suivant l'hémorragie. Cette réaction inflammatoire du cerveau peut provoquer une augmentation dangereuse de la pression intracrânienne, nécessitant parfois un traitement chirurgical d'urgence [18].
À plus long terme, l'hydrocéphalie peut compliquer l'évolution. L'accumulation de liquide céphalo-rachidien dans les ventricules cérébraux provoque des troubles de la marche, des troubles cognitifs et une incontinence urinaire. Un drainage peut alors être nécessaire [14,18].
Les complications systémiques ne sont pas rares : infections pulmonaires, thromboses veineuses, troubles du rythme cardiaque. C'est pourquoi la surveillance en soins intensifs est si importante dans les premiers jours [8,15]. Certains patients peuvent aussi développer des crises d'épilepsie, nécessitant un traitement antiépileptique [13].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic d'une hémorragie intracrânienne hypertensive dépend de nombreux facteurs, et il est important de garder espoir même dans les situations difficiles. La mortalité reste élevée : environ 30 à 40% dans le premier mois, mais ces chiffres s'améliorent grâce aux progrès thérapeutiques [1,2].
Plusieurs éléments influencent le pronostic. L'âge du patient joue un rôle majeur : les personnes de moins de 60 ans ont généralement un meilleur pronostic. Le volume de l'hématome est également déterminant : plus il est important, plus les séquelles risquent d'être lourdes [16,17].
La localisation de l'hémorragie compte énormément. Un hématome dans les zones "silencieuses" du cerveau peut passer presque inaperçu, tandis qu'une hémorragie dans des zones critiques comme le tronc cérébral peut avoir des conséquences dramatiques [15,16].
Mais attention aux statistiques : chaque patient est unique. Certaines personnes récupèrent de façon remarquable malgré un pronostic initial sombre, tandis que d'autres gardent des séquelles importantes malgré une hémorragie apparemment modeste. La motivation du patient et la qualité de la rééducation jouent un rôle fondamental dans la récupération [13].
Peut-on Prévenir l'Hémorragie Intracrânienne Hypertensive ?
La prévention de l'hémorragie intracrânienne hypertensive repose essentiellement sur le contrôle de l'hypertension artérielle. C'est le facteur de risque le plus important et heureusement le plus facilement modifiable. Un suivi régulier chez votre médecin traitant, avec prise de tension systématique, peut littéralement vous sauver la vie [12].
Les objectifs tensionnels ont évolué ces dernières années. Pour la plupart des patients, l'objectif est désormais inférieur à 140/90 mmHg, et même 130/80 mmHg chez les personnes à haut risque cardiovasculaire. Ces chiffres peuvent paraître contraignants, mais ils réduisent drastiquement le risque d'hémorragie cérébrale [12].
L'hygiène de vie joue un rôle crucial dans la prévention. Une alimentation pauvre en sel (moins de 6g par jour), une activité physique régulière (30 minutes de marche quotidienne suffisent), l'arrêt du tabac et une consommation d'alcool modérée contribuent significativement à maintenir une tension artérielle normale.
Pour les patients sous anticoagulants, la surveillance est renforcée. L'équilibre entre prévention des thromboses et risque hémorragique nécessite un suivi médical rapproché et des contrôles biologiques réguliers. Les nouveaux anticoagulants oraux offrent un profil de sécurité amélioré [8].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié en 2024-2025 des recommandations actualisées concernant la prise en charge des hémorragies intracérébrales. La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste particulièrement sur la nécessité d'une prise en charge précoce en unité neurovasculaire, idéalement dans les 3 heures suivant les premiers symptômes [1,2].
Santé Publique France recommande un dépistage systématique de l'hypertension artérielle chez tous les adultes de plus de 40 ans, avec une mesure annuelle de la tension artérielle. Cette stratégie préventive vise à identifier et traiter l'hypertension avant qu'elle ne provoque des complications [3,4].
Les nouvelles recommandations européennes, adoptées par la France, préconisent une approche multidisciplinaire associant neurologues, neurochirurgiens, réanimateurs et équipes de rééducation dès la phase aiguë. Cette coordination améliore significativement le pronostic fonctionnel [1,2].
L'INSERM souligne l'importance de la recherche clinique dans ce domaine. Les patients éligibles doivent être informés des essais thérapeutiques en cours, car la participation à ces études peut leur donner accès à des traitements innovants tout en contribuant aux progrès médicaux [3,4].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients et leurs familles dans cette épreuve difficile. France AVC, association nationale, propose un soutien psychologique, des groupes de parole et des informations pratiques sur les démarches administratives. Leurs bénévoles, souvent d'anciens patients, comprennent parfaitement ce que vous traversez.
L'Association pour la Recherche sur les Accidents Vasculaires Cérébraux (ARCAVC) finance des projets de recherche et informe le public sur les avancées thérapeutiques. Leur site internet regorge d'informations fiables et actualisées.
Au niveau local, de nombreuses associations régionales organisent des activités de rééducation collective : ateliers mémoire, groupes de marche adaptée, cours d'informatique pour réapprendre à utiliser un clavier. Ces activités sont précieuses pour rompre l'isolement et maintenir le lien social.
N'oubliez pas les ressources institutionnelles : les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) peuvent vous aider dans vos démarches de reconnaissance de handicap et d'aménagement de votre domicile. Les assistantes sociales hospitalières sont également des interlocutrices privilégiées pour vous orienter.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec les séquelles d'une hémorragie intracrânienne demande des adaptations concrètes au quotidien. Pour les troubles moteurs, l'ergothérapie peut transformer votre domicile : barres d'appui dans la salle de bain, rehausseurs de toilettes, couverts adaptés. Ces aménagements simples redonnent autonomie et confiance en soi.
Concernant la fatigue cognitive, planifiez vos activités aux moments où vous êtes le plus en forme, généralement le matin. Utilisez des aide-mémoires : agenda, alarmes sur le téléphone, listes de courses. Ne culpabilisez pas de faire des pauses régulières.
Pour la reprise du travail, n'hésitez pas à solliciter la médecine du travail. Un aménagement de poste, un temps partiel thérapeutique, ou même une reconversion peuvent être envisagés. Votre employeur a des obligations légales d'adaptation.
Côté conduite automobile, une évaluation par un médecin agréé est obligatoire. Mais rassurez-vous : beaucoup de patients reprennent le volant après adaptation du véhicule si nécessaire. L'important est de ne pas prendre de risques inconsidérés.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter en urgence, même si vous avez déjà eu une hémorragie intracrânienne. Une céphalée brutale et intense, différente de vos maux de tête habituels, nécessite un appel immédiat au 15. Ne prenez aucun risque : il peut s'agir d'une récidive.
Les troubles neurologiques nouveaux sont également des signaux d'alarme : faiblesse soudaine d'un membre, troubles de la parole, perte de vision, vertiges intenses. Ces symptômes peuvent traduire un nouvel accident vasculaire, qu'il soit hémorragique ou ischémique.
En dehors de l'urgence, consultez votre médecin traitant si vous ressentez une aggravation de vos séquelles habituelles, des troubles du sommeil persistants, ou des signes de dépression. Un suivi régulier permet d'adapter les traitements et d'optimiser votre récupération.
N'oubliez pas les consultations de contrôle programmées : neurologie, cardiologie, ophtalmologie selon votre situation. Ces rendez-vous peuvent paraître contraignants, mais ils permettent de dépister précocement d'éventuelles complications et d'ajuster vos traitements.
Questions Fréquentes
Peut-on faire une récidive d'hémorragie intracrânienne ?Oui, le risque de récidive existe, estimé à environ 5% par an. C'est pourquoi le contrôle strict de la tension artérielle et le suivi médical régulier sont essentiels [12].
Combien de temps dure la récupération ?
La récupération maximale s'observe généralement dans les 6 premiers mois, mais des améliorations peuvent survenir jusqu'à 2 ans après l'accident. Chaque patient évolue à son rythme [13].
Peut-on reprendre une activité sportive ?
Oui, mais avec l'accord de votre médecin. Les sports d'endurance modérée sont généralement recommandés, tandis que les sports de contact ou à forte intensité sont déconseillés.
Les médicaments contre l'hypertension sont-ils à vie ?
Dans la plupart des cas, oui. L'arrêt du traitement antihypertenseur expose à un risque majeur de récidive. Seul votre médecin peut décider d'une modification de traitement [12].
Peut-on voyager après une hémorragie intracrânienne ?
Les voyages sont possibles, mais nécessitent quelques précautions : emporter suffisamment de médicaments, connaître les coordonnées d'un hôpital sur place, éviter les destinations à très haute altitude.
Questions Fréquentes
Peut-on faire une récidive d'hémorragie intracrânienne ?
Oui, le risque de récidive existe, estimé à environ 5% par an. C'est pourquoi le contrôle strict de la tension artérielle et le suivi médical régulier sont essentiels.
Combien de temps dure la récupération ?
La récupération maximale s'observe généralement dans les 6 premiers mois, mais des améliorations peuvent survenir jusqu'à 2 ans après l'accident. Chaque patient évolue à son rythme.
Peut-on reprendre une activité sportive ?
Oui, mais avec l'accord de votre médecin. Les sports d'endurance modérée sont généralement recommandés, tandis que les sports de contact ou à forte intensité sont déconseillés.
Les médicaments contre l'hypertension sont-ils à vie ?
Dans la plupart des cas, oui. L'arrêt du traitement antihypertenseur expose à un risque majeur de récidive. Seul votre médecin peut décider d'une modification de traitement.
Peut-on voyager après une hémorragie intracrânienne ?
Les voyages sont possibles, mais nécessitent quelques précautions : emporter suffisamment de médicaments, connaître les coordonnées d'un hôpital sur place, éviter les destinations à très haute altitude.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [4] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [5] Efficacy and Safety of Neuroendoscopic Surgery versus Conventional Treatment. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Conditions and Diseases - MedTech-Tracker. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Propofol: Uses, Interactions, Mechanism of Action - DrugBank. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Challenges of The Treatment of Pulmonary Embolism Following Intracerebral Hemorrhage in a Hypertensive Patient. 2024.Lien
- [9] Séquelles maculaires d'hypertension intracrânienne idiopathique fulminante: à propos d'un cas. 2022.Lien
- [10] Hemorrhagic cerebromeningeal stroke secondary to hypertension during pregnancy. 2022.Lien
- [11] Syndrome de perfusion du propofol: cas d'un PRIS chez une patiente hospitalisée pour hémorragie sous-arachnoïdienne. 2024.Lien
- [12] Hypertension artérielle et accidents vasculaires cérébraux. Anesthésie & Réanimation. 2023.Lien
- [13] La sclérose hippocampique, stade terminal des crises symptomatiques aiguës chez les patients avec hémorragie cérébrale.Lien
- [14] Thrombose unilatérale de la veine cérébrale interne: fin de paradigme de latéralité? 2025.Lien
- [15] Prise en charge initiale d'une hémorragie méningée. Anesthésie & Réanimation. 2022.Lien
- [16] Hémorragie intracérébrale - Troubles du cerveau. MSD Manuals.Lien
- [17] Hémorragie cérébrale : Symptômes et traitements. Elsan Care.Lien
- [18] Hypertension intracrânienne idiopathique. MSD Manuals.Lien
Publications scientifiques
- … dans un Milieu à Ressources Limitées: Challenges of The Treatment of Pulmonary Embolism Following Intracerebral Hemorrhage in a Hypertensive Patient in a Low … (2024)
- [PDF][PDF] Séquelles maculaires d'hypertension intracrânienne idiopathique fulminante: à propos d'un cas (2022)
- Hemorrhagic cerebromeningeal stroke secondary to hypertension during pregnancy: a case report and review of the literature (2022)
- Cas clinique commenté: syndrome de perfusion du propofol: cas d'un PRIS chez une patiente hospitalisée pour hémorragie sous-arachnoïdienne (2024)
- Hypertension artérielle et accidents vasculaires cérébraux (2023)1 citations
Ressources web
- Hémorragie intracérébrale - Troubles du cerveau, de la ... (msdmanuals.com)
L'hémorragie intracérébrale est souvent due à une hypertension artérielle chronique. · Des céphalées intenses sont souvent le premier symptôme. · Le diagnostic ...
- Hémorragie cérébrale : Symptômes et traitements (elsan.care)
Cette hémorragie cérébrale entraine, dans la majorité des cas, des céphalées violentes et des vomissements comme premiers signes cliniques.
- Hypertension intracrânienne idiopathique (msdmanuals.com)
La céphalée peut être accompagnée de nausées, de vision double ou trouble, et de bruits lancinants dans la tête qui se produisent avec chaque battement du pouls ...
- Hypertension intracrânienne : définition, symptômes et ... (deuxiemeavis.fr)
16 avr. 2024 — Les tests courants pour diagnostiquer cette condition incluent un examen ophtalmologique, une imagerie cérébrale par résonance magnétique (IRM) ...
- Hémorragie intracérébrale - Troubles neurologiques (merckmanuals.com)
La cause est généralement une HTA. Les symptômes typiques comprennent des déficits neurologiques focaux, souvent accompagnés de céphalées à début brutal, de ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
