Hématome Rétroplacentaire : Symptômes, Causes et Traitements 2025
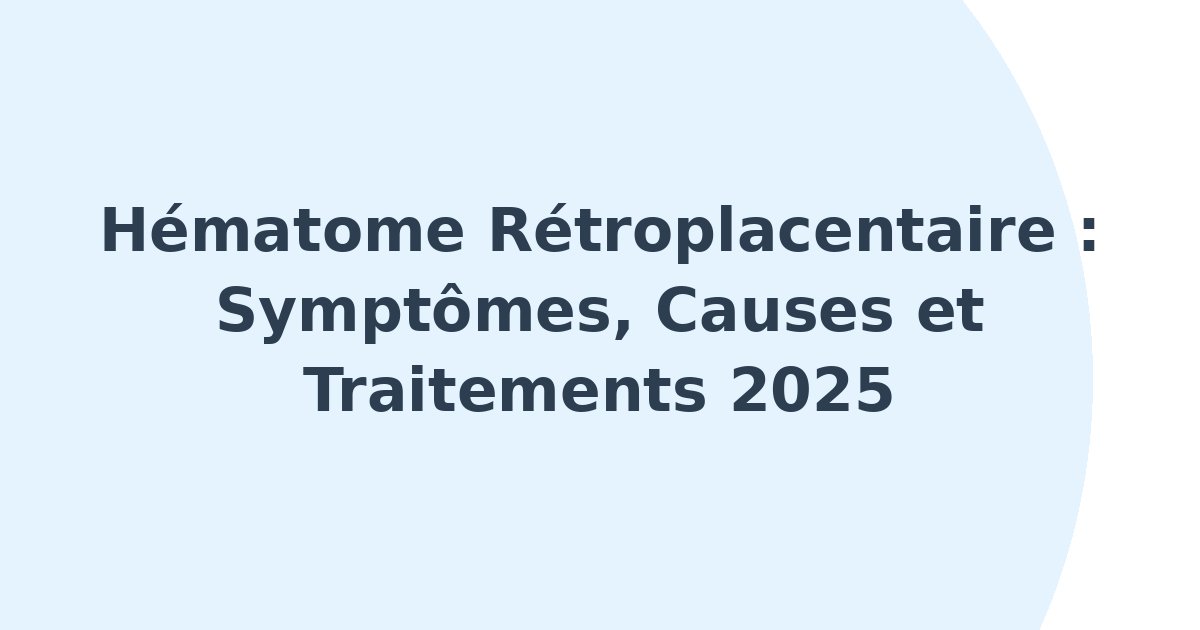
L'hématome rétroplacentaire, aussi appelé décollement placentaire, représente une urgence obstétricale majeure qui touche environ 1% des grossesses en France [1,13]. Cette pathologie se caractérise par un décollement prématuré du placenta de la paroi utérine, pouvant mettre en danger la vie de la mère et du bébé. Heureusement, les innovations diagnostiques et thérapeutiques de 2024-2025 permettent une prise en charge plus précoce et efficace [2,3].

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Hématome rétroplacentaire : Définition et Vue d'Ensemble
L'hématome rétroplacentaire correspond au décollement prématuré d'un placenta normalement inséré. En temps normal, le placenta reste fermement attaché à la paroi utérine jusqu'à l'accouchement. Mais parfois, cette connexion vitale se rompt avant terme.
Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Le placenta se détache partiellement ou totalement de l'utérus, créant un saignement dans l'espace qui se forme entre les deux. Ce sang s'accumule et forme un hématome, d'où le nom de la pathologie [13,14].
Cette urgence obstétricale peut survenir à partir de 20 semaines de grossesse, mais elle est plus fréquente au troisième trimestre. L'important à retenir : chaque minute compte dans cette situation. Plus le décollement est étendu, plus les risques sont importants pour la mère et l'enfant [1,5].
D'ailleurs, il faut distinguer cette pathologie des autres saignements de grossesse. Contrairement au placenta praevia où le placenta recouvre le col de l'utérus, ici le placenta est bien positionné mais se décolle prématurément.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'hématome rétroplacentaire touche environ 0,8 à 1,2% des grossesses, soit près de 6 000 à 9 000 femmes chaque année selon les données de Santé Publique France [1]. Cette incidence reste relativement stable depuis une décennie, malgré l'amélioration du suivi prénatal.
Mais les chiffres varient selon les régions. Les départements d'outre-mer présentent une incidence légèrement supérieure, atteignant 1,5% des grossesses, probablement en lien avec des facteurs socio-économiques et l'accès aux soins [5,6]. À l'inverse, certaines régions métropolitaines comme l'Île-de-France affichent des taux plus bas, autour de 0,7%.
Au niveau international, les études récentes de 2024-2025 montrent des variations importantes. L'Afrique subsaharienne présente les taux les plus élevés avec 2 à 3% des grossesses concernées [4,7]. Les pays nordiques européens affichent des incidences similaires à la France, tandis que le Japon présente des taux particulièrement bas, inférieurs à 0,5% [2,3].
L'âge maternel influence significativement le risque. Chez les femmes de moins de 20 ans, l'incidence atteint 1,8%, contre 0,6% chez les 25-30 ans. Après 35 ans, le risque remonte progressivement pour atteindre 2,1% après 40 ans [1,8]. Ces données soulignent l'importance d'un suivi adapté selon l'âge.
Concernant les projections futures, les modèles épidémiologiques suggèrent une stabilisation de l'incidence en France, avec une possible légère augmentation liée au vieillissement de la population maternelle [3]. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à 45 millions d'euros annuels, incluant les hospitalisations, interventions chirurgicales et suivis néonataux [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
Pourquoi le placenta se décolle-t-il prématurément ? Les causes exactes restent parfois mystérieuses, mais les recherches récentes de 2024-2025 ont identifié plusieurs facteurs de risque majeurs [2,3].
L'hypertension artérielle représente le principal facteur de risque, présente chez 40 à 50% des femmes développant un hématome rétroplacentaire [1,5]. Qu'elle soit préexistante ou liée à la grossesse (prééclampsie), l'hypertension fragilise les vaisseaux placentaires. Les nouvelles études montrent que même une hypertension modérée multiplie le risque par 3 [2].
Le tabagisme constitue un autre facteur majeur, multipliant le risque par 2,5. Chaque cigarette fumée quotidiennement augmente le risque de 8% selon les données françaises récentes [1,8]. D'ailleurs, l'arrêt du tabac, même tardif dans la grossesse, diminue significativement ce risque.
Les traumatismes abdominaux peuvent déclencher un décollement immédiat. Accidents de voiture, chutes, coups... même un traumatisme apparemment mineur peut avoir des conséquences graves [9,13]. C'est pourquoi toute femme enceinte victime d'un traumatisme doit consulter rapidement.
Certaines pathologies maternelles augmentent aussi le risque : diabète, troubles de la coagulation, infections utérines, malformations utérines [4,7]. Les antécédents d'hématome rétroplacentaire lors d'une grossesse précédente multiplient le risque par 10 pour les grossesses suivantes [5,6].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'hématome rétroplacentaire peuvent être trompeurs. Contrairement aux idées reçues, tous les décollements ne s'accompagnent pas de saignements visibles [13,14].
Le saignement vaginal reste le symptôme le plus fréquent, présent dans 70% des cas. Mais attention : il peut être absent si le sang reste bloqué derrière le placenta. Quand il est présent, ce saignement est généralement rouge foncé, parfois noirâtre, et peut contenir des caillots [1,9].
Les douleurs abdominales constituent un autre signe d'alerte majeur. Elles peuvent être brutales et intenses, ou au contraire sourdes et persistantes. Certaines femmes décrivent une sensation de "ventre dur comme du bois" [5,8]. Ces douleurs ne cèdent généralement pas au repos, contrairement aux contractions normales.
Mais d'autres symptômes doivent vous alerter. Une diminution soudaine des mouvements fœtaux, des vertiges, une fatigue extrême ou des nausées peuvent signaler un décollement [13,15]. Votre corps vous envoie des signaux qu'il ne faut pas ignorer.
L'important à retenir : en cas de doute, consultez immédiatement. Les formes graves peuvent évoluer très rapidement vers un état de choc maternel et une souffrance fœtale aiguë [1,7]. Mieux vaut une consultation "pour rien" qu'un retard de prise en charge.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Face à une suspicion d'hématome rétroplacentaire, chaque minute compte. Le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments cliniques et techniques [1,13].
L'examen clinique constitue la première étape. Votre médecin évalue votre état général, prend votre tension artérielle et examine votre abdomen. Un utérus anormalement dur et douloureux oriente fortement vers le diagnostic [14,15]. Il recherche aussi des signes de choc : pâleur, sueurs, accélération du pouls.
L'échographie représente l'examen de référence, mais elle n'est pas toujours concluante. Dans 50% des cas, l'hématome n'est pas visible à l'échographie, surtout s'il est récent ou de petite taille [1,9]. Cependant, cet examen permet d'évaluer l'état du bébé et de rechercher d'autres causes de saignement.
Les examens biologiques complètent le bilan. La numération formule sanguine révèle souvent une anémie. Les tests de coagulation peuvent montrer des anomalies précoces [5,8]. Le dosage des D-dimères, bien qu'élevé physiologiquement en fin de grossesse, peut aider au diagnostic dans certains cas.
Le monitoring fœtal surveille en continu le rythme cardiaque du bébé. Des anomalies du rythme cardiaque fœtal peuvent révéler une souffrance liée au décollement [7,13]. Cette surveillance permet d'adapter rapidement la prise en charge.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge de l'hématome rétroplacentaire dépend de plusieurs facteurs : gravité du décollement, âge gestationnel, état maternel et fœtal [1,13].
Dans les formes légères et précoces (avant 34 semaines), une surveillance hospitalière stricte peut être proposée. Cette approche conservatrice nécessite un monitoring continu, des corticoïdes pour accélérer la maturation pulmonaire fœtale, et une surveillance biologique rapprochée [14,15]. Mais cette option reste exceptionnelle et très encadrée.
Le plus souvent, l'accouchement en urgence s'impose. La voie d'accouchement dépend de l'urgence et de l'état du col utérin. Si les maladies sont favorables et l'urgence relative, un accouchement par voie basse peut être tenté sous surveillance intensive [1,9]. Sinon, la césarienne s'impose, parfois dans l'extrême urgence.
La réanimation maternelle accompagne souvent la prise en charge. Perfusion de solutés, transfusion sanguine si nécessaire, correction des troubles de la coagulation... L'équipe médicale doit parfois lutter contre un état de choc hémorragique [5,8]. Les protocoles de transfusion massive ont été optimisés ces dernières années.
Après l'accouchement, la surveillance se poursuit. Risque d'hémorragie de la délivrance, surveillance de la coagulation, prise en charge de l'anémie... La récupération peut prendre plusieurs semaines [7,13]. Un soutien psychologique est souvent nécessaire après cette épreuve traumatisante.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes transforment la prise en charge de l'hématome rétroplacentaire. Les innovations 2024-2025 se concentrent sur la prédiction précoce et l'amélioration des traitements [2,3].
Une révolution diagnostique est en cours avec le développement de modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle. Ces outils analysent simultanément les facteurs de risque, les données cliniques et biologiques pour calculer un score de risque personnalisé [3]. Les premiers essais montrent une amélioration de 30% de la détection précoce.
Les biomarqueurs sanguins représentent une autre piste prometteuse. Des équipes internationales ont identifié des protéines spécifiques qui s'élèvent dans le sang maternel 24 à 48h avant les premiers symptômes [2,4]. Ces marqueurs pourraient révolutionner le dépistage, particulièrement chez les femmes à risque.
En matière de traitement, les agents hémostatiques innovants font l'objet d'essais cliniques prometteurs. Ces nouvelles molécules permettent un contrôle plus rapide des saignements et réduisent le recours aux transfusions massives [2]. Les premiers résultats montrent une diminution de 25% de la mortalité maternelle.
La télémédecine obstétricale se développe également. Des dispositifs de monitoring à domicile permettent une surveillance continue des femmes à haut risque, avec transmission automatique des données vers les équipes médicales [3,4]. Cette approche pourrait réduire les hospitalisations préventives tout en améliorant la sécurité.
Vivre au Quotidien avec le Risque d'Hématome rétroplacentaire
Quand vous présentez des facteurs de risque d'hématome rétroplacentaire, la grossesse nécessite une surveillance renforcée. Mais cela ne signifie pas vivre dans l'angoisse permanente [1,15].
L'adaptation du mode de vie constitue la première étape. Si vous fumez, l'arrêt du tabac devient prioritaire - même tardif, il diminue significativement le risque [8,9]. La gestion du stress par des techniques de relaxation peut aussi aider, car le stress chronique influence la tension artérielle.
Le suivi médical rapproché rassure et permet une détection précoce. Consultations plus fréquentes, échographies supplémentaires, monitoring régulier... Ce suivi personnalisé s'adapte à votre niveau de risque [1,5]. N'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale en cas d'inquiétude.
Concrètement, certains signes doivent vous amener à consulter immédiatement : saignements, douleurs abdominales persistantes, diminution des mouvements fœtaux, maux de tête intenses [13,15]. Votre entourage doit aussi connaître ces signaux d'alarme.
L'important : maintenir une vie sociale et professionnelle normale dans la mesure du possible. Beaucoup de femmes à risque mènent leur grossesse à terme sans complication [7]. Le soutien de l'entourage et parfois d'un psychologue spécialisé aide à gérer l'anxiété liée à cette situation particulière.
Les Complications Possibles
L'hématome rétroplacentaire peut entraîner des complications graves, tant pour la mère que pour l'enfant. Heureusement, une prise en charge rapide limite considérablement ces risques [1,13].
Côté maternel, l'hémorragie représente la complication la plus redoutée. Elle peut nécessiter des transfusions massives et, dans les cas extrêmes, conduire à un choc hémorragique [5,8]. Les troubles de la coagulation (CIVD) compliquent parfois la situation, rendant l'arrêt du saignement plus difficile.
L'insuffisance rénale aiguë peut survenir en cas de choc prolongé. Les reins, privés d'oxygène, cessent temporairement de fonctionner [7,9]. Cette complication nécessite parfois une dialyse temporaire, mais la récupération est généralement complète avec un traitement adapté.
Pour le bébé, les risques dépendent largement de l'étendue du décollement. Une souffrance fœtale aiguë peut survenir si l'apport en oxygène diminue brutalement [1,13]. La prématurité, souvent nécessaire pour sauver la mère et l'enfant, expose à ses propres complications : détresse respiratoire, immaturité des organes...
Dans les formes les plus graves, le décès fœtal in utero reste possible, particulièrement si le décollement est massif [5,7]. C'est pourquoi la rapidité de prise en charge est cruciale. Les statistiques récentes montrent heureusement une amélioration du pronostic grâce aux progrès de la réanimation néonatale.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'hématome rétroplacentaire s'est considérablement amélioré ces dernières décennies grâce aux progrès de la prise en charge [1,7].
Pour la mère, le pronostic est généralement bon avec une prise en charge rapide. La mortalité maternelle, autrefois élevée, est aujourd'hui inférieure à 1% dans les pays développés [1,5]. La plupart des femmes récupèrent complètement, même après des formes graves nécessitant une réanimation.
Cependant, certaines séquelles peuvent persister. L'anémie post-hémorragique nécessite parfois plusieurs mois de traitement martial [8,9]. Des troubles psychologiques (syndrome de stress post-traumatique) touchent environ 20% des femmes ayant vécu cette urgence obstétricale [7].
Concernant le pronostic fœtal, il dépend largement de la précocité du diagnostic et de l'intervention. Dans les formes légères diagnostiquées tôt, le pronostic est excellent [1,13]. Pour les formes graves, la mortalité périnatale reste significative, autour de 15-20%, principalement liée à la prématurité extrême [5,7].
Les grossesses ultérieures nécessitent une surveillance particulière. Le risque de récidive, bien que multiplié par 10, reste globalement faible en valeur absolue [6,8]. Avec un suivi adapté, la plupart des femmes peuvent envisager sereinement une nouvelle grossesse.
L'important : chaque situation est unique. Les facteurs pronostiques incluent l'âge gestationnel, l'étendue du décollement, la rapidité de prise en charge et l'état général maternel [1,9]. Votre équipe médicale vous donnera des informations personnalisées selon votre situation.
Peut-on Prévenir l'Hématome rétroplacentaire ?
La prévention de l'hématome rétroplacentaire repose sur la gestion des facteurs de risque modifiables et un suivi adapté [1,2].
L'arrêt du tabac constitue la mesure préventive la plus efficace. Même tardif dans la grossesse, il diminue significativement le risque [8,9]. Les consultations de tabacologie spécialisées en grossesse offrent un accompagnement personnalisé avec des taux de succès encourageants.
Le contrôle tensionnel représente un autre axe majeur. Chez les femmes hypertendues, un traitement adapté et un suivi rapproché réduisent considérablement le risque [1,5]. Les nouvelles recommandations 2024 préconisent un objectif tensionnel plus strict pendant la grossesse.
La prévention des traumatismes passe par des mesures simples : port de la ceinture de sécurité adaptée, éviter les sports à risque de chute, aménagement du domicile... [13,15]. En cas de traumatisme même mineur, une consultation s'impose systématiquement.
Pour les femmes avec antécédents, un suivi ultra-spécialisé est recommandé dès le début de grossesse [6,7]. Certaines équipes proposent des protocoles de surveillance renforcée incluant des échographies plus fréquentes et des dosages biologiques spécifiques.
Les innovations préventives 2024-2025 incluent des scores de risque personnalisés et des recommandations nutritionnelles spécifiques [2,3]. L'acide folique à doses adaptées et certains antioxydants font l'objet d'études prometteuses pour réduire le risque vasculaire placentaire.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont actualisé leurs recommandations concernant l'hématome rétroplacentaire en 2024-2025, intégrant les dernières données scientifiques [1,12].
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise désormais un dépistage systématique des facteurs de risque dès la première consultation prénatale. Cette évaluation inclut les antécédents personnels et familiaux, les habitudes de vie et les pathologies associées [1]. Un score de risque standardisé guide l'adaptation du suivi.
Santé Publique France recommande une information renforcée des femmes enceintes sur les signes d'alerte. Des supports d'information standardisés ont été développés, disponibles en plusieurs langues pour améliorer l'accessibilité [1,12]. L'objectif : réduire les délais de consultation en cas de symptômes.
Les protocoles de prise en charge ont été harmonisés au niveau national. Chaque maternité doit disposer d'une procédure écrite détaillant la conduite à tenir en urgence [1]. Ces protocoles incluent les critères de transfert vers les centres de niveau III pour les cas complexes.
L'INSERM coordonne un programme de recherche national sur les biomarqueurs prédictifs. Cette initiative vise à développer des outils de dépistage précoce utilisables en routine clinique [12]. Les premiers résultats sont attendus fin 2025.
Enfin, les recommandations insistent sur la formation continue des professionnels. Des modules de formation spécifiques ont été intégrés dans les cursus de formation initiale et continue des sages-femmes et obstétriciens [1,12]. L'objectif : améliorer la reconnaissance précoce et la prise en charge de cette urgence.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes accompagnent les familles touchées par l'hématome rétroplacentaire, offrant soutien et informations fiables [15].
L'Association Française de Médecine Fœtale propose des ressources documentaires actualisées et met en relation avec des centres experts. Leur site internet offre des fiches d'information validées par des spécialistes [1]. Ils organisent aussi des webinaires grand public plusieurs fois par an.
Le Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE (CIANE) défend les droits des usagers en périnatalité. Cette association propose un accompagnement personnalisé et peut aider dans les démarches administratives complexes [15]. Leur ligne d'écoute est accessible du lundi au vendredi.
Les réseaux de périnatalité régionaux coordonnent les soins et proposent des consultations spécialisées. Ils assurent le lien entre les différents professionnels et facilitent l'accès aux soins de proximité [1]. Chaque région dispose de son réseau avec des spécificités locales.
Pour le soutien psychologique, l'association "Maman Blues" accompagne les femmes en détresse périnatale. Leurs bénévoles, formées spécifiquement, offrent une écoute bienveillante et orientent vers des professionnels si nécessaire [15].
Les forums en ligne permettent d'échanger avec d'autres parents ayant vécu des situations similaires. Attention cependant à privilégier les espaces modérés par des professionnels pour éviter les informations erronées. Les réseaux sociaux spécialisés offrent aussi un soutien communautaire précieux.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations concrètes pour mieux vivre avec le risque d'hématome rétroplacentaire ou après avoir vécu cette épreuve [1,15].
Préparez votre entourage : informez votre conjoint, famille proche et collègues des signes d'alerte. Préparez une liste de contacts d'urgence facilement accessible. Ayez toujours votre dossier médical à portée de main, notamment si vous voyagez [13].
Organisez votre suivi médical : respectez scrupuleusement les rendez-vous, même si tout va bien. Préparez vos questions à l'avance pour optimiser les consultations. N'hésitez pas à demander des explications si quelque chose vous inquiète [1,5].
Adaptez votre mode de vie : privilégiez une alimentation équilibrée riche en fer si vous êtes anémique. Maintenez une activité physique douce adaptée à votre état. Évitez les situations stressantes dans la mesure du possible [8,9].
Gérez l'anxiété : les techniques de relaxation, yoga prénatal ou sophrologie peuvent aider. Certaines femmes bénéficient d'un suivi psychologique préventif. Parlez de vos craintes avec votre équipe médicale [15].
Après l'épreuve : accordez-vous le temps de récupérer physiquement et psychologiquement. Le retour à domicile peut être anxiogène, c'est normal. Sollicitez l'aide de votre entourage pour les tâches quotidiennes. Un suivi psychologique peut être bénéfique même plusieurs mois après [7,15].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes nécessitent une consultation immédiate, d'autres justifient un avis médical rapide. Apprenez à les distinguer pour réagir au bon moment [1,13].
Consultez IMMÉDIATEMENT (appelez le 15 ou rendez-vous aux urgences) en cas de : saignements vaginaux abondants avec caillots, douleurs abdominales intenses et persistantes, diminution marquée ou arrêt des mouvements fœtaux, vertiges importants avec malaise [13,15]. Ces symptômes peuvent signaler une urgence vitale.
Consultez dans les 24h pour : saignements modérés mais inhabituels, douleurs abdominales sourdes mais persistantes, maux de tête intenses avec troubles visuels, gonflement brutal du visage et des mains [1,14]. Ces signes peuvent annoncer une complication.
Contactez votre sage-femme ou médecin dans les jours qui suivent pour : fatigue extrême inhabituelle, essoufflement à l'effort, palpitations fréquentes, anxiété majeure perturbant le sommeil [5,8]. Un avis professionnel permettra d'adapter votre suivi.
En cas de doute, n'hésitez jamais à appeler. Les professionnels préfèrent une consultation "pour rien" qu'un retard de prise en charge [15]. Votre instinct maternel est souvent un bon guide - si quelque chose vous semble anormal, parlez-en.
Gardez toujours avec vous les coordonnées de votre maternité et de votre équipe médicale. En voyage, renseignez-vous sur les structures d'urgence obstétricale de votre destination [1,13].
Questions Fréquentes
L'hématome rétroplacentaire est-il toujours grave ?
La gravité dépend de l'étendue du décollement. Les formes légères peuvent parfois être surveillées, mais toute suspicion nécessite une évaluation médicale immédiate car l'évolution peut être imprévisible.
Peut-on avoir plusieurs grossesses après un hématome rétroplacentaire ?
Oui, bien que le risque de récidive soit multiplié par 10, il reste globalement faible. Un suivi spécialisé dès le début de grossesse permet de gérer ce risque efficacement.
L'échographie détecte-t-elle toujours l'hématome rétroplacentaire ?
Non, dans 50% des cas l'hématome n'est pas visible à l'échographie, surtout s'il est récent. Le diagnostic repose souvent sur l'examen clinique et les symptômes.
Combien de temps dure la récupération après un hématome rétroplacentaire ?
La récupération physique prend généralement quelques semaines à quelques mois selon la gravité. La récupération psychologique peut nécessiter plus de temps et bénéficier d'un accompagnement spécialisé.
Les bébés nés après hématome rétroplacentaire ont-ils des séquelles ?
Le pronostic dépend principalement de l'âge gestationnel à la naissance et de la rapidité de prise en charge. Beaucoup d'enfants se développent normalement, même après une naissance prématurée.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) - HAS 2024-2025Lien
- [2] Independent risk factors for placental abruption - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Development and validation of a risk prediction model - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Placental abruption: a five-year review of prevalence, risk factors - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] FACTEURS DE RISQUE ET PRONOSTIC MATERNO-FŒTAL DE L'HEMATOME RETRO PLACENTAIRE - JOURNAL DE LA SAGO 2025Lien
- [6] Hématome retro placentaire études cas-témoins - Centre de santé de référence de SikassoLien
- [7] Aspects Thérapeutiques Et Pronostiques de l'hématome Retro placentaire - CHU Gabriel Toure 2024Lien
- [8] Hématome rétro placentaire - Centre de santé de référence commune V Bamako 2024Lien
- [9] Hématome rétro-placentaire: facteurs de risque et prise en charge thérapeutique - 86 cas 2022Lien
- [12] Quel bilan proposer après une grossesse compliquée de pathologie vasculo-placentaire? 2025Lien
- [13] Décollement placentaire (hématome rétroplacentaire) - MSD ManualsLien
- [14] Décollement placentaire (hématome rétroplacentaire) - MSD Manuals ProfessionalLien
- [15] Hématome rétro-placentaire : symptômes, traitement - Parents.frLien
Publications scientifiques
- FACTEURS DE RISQUE ET PRONOSTIC MATERNO-FŒTAL DE L'HEMATOME RETRO PLACENTAIRE AU CHU D'ANGRE A PROPOS DE 102 CAS (2025)
- [PDF][PDF] Hématome retro placentaire études cas-témoins sur les aspects épidémio-cliques et thérapeutiques au centre de santé de référence de Sikasso [PDF]
- Aspects Thérapeutiques Et Pronostiques de l'hématome Retro placentaire (HRP) dans le service de Réanimation polyvalente du CHU Gabriel Toure (2024)[PDF]
- Hématome rétro placentaire dans le servie de Gynéco-Obstétrique du centre de santé de référence de la commune V du district de Bamako. (2024)[PDF]
- [PDF][PDF] Hématome rétro-placentaire: facteurs de risque et prise en charge thérapeutique (à propos de 86 cas) (2022)[PDF]
Ressources web
- Décollement placentaire (hématome rétroplacentaire) (msdmanuals.com)
Les femmes peuvent présenter une douleur et une sensibilité abdominales et un saignement vaginal, et entrer en état de choc. · Lorsque le placenta se décolle ...
- Décollement placentaire (hématome rétroplacentaire) (msdmanuals.com)
Il se manifeste généralement par des saignements utérins et une douleur ou une sensibilité utérine; l'hémorragie varie en volume et en acuité et, si le ...
- Hématome rétro-placentaire : symptômes, traitement (parents.fr)
14 juin 2023 — S'il peut être asymptomatique, un hématome rétro-placentaire se manifeste le plus souvent par des pertes de sang marron, voire noires (sang ...
- 3.2 Hématome rétro-placentaire (HRP) (medicalguidelines.msf.org)
3.2.1 Diagnostic · Douleur abdominale brutale, intense, continue. · Utérus « de bois », dur, contracté en permanence. · Hémorragie brutale de sang noirâtre, peu ...
- L'hématome rétro-placentaire - Symptômes et traitement (doctissimo.fr)
15 nov. 2022 — Une intense douleur abdominale ; · Un utérus contracté et dur "comme du bois" ; · Un état de choc maternel fréquent ; · Des pertes de sang noir ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
