Fièvre Catarrhale du Mouton : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
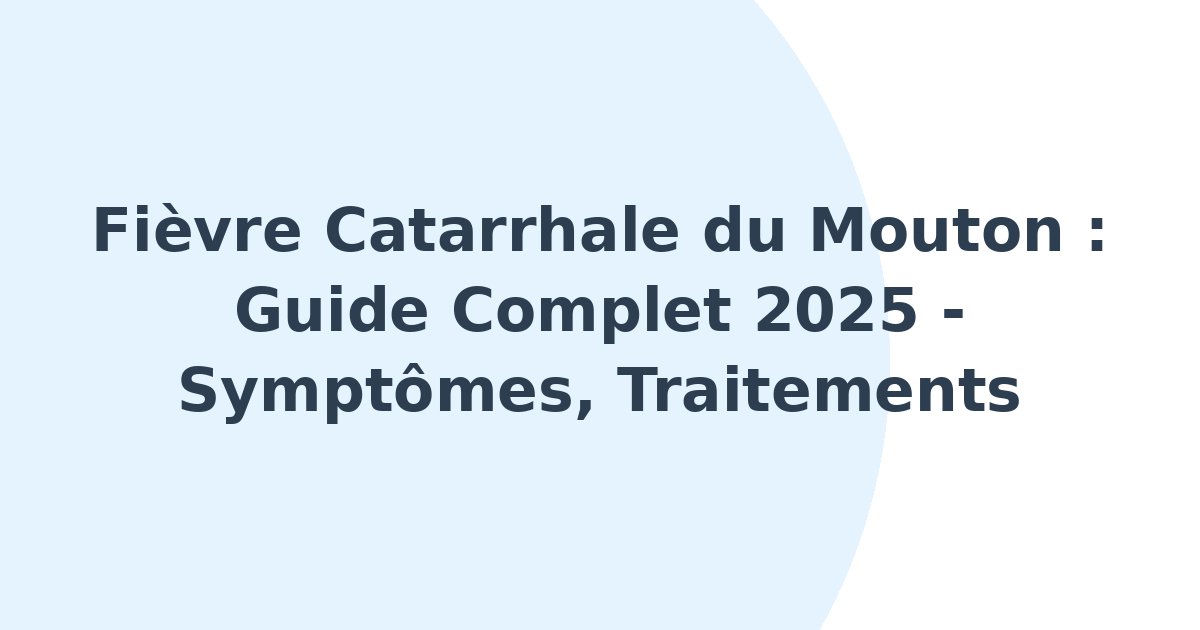
La fièvre catarrhale du mouton, également appelée bluetongue, est une maladie virale qui touche principalement les ruminants. Bien qu'elle affecte surtout les animaux, cette pathologie suscite des préoccupations importantes en santé publique vétérinaire. Transmise par des insectes vecteurs, elle représente un enjeu majeur pour l'élevage français et européen.
Téléconsultation et Fièvre catarrhale du mouton
Téléconsultation non recommandéeLa fièvre catarrhale du mouton est une maladie vectorielle grave touchant les ruminants, nécessitant un diagnostic vétérinaire spécialisé immédiat et une déclaration obligatoire aux autorités sanitaires. Cette pathologie animale requiert des examens complémentaires spécifiques et des mesures de biosécurité qui ne peuvent être évaluées à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Description des symptômes observés chez les animaux (œdème facial, boiteries, lésions buccales). Évaluation de l'historique épidémiologique du troupeau et des mouvements d'animaux récents. Analyse des mesures de protection déjà mises en place contre les vecteurs (Culicoides). Orientation vers les services vétérinaires compétents et les autorités sanitaires.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique vétérinaire obligatoire pour confirmer le diagnostic. Prélèvements sanguins pour sérologie et RT-PCR indispensables. Évaluation de l'état général du troupeau et mise en place de mesures de quarantaine. Déclaration obligatoire aux services vétérinaires départementaux.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge vétérinaire urgente. En cas de suspicion de fièvre catarrhale du mouton, contactez immédiatement votre vétérinaire traitant ou les services vétérinaires départementaux.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion clinique nécessitant confirmation diagnostique par prélèvements. Évaluation de l'ampleur de l'atteinte dans le troupeau et mise en place de mesures de quarantaine. Décès d'animaux nécessitant autopsie et prélèvements spécialisés. Coordination avec les autorités sanitaires pour les mesures de police sanitaire.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Mortalité brutale dans le troupeau avec symptômes évocateurs. Détresse respiratoire sévère chez plusieurs animaux. Suspicion d'introduction de souche virulente nécessitant isolement immédiat du troupeau.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Mortalité brutale et inexpliquée dans le troupeau
- Détresse respiratoire sévère avec cyanose de la langue (langue bleue)
- Œdème facial massif avec impossibilité de s'alimenter
- Hyperthermie élevée associée à une prostration marquée chez plusieurs animaux
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence vétérinaire. En cas de suspicion de fièvre catarrhale du mouton, contactez immédiatement votre vétérinaire ou les services vétérinaires départementaux.
Spécialité recommandée
Vétérinaire spécialisé en pathologie des ruminants — consultation en présentiel indispensable
La fièvre catarrhale du mouton est une maladie réglementée nécessitant une expertise vétérinaire spécialisée pour le diagnostic, les prélèvements et la déclaration obligatoire. La consultation vétérinaire en présentiel est indispensable pour la confirmation diagnostique et la mise en place des mesures sanitaires.
Fièvre catarrhale du mouton : Définition et Vue d'Ensemble
La fièvre catarrhale du mouton est une maladie virale non contagieuse qui affecte les ruminants domestiques et sauvages [11]. Cette pathologie, causée par le virus bluetongue (BTV), appartient à la famille des Reoviridae et comprend 29 sérotypes différents identifiés à ce jour [4].
Le virus se transmet exclusivement par la piqûre de petits insectes appelés culicoïdes, principalement Culicoides imicola et Culicoides obsoletus [6]. Ces moucherons hématophages sont actifs au crépuscule et durant la nuit, particulièrement entre mai et octobre en France [10].
Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, cette maladie ne touche pas uniquement les moutons. Elle affecte également les bovins, les chèvres, les cerfs et d'autres ruminants sauvages [11]. D'ailleurs, les bovins peuvent être porteurs asymptomatiques, ce qui complique la surveillance épidémiologique [7].
L'importance de cette pathologie réside dans son impact économique considérable sur l'élevage. En effet, elle peut provoquer des pertes importantes dans les troupeaux et entraîner des restrictions commerciales majeures [12]. Heureusement, il faut savoir que cette maladie ne se transmet pas à l'homme, ce qui rassure quant aux risques de santé publique directe.
Épidémiologie en France et dans le Monde
La situation épidémiologique de la fièvre catarrhale du mouton en France a considérablement évolué ces dernières années. Selon les données du ministère de l'Agriculture, plus de 2 847 foyers ont été confirmés en 2023, marquant une recrudescence significative de la maladie [1].
En Europe, la réémergence du sérotype 8 (BTV-8) depuis 2015 constitue un phénomène préoccupant [4,8]. Ce sérotype, particulièrement virulent, avait déjà causé une épizootie majeure entre 2006 et 2009. Les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne ont été les premiers touchés par cette nouvelle vague [8].
La France métropolitaine présente des variations régionales importantes. Les régions du Sud-Ouest et du Sud-Est sont traditionnellement les plus affectées, en raison de maladies climatiques favorables aux vecteurs [10]. Cependant, le réchauffement climatique étend progressivement la zone d'activité des culicoïdes vers le nord [4].
Au niveau mondial, la maladie est endémique dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales. L'Afrique subsaharienne, l'Australie et certaines parties de l'Amérique du Nord sont particulièrement concernées [3]. Récemment, la Pologne a signalé sa première détection du sérotype 3, illustrant l'expansion géographique continue de la pathologie [3].
Les Causes et Facteurs de Risque
Le virus bluetongue appartient au genre Orbivirus et possède un génome à ARN double brin segmenté [5]. Cette structure particulière lui confère une capacité de mutation et de recombinaison importante, expliquant l'existence de multiples sérotypes [5].
Les culicoïdes constituent le maillon essentiel de la transmission. Ces insectes s'infectent en se nourrissant sur un animal virémique, puis deviennent capables de transmettre le virus après une période d'incubation de 10 à 25 jours selon la température [6]. Plus il fait chaud, plus cette période est courte, ce qui explique la saisonnalité de la maladie.
Plusieurs facteurs environnementaux influencent la propagation de la pathologie. L'humidité et la température sont déterminantes pour la survie et l'activité des vecteurs [6]. Les zones humides, les cours d'eau et les points d'abreuvement constituent des sites de reproduction privilégiés pour les culicoïdes [10].
Certaines pratiques d'élevage peuvent également augmenter les risques. Le pâturage en extérieur, particulièrement au crépuscule, expose davantage les animaux aux piqûres [10]. D'ailleurs, les animaux jeunes et les femelles gestantes présentent une sensibilité accrue à l'infection [7].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la fièvre catarrhale varient considérablement selon l'espèce animale et le sérotype viral impliqué. Chez les moutons, la maladie se manifeste classiquement par une hyperthermie pouvant atteindre 42°C, accompagnée d'une prostration marquée [10].
L'un des signes les plus caractéristiques est la cyanose de la langue, qui lui donne cette couleur bleutée à l'origine du nom "bluetongue" [11]. Cette coloration s'accompagne souvent d'un œdème facial important, particulièrement visible au niveau des lèvres et des paupières [10].
Les troubles locomoteurs constituent également un symptôme fréquent. Les animaux développent des boiteries dues à une inflammation des tissus péri-unguéaux et des lésions au niveau des onglons [10]. Ces lésions peuvent être si douloureuses que les animaux refusent de se déplacer.
Chez les bovins, la présentation clinique est généralement plus discrète. Ils peuvent présenter une hyperthermie modérée, une baisse de production laitière et parfois des lésions buccales [7]. Cependant, beaucoup restent asymptomatiques tout en étant virémiques, ce qui complique la détection [11].
Il faut savoir que la mortalité varie énormément selon les circonstances. Elle peut atteindre 30% chez les moutons lors d'épizooties sévères, mais reste généralement plus faible chez les autres espèces [10].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la fièvre catarrhale repose sur une approche combinée associant examen clinique et analyses de laboratoire. Face à des symptômes évocateurs, le vétérinaire procède d'abord à un examen clinique approfondi, recherchant les signes caractéristiques de la maladie [9].
La confirmation virologique constitue l'étape cruciale du diagnostic. Elle s'effectue par RT-PCR (transcription inverse suivie d'amplification en chaîne par polymérase) sur des échantillons de sang total prélevés sur tube EDTA [11]. Cette technique permet non seulement de confirmer la présence du virus, mais aussi d'identifier le sérotype impliqué [9].
Les prélèvements doivent être réalisés de préférence en phase aiguë de la maladie, lorsque la virémie est maximale. Concrètement, cela correspond aux 3-7 premiers jours suivant l'apparition des symptômes [11]. Passé ce délai, la détection virale devient plus difficile.
En complément, des analyses sérologiques peuvent être effectuées pour détecter les anticorps spécifiques. Ces tests sont particulièrement utiles pour les enquêtes épidémiologiques et la surveillance des troupeaux [9]. Cependant, ils ne permettent pas de distinguer les animaux vaccinés des animaux infectés naturellement.
Le diagnostic différentiel doit écarter d'autres maladies présentant des symptômes similaires, notamment la fièvre aphteuse, l'ecthyma contagieux ou certaines intoxications [10]. Cette démarche nécessite l'expertise d'un vétérinaire expérimenté.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Actuellement, il n'existe aucun traitement spécifique contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton. La prise en charge repose donc exclusivement sur des mesures symptomatiques et de soutien [10,11].
Le traitement symptomatique vise à soulager la souffrance des animaux et à prévenir les complications secondaires. L'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens permet de réduire la fièvre et l'inflammation [10]. Les soins locaux des lésions buccales et podales sont également essentiels pour éviter les surinfections bactériennes.
L'hydratation et le soutien nutritionnel constituent des aspects cruciaux de la prise en charge. Les animaux atteints présentent souvent une anorexie marquée et peuvent se déshydrater rapidement [10]. Dans les cas sévères, une fluidothérapie peut s'avérer nécessaire.
La prévention par vaccination représente actuellement la stratégie la plus efficace. Plusieurs vaccins inactivés sont disponibles sur le marché européen, offrant une protection spécifique contre différents sérotypes . Ces vaccins doivent être administrés avant la saison d'activité des vecteurs pour être pleinement efficaces.
Cependant, la vaccination présente certaines limites. Elle doit être adaptée aux sérotypes circulants dans la région, et l'immunité conférée est généralement de courte durée, nécessitant des rappels annuels [11]. De plus, les animaux vaccinés peuvent présenter une virémie transitoire, compliquant la surveillance épidémiologique.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque une période d'innovation importante dans la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton. Boehringer Ingelheim, leader mondial en santé animale, a annoncé le développement de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses .
Les vaccins de nouvelle génération constituent l'axe de recherche prioritaire. Ces nouveaux vaccins visent à offrir une protection plus large contre plusieurs sérotypes simultanément, réduisant ainsi le nombre d'injections nécessaires . Cette approche multivalente représente un progrès majeur pour la praticité de la vaccination en élevage.
Parallèlement, des recherches avancées portent sur les mécanismes de pathogenèse impliquant les protéines NS4 et NS5 du virus [5]. Ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement d'antiviraux spécifiques, qui pourraient révolutionner la prise en charge de la maladie.
La surveillance épidémiologique bénéficie également d'innovations technologiques. Les systèmes de détection précoce basés sur l'intelligence artificielle permettent désormais d'anticiper les épizooties [1,2]. Ces outils analysent en temps réel les données climatiques, entomologiques et épidémiologiques pour prédire les zones à risque.
En France, les autorités sanitaires ont renforcé leur dispositif de surveillance en 2025, avec un focus particulier sur les régions frontalières . Cette approche proactive vise à détecter plus rapidement l'introduction de nouveaux sérotypes sur le territoire national.
Vivre au Quotidien avec Fièvre catarrhale du mouton
Pour les éleveurs confrontés à la fièvre catarrhale, l'adaptation des pratiques quotidiennes devient essentielle. La gestion d'un troupeau touché nécessite une vigilance constante et des mesures préventives rigoureuses [10].
L'aménagement des maladies d'élevage constitue la première ligne de défense. Il est recommandé de rentrer les animaux en stabulation durant les heures d'activité maximale des culicoïdes, soit entre 18h et 8h du matin [10]. Cette mesure simple peut réduire significativement l'exposition aux vecteurs.
La lutte contre les sites de reproduction des culicoïdes représente un défi permanent. L'élimination des eaux stagnantes, l'entretien des systèmes de drainage et la gestion des fumiers humides sont autant d'actions qui limitent la prolifération des insectes [6]. Certains éleveurs utilisent également des ventilateurs dans les bâtiments, car les culicoïdes supportent mal les courants d'air.
Le suivi sanitaire doit être renforcé pendant les périodes à risque. Une surveillance quotidienne des animaux permet de détecter précocement les premiers signes cliniques [10]. En cas de suspicion, l'isolement des animaux malades et l'appel immédiat au vétérinaire sont indispensables.
L'impact psychologique sur les éleveurs ne doit pas être négligé. La perte d'animaux et les contraintes économiques peuvent générer un stress important. Heureusement, des réseaux de soutien existent, notamment à travers les groupements de défense sanitaire [7].
Les Complications Possibles
La fièvre catarrhale du mouton peut entraîner diverses complications, particulièrement chez les animaux les plus sensibles. Les complications respiratoires figurent parmi les plus préoccupantes, avec le développement possible d'œdèmes pulmonaires sévères [10].
Les troubles de la reproduction constituent une complication majeure chez les femelles gestantes. Le virus peut provoquer des avortements, des malformations fœtales ou des mortalités néonatales [11]. Ces effets sont particulièrement marqués lorsque l'infection survient durant le premier tiers de la gestation.
Les complications podales peuvent avoir des conséquences durables sur la mobilité des animaux. Les lésions au niveau des onglons peuvent s'infecter secondairement, entraînant des boiteries chroniques [10]. Dans certains cas, ces lésions nécessitent des soins prolongés et peuvent affecter définitivement la locomotion.
Chez les jeunes animaux, la maladie peut compromettre la croissance et le développement. Les agneaux infectés présentent souvent un retard de croissance persistant, même après guérison [10]. Cette complication a des répercussions économiques importantes pour les éleveurs.
Les surinfections bactériennes représentent également un risque non négligeable. Les lésions cutanées et muqueuses constituent des portes d'entrée pour diverses bactéries pathogènes, pouvant compliquer l'évolution de la maladie [10]. Un traitement antibiotique peut alors s'avérer nécessaire.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la fièvre catarrhale varie considérablement selon plusieurs facteurs déterminants. L'espèce animale constitue le premier élément pronostique : les moutons présentent généralement les formes les plus sévères, tandis que les bovins développent souvent des infections subcliniques [11].
Le sérotype viral influence également l'évolution de la maladie. Certains sérotypes, comme le BTV-8, sont réputés plus virulents et entraînent des taux de mortalité plus élevés [4,8]. À l'inverse, d'autres sérotypes provoquent des formes plus bénignes avec une mortalité réduite.
L'âge des animaux joue un rôle crucial dans le pronostic. Les jeunes et les animaux âgés présentent une sensibilité accrue et un risque de complications plus important [10]. Les femelles gestantes constituent également une population à risque particulier.
Avec une prise en charge adaptée, la majorité des animaux survivants récupèrent complètement en 2 à 4 semaines [10]. Cependant, certaines séquelles peuvent persister, notamment au niveau locomoteur ou reproductif. L'immunité acquise après infection naturelle est généralement solide et durable pour le sérotype concerné [11].
Au niveau du troupeau, l'impact économique peut être considérable. Outre les pertes directes par mortalité, la maladie entraîne des baisses de production, des coûts vétérinaires et des restrictions commerciales [12]. La récupération économique complète peut nécessiter plusieurs années.
Peut-on Prévenir Fièvre catarrhale du mouton ?
La prévention de la fièvre catarrhale repose sur une approche intégrée combinant vaccination, lutte anti-vectorielle et mesures de biosécurité. La vaccination constitue actuellement la méthode préventive la plus efficace disponible [11].
Les programmes de vaccination doivent être adaptés aux sérotypes circulants dans la région. En France, les vaccins contre les sérotypes 1, 4 et 8 sont couramment utilisés [10]. La primo-vaccination nécessite généralement deux injections à 3-4 semaines d'intervalle, suivies d'un rappel annuel.
La lutte contre les culicoïdes représente un défi complexe mais essentiel. L'élimination des gîtes larvaires constitue la mesure la plus efficace : drainage des zones humides, gestion des fumiers et élimination des eaux stagnantes [6]. L'utilisation d'insecticides peut être envisagée dans certaines situations, mais leur efficacité reste limitée.
Les mesures de biosécurité incluent la limitation des mouvements d'animaux pendant les périodes à risque et la mise en place de quarantaines pour les nouveaux arrivants [10]. Le contrôle des déplacements commerciaux constitue également un élément clé de la prévention à l'échelle régionale.
L'aménagement des bâtiments d'élevage peut réduire significativement l'exposition aux vecteurs. L'installation de moustiquaires, de ventilateurs et l'éclairage adapté contribuent à limiter la présence des culicoïdes [10]. Ces investissements, bien que coûteux, s'avèrent souvent rentables à long terme.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi un cadre réglementaire strict pour la gestion de la fièvre catarrhale du mouton. Le ministère de l'Agriculture coordonne la surveillance nationale et définit les mesures de lutte obligatoires [12].
L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) joue un rôle central dans l'évaluation des risques et l'expertise scientifique. Ses recommandations portent sur les stratégies de vaccination, les mesures de biosécurité et l'évolution de la situation épidémiologique [11]. L'agence publie régulièrement des avis actualisés selon l'évolution de la situation.
La déclaration obligatoire de tout foyer suspect constitue une obligation légale pour les vétérinaires et les éleveurs. Cette surveillance permet de cartographier la maladie en temps réel et d'adapter les mesures de lutte [12]. Les données collectées alimentent le système national de surveillance épidémiologique.
Les autorités européennes coordonnent leurs actions à travers l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) et l'OIE (Organisation mondiale de la santé animale). Cette coopération internationale est essentielle pour gérer une maladie qui ne connaît pas les frontières [2].
En 2025, les autorités françaises ont renforcé leur dispositif de surveillance, particulièrement dans les zones frontalières . Cette vigilance accrue vise à détecter précocement l'introduction de nouveaux sérotypes et à limiter leur propagation sur le territoire national.
Ressources et Associations de Patients
Bien que la fièvre catarrhale du mouton soit une maladie animale, de nombreuses ressources existent pour accompagner les éleveurs confrontés à cette pathologie. Les Groupements de Défense Sanitaire (GDS) constituent le premier niveau de soutien technique et administratif [7].
Les GDS régionaux proposent des formations, des conseils personnalisés et un accompagnement dans la mise en place des mesures préventives. Ils organisent également des réunions d'information et facilitent les échanges d'expériences entre éleveurs [7]. Leur expertise locale est particulièrement précieuse pour adapter les recommandations aux spécificités régionales.
Les chambres d'agriculture offrent un soutien technique et économique aux exploitations touchées. Elles peuvent aider à évaluer l'impact financier de la maladie et orienter vers les dispositifs d'aide existants [10]. Leurs conseillers spécialisés en santé animale constituent une ressource précieuse.
Au niveau national, la Fédération Nationale des GDS coordonne les actions et diffuse l'information sanitaire. Elle maintient des liens étroits avec les autorités sanitaires et participe à l'élaboration des stratégies de lutte [7].
Les réseaux professionnels et les syndicats d'éleveurs proposent également un soutien moral et pratique. Ces structures comprennent les difficultés spécifiques liées à cette maladie et peuvent orienter vers des solutions adaptées. L'entraide entre éleveurs reste souvent la ressource la plus précieuse dans les moments difficiles.
Nos Conseils Pratiques
Face à la fièvre catarrhale du mouton, l'anticipation reste votre meilleure alliée. Établissez un calendrier de vaccination adapté à votre région et respectez-le scrupuleusement. N'attendez pas l'apparition des premiers cas pour agir [10].
Investissez dans l'aménagement de vos bâtiments. L'installation de ventilateurs, même simples, peut considérablement réduire la présence des culicoïdes. Ces insectes détestent les courants d'air et évitent les zones ventilées [6]. Pensez également à éliminer tous les points d'eau stagnante autour de vos installations.
Développez une routine de surveillance quotidienne de vos animaux. Apprenez à reconnaître les premiers signes de la maladie : abattement, fièvre, œdème facial. Plus la détection est précoce, meilleures sont les chances de limiter la propagation [10].
Maintenez un contact étroit avec votre vétérinaire, particulièrement pendant la saison à risque. N'hésitez pas à le solliciter dès les premiers doutes. Un diagnostic précoce peut faire la différence entre une épizootie limitée et une catastrophe sanitaire.
Documentez tout ce qui se passe dans votre élevage. Tenez un registre des vaccinations, des traitements et des observations cliniques. Ces informations seront précieuses pour votre vétérinaire et pour les autorités sanitaires [12]. Elles vous aideront également à améliorer vos pratiques pour l'avenir.
Quand Consulter un Médecin ?
Concernant la fièvre catarrhale du mouton, il est important de rappeler que cette maladie ne se transmet pas à l'homme. Vous n'avez donc pas à craindre de contamination directe par contact avec vos animaux malades [11].
Cependant, si vous êtes éleveur ou vétérinaire et que vous présentez des symptômes inhabituels après manipulation d'animaux suspects, une consultation médicale peut être rassurante. Bien que la transmission inter-espèces soit exclue, d'autres pathologies peuvent parfois être confondues [11].
Les professionnels de la santé doivent être informés de votre activité professionnelle lors de toute consultation. Cette information permet d'orienter le diagnostic vers d'autres zoonoses potentielles qui, elles, peuvent affecter l'homme [9].
En cas de piqûres multiples de culicoïdes, surveillez l'apparition de réactions allergiques locales. Ces insectes peuvent provoquer des démangeaisons importantes et des réactions cutanées chez certaines personnes sensibles. Un traitement symptomatique peut alors être nécessaire.
Rassurez-vous, la fièvre catarrhale du mouton ne constitue pas un risque pour la santé humaine. Votre préoccupation principale doit rester la santé de vos animaux et la consultation vétérinaire en cas de suspicion [11]. Concentrez vos efforts sur la prévention et la surveillance de votre troupeau.
Questions Fréquentes
La fièvre catarrhale peut-elle se transmettre à l'homme ?
Non, cette maladie est strictement animale et ne se transmet pas à l'homme. Vous pouvez manipuler vos animaux malades généralement bien toléré de contamination.
Combien de temps dure l'immunité après vaccination ?
L'immunité vaccinale dure généralement 12 mois, nécessitant un rappel annuel. L'immunité naturelle après infection est plus durable mais spécifique au sérotype concerné.
Peut-on consommer la viande d'animaux guéris ?
Oui, la consommation de viande d'animaux guéris ne présente aucun risque pour la santé humaine. Le virus ne survit pas dans la viande.
Les culicoïdes sont-ils actifs toute l'année ?
Non, leur activité est saisonnière, principalement de mai à octobre en France. Ils sont plus actifs au crépuscule et la nuit.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] SIMV | 🇫🇷🐑 Fièvre catarrhale ovine #FCO au 15 mai 2025Lien
- [2] Boehringer Ingelheim traite davantage de patients en 2024Lien
- [3] RÉPONSES des ministres aux questions écritesLien
- [4] Latest bluetongue announcementLien
- [5] First Detection of Bluetongue Virus Type 3 in PolandLien
- [6] Actualités sur deux maladies virales vectorielles zoonotiques en EuropeLien
- [7] Rôle des protéines NS4 et NS5 du virus de la fièvre catarrhale ovineLien
- [8] Étude de la biodiversité des Culicoides responsable de la fièvre catarrhaleLien
- [9] FCO La Fièvre Catarrhale OvineLien
- [10] Hypothèse sur la réémergence du virus BTV-8 en 2015Lien
- [13] Maladies infectieuses chez l'animal: l'importance du diagnosticLien
- [14] FCO : Maladie, symptômes, conséquences et traitementsLien
- [15] La fièvre catarrhale ovine (FCO), ou Bluetongue en 5 questionsLien
- [16] Description de la fièvre catarrhale ovine (FCO)Lien
Publications scientifiques
- Actualités sur deux maladies virales vectorielles zoonotiques en Europe: West Nile et Usutu-Réémergence du sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) (2023)1 citations[PDF]
- Rôle des protéines NS4 et NS5 du virus de la fièvre catarrhale ovine dans les mécanismes de pathogenèse et de transmission interspécifique (2022)
- … A L'ETUDE DE LA BIODIVERSITE DES CULICOIDES (DIPTERA, CERATOPOGONIDAE) RESPONSABLE DE LA FIEVRE CATARRHALE DANS LA REGION DE … (2022)[PDF]
- [PDF][PDF] RURALE [PDF]
- HYPOTHÈSE SUR LA RÉÉMERGENCE DU VIRUS BTV-8 EN 2015, EN FRANCE. (2022)
Ressources web
- FCO : Maladie, symptômes, conséquences et traitements (frgdsaura.fr)
13 mai 2025 — La FCO - les symptômes. La Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) est une maladie virale, non contagieuse (contamination possible par les aiguilles), ...
- La fièvre catarrhale ovine (FCO), ou Bluetongue en 5 ... (anses.fr)
Les symptômes sont : fièvre, troubles respiratoires, salivations, œdème de la face, cyanose de la langue. La maladie peut aussi être asymptomatique ...
- Description de la la fièvre catarrhale ovine (FCO) (agriculture.gouv.fr)
29 nov. 2011 — Cette maladie ne touche que les ruminants et se manifeste chez les ovins principalement par différents symptômes : fièvre, boiteries, œdèmes, ...
- Fièvre catarrhale du mouton ou maladie de la langue bleue (woah.org)
La fièvre catarrhale du mouton ou maladie de la langue bleue est une maladie virale non contagieuse qui touche les ruminants domestiques et sauvages ...
- La Fièvre Catarrhale Ovine (www2.zoetis.fr)
Les signes cliniques peuvent comprendre des écoulements nasaux et oculaires, une hypersalivation et des lésions de la mamelle et des trayons, des boiterie, des ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
