Fièvre à virus West Nile : Symptômes, Traitement et Prévention 2025
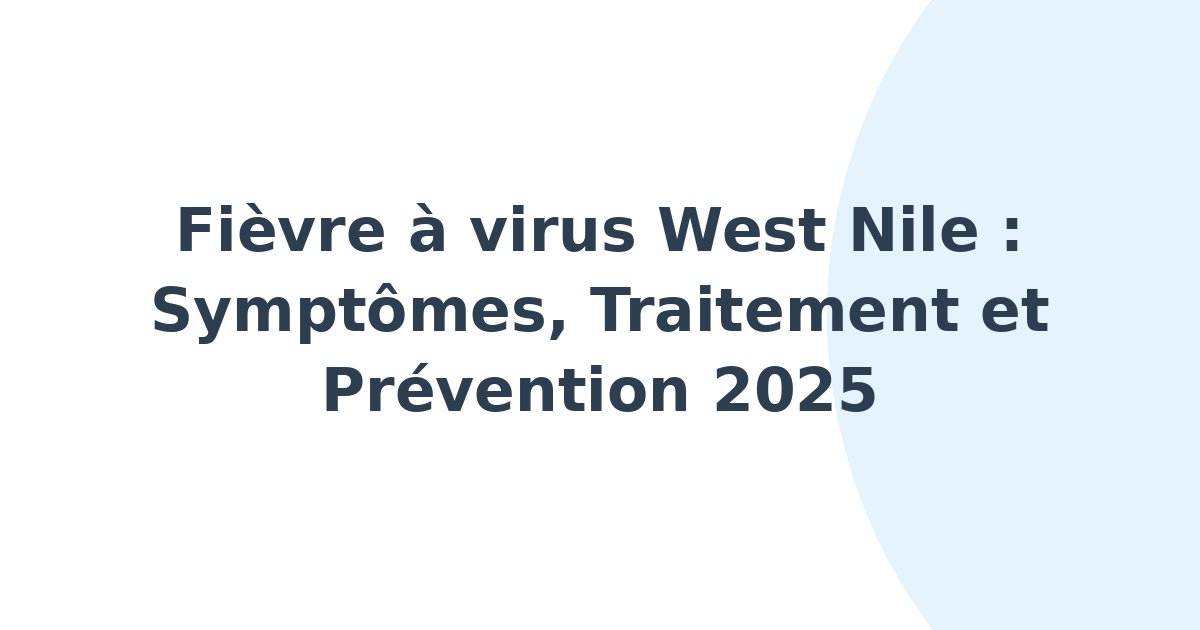
La fièvre à virus West Nile est une maladie vectorielle transmise par les moustiques qui préoccupe de plus en plus les autorités sanitaires françaises. En 2024, Santé Publique France a recensé une augmentation significative des cas autochtones, particulièrement dans le sud de la France [1,6]. Cette pathologie, longtemps considérée comme exotique, s'implante progressivement sur notre territoire. Comprendre ses symptômes, son évolution et les moyens de s'en protéger devient essentiel pour tous.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Fièvre à virus West Nile : Définition et Vue d'Ensemble
Le virus West Nile appartient à la famille des flavivirus, comme ceux de la dengue ou de la fièvre jaune. Découvert en 1937 en Ouganda, il tire son nom de la région du Nil occidental où il fut identifié pour la première fois [17]. Mais ne vous y trompez pas : ce virus a largement dépassé ses frontières d'origine.
Concrètement, cette pathologie se transmet principalement par la piqûre de moustiques infectés, notamment du genre Culex. Les oiseaux constituent le réservoir naturel du virus, créant un cycle de transmission complexe entre oiseaux et moustiques [4,5]. L'homme et les mammifères sont des hôtes « accidentels » qui ne participent généralement pas à la propagation du virus.
D'ailleurs, il faut savoir que la plupart des personnes infectées - environ 80% - ne développent aucun symptôme [18]. Cependant, quand la maladie se manifeste, elle peut prendre différentes formes, allant d'un syndrome grippal bénin à des complications neurologiques graves. Cette variabilité clinique rend parfois le diagnostic délicat.
Épidémiologie en France et dans le Monde
La situation épidémiologique du virus West Nile en France a considérablement évolué ces dernières années. Selon les données de Santé Publique France, l'année 2024 marque un tournant avec l'identification de plusieurs cas autochtones dans le Var, confirmant l'implantation du virus sur le territoire métropolitain [1,6].
En Europe, le bilan de la saison 2022 révèle une circulation active du virus dans plusieurs pays méditerranéens [11]. La France n'était alors touchée que sporadiquement, mais les données 2024 montrent une évolution préoccupante. Les régions PACA et Occitanie concentrent actuellement la majorité des cas détectés [6].
À l'échelle mondiale, les États-Unis restent le pays le plus touché avec plusieurs milliers de cas annuels. Mais l'Europe connaît une expansion géographique constante du virus, favorisée par le réchauffement climatique et l'extension de l'aire de répartition des moustiques vecteurs [7,8]. La Turquie, par exemple, fait face à une émergence récente d'infections à virus West Nile [8].
Concernant les données démographiques, les personnes âgées de plus de 50 ans présentent un risque accru de développer des formes neurologiques graves [12,14]. Cette vulnérabilité liée à l'âge s'explique par des modifications du système immunitaire et une plus grande susceptibilité aux complications [15,16].
Les Causes et Facteurs de Risque
La transmission du virus West Nile suit un schéma bien précis. Les moustiques du genre Culex s'infectent en piquant des oiseaux porteurs du virus. Ces moustiques deviennent alors capables de transmettre l'infection à d'autres oiseaux, mais aussi accidentellement à l'homme [4,5].
Plusieurs facteurs augmentent votre risque d'exposition. L'activité en extérieur pendant les heures de forte activité des moustiques - principalement au crépuscule et à l'aube - constitue le principal facteur de risque. Les zones humides, les jardins avec points d'eau stagnante et les régions où circule le virus représentent des environnements à risque [5].
Mais attention, certaines personnes présentent une vulnérabilité particulière. L'âge avancé, l'immunodépression, les maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension augmentent le risque de complications [12,16]. D'ailleurs, des recherches récentes suggèrent qu'une auto-immunité dirigée contre les interférons de type I pourrait expliquer certaines formes graves [16].
Il est important de noter que la transmission interhumaine reste exceptionnelle. Cependant, des cas de transmission par transfusion sanguine, transplantation d'organes ou allaitement maternel ont été rapportés, justifiant les mesures de précaution dans ces domaines [2,3,13].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les symptômes de la fièvre West Nile n'est pas toujours évident. En effet, comme mentionné précédemment, 80% des infections passent inaperçues [18]. Quand des symptômes apparaissent, ils surviennent généralement 2 à 14 jours après la piqûre infectante.
La forme la plus courante ressemble à un syndrome grippal. Vous pourriez ressentir une fièvre soudaine, des maux de tête intenses, des douleurs musculaires et articulaires. Souvent s'ajoutent une fatigue marquée, des nausées et parfois une éruption cutanée sur le tronc [17,18]. Ces symptômes durent habituellement 3 à 6 jours chez les personnes en bonne santé.
Cependant, environ 1% des patients développent des complications neurologiques graves. Les manifestations peuvent inclure une méningite, une encéphalite ou une paralysie flasque aiguë [12,14]. Les signes d'alarme comprennent des troubles de la conscience, une raideur de nuque, des convulsions ou une faiblesse musculaire brutale [15].
Chez les personnes âgées, les symptômes neurologiques peuvent être plus subtils. Une confusion, des troubles de l'équilibre ou des modifications du comportement doivent alerter [15]. Il faut savoir que ces formes graves nécessitent une prise en charge hospitalière immédiate.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'infection à virus West Nile repose sur plusieurs étapes complémentaires. Votre médecin commencera par un interrogatoire détaillé, recherchant notamment vos activités récentes en extérieur et vos voyages éventuels dans des zones à risque [14].
L'examen clinique permet d'évaluer vos symptômes et de rechercher des signes neurologiques. Mais le diagnostic de certitude nécessite des analyses biologiques spécialisées. Les tests sérologiques recherchent des anticorps spécifiques contre le virus, tandis que la PCR peut détecter directement l'ARN viral dans le sang ou le liquide céphalorachidien [14,18].
En cas de suspicion de complications neurologiques, des examens complémentaires s'imposent. La ponction lombaire permet d'analyser le liquide céphalorachidien, révélant souvent une pléocytose lymphocytaire. L'IRM cérébrale peut montrer des lésions caractéristiques, particulièrement au niveau du tronc cérébral et des noyaux gris centraux [12,15].
Il faut noter que le diagnostic différentiel est parfois complexe. D'autres arboviroses comme la dengue, le chikungunya ou le virus Zika peuvent présenter des symptômes similaires [10]. C'est pourquoi les laboratoires utilisent souvent des panels de détection multi-pathogènes pour éviter les erreurs diagnostiques.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Actuellement, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre le virus West Nile. La prise en charge repose donc sur un traitement symptomatique adapté à chaque patient [17,18]. Cette réalité peut sembler frustrante, mais rassurez-vous : la majorité des patients guérissent spontanément sans séquelles.
Pour les formes bénignes, le traitement comprend du repos, une hydratation suffisante et des antalgiques pour soulager la fièvre et les douleurs. Le paracétamol est généralement privilégié, tandis que l'aspirine est évitée en raison du risque hémorragique [17]. Votre médecin pourra également prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens si nécessaire.
Les formes neurologiques graves nécessitent une hospitalisation en service spécialisé. La prise en charge inclut alors une surveillance neurologique rapprochée, un traitement de l'œdème cérébral si présent, et la prévention des complications [12,15]. Dans certains cas sévères, des corticoïdes ou des immunoglobulines intraveineuses peuvent être utilisés, bien que leur efficacité reste débattue.
La rééducation joue un rôle crucial pour les patients ayant développé des séquelles neurologiques. Kinésithérapie, orthophonie et ergothérapie peuvent être nécessaires selon les déficits observés. L'important est de commencer cette rééducation précocement pour optimiser la récupération fonctionnelle.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur le virus West Nile connaît des avancées prometteuses en 2024-2025. Plusieurs pistes thérapeutiques innovantes sont actuellement à l'étude, offrant de nouveaux espoirs pour les patients [7]. Les chercheurs explorent notamment des antiviraux à large spectre qui pourraient être efficaces contre plusieurs flavivirus.
Une découverte majeure concerne le rôle de l'auto-immunité dans les formes graves. Des études récentes montrent que certains patients développent des anticorps dirigés contre leurs propres interférons de type I, compromettant leur réponse immunitaire antivirale [16]. Cette découverte ouvre la voie à des traitements immunomodulateurs ciblés.
Du côté de la prévention, les recherches vaccinales progressent. Plusieurs candidats vaccins sont en développement, utilisant différentes approches : vaccins à ARN messager, vaccins vectorisés ou vaccins à sous-unités protéiques [7]. Bien qu'aucun ne soit encore disponible pour l'homme, les résultats précliniques sont encourageants.
Les autorités sanitaires françaises renforcent également leur dispositif de surveillance. Le ministère de la Santé a mis en place un plan de lutte contre les maladies vectorielles qui inclut une surveillance renforcée du virus West Nile [4,5]. Cette approche intégrée associe surveillance entomologique, aviaire et humaine pour une détection précoce des foyers de circulation virale.
Vivre au Quotidien avec Fièvre à virus West Nile
Vivre avec les séquelles d'une infection à virus West Nile peut représenter un défi quotidien pour certains patients. Heureusement, la majorité des personnes récupèrent complètement sans complications durables [17]. Cependant, environ 10% des patients ayant développé une forme neurologique conservent des séquelles à long terme.
Ces séquelles peuvent inclure une fatigue persistante, des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration ou des faiblesses musculaires résiduelles [12,15]. Il est important de comprendre que ces symptômes ne sont pas « dans votre tête » - ils correspondent à des lésions neurologiques réelles qui nécessitent du temps pour guérir.
L'adaptation du mode de vie devient alors essentielle. Planifier vos activités en fonction de votre niveau d'énergie, prendre des pauses régulières et maintenir un sommeil de qualité constituent des stratégies importantes. Certains patients trouvent bénéfique de tenir un journal de leurs symptômes pour identifier les facteurs déclenchants ou aggravants.
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Faire face à une maladie neurologique peut générer de l'anxiété ou des épisodes dépressifs. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou à consulter un psychologue spécialisé. Des groupes de soutien, bien que rares pour cette pathologie spécifique, peuvent également apporter une aide précieuse.
Les Complications Possibles
Les complications neurologiques représentent l'aspect le plus préoccupant de l'infection à virus West Nile. Bien qu'elles ne touchent qu'environ 1% des patients infectés, leur gravité potentielle justifie une vigilance particulière [12,18]. Ces complications peuvent survenir chez n'importe qui, mais les personnes âgées et immunodéprimées présentent un risque accru.
La méningite constitue la forme la plus fréquente des complications neurologiques. Elle se manifeste par des maux de tête intenses, une raideur de nuque et une photophobie. Heureusement, cette forme évolue généralement favorablement avec un traitement symptomatique approprié [14,15].
L'encéphalite représente une complication plus sévère, caractérisée par une inflammation du tissu cérébral. Les patients peuvent présenter des troubles de la conscience, des convulsions, des déficits neurologiques focaux ou des troubles du comportement [12,15]. Cette forme nécessite une prise en charge en réanimation et peut laisser des séquelles permanentes.
La paralysie flasque aiguë constitue la complication la plus redoutable. Elle ressemble cliniquement à la poliomyélite, avec une faiblesse musculaire brutale pouvant affecter les membres ou les muscles respiratoires [15]. Cette complication, bien que rare, peut entraîner des handicaps permanents et nécessite parfois une assistance respiratoire.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'infection à virus West Nile varie considérablement selon la forme clinique développée. Pour la grande majorité des patients - ceux qui développent une forme fébrile simple - la guérison est complète et survient en quelques jours à quelques semaines [17,18]. Ces personnes ne gardent généralement aucune séquelle et peuvent reprendre leurs activités normales.
Pour les patients ayant développé une méningite, le pronostic reste généralement favorable. La plupart récupèrent complètement, bien que certains puissent conserver des maux de tête persistants ou une fatigue prolongée pendant plusieurs mois [14,15]. Il est important de savoir que ces symptômes résiduels s'améliorent progressivement avec le temps.
Le pronostic des encéphalites est plus réservé. Environ 10 à 15% des patients gardent des séquelles neurologiques permanentes, incluant des troubles cognitifs, des déficits moteurs ou des troubles de l'humeur [12,15]. L'âge avancé et la sévérité initiale des symptômes constituent les principaux facteurs pronostiques défavorables.
Concernant la mortalité, elle reste heureusement faible dans l'ensemble. Le taux de décès est inférieur à 1% pour l'ensemble des infections symptomatiques, mais peut atteindre 10% chez les patients développant une encéphalite sévère, particulièrement chez les personnes âgées [18]. Ces chiffres soulignent l'importance d'une prise en charge précoce et adaptée.
Peut-on Prévenir Fièvre à virus West Nile ?
La prévention de l'infection à virus West Nile repose essentiellement sur la protection contre les piqûres de moustiques. Cette approche, bien que simple en théorie, nécessite une vigilance constante, particulièrement dans les zones où circule le virus [4,5]. Les mesures préventives doivent être adaptées selon votre lieu de résidence et vos activités.
L'utilisation de répulsifs cutanés constitue la première ligne de défense. Choisissez des produits contenant du DEET, de l'icaridine ou de l'IR3535, en respectant les concentrations recommandées selon votre âge. Appliquez le répulsif sur toutes les zones de peau exposées, en renouvelant l'application selon les indications du fabricant [5].
Les mesures vestimentaires jouent également un rôle important. Portez des vêtements longs, de couleur claire et de préférence imprégnés d'insecticide lors d'activités en extérieur. Les chaussures fermées et les chaussettes hautes offrent une protection supplémentaire. Ces précautions sont particulièrement importantes au crépuscule et à l'aube, moments de forte activité des moustiques Culex.
La lutte contre les gîtes larvaires autour de votre domicile représente une stratégie complémentaire essentielle. Éliminez toutes les collections d'eau stagnante : soucoupes de pots de fleurs, gouttières obstruées, récipients abandonnés. Changez régulièrement l'eau des vases et des abreuvoirs pour animaux. Cette démarche collective, si elle est adoptée par tous, peut considérablement réduire la population de moustiques dans votre quartier [5].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont renforcé leur dispositif de surveillance et de prévention face à l'émergence du virus West Nile sur le territoire métropolitain. Le ministère de la Santé a élaboré un plan national de lutte contre les maladies vectorielles qui inclut spécifiquement cette pathologie [4,5].
Santé Publique France coordonne la surveillance épidémiologique à travers un réseau intégré associant surveillance humaine, aviaire et entomologique. Cette approche « One Health » permet une détection précoce de la circulation virale et une réponse rapide en cas d'émergence de foyers [1,6]. Les professionnels de santé sont invités à signaler tout cas suspect, particulièrement dans les régions à risque.
Concernant la sécurité transfusionnelle, l'Établissement français du sang a mis en place des mesures spécifiques. Un dépistage systématique est réalisé sur les dons de sang dans les zones où circule le virus, et des questionnaires renforcés permettent d'identifier les donneurs à risque [2,3]. Ces mesures visent à prévenir toute transmission par voie transfusionnelle.
L'Agence régionale de santé PACA a émis des recommandations spécifiques suite à la détection de cas autochtones dans le Var. Ces recommandations incluent une sensibilisation renforcée des professionnels de santé, une information du public sur les mesures de protection individuelle, et un renforcement de la lutte antivectorielle dans les communes concernées [6].
Ressources et Associations de Patients
Bien que l'infection à virus West Nile soit encore relativement rare en France, plusieurs ressources peuvent vous accompagner si vous êtes concerné par cette pathologie. Les associations généralistes de patients atteints de maladies neurologiques peuvent offrir un soutien précieux, même si elles ne sont pas spécifiquement dédiées au virus West Nile.
L'Institut Pasteur propose des informations détaillées et régulièrement mises à jour sur cette maladie [17]. Leur site web constitue une source fiable pour comprendre les mécanismes de transmission, les symptômes et les mesures de prévention. Ces informations sont rédigées dans un langage accessible tout en conservant leur rigueur scientifique.
Pour les aspects neurologiques, la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau peut vous orienter vers des spécialistes et des centres de référence. Bien qu'elle ne traite pas spécifiquement du virus West Nile, elle dispose d'un réseau de neurologues expérimentés dans la prise en charge des encéphalites virales.
N'oubliez pas que votre médecin traitant reste votre interlocuteur privilégié. Il peut vous mettre en relation avec des spécialistes, vous orienter vers des services de rééducation si nécessaire, et coordonner votre prise en charge. En cas de séquelles importantes, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) peuvent vous accompagner dans vos démarches administratives et l'accès aux aides disponibles.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour vous protéger efficacement contre le virus West Nile. Premièrement, adoptez une routine de protection systématique dès que vous sortez en extérieur, particulièrement entre mai et octobre quand les moustiques sont les plus actifs. Cette habitude doit devenir aussi naturelle que de mettre sa ceinture de sécurité en voiture.
Organisez votre domicile en « zone protégée ». Installez des moustiquaires aux fenêtres et portes, utilisez des ventilateurs (les moustiques volent mal dans les courants d'air), et éliminez méthodiquement tous les points d'eau stagnante chaque semaine. Pensez aux endroits moins évidents : bâches de piscine, jouets d'enfants oubliés dehors, coupelles sous les pots de fleurs.
Si vous jardinez ou pratiquez des activités de plein air, planifiez-les en évitant les heures de forte activité des moustiques. Tôt le matin ou en fin d'après-midi constituent les créneaux les plus sûrs. Gardez toujours un répulsif dans votre sac ou votre voiture pour les sorties imprévues.
En cas de symptômes évocateurs après une exposition possible, ne temporisez pas. Consultez rapidement votre médecin en mentionnant vos activités récentes en extérieur et votre lieu de résidence. Un diagnostic précoce, même s'il n'existe pas de traitement spécifique, permet une surveillance adaptée et une prise en charge optimale des complications éventuelles.
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter peut faire la différence dans la prise en charge de l'infection à virus West Nile. Consultez votre médecin dans les 48 heures si vous développez une fièvre élevée accompagnée de maux de tête intenses, particulièrement si vous avez été exposé aux moustiques dans une zone où circule le virus [14].
Certains signes nécessitent une consultation en urgence. Rendez-vous immédiatement aux urgences si vous présentez des troubles de la conscience, une confusion mentale, une raideur de nuque, des convulsions ou une faiblesse musculaire brutale [12,15]. Ces symptômes peuvent indiquer une complication neurologique grave nécessitant une prise en charge hospitalière immédiate.
Pour les personnes à risque - plus de 50 ans, immunodéprimées ou souffrant de maladies chroniques - la vigilance doit être renforcée. N'hésitez pas à consulter même pour des symptômes apparemment bénins si vous avez été exposé aux moustiques. Votre médecin pourra évaluer la nécessité d'examens complémentaires [16].
Après une infection confirmée, un suivi médical régulier est recommandé, particulièrement si vous avez développé des complications neurologiques. Signalez à votre médecin tout symptôme persistant ou toute dégradation de votre état : fatigue anormale, troubles de la mémoire, difficultés de concentration ou faiblesse musculaire. Ces éléments peuvent nécessiter une réévaluation de votre prise en charge.
Questions Fréquentes
Le virus West Nile peut-il se transmettre d'une personne à l'autre ?Non, la transmission interhumaine directe n'existe pas. Le virus se transmet uniquement par piqûre de moustiques infectés. Cependant, des cas exceptionnels de transmission par transfusion sanguine, transplantation d'organes ou allaitement maternel ont été rapportés [2,3,13].
Existe-t-il un vaccin contre le virus West Nile ?
Actuellement, aucun vaccin n'est disponible pour l'homme. Plusieurs candidats vaccins sont en développement, mais ils ne sont pas encore commercialisés [7]. La prévention repose donc uniquement sur la protection contre les piqûres de moustiques.
Peut-on attraper le virus West Nile plusieurs fois ?
L'infection confère généralement une immunité durable. Les réinfections sont exceptionnelles et concernent principalement des personnes immunodéprimées [18]. Si vous avez déjà été infecté, votre risque de nouvelle infection est donc très faible.
Les animaux domestiques peuvent-ils transmettre le virus ?
Non, les chiens et chats ne transmettent pas le virus à l'homme. Ils peuvent être infectés mais ne participent pas au cycle de transmission. Seuls les moustiques peuvent vous transmettre l'infection [4,5].
Combien de temps dure l'immunité après une infection ?
L'immunité semble durable, probablement à vie pour la plupart des personnes. Les anticorps protecteurs persistent plusieurs années après l'infection [18]. Cependant, des études à long terme sont encore nécessaires pour confirmer cette durée d'immunité.
Questions Fréquentes
Le virus West Nile peut-il se transmettre d'une personne à l'autre ?
Non, la transmission interhumaine directe n'existe pas. Le virus se transmet uniquement par piqûre de moustiques infectés. Cependant, des cas exceptionnels de transmission par transfusion sanguine, transplantation d'organes ou allaitement maternel ont été rapportés.
Existe-t-il un vaccin contre le virus West Nile ?
Actuellement, aucun vaccin n'est disponible pour l'homme. Plusieurs candidats vaccins sont en développement, mais ils ne sont pas encore commercialisés. La prévention repose donc uniquement sur la protection contre les piqûres de moustiques.
Peut-on attraper le virus West Nile plusieurs fois ?
L'infection confère généralement une immunité durable. Les réinfections sont exceptionnelles et concernent principalement des personnes immunodéprimées. Si vous avez déjà été infecté, votre risque de nouvelle infection est donc très faible.
Les animaux domestiques peuvent-ils transmettre le virus ?
Non, les chiens et chats ne transmettent pas le virus à l'homme. Ils peuvent être infectés mais ne participent pas au cycle de transmission. Seuls les moustiques peuvent vous transmettre l'infection.
Combien de temps dure l'immunité après une infection ?
L'immunité semble durable, probablement à vie pour la plupart des personnes. Les anticorps protecteurs persistent plusieurs années après l'infection. Cependant, des études à long terme sont encore nécessaires pour confirmer cette durée d'immunité.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] RENCONTRES DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Don de sang et risque de transmission d'agents. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Don de sang. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [4] Fièvre du Nil occidental ou infection par le virus West Nile. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Moustiques vecteurs de maladies - Ministère de la Santé. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Cas autochtones d'infection à virus West Nile dans le Var. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] West Nile virus - a re-emerging global threat. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Emerging West Nile virus infections in Türkiye. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [11] Bilan de la saison 2022 de fièvre West Nile en Europe.Lien
- [12] Manifestations neurologiques de l'infection par le Virus West Nile. 2025.Lien
- [13] Transmission des arbovirus par allaitement: le virus Zika et le virus de la fièvre jaune. 2022.Lien
- [14] Manifestations cliniques et problèmes diagnostiques d'une infection à West Nile virus. 2025.Lien
- [15] Rhombencéphalite du sujet âgé au virus West Nile: à propos d'un cas et revue de la littérature. 2023.Lien
- [16] Formes graves de maladie à virus West-Nile: Le rôle de l'auto-immunité anti-IFN de type I. 2025.Lien
- [17] West Nile : symptômes, traitement, prévention. Institut Pasteur.Lien
- [18] Virus West Nile (virus du Nil occidental). MSD Manuals.Lien
Publications scientifiques
- Actualités sur deux maladies virales vectorielles zoonotiques en Europe: West Nile et Usutu-Réémergence du sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) (2023)1 citations[PDF]
- [PDF][PDF] Investigation et riposte face à un cas de fièvre hémorragique virale positif aux immunoglobulines des virus Zika, West Nile, fièvre jaune et dengue dans le … (2023)
- [PDF][PDF] Bilan de la saison 2022 de fièvre West Nile en Europe [PDF]
- Manifestations neurologiques de l'infection par le Virus West Nile (2025)
- Transmission des arbovirus par allaitement: le virus Zika et le virus de la fièvre jaune (2022)
Ressources web
- West Nile : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
Il entraîne une fièvre brutale, parfois associée à des complications neurologiques qui peuvent être sévères chez de nombreuses espèces animales.
- Virus West Nile (virus du Nil occidental) (msdmanuals.com)
La plupart des sujets qui ont une fièvre et des myalgies typiques guérissent complètement, mais la fatigue et la faiblesse peuvent durer des semaines ou des ...
- Fièvre du Nil occidental ou infection par le virus West Nile (sante.gouv.fr)
9 août 2024 — La période d'incubation dure classiquement de 2 à 6 jours mais peut se prolonger jusqu'à 14 jours. L'infection passe la plupart du temps. Dans ...
- Virus du Nil Occidental (santepubliquefrance.fr)
de ENS PLUS — Le Virus du Nil Occidental (ou West Nile Virus) est un arbovirus ... Les symptômes les plus fréquents sont une fièvre et des douleurs articulaires.
- Fièvre ou Virus du Nil Occidental : symptômes & prévention (elsan.care)
Comment diagnostique-t-on cette infection au VNO ? Par des tests sanguins spécifiques, qui détectent la présence d'anticorps contre le virus. La détection des ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
