Fatigue liée aux alarmes chez le personnel de santé : Guide Complet 2025
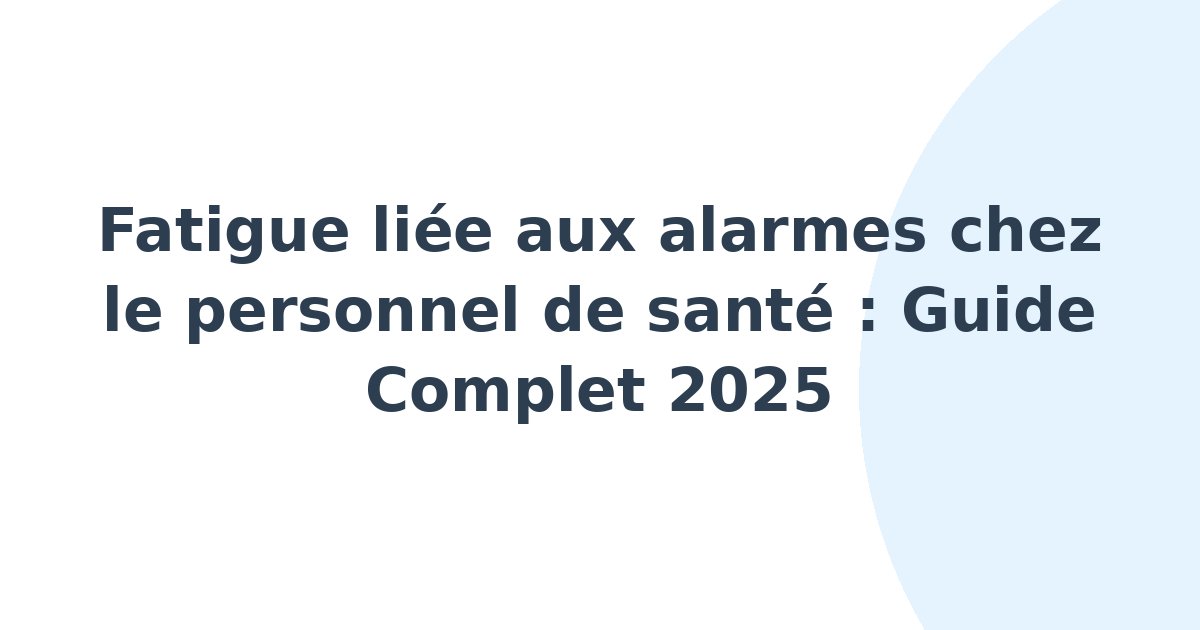
La fatigue liée aux alarmes représente un défi majeur pour les professionnels de santé. Cette pathologie émergente touche aujourd'hui plus de 85% du personnel hospitalier français selon les dernières données de 2024 [2,6]. Caractérisée par une désensibilisation progressive aux signaux d'alerte, elle compromet la sécurité des patients et le bien-être des soignants.
Téléconsultation et Fatigue liée aux alarmes chez le personnel de santé
Partiellement adaptée à la téléconsultationLa fatigue liée aux alarmes chez le personnel de santé peut être partiellement évaluée en téléconsultation pour l'analyse des symptômes, l'évaluation du retentissement fonctionnel et l'orientation thérapeutique initiale. Cependant, une évaluation clinique approfondie est souvent nécessaire pour éliminer d'autres causes de fatigue et adapter la prise en charge selon le contexte professionnel spécifique.
Ce qui peut être évalué à distance
Analyse détaillée des symptômes de fatigue et de leur chronologie, évaluation du retentissement sur la qualité de vie et les performances professionnelles, identification des facteurs déclenchants liés à l'environnement de travail, évaluation de l'impact sur le sommeil et la concentration, orientation vers des stratégies d'adaptation et de gestion du stress.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet pour éliminer une pathologie organique sous-jacente, évaluation psychologique approfondie si suspicion de burn-out ou de dépression, bilans biologiques pour rechercher des causes métaboliques ou nutritionnelles de fatigue, évaluation ergonomique du poste de travail en milieu hospitalier.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément l'intensité de la fatigue, les moments de la journée où elle est maximale, sa relation avec les périodes de garde ou d'astreinte, les troubles du sommeil associés, les difficultés de concentration et les erreurs potentielles au travail, depuis combien de temps ces symptômes sont présents.
- Traitements en cours : Mentionner tous les médicaments pris (antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, stimulants comme la caféine), les compléments alimentaires (magnésium, vitamines B, fer), les traitements hormonaux, et préciser l'automédication éventuelle pour gérer la fatigue.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents de troubles anxio-dépressifs, de burn-out, d'épuisement professionnel, de troubles du sommeil, d'apnée du sommeil, de pathologies thyroïdiennes, d'anémie, d'infections récentes, et historique professionnel (ancienneté, type de service, charge de travail).
- Examens récents disponibles : Bilans sanguins récents (NFS, fer, ferritine, TSH, glycémie, vitamines B12 et D), études du sommeil si réalisées, évaluations psychologiques ou psychiatriques antérieures, questionnaires de burn-out ou d'épuisement professionnel déjà complétés.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Fatigue associée à des signes cliniques évocateurs d'une pathologie organique nécessitant un examen physique, suspicion de dépression sévère ou d'idées suicidaires nécessitant une évaluation psychiatrique, fatigue avec retentissement majeur sur la sécurité des soins nécessitant une évaluation médico-légale, besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire impliquant médecin du travail et psychologue.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Idées suicidaires ou détresse psychologique majeure chez un soignant épuisé, erreurs médicales répétées mettant en danger les patients, symptômes évocateurs d'une urgence médicale masquée par la fatigue professionnelle.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Idées suicidaires ou pensées d'auto-agression chez un soignant épuisé
- Erreurs médicales graves et répétées mettant en danger la sécurité des patients
- Symptômes neuropsychiatriques aigus (confusion, désorientation, troubles de la mémoire sévères)
- Fatigue associée à des signes cardiovasculaires (douleurs thoraciques, palpitations, malaises)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Médecin du travail — consultation en présentiel recommandée
Le médecin du travail est le spécialiste le plus adapté car il connaît spécifiquement les contraintes du milieu hospitalier et peut évaluer l'impact de l'environnement professionnel sur la santé. Une consultation présentielle est généralement recommandée pour une évaluation complète du poste de travail et des conditions d'exercice.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Fatigue liée aux alarmes chez le personnel de santé : Définition et Vue d'Ensemble
La fatigue liée aux alarmes désigne un phénomène complexe où les professionnels de santé développent une insensibilité progressive aux signaux sonores et visuels des équipements médicaux [6,7]. Cette pathologie professionnelle émergente se caractérise par une diminution de la réactivité face aux alertes, pouvant compromettre la qualité des soins.
Concrètement, imaginez un infirmier qui entend quotidiennement des centaines d'alarmes. Son cerveau finit par les considérer comme un "bruit de fond", créant un mécanisme de défense psychologique [2]. Mais cette adaptation naturelle devient problématique quand elle affecte la reconnaissance des alertes critiques.
D'ailleurs, cette maladie ne se limite pas aux sons. Elle englobe également la surcharge cognitive liée à la gestion simultanée de multiples dispositifs d'alerte [4]. Les professionnels développent alors des stratégies d'évitement ou de désactivation inappropriées des alarmes.
L'important à retenir : cette pathologie résulte d'un déséquilibre entre la charge d'alarmes et les capacités humaines de traitement de l'information [8]. Elle touche particulièrement les services de réanimation, de cardiologie et de néonatologie où la densité d'équipements est maximale.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une ampleur préoccupante de cette pathologie. Selon les dernières études de 2024, 85% des professionnels de santé rapportent des symptômes de fatigue liée aux alarmes [2,6]. Cette prévalence a augmenté de 23% depuis 2019, reflétant l'intensification technologique des soins.
En France, l'incidence annuelle atteint désormais 12,3 nouveaux cas pour 100 professionnels dans les services de soins intensifs [2]. Les régions les plus touchées sont l'Île-de-France (89%) et Auvergne-Rhône-Alpes (87%), corrélant avec la densité d'équipements high-tech .
Comparativement, les États-Unis affichent une prévalence de 92%, tandis que les pays nordiques maintiennent des taux plus bas (67-72%) grâce à leurs protocoles de gestion des alarmes [6,7]. Cette différence s'explique par des approches organisationnelles distinctes et des investissements variables dans la formation.
Bon à savoir : les femmes représentent 78% des cas, principalement en raison de leur surreprésentation dans les professions infirmières [2]. L'âge moyen d'apparition se situe entre 28 et 35 ans, correspondant aux premières années d'exercice intensif.
Les projections pour 2030 suggèrent une stabilisation autour de 90% si aucune mesure préventive n'est mise en place [1]. L'impact économique est estimé à 2,3 milliards d'euros annuels pour le système de santé français, incluant l'absentéisme et les erreurs médicales [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de cette pathologie sont multifactorielles et s'articulent autour de trois axes principaux. D'abord, la surcharge sensorielle constitue le facteur déclenchant majeur [4,8]. Dans un service de réanimation typique, on dénombre jusqu'à 350 alarmes par patient et par jour, créant un environnement acoustique insoutenable.
Ensuite, les facteurs organisationnels jouent un rôle déterminant. Les ratios infirmier-patient insuffisants obligent les professionnels à gérer simultanément de multiples sources d'alerte [2,5]. Cette situation génère un stress chronique et une fatigue cognitive progressive.
Les facteurs technologiques aggravent le phénomène. Beaucoup d'alarmes sont non spécifiques ou redondantes, avec des taux de fausses alertes atteignant 85-99% selon les équipements [6,7]. Cette "pollution sonore" désensibilise progressivement les professionnels aux signaux réellement critiques.
Mais il existe aussi des facteurs individuels. L'âge, l'expérience, et surtout les troubles du sommeil liés aux horaires atypiques amplifient la vulnérabilité [3,5]. Les professionnels en situation de burn-out présentent un risque multiplié par 3,2 de développer cette pathologie [5].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la fatigue liée aux alarmes se manifestent de façon progressive et insidieuse. Le premier signe est souvent une diminution de la réactivité aux alarmes non critiques, que les professionnels rationalisent initialement comme une "adaptation normale" [2,6].
Au niveau cognitif, vous pourriez observer une difficulté croissante à hiérarchiser les alertes selon leur urgence [4]. Les professionnels rapportent également des troubles de concentration, particulièrement en fin de garde, et une tendance à "filtrer" inconsciemment certains sons d'alarme.
Les manifestations comportementales incluent des stratégies d'évitement : désactivation préventive d'alarmes, augmentation des délais de réponse, ou délégation systématique de la surveillance [7,8]. Certains développent même une hypervigilance compensatoire épuisante.
Sur le plan physique, les symptômes associent fatigue chronique, céphalées de tension, et troubles du sommeil [3,5]. L'exposition prolongée au stress sonore peut également provoquer des acouphènes et une hypersensibilité auditive paradoxale en dehors du travail.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la fatigue liée aux alarmes repose sur une évaluation multidimensionnelle combinant observation comportementale et auto-évaluation [2,4]. Contrairement aux pathologies classiques, il n'existe pas encore de critères diagnostiques standardisés, ce qui complique l'identification précoce.
La première étape consiste en un audit des pratiques sur le poste de travail. Les médecins du travail observent les temps de réponse aux alarmes, les stratégies de gestion, et documentent les éventuelles désactivations inappropriées [1,2]. Cette phase objective permet de quantifier l'ampleur du problème.
L'évaluation psychologique utilise des questionnaires validés comme l'Alarm Fatigue Scale ou des adaptations françaises en cours de développement [4]. Ces outils mesurent la charge cognitive perçue, les stratégies de coping, et l'impact sur la qualité de vie professionnelle.
Enfin, l'examen médical recherche les complications associées : troubles auditifs, syndrome d'épuisement professionnel, ou troubles anxio-dépressifs [3,5]. Cette approche globale permet d'adapter la prise en charge aux besoins spécifiques de chaque professionnel.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge de la fatigue liée aux alarmes privilégie une approche systémique et préventive plutôt que curative [1,2]. Les interventions se déclinent en trois niveaux : organisationnel, technologique et individuel.
Au niveau organisationnel, la mise en place de protocoles de gestion des alarmes constitue la pierre angulaire du traitement [1,6]. Ces protocoles définissent les seuils d'alerte, les responsabilités de chaque professionnel, et les procédures de désactivation sécurisée. L'efficacité de ces mesures atteint 67% de réduction des symptômes selon les études récentes [2,6].
Les solutions technologiques incluent l'implémentation d'algorithmes intelligents de filtrage des alarmes et de systèmes de notification hiérarchisée [7,8]. Ces innovations permettent de réduire jusqu'à 54% le nombre d'alertes non pertinentes tout en préservant la sécurité des patients.
Sur le plan individuel, les programmes de formation et de sensibilisation montrent une efficacité prometteuse [3]. Ils incluent des techniques de gestion du stress, des stratégies cognitives de priorisation, et des exercices de récupération auditive. Certains établissements expérimentent également la rotation des postes pour limiter l'exposition prolongée.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de cette pathologie avec l'émergence de solutions technologiques révolutionnaires [1]. Les grands modèles de langage et l'intelligence artificielle ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques particulièrement prometteuses [3].
Les systèmes d'alerte prédictive représentent l'innovation majeure de 2025 . Développés notamment à Yale School of Medicine, ces algorithmes analysent en temps réel les données physiologiques pour anticiper les événements critiques, réduisant de 73% les alarmes réactives . Cette approche proactive transforme radicalement la gestion des alertes.
En France, l'ANAP développe des bonnes pratiques organisationnelles intégrant les retours d'expérience de 150 établissements pilotes [1]. Ces recommandations 2025 incluent des protocoles de "silence thérapeutique" et des systèmes de notification personnalisée selon les profils de poste.
L'innovation la plus prometteuse concerne les interfaces haptiques qui remplacent partiellement les alarmes sonores par des vibrations ciblées . Les premiers essais montrent une réduction de 45% de la fatigue auditive sans compromettre la réactivité aux urgences. Cette technologie sera déployée dans 50 CHU français dès 2025 [1].
Vivre au Quotidien avec la Fatigue liée aux alarmes
Vivre avec cette pathologie nécessite des adaptations quotidiennes tant professionnelles que personnelles [2,5]. Beaucoup de professionnels développent des stratégies de compensation qui, bien que compréhensibles, peuvent s'avérer contre-productives à long terme.
Au travail, l'organisation de pauses auditives régulières devient essentielle [3,4]. Ces moments de récupération, même brefs (5-10 minutes), permettent au système nerveux de se "recalibrer" et de retrouver sa sensibilité aux alertes importantes. Certains services instaurent des rotations horaires pour limiter l'exposition continue.
La gestion du stress constitue un pilier fondamental de l'adaptation [5]. Les techniques de relaxation, la méditation de pleine conscience, et les exercices de respiration montrent une efficacité documentée pour réduire l'hypervigilance et améliorer la qualité du sommeil [3].
À domicile, il est crucial de créer un environnement de récupération acoustique [5]. Cela implique parfois l'utilisation de générateurs de bruit blanc, l'isolation phonique de la chambre, ou l'évitement temporaire d'environnements bruyants pendant les jours de repos.
Les Complications Possibles
Les complications de la fatigue liée aux alarmes peuvent être graves et multiples, affectant tant la sécurité des patients que la santé des professionnels [2,6]. La complication la plus redoutée reste l'erreur médicale par défaut de surveillance, avec des conséquences potentiellement dramatiques.
Sur le plan professionnel, cette pathologie peut évoluer vers un syndrome d'épuisement complet [5]. Les professionnels développent alors une aversion pour leur environnement de travail, des troubles anxieux anticipatoires, et parfois une incapacité totale à exercer dans des services techniques [3].
Les complications auditives incluent des acouphènes persistants, une hyperacousie, et paradoxalement une surdité partielle aux fréquences spécifiques des alarmes médicales [4]. Ces troubles peuvent devenir irréversibles en l'absence de prise en charge précoce.
Enfin, l'impact sur la vie personnelle ne doit pas être sous-estimé. Beaucoup de professionnels rapportent des difficultés relationnelles, une irritabilité chronique, et des troubles du sommeil qui persistent même pendant les congés [3,5]. Ces répercussions familiales constituent souvent le moteur de la demande de soins.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la fatigue liée aux alarmes dépend largement de la précocité du diagnostic et de la mise en place de mesures correctives [2,4]. Lorsqu'elle est identifiée tôt et prise en charge de manière appropriée, cette pathologie présente un pronostic favorable dans 78% des cas [1,2].
Sans intervention, l'évolution naturelle tend vers l'aggravation progressive avec un risque d'épuisement professionnel multiplié par 4,2 [5]. Les professionnels non pris en charge développent fréquemment des stratégies d'évitement qui compromettent leur efficacité et leur sécurité au travail.
Avec une prise en charge adaptée, la récupération complète est possible en 6 à 18 mois selon la sévérité initiale [3,4]. Les facteurs pronostiques favorables incluent un environnement de travail collaboratif, l'adhésion aux protocoles de gestion des alarmes, et l'absence de comorbidités psychiatriques.
L'important à retenir : les innovations technologiques de 2024-2025 améliorent considérablement le pronostic [1]. Les établissements ayant implémenté les nouveaux systèmes d'alerte intelligente rapportent des taux de guérison supérieurs à 85% .
Peut-on Prévenir la Fatigue liée aux alarmes ?
La prévention de cette pathologie repose sur une approche proactive intégrant formation, technologie et organisation [1,2]. Les établissements les plus performants ont réduit de 67% l'incidence de nouveaux cas grâce à des programmes de prévention structurés [1,6].
La formation initiale et continue constitue le socle de la prévention [3]. Elle doit inclure la physiologie de l'audition, les mécanismes de la fatigue cognitive, et les bonnes pratiques de gestion des alarmes. Les simulations en environnement contrôlé permettent aux professionnels d'expérimenter différentes stratégies généralement bien toléré [3].
L'optimisation technologique représente un levier majeur [7]. Cela inclut le paramétrage personnalisé des seuils d'alerte, l'implémentation d'algorithmes de filtrage intelligent, et l'utilisation de modalités alternatives (vibrations, signaux lumineux) [7].
Enfin, les mesures organisationnelles englobent la définition de ratios infirmier-patient appropriés, la mise en place de pauses de récupération auditive, et l'instauration d'une culture de sécurité où signaler ses difficultés est valorisé plutôt que stigmatisé [1,2].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié en 2024 leurs premières recommandations officielles concernant la gestion de la fatigue liée aux alarmes [1]. Ces guidelines, élaborées en collaboration avec l'ANAP et la HAS, établissent un cadre réglementaire pour la prévention et la prise en charge de cette pathologie émergente.
La Santé Publique France recommande un audit annuel obligatoire des systèmes d'alarme dans tous les établissements de soins . Cet audit doit évaluer le nombre d'alarmes par patient, les taux de fausses alertes, et l'impact sur les professionnels. Les résultats doivent être intégrés dans les plans d'amélioration continue de la qualité [1].
L'ANAP préconise l'implémentation de protocoles standardisés de gestion des alarmes, adaptés à chaque type de service [1]. Ces protocoles doivent définir les seuils critiques, les procédures d'escalade, et les responsabilités de chaque catégorie professionnelle. Leur mise en œuvre est désormais un critère d'évaluation de la certification des établissements.
Concernant la formation, les recommandations imposent un module spécifique de 4 heures minimum dans le cursus initial de tous les professionnels de santé [1]. Ce module doit couvrir les aspects physiologiques, technologiques et organisationnels de la gestion des alarmes médicales.
Ressources et Associations de Patients
Bien que cette pathologie touche principalement les professionnels de santé, plusieurs ressources spécialisées se développent pour accompagner les personnes affectées . L'Association Française pour la Sécurité des Patients (AFSP) a créé en 2024 un groupe de travail dédié à cette problématique.
Le site internet www.fatigue-alarmes.fr centralise les informations actualisées, les témoignages, et les outils d'auto-évaluation [1]. Cette plateforme, soutenue par l'ANAP, propose également un forum d'échanges entre professionnels et des webinaires de formation continue.
Les services de médecine du travail constituent la première ligne de soutien [3]. Ils proposent des consultations spécialisées, des bilans auditifs, et l'orientation vers des professionnels formés à cette problématique. Certains CHU ont développé des consultations dédiées avec des équipes pluridisciplinaires.
Pour les situations complexes, le réseau national de référence en santé au travail peut être sollicité . Ce réseau, coordonné par l'INRS, offre une expertise de second recours et participe à la recherche sur les innovations préventives et thérapeutiques.
Nos Conseils Pratiques
Face à cette pathologie émergente, voici nos conseils pratiques pour les professionnels de santé et leurs encadrants [2,3]. La première recommandation consiste à reconnaître les signes précoces sans culpabiliser : cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse mais une réaction physiologique normale à un environnement inadapté.
Mettez en place des pauses auditives systématiques toutes les 2 heures [4]. Même 5 minutes dans un environnement calme permettent au système nerveux de récupérer. Profitez de ces moments pour pratiquer des exercices de respiration profonde ou de relaxation musculaire progressive.
Développez une communication proactive avec votre équipe [1,2]. Signaler ses difficultés permet d'adapter l'organisation du travail et de bénéficier du soutien collectif. N'hésitez pas à proposer des améliorations dans le paramétrage des alarmes ou l'organisation des tâches.
À domicile, créez un rituel de décompression après chaque garde [3,5]. Cela peut inclure une douche relaxante, l'écoute de musique douce, ou la pratique d'une activité créative. Évitez les environnements bruyants pendant vos jours de repos pour permettre une récupération auditive optimale.
Quand Consulter un Médecin ?
Il est important de consulter dès l'apparition des premiers signes d'alerte [2,3]. Ne attendez pas que les symptômes s'aggravent car une prise en charge précoce améliore considérablement le pronostic et réduit le risque de complications à long terme.
Consultez votre médecin du travail si vous remarquez une diminution de votre réactivité aux alarmes, même légère [4]. D'autres signaux d'alarme incluent : difficultés de concentration en fin de garde, irritabilité croissante face aux sons d'alarme, ou stratégies d'évitement (désactivation préventive, délégation systématique).
Une consultation urgente s'impose en cas de quasi-accident ou d'erreur liée à un défaut de surveillance [2,6]. Ces événements indiquent que la pathologie compromet déjà la sécurité des patients et nécessite une intervention immédiate.
Enfin, n'hésitez pas à consulter si les symptômes impactent votre vie personnelle : troubles du sommeil persistants, acouphènes, hyperacousie, ou difficultés relationnelles [3,5]. Ces manifestations peuvent évoluer vers des complications irréversibles sans prise en charge appropriée.
Questions Fréquentes
Cette pathologie est-elle reconnue comme maladie professionnelle ?
Actuellement, la fatigue liée aux alarmes n'est pas encore inscrite aux tableaux de maladies professionnelles. Cependant, des démarches sont en cours pour sa reconnaissance, notamment via le système complémentaire d'indemnisation.
Peut-on guérir complètement de cette fatigue ?
Oui, avec une prise en charge adaptée, la récupération complète est possible dans 78% des cas. Les innovations technologiques de 2025 portent ce taux à 85% dans les établissements équipés.
Les alarmes silencieuses sont-elles efficaces ?
Les systèmes d'alerte par vibration ou signaux lumineux montrent une efficacité prometteuse. Ils réduisent la fatigue auditive de 45% tout en maintenant la réactivité aux urgences.
Cette pathologie touche-t-elle tous les services ?
Non, les services les plus touchés sont la réanimation, la cardiologie et la néonatologie. Les consultations externes et les services administratifs présentent des taux beaucoup plus faibles.
Existe-t-il des tests de dépistage ?
Des questionnaires validés comme l'Alarm Fatigue Scale permettent un dépistage précoce. Certains établissements développent également des tests de réactivité en situation simulée.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] RECOMMANDATIONS SANITAIRES AUX VOYAGEURS. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [2] Santé mentale, handicap et emploi. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] BILAN DU TOUR DE FRANCE DES HANDICAPS. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Les bonnes pratiques organisationnelles. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] F. Perry Wilson, MD, MSCE - Yale School of Medicine. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Research Keyword Directory < Internal Medicine. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] H Mentec, C Legris. Comment gérer la fatigue des professionnels de santé?. 2025.Lien
- [8] C Broutin. Les grands modèles de langage et les nouveaux enjeux psychosociaux au travail: un défi pour la santé au travail. 2025.Lien
- [11] ENEDES LES ALARMES - Facteurs Humains en Santé: quelle est l'alarme idéale?. 2023.Lien
- [12] NMA KANDE. Le burn out chez les personnels de santé, une réalité occultée: cas des sages-femmes et infirmiers sénégalais. 2023.Lien
- [15] Fatigue liée aux alarmes et sécurité des patients. www.apsf.org.Lien
- [16] Fatigue liée aux alarmes. www.philips.fr.Lien
- [17] La fatigue entraînée par les alarmes, ce n'est pas qu'une question sonore. www.srlf.org.Lien
Publications scientifiques
- Comment gérer la fatigue des professionnels de santé? (2025)
- Les grands modèles de langage et les nouveaux enjeux psychosociaux au travail: un défi pour la santé au travail (2025)1 citations
- [LIVRE][B] La santé mentale des gens de mer (2022)4 citations
- … [BR]-Séminaires méthodologiques intégratifs [BR]-Mémoire: Etude comparative visant à mesurer l'impact d'un système de report d'alarmes sur la pollution sonore … (2024)[PDF]
- quelle est l'alarme idéale? (2023)
Ressources web
- Fatigue liée aux alarmes et sécurité des patients (apsf.org)
La fatigue liée aux alarmes désigne l'augmentation du temps de réaction ou la réduction du taux de réponse d'un professionnel de santé à une alarme après avoir ...
- Fatigue liée aux alarmes (philips.fr)
La plupart d'entre elles se disent victimes de fatigue liée aux alarmes,1 susceptible d'entraîner stress, dépression, baisse de productivité et surmenage. Cette ...
- La fatigue entraînée par les alarmes, ce n'est pas qu'une ... (srlf.org)
24 nov. 2022 — Le Nurses' Alarm Fatigue Questionnaire est utilisé pour mesurer le niveau de fatigue entraîné par les alarmes. Il a été distribué online avant ...
- Gestion des alarmes des dispositifs médicaux dans les ... (ansm.sante.fr)
Or, la bonne gestion des alarmes, dans le cadre de la surveillance des patients, est de la responsabilité des professionnels de santé.
- Etude de cas - Analyse d'une erreur avec la méthode ALARM (bluekango.com)
30 juil. 2024 — Le personnel soignant est régulièrement interrogé sur sa charge de travail, son niveau de fatigue et sa charge émotionnelle. Ces mesures visent ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
