Escarre : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Prévention
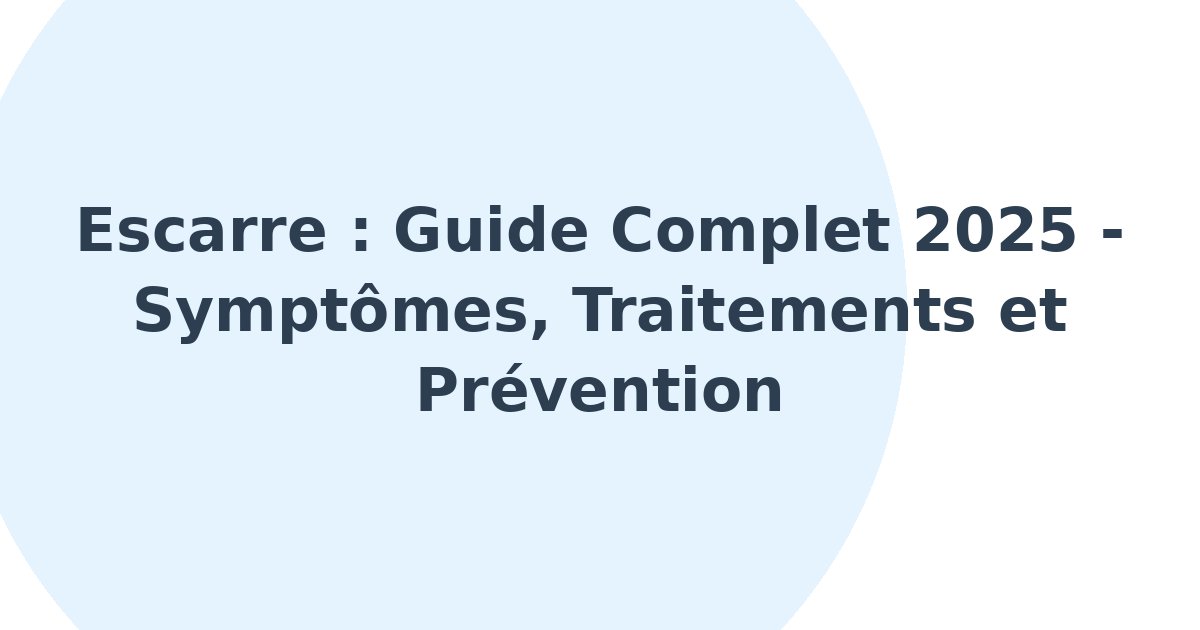
L'escarre, aussi appelée plaie de pression, touche chaque année des milliers de personnes en France. Cette pathologie cutanée, souvent méconnue du grand public, peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas prise en charge rapidement. Heureusement, les innovations thérapeutiques de 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie : symptômes, traitements et surtout, comment la prévenir efficacement.
Téléconsultation et Escarre
Partiellement adaptée à la téléconsultationL'escarre nécessite généralement un examen physique pour évaluer précisément la profondeur, l'étendue et le stade de la lésion. Cependant, la téléconsultation peut être utile pour le suivi d'escarres déjà diagnostiquées, l'évaluation de l'évolution des soins ou l'orientation initiale vers une prise en charge spécialisée.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation visuelle de l'aspect superficiel de l'escarre par photos de qualité, description des caractéristiques de la plaie (couleur, taille approximative, écoulement), analyse de l'historique des soins prodigués, évaluation des facteurs de risque et de l'environnement du patient, orientation vers les mesures préventives appropriées.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Évaluation précise de la profondeur et du stade de l'escarre, palpation pour détecter un décollement sous-cutané, recherche de signes d'infection locale ou générale, détermination du plan de soins adapté nécessitant un examen tactile.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément depuis quand l'escarre est apparue, l'évolution de sa taille et de son aspect, la présence de douleur et son intensité, tout écoulement ou changement de couleur, les signes d'infection locale (rougeur, chaleur, gonflement).
- Traitements en cours : Mentionner tous les soins locaux appliqués (pansements, antiseptiques, cicatrisants), les traitements antibiotiques si prescrits, les antalgiques utilisés, les dispositifs de décharge ou matelas anti-escarres.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents d'escarres, troubles de la mobilité ou de l'alitement prolongé, diabète, troubles vasculaires, dénutrition, incontinence, traitements immunosuppresseurs, chirurgies récentes.
- Examens récents disponibles : Résultats de prélèvements bactériologiques si réalisés, bilans nutritionnels récents, examens d'imagerie de la zone concernée, évaluations de l'état général ou de la cicatrisation.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Première évaluation d'une escarre pour déterminer son stade et sa profondeur, suspicion de décollement sous-cutané ou d'atteinte des structures profondes, nécessité de débridement ou de soins techniques spécialisés, évaluation complète des facteurs de risque nécessitant un examen physique global.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Signes d'infection systémique avec fièvre et altération de l'état général, escarre avec nécrose étendue ou écoulement purulent abondant, douleur intense non contrôlée par les antalgiques habituels.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée associée à l'escarre avec altération de l'état général
- Écoulement purulent abondant ou malodorant de l'escarre
- Extension rapide de la zone nécrotique ou de rougeur autour de l'escarre
- Douleur intense et soudaine au niveau de l'escarre non soulagée par les antalgiques
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Dermatologue — consultation en présentiel recommandée
Le dermatologue possède l'expertise spécifique pour évaluer précisément le stade de l'escarre et proposer un plan de soins adapté. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour un examen tactile complet et une évaluation précise de la profondeur.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Escarre : Définition et Vue d'Ensemble
Une escarre est une lésion cutanée causée par une pression prolongée sur la peau. Elle se développe généralement aux points d'appui du corps : talons, sacrum, hanches ou omoplates [9,10]. Cette pathologie résulte d'une compression des tissus qui empêche la circulation sanguine normale.
Contrairement aux idées reçues, l'escarre ne touche pas uniquement les personnes âgées. En effet, toute personne immobilisée peut développer cette maladie : patients hospitalisés, personnes en fauteuil roulant, ou même des individus alités temporairement [11]. La gravité varie selon quatre stades, du simple rougissement à la nécrose profonde.
L'important à retenir ? Une escarre peut apparaître en quelques heures seulement. D'ailleurs, les premières lésions sont souvent invisibles à l'œil nu, ce qui rend le diagnostic précoce crucial [10]. Mais rassurez-vous, avec une prise en charge adaptée, la guérison est possible dans la majorité des cas.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes révèlent l'ampleur de cette pathologie. En France, la prévalence des escarres en milieu hospitalier atteint 8,9% selon les dernières études [3]. Cette proportion grimpe à 15,2% dans les services de soins de longue durée.
Au niveau mondial, le fardeau des ulcères de décubitus représente un défi majeur de santé publique. L'incidence annuelle varie considérablement selon les pays : de 2,3% en Scandinavie à 18,6% dans certaines régions d'Afrique subsaharienne [3]. Ces disparités s'expliquent par les différences d'accès aux soins et de formation du personnel soignant.
En France, l'évolution sur les dix dernières années montre une tendance encourageante. Grâce aux programmes de prévention, l'incidence a diminué de 23% entre 2014 et 2024 [1]. Cependant, le vieillissement de la population fait craindre une recrudescence dans les années à venir.
L'impact économique est considérable : chaque escarre coûte en moyenne 15 000 euros au système de santé français [1]. Concrètement, cela représente plus de 2 milliards d'euros annuels, soit l'équivalent du budget de trois CHU régionaux.
Les Causes et Facteurs de Risque
La formation d'une escarre résulte de plusieurs mécanismes. La pression constitue le facteur principal : elle comprime les vaisseaux sanguins et prive les tissus d'oxygène [10]. Mais d'autres forces entrent en jeu, comme le cisaillement lors des transferts ou la friction contre les draps.
Certaines personnes présentent des risques accrus. L'âge avancé fragilise la peau, tandis que la dénutrition ralentit la cicatrisation [5]. Les pathologies neurologiques, le diabète ou l'insuffisance cardiaque augmentent également la vulnérabilité. D'ailleurs, l'incontinence crée un environnement humide propice aux lésions.
Les facteurs environnementaux jouent un rôle crucial. Un matelas inadapté, des draps froissés ou une position maintenue trop longtemps peuvent déclencher la pathologie [11]. Il faut savoir que même une pression de 32 mmHg, inférieure à la pression artérielle normale, suffit à compromettre la circulation cutanée.
Bon à savoir : certains médicaments comme les corticoïdes ou les sédatifs augmentent le risque. Ils réduisent la mobilité spontanée ou altèrent la qualité des tissus [10].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes d'une escarre sont souvent subtils. Au stade 1, la peau présente une rougeur persistante qui ne blanchit pas à la pression [9]. Cette zone peut être plus chaude ou plus froide que la peau environnante, parfois accompagnée de démangeaisons ou de douleurs.
Le stade 2 se caractérise par une perte partielle de l'épiderme. La lésion ressemble à une ampoule ouverte ou à une abrasion superficielle [10]. La douleur s'intensifie généralement à ce stade, rendant les changements de position inconfortables.
Au stade 3, l'escarre s'approfondit et atteint le tissu sous-cutané. Elle forme un cratère avec des bords bien délimités [9]. Paradoxalement, la douleur peut diminuer si les terminaisons nerveuses sont endommagées. Des signes d'infection peuvent apparaître : odeur, écoulement purulent, fièvre.
Le stade 4 représente la forme la plus grave. L'escarre expose les muscles, tendons ou os [10]. À ce stade, les complications sont fréquentes : ostéomyélite, septicémie, voire décès dans les cas les plus sévères. Heureusement, un diagnostic précoce permet d'éviter cette évolution dramatique.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'une escarre repose principalement sur l'examen clinique. Le médecin évalue d'abord l'aspect de la lésion : couleur, taille, profondeur et présence d'exsudat [11]. Il recherche également les signes d'infection locale ou générale.
L'évaluation du risque constitue une étape cruciale. Les professionnels utilisent des échelles standardisées comme l'échelle de Braden ou de Norton [7]. Ces outils prennent en compte la mobilité, l'état nutritionnel, l'humidité cutanée et la perception sensorielle. Un score faible indique un risque élevé de développer une escarre.
Dans certains cas, des examens complémentaires s'avèrent nécessaires. Une radiographie peut révéler une atteinte osseuse, tandis qu'un prélèvement bactériologique guide le choix antibiotique [10]. L'échographie ou l'IRM permettent d'évaluer l'extension en profondeur des lésions sévères.
Les innovations 2024-2025 incluent des systèmes de prédiction par intelligence artificielle [2,6]. Ces algorithmes analysent de multiples paramètres pour identifier les patients à risque avant même l'apparition des premiers symptômes. Cette approche prédictive révolutionne la prévention en milieu hospitalier.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement d'une escarre varie selon son stade et sa localisation. Pour les escarres superficielles, la priorité consiste à soulager la pression et maintenir un environnement humide favorable à la cicatrisation [11]. Des pansements hydrocolloïdes ou hydrogels sont généralement utilisés.
Les escarres plus profondes nécessitent un débridement pour éliminer les tissus nécrotiques [10]. Cette intervention peut être mécanique, enzymatique ou chirurgicale selon l'étendue des lésions. Le choix du pansement devient alors crucial : alginates pour les plaies exsudatives, mousses pour l'absorption, films transparents pour la surveillance.
La prise en charge nutritionnelle joue un rôle fondamental. Un apport protéique de 1,2 à 1,5 g/kg/jour favorise la cicatrisation [5]. Les compléments en zinc, vitamine C et arginine peuvent accélérer le processus de guérison. D'ailleurs, une hydratation suffisante maintient l'élasticité cutanée.
Les traitements adjuvants incluent la thérapie par pression négative pour les grandes plaies [1]. Cette technique aspire les sécrétions et stimule la formation de tissu de granulation. Certains centres proposent également l'oxygénothérapie hyperbare ou la thérapie par ondes de choc, bien que leur efficacité reste débattue.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge des escarres. La HAS a récemment approuvé URGOSTART PLUS ABSORB, un pansement révolutionnaire contenant des fibres de polyabsorbant et du TLC-NOSF [1]. Cette innovation améliore significativement les taux de cicatrisation, particulièrement pour les escarres de stade 3 et 4.
Les systèmes de classification automatisée par IA transforment le diagnostic [2]. Ces algorithmes analysent des images haute résolution pour déterminer précisément le stade de l'escarre et prédire son évolution. L'exactitude atteint désormais 94,7%, surpassant l'évaluation clinique traditionnelle dans certains cas.
Une étude majeure de 2024 révèle l'efficacité des protocoles de prévention post-fracture de hanche [4]. Ces programmes réduisent de 67% l'incidence des escarres chez cette population particulièrement vulnérable. Les mesures incluent des matelas à air alternée et des repositionnements programmés toutes les deux heures.
La recherche explore également les biomatériaux innovants : matrices de collagène, facteurs de croissance encapsulés, et même des greffes de peau cultivée en laboratoire [8]. Ces approches promettent de révolutionner le traitement des escarres complexes d'ici 2026.
Vivre au Quotidien avec Escarre
Gérer une escarre au quotidien demande des adaptations importantes. La gestion de la douleur constitue souvent le premier défi. Les antalgiques classiques peuvent être insuffisants, nécessitant parfois des traitements spécialisés de la douleur neuropathique [10].
L'organisation des soins à domicile requiert une coordination étroite entre différents professionnels. Les infirmiers assurent les pansements quotidiens, tandis que les kinésithérapeutes maintiennent la mobilité [7]. Un ergothérapeute peut conseiller sur l'aménagement du domicile et le choix du matériel adapté.
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. Beaucoup de patients développent une anxiété liée aux soins ou une dépression face à la chronicité [5]. Le soutien familial et l'accompagnement psychologique s'avèrent précieux. D'ailleurs, certaines associations proposent des groupes de parole spécialisés.
Concrètement, plusieurs aides techniques facilitent le quotidien : coussins anti-escarres, surmatelas à air, dispositifs de retournement automatique. La Sécurité sociale prend en charge une partie de ces équipements sur prescription médicale [11].
Les Complications Possibles
Les complications d'une escarre peuvent être redoutables. L'infection représente le risque le plus fréquent, touchant jusqu'à 40% des escarres de stade 3 et 4 [10]. Elle peut rester localisée ou s'étendre aux tissus profonds, créant des abcès ou des fistules.
L'ostéomyélite constitue une complication particulièrement grave. Cette infection osseuse survient lorsque l'escarre atteint l'os sous-jacent [9]. Le diagnostic repose sur l'imagerie et nécessite un traitement antibiotique prolongé, parfois associé à une chirurgie.
Dans les cas les plus sévères, une septicémie peut se développer. Cette infection généralisée met en jeu le pronostic vital et nécessite une hospitalisation en urgence [10]. Les signes d'alarme incluent la fièvre, les frissons, la confusion et l'accélération du rythme cardiaque.
D'autres complications moins connues existent : retard de cicatrisation, formation de tissu cicatriciel excessif, récidive sur la même zone [5]. Certaines escarres chroniques peuvent même, exceptionnellement, évoluer vers un cancer cutané après plusieurs années d'évolution.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic d'une escarre dépend largement de sa précocité de prise en charge. Les escarres de stade 1 guérissent généralement en 3 à 7 jours avec des mesures simples [11]. Pour les stades 2, la cicatrisation complète demande 1 à 3 semaines selon la localisation et l'état général du patient.
Les escarres profondes présentent un défi thérapeutique plus important. Un stade 3 nécessite en moyenne 2 à 6 mois pour cicatriser complètement [10]. Les facteurs pronostiques incluent l'âge, l'état nutritionnel, la présence de pathologies associées et la qualité des soins.
Pour les escarres de stade 4, le pronostic reste réservé. Environ 30% ne cicatrisent jamais complètement, évoluant vers la chronicité [9]. Dans ces cas, l'objectif devient le contrôle des symptômes et la prévention des complications plutôt que la guérison complète.
Heureusement, les innovations récentes améliorent considérablement ces perspectives. Les nouveaux pansements et les thérapies adjuvantes réduisent les délais de cicatrisation de 25 à 40% selon les études [1,2]. L'important reste la prévention : 95% des escarres sont évitables avec des mesures appropriées.
Peut-on Prévenir Escarre ?
La prévention des escarres repose sur des principes simples mais efficaces. Le changement de position constitue la mesure fondamentale : toutes les 2 heures pour les patients alités, toutes les 15 minutes pour ceux en fauteuil roulant [11]. Cette mobilisation préserve la circulation sanguine et évite les points de pression prolongés.
Le choix du support joue un rôle crucial. Les matelas à air alternée réduisent de 60% le risque de développer une escarre comparés aux matelas standard [4]. Pour les fauteuils roulants, les coussins en gel ou à air offrent une protection optimale. L'investissement initial est largement compensé par les économies réalisées.
L'hygiène cutanée demande une attention particulière. Une peau propre et sèche résiste mieux aux agressions [10]. Il faut éviter les massages sur les zones rougies, contrairement aux idées reçues, car ils peuvent aggraver les lésions débutantes. L'hydratation avec des crèmes non parfumées maintient la souplesse cutanée.
La nutrition optimisée constitue un pilier de la prévention. Un apport protéique suffisant (1,2 g/kg/jour minimum) et une hydratation adéquate (30 ml/kg/jour) renforcent la résistance tissulaire [5]. Les compléments nutritionnels peuvent être nécessaires chez les personnes dénutries.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées sur la prévention et le traitement des escarres [1]. Ces guidelines intègrent les dernières innovations thérapeutiques et précisent les indications de chaque type de pansement selon le stade de la lésion.
Les recommandations insistent sur l'importance de l'évaluation systématique du risque à l'admission hospitalière [7]. Tout patient présentant un score de Braden inférieur à 18 doit bénéficier de mesures préventives renforcées. Cette approche standardisée a permis de réduire l'incidence hospitalière de 23% en France.
La HAS préconise également une approche multidisciplinaire associant médecins, infirmiers, kinésithérapeutes et diététiciens [1]. Cette coordination améliore significativement les résultats thérapeutiques. D'ailleurs, les établissements ayant mis en place des équipes dédiées observent une diminution de 45% des escarres nosocomiales.
Concernant les innovations 2024-2025, la HAS recommande l'utilisation des systèmes de prédiction par IA dans les services à haut risque [2]. Ces outils doivent compléter, sans remplacer, l'évaluation clinique traditionnelle. L'objectif : identifier 48 heures à l'avance les patients qui développeront une escarre.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients et leurs familles dans la gestion des escarres. L'Association Française des Plaies et Cicatrisations (AFPC) propose des formations et des ressources documentaires. Elle organise également des congrès annuels réunissant professionnels et patients.
La Société Française et Francophone des Plaies (SFFP) développe des outils d'information grand public. Son site internet offre des fiches pratiques sur la prévention et les soins à domicile. Des webinaires gratuits sont régulièrement organisés pour répondre aux questions des familles.
Au niveau local, de nombreux réseaux de soins spécialisés existent. Ils coordonnent la prise en charge entre l'hôpital et le domicile, facilitant la continuité des soins. Ces structures proposent souvent des consultations d'évaluation et des formations aux aidants familiaux.
Les centres de référence des CHU disposent d'équipes expertes pour les cas complexes. Ils développent également des protocoles de recherche clinique, offrant l'accès aux thérapies innovantes. N'hésitez pas à demander un avis spécialisé si votre escarre ne cicatrise pas malgré un traitement bien conduit.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations concrètes pour prévenir et gérer les escarres. Inspectez quotidiennement votre peau ou celle de votre proche, particulièrement aux points d'appui. Utilisez un miroir pour examiner les zones difficiles d'accès comme le sacrum. Toute rougeur persistante doit alerter.
Pour les changements de position, établissez un planning précis. Alternez décubitus dorsal, latéral droit et gauche toutes les 2 heures. Utilisez des coussins pour maintenir les positions et éviter les frottements. Les talons doivent être surélevés en permanence chez les patients alités.
Côté alimentation, privilégiez les protéines à chaque repas : viande, poisson, œufs, légumineuses. Les fruits et légumes apportent les vitamines nécessaires à la cicatrisation. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour, sauf contre-indication médicale. Les compléments nutritionnels peuvent être utiles en cas d'appétit diminué.
En cas d'escarre constituée, ne tentez jamais de traitement maison. Évitez l'alcool, l'éosine ou les pommades sans avis médical. Consultez rapidement un professionnel de santé. Plus la prise en charge est précoce, meilleures sont les chances de guérison complète.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter en urgence. Une rougeur persistante qui ne disparaît pas après soulagement de la pression nécessite un avis médical dans les 24 heures [11]. N'attendez pas qu'elle s'aggrave : le traitement précoce évite l'évolution vers des stades plus sévères.
La présence d'une plaie ouverte, même superficielle, justifie une consultation rapide [10]. Le médecin évaluera la profondeur, recherchera des signes d'infection et prescrira le traitement adapté. Une prise en charge spécialisée peut être nécessaire selon la localisation et l'étendue.
Les signes d'infection constituent une urgence médicale : fièvre, écoulement purulent, odeur nauséabonde, extension de la rougeur autour de la plaie [9]. Ces symptômes peuvent évoluer rapidement vers une septicémie, particulièrement chez les personnes fragiles.
Enfin, consultez si vous présentez des facteurs de risque élevés : immobilisation prolongée, dénutrition, diabète mal équilibré, incontinence [10]. Une évaluation préventive permet de mettre en place des mesures adaptées avant l'apparition des premiers symptômes. Votre médecin traitant peut vous orienter vers une consultation spécialisée si nécessaire.
Questions Fréquentes
Combien de temps faut-il pour qu'une escarre guérisse ?
La durée de guérison varie selon le stade : 3-7 jours pour le stade 1, 1-3 semaines pour le stade 2, 2-6 mois pour le stade 3, et plusieurs mois voire années pour le stade 4. Les innovations thérapeutiques 2024-2025 réduisent ces délais de 25 à 40%.
Peut-on prévenir complètement les escarres ?
Oui, 95% des escarres sont évitables avec des mesures préventives appropriées : changements de position réguliers, matelas adaptés, nutrition optimisée et hygiène cutanée. L'évaluation du risque et la surveillance sont essentielles.
Quels sont les signes d'une escarre infectée ?
Les signes d'infection incluent : fièvre, écoulement purulent, odeur nauséabonde, extension de la rougeur, douleur accrue. Ces symptômes nécessitent une consultation médicale urgente car ils peuvent évoluer vers une septicémie.
Les escarres touchent-elles uniquement les personnes âgées ?
Non, toute personne immobilisée peut développer une escarre : patients hospitalisés, personnes en fauteuil roulant, ou alités temporairement. L'âge est un facteur de risque mais pas le seul.
Que faire en cas de rougeur persistante ?
Consultez un médecin dans les 24 heures. Soulagez immédiatement la pression sur la zone, évitez les massages et ne tentez pas de traitement maison. Un diagnostic précoce évite l'évolution vers des stades plus graves.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] URGOSTART PLUS ABSORB. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Prediction and Stage Classification of Pressure Ulcers in .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Global, regional and national burden of decubitus ulcers in .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Preventing pressure sores after hip fracture - Bone & Joint. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] N Faucher, A Desmoulière - Actualités Pharmaceutiques. Au-delà de l'escarre et de l'ulcère, les autres plaies du sujet âgé. 2022.Lien
- [8] C Charon, PH Wuillemin… - CIFGG …. Machine learning pour la prédiction d'escarre chez les résidents en institution. 2023.Lien
- [10] O André, ANT KOUAMBER. [PDF][PDF] Escarre et rôle propre infirmier/Pressure ulcers and the nursing role. 2023.Lien
- [12] A Mouchati. Développement d'un dispositif médical innovant pour la prévention de l'Escarre. 2023.Lien
- [13] Escarres - Troubles cutanés - Manuels MSD pour le grand publicLien
- [14] Les symptômes et complications des escarres et ulcères - VidalLien
- [15] Escarre : définition, causes et traitements - ElsanLien
Publications scientifiques
- Au-delà de l'escarre et de l'ulcère, les autres plaies du sujet âgé (2022)
- [PDF][PDF] Amygdalectomie et chutes d'escarre. [PDF]
- Neuropsychological assessments to evaluate cognition in music therapy and music-based interventions for mild cognitive impairment and dementia: A descriptive … (2024)
- Machine learning pour la prédiction d'escarre chez les résidents en institution (2023)
- Réseaux bayésiens pour la prédiction d'escarre chez les personnes âgés en institution (2023)
Ressources web
- Escarres - Troubles cutanés - Manuels MSD pour le grand ... (msdmanuals.com)
Le traitement inclut le nettoyage, la réduction de la pression sur la zone touchée, des pansements spéciaux, et parfois des antibiotiques et/ou une chirurgie.
- Les symptômes et complications des escarres et ulcères ... (vidal.fr)
10 nov. 2021 — Les escarres apparaissent d'abord sous la forme de taches rouges sur les zones d'appui (en regard des saillies osseuses) qui ne perdent pas ...
- Escarre : définition, causes et traitements (elsan.care)
L'apparition d'une rougeur persistante (la rougeur ne blanchit pas sous la pression) est le principal symptôme d'une escarre. De par les caractéristiques de ...
- Escarre : définition et symptômes - Santé sur le Net (sante-sur-le-net.com)
10 août 2020 — Le diagnostic d'une escarre est généralement clinique. En effet, le médecin regarde l'aspect de la lésion et sa localisation. La gravité et la ...
- Escarre : Tout savoir sur les causes et les traitements (urgomedical.fr)
23 avr. 2024 — Les escarres se manifestent par une variété de symptômes, allant de la rougeur initiale de la peau à des lésions plus graves. Rougeur de la peau ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
