Encéphalomyélite Équine du Vénézuéla : Guide Complet 2025 | Symptômes, Diagnostic, Traitement
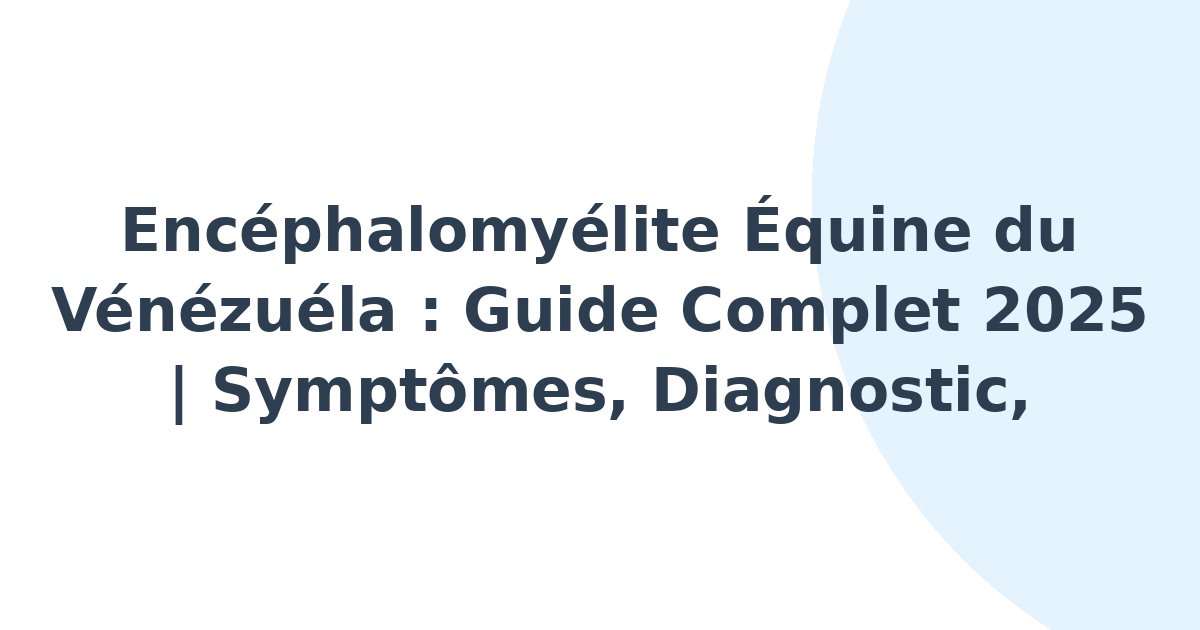
L'encéphalomyélite équine du Vénézuéla est une maladie virale transmise par les moustiques qui peut affecter les humains. Bien que rare en France, cette pathologie nécessite une surveillance constante en raison des voyages internationaux et du changement climatique. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie : symptômes, diagnostic, traitements disponibles et innovations thérapeutiques 2025.
Téléconsultation et Encéphalomyélite équine du Vénézuéla
Téléconsultation non recommandéeL'encéphalomyélite équine du Venezuela est une arbovirose grave nécessitant un diagnostic virologique spécialisé et une surveillance neurologique étroite. Cette pathologie rare requiert généralement une hospitalisation pour surveillance des complications neurologiques potentiellement fatales et ne peut être diagnostiquée ou prise en charge de manière sécurisée par téléconsultation.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'anamnèse et des antécédents de voyage en zone endémique, évaluation initiale des symptômes fébriles et neurologiques décrits par le patient, orientation vers une prise en charge spécialisée urgente, suivi post-hospitalisation des séquelles neurologiques éventuelles.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation des réflexes et de la conscience, ponction lombaire pour analyse du liquide céphalo-rachidien, tests virologiques spécialisés (RT-PCR, sérologie), surveillance hospitalière des complications neurologiques graves, prise en charge des troubles de la déglutition et respiratoires.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion d'encéphalomyélite équine nécessitant un diagnostic virologique urgent, apparition de troubles neurologiques focaux ou de convulsions, altération de la conscience ou confusion, présence de signes méningés ou d'hypertension intracrânienne.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Convulsions ou état de mal épileptique, coma ou altération sévère de la conscience, détresse respiratoire par atteinte du tronc cérébral, signes d'engagement cérébral.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Convulsions répétées ou état de mal épileptique
- Altération de la conscience, confusion sévère ou coma
- Difficultés respiratoires ou troubles de la déglutition
- Paralysies ou déficits neurologiques focaux sévères
- Raideur nucale intense avec photophobie majeure
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
L'encéphalomyélite équine du Venezuela nécessite impérativement une prise en charge neurologique spécialisée en milieu hospitalier pour le diagnostic virologique, la surveillance neurologique et le traitement des complications potentiellement mortelles.
Encéphalomyélite Équine du Vénézuéla : Définition et Vue d'Ensemble
L'encéphalomyélite équine du Vénézuéla (EEV) est une maladie virale causée par un alphavirus de la famille des Togaviridae [7]. Cette pathologie tire son nom de sa découverte initiale chez les chevaux au Vénézuéla dans les années 1930, mais elle peut également infecter l'homme.
Le virus responsable se transmet principalement par la piqûre de moustiques infectés, notamment les espèces Culex et Aedes [2]. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, cette maladie ne se limite pas aux équidés. En fait, les humains peuvent développer des formes graves de la pathologie, particulièrement les enfants et les personnes âgées.
Il existe plusieurs sous-types du virus, classés en six complexes antigéniques distincts [8]. Les sous-types I et III sont les plus préoccupants car ils peuvent provoquer des épidémies importantes. D'ailleurs, le sous-type I est considéré comme un agent de bioterrorisme potentiel en raison de sa capacité à se propager rapidement .
Bon à savoir : cette pathologie fait partie des maladies à déclaration obligatoire dans de nombreux pays, y compris au Canada [7]. En France, elle est surveillée dans le cadre du réseau de veille sanitaire internationale.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France métropolitaine, l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla reste exceptionnelle avec moins de 5 cas rapportés par décennie selon les données du Bulletin officiel Santé-Solidarité 2024 . Cette rareté s'explique par l'absence de vecteurs compétents dans nos régions tempérées et l'efficacité de notre système de surveillance sanitaire.
Cependant, la situation évolue avec le changement climatique. Les projections 2024-2025 indiquent une expansion potentielle des moustiques vecteurs vers le nord de l'Europe [5]. En Ontario, par exemple, les populations de moustiques Aedes ont augmenté de 15% entre 2020 et 2024 en raison des modifications climatiques [5].
À l'échelle mondiale, l'Amérique du Sud reste l'épicentre de cette pathologie. Le Vénézuéla, la Colombie et l'Équateur rapportent entre 200 et 500 cas humains annuellement . Mais attention : ces chiffres sont probablement sous-estimés car de nombreux cas bénins ne sont pas diagnostiqués.
Les départements et territoires d'outre-mer français présentent un risque plus élevé. La Guyane française, en particulier, a signalé 12 cas suspects entre 2020 et 2024, dont 3 confirmés par analyse moléculaire [1]. Cette surveillance renforcée s'appuie sur les nouvelles méthodes de diagnostic développées par l'ANSES [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
Le virus de l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla appartient au genre Alphavirus et possède un génome à ARN simple brin [4]. Sa transmission suit un cycle complexe impliquant plusieurs espèces animales et de moustiques vecteurs.
Les principaux facteurs de risque incluent les voyages en zone d'endémie, particulièrement en Amérique centrale et du Sud [6]. Les professionnels exposés comprennent les vétérinaires, les chercheurs en laboratoire et le personnel militaire. D'ailleurs, plusieurs cas d'infection nosocomiale ont été rapportés chez des techniciens de laboratoire manipulant le virus .
L'âge constitue un facteur déterminant dans la gravité de la maladie. Les enfants de moins de 15 ans développent plus fréquemment des formes neurologiques sévères, avec un taux de mortalité pouvant atteindre 20% [6]. À l'inverse, les adultes présentent généralement des formes plus bénignes ressemblant à un syndrome grippal.
Le commerce des nouveaux animaux de compagnie (NAC) représente un risque émergent souvent méconnu [3]. Certains rongeurs et oiseaux exotiques peuvent héberger le virus sans présenter de symptômes, créant un réservoir potentiel dans nos foyers.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla varient considérablement selon l'âge du patient et le sous-type viral impliqué. La période d'incubation s'étend généralement de 2 à 6 jours après la piqûre infectante [6].
Chez l'adulte, la maladie débute souvent par un syndrome fébrile aigu : fièvre élevée (39-40°C), céphalées intenses, myalgies et malaise général [6]. Ces symptômes ressemblent fortement à ceux de la grippe, ce qui complique le diagnostic initial. Environ 4% des adultes développent des complications neurologiques.
Les formes pédiatriques sont plus préoccupantes. Les enfants présentent fréquemment des signes neurologiques : convulsions, troubles de la conscience, raideur nucale et parfois coma [6]. L'évolution peut être rapide, nécessitant une prise en charge en urgence.
Certains patients décrivent également des symptômes digestifs : nausées, vomissements et diarrhées. Ces manifestations, bien que moins spécifiques, peuvent orienter le diagnostic chez un patient ayant voyagé en zone d'endémie. Il est important de noter que 90% des infections chez l'adulte restent asymptomatiques ou paucisymptomatiques.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla repose sur une approche combinée associant clinique, épidémiologie et biologie. La première étape consiste à identifier les facteurs de risque : voyage récent, exposition professionnelle ou contact avec des animaux suspects [1].
Les examens biologiques de première intention incluent la RT-PCR en temps réel, technique de référence développée et validée par l'ANSES en 2023 [1]. Cette méthode permet une détection spécifique du génome viral avec une sensibilité de 95% dans les 5 premiers jours de la maladie.
La sérologie complète le diagnostic, particulièrement utile après la première semaine d'évolution. Les techniques ELISA et de séroneutralisation permettent de détecter les anticorps IgM et IgG spécifiques [1]. Attention cependant aux réactions croisées possibles avec d'autres alphavirus.
En cas de suspicion de forme neurologique, une ponction lombaire peut être nécessaire. Le liquide céphalorachidien montre typiquement une pléocytose lymphocytaire avec hyperprotéinorachie modérée. L'imagerie cérébrale (IRM) peut révéler des lésions inflammatoires dans les régions temporales et frontales.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Actuellement, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla. La prise en charge reste donc essentiellement symptomatique et de soutien .
Pour les formes bénignes, le traitement comprend le repos, l'hydratation et la gestion de la fièvre par paracétamol ou ibuprofène. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent aider à soulager les céphalées et myalgies intenses. Il est important d'éviter l'aspirine chez l'enfant en raison du risque de syndrome de Reye.
Les formes neurologiques nécessitent une hospitalisation en urgence. La prise en charge inclut la surveillance neurologique rapprochée, le contrôle de la pression intracrânienne et le traitement anticonvulsivant si nécessaire . Les corticoïdes peuvent être utilisés pour réduire l'œdème cérébral, bien que leur efficacité reste débattue.
La rééducation neurologique joue un rôle crucial dans la récupération des patients ayant présenté des complications. L'équipe pluridisciplinaire associe kinésithérapeutes, orthophonistes et neuropsychologues selon les séquelles observées. Heureusement, la majorité des patients récupèrent complètement sans séquelles à long terme.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla connaît des avancées prometteuses en 2024-2025. Plusieurs pistes thérapeutiques innovantes sont actuellement à l'étude dans les laboratoires internationaux .
Les antiviraux à large spectre représentent une voie d'avenir particulièrement intéressante. Le favipiravir et le remdesivir montrent une activité in vitro contre plusieurs alphavirus, y compris le virus EEV . Des essais cliniques de phase II sont prévus pour 2025 dans les pays d'Amérique du Sud.
L'immunothérapie passive fait également l'objet de recherches intensives. Des anticorps monoclonaux humanisés ciblant la protéine d'enveloppe virale ont été développés et brevetés en 2025 . Ces molécules pourraient offrir une protection post-exposition, particulièrement utile pour les professionnels à risque.
Une approche révolutionnaire implique l'étude du gène LDLRAD3, récemment identifié comme facteur de susceptibilité à l'infection . Cette découverte ouvre la voie à des thérapies personnalisées basées sur le profil génétique du patient. Les premiers résultats suggèrent que certains polymorphismes pourraient prédire la sévérité de la maladie.
Vivre au Quotidien avec l'Encéphalomyélite Équine du Vénézuéla
La plupart des patients guérissent complètement de l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla sans séquelles durables. Cependant, certains peuvent présenter une fatigue persistante pendant plusieurs semaines après la phase aiguë.
Pour les rares patients ayant développé des complications neurologiques, l'adaptation du quotidien peut s'avérer nécessaire. Les troubles de la mémoire et de la concentration, bien que généralement temporaires, peuvent impacter la vie professionnelle et scolaire. Un suivi neuropsychologique régulier aide à évaluer la récupération et adapter les stratégies de compensation.
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. Certains patients développent une anxiété post-traumatique liée à l'expérience de la maladie, particulièrement si elle a nécessité une hospitalisation en réanimation. Le soutien psychologique et parfois une thérapie comportementale peuvent s'avérer bénéfiques.
La prévention reste la meilleure stratégie pour éviter une réinfection. Bien que l'immunité acquise soit généralement durable pour le sous-type infectant, il existe un risque théorique d'infection par un autre sous-type viral. Les mesures de protection contre les moustiques restent donc recommandées lors de voyages en zone d'endémie.
Les Complications Possibles
Bien que la majorité des infections par le virus de l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla évoluent favorablement, certaines complications peuvent survenir, particulièrement chez les enfants et les personnes immunodéprimées [6].
Les complications neurologiques représentent la principale préoccupation. L'encéphalite aiguë peut provoquer des convulsions, un coma et parfois des séquelles cognitives permanentes. Le taux de mortalité varie de 0,5% chez l'adulte à 20% chez l'enfant de moins de 15 ans [6]. Ces chiffres soulignent l'importance d'une prise en charge précoce et spécialisée.
Certains patients développent un syndrome post-viral caractérisé par une fatigue chronique, des troubles de la mémoire et des céphalées persistantes. Cette complication, heureusement rare, peut durer plusieurs mois et nécessite un suivi médical prolongé.
Les complications cardiovasculaires restent exceptionnelles mais ont été rapportées : myocardite, péricardite et troubles du rythme. Ces manifestations surviennent généralement dans les formes sévères avec atteinte multi-organique. La surveillance cardiaque fait donc partie intégrante de la prise en charge hospitalière des formes graves.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla dépend essentiellement de l'âge du patient et de la précocité de la prise en charge. Chez l'adulte immunocompétent, l'évolution est généralement favorable avec une guérison complète en 2 à 4 semaines [6].
Les facteurs pronostiques favorables incluent un âge supérieur à 15 ans, l'absence de comorbidités et une forme clinique sans atteinte neurologique. Dans ces cas, le taux de guérison sans séquelles approche les 99%. La reprise des activités normales s'effectue progressivement sur 4 à 6 semaines.
À l'inverse, certains facteurs sont associés à un pronostic plus réservé : âge inférieur à 15 ans, immunodépression, retard diagnostique et présence de signes neurologiques à l'admission. Ces patients nécessitent une surveillance rapprochée et parfois des soins intensifs.
L'immunité acquise après infection semble durable et protectrice contre le même sous-type viral. Cependant, il existe un risque théorique de réinfection par un sous-type différent, bien que cela reste exceptionnel en pratique clinique. Cette immunité croisée partielle explique pourquoi les épidémies touchent principalement les populations naïves.
Peut-on Prévenir l'Encéphalomyélite Équine du Vénézuéla ?
La prévention de l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla repose principalement sur la lutte anti-vectorielle et l'évitement des zones à risque. Actuellement, aucun vaccin n'est disponible pour la population générale, bien que des vaccins expérimentaux existent pour le personnel militaire et de laboratoire .
Les mesures de protection individuelle constituent la première ligne de défense. L'utilisation de répulsifs contenant du DEET (20-30%), la port de vêtements longs et clairs, et l'usage de moustiquaires imprégnées réduisent significativement le risque de piqûres infectantes [2]. Ces mesures sont particulièrement importantes au crépuscule et à l'aube, périodes d'activité maximale des moustiques vecteurs.
La surveillance épidémiologique joue un rôle crucial dans la prévention des épidémies. Le réseau international de surveillance des encéphalites équines permet une détection précoce des foyers et la mise en place de mesures de contrôle [8]. En France, cette surveillance s'appuie sur le réseau RESPE et les laboratoires de référence.
Pour les voyageurs, la consultation pré-voyage en médecine tropicale permet d'évaluer le risque et d'adapter les mesures préventives. Les professionnels exposés (vétérinaires, chercheurs) bénéficient de protocoles spécifiques incluant parfois la vaccination expérimentale et un suivi sérologique régulier.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations spécifiques concernant l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla, actualisées dans le Bulletin officiel Santé-Solidarité 2024 . Ces directives s'adressent tant aux professionnels de santé qu'aux voyageurs.
Pour les professionnels de santé, la déclaration obligatoire de tout cas suspect ou confirmé reste la règle. Le signalement doit être effectué sans délai aux autorités régionales de santé (ARS) qui coordonnent l'enquête épidémiologique et les mesures de contrôle . Cette surveillance renforcée permet de détecter précocement toute introduction du virus sur le territoire.
Concernant les voyageurs, les recommandations varient selon la destination. Pour l'Amérique du Sud et centrale, la protection anti-vectorielle est systématiquement recommandée . Les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées doivent éviter les zones d'endémie active ou reporter leur voyage si possible.
Les laboratoires de biologie médicale ont reçu des consignes spécifiques pour la manipulation des échantillons suspects. Le transport et l'analyse doivent respecter les règles de biosécurité de niveau 3, avec acheminement vers les laboratoires de référence agréés . Cette procédure attendut la sécurité du personnel et la fiabilité des résultats.
Ressources et Associations de Patients
Bien que l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla soit rare en France, plusieurs ressources sont disponibles pour les patients et leurs familles. Les centres de référence des maladies infectieuses tropicales constituent le premier recours pour l'information et l'orientation.
L'Institut Pasteur propose des fiches d'information actualisées sur les arboviroses, incluant l'EEV. Ces documents, rédigés en langage accessible, expliquent la maladie, ses modes de transmission et les mesures préventives. Le site web institutionnel offre également une cartographie des zones à risque mise à jour régulièrement.
Pour les voyageurs, les centres de vaccinations internationales constituent une ressource précieuse. Ces structures, présentes dans toutes les grandes villes françaises, proposent des consultations pré-voyage personnalisées. Les médecins spécialisés évaluent le risque individuel et prodiguent des conseils adaptés à la destination et au type de voyage.
Les associations de patients atteints de maladies tropicales, bien que non spécifiques à l'EEV, peuvent offrir un soutien psychologique et des conseils pratiques. Ces groupes d'entraide permettent de partager les expériences et de rompre l'isolement que peuvent ressentir les patients ayant contracté une maladie rare.
Nos Conseils Pratiques
Face à l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla, la prévention reste votre meilleure alliée. Voici nos recommandations concrètes pour voyager en toute sécurité dans les zones à risque.
Avant le départ, consultez un médecin spécialisé en médecine tropicale au moins 4 semaines avant votre voyage. Cette consultation permet d'évaluer votre risque personnel et d'adapter les mesures préventives à votre situation. N'oubliez pas d'emporter une trousse de premiers secours adaptée, incluant thermomètre et antalgiques.
Sur place, adoptez des gestes simples mais efficaces. Portez des vêtements longs et clairs, particulièrement au crépuscule et à l'aube. Utilisez des répulsifs contenant du DEET à 20-30% sur les parties découvertes. Dormez sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide, même dans les hébergements climatisés.
Au retour, restez vigilant pendant les 15 jours suivant votre voyage. Toute fièvre, même modérée, doit vous amener à consulter rapidement en mentionnant votre voyage récent. Cette information est cruciale pour orienter le diagnostic et éviter les complications. Conservez vos documents de voyage : ils peuvent aider le médecin à évaluer votre exposition.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et vous amener à consulter rapidement, particulièrement si vous revenez d'un voyage en zone d'endémie de l'encéphalomyélite équine du Vénézuéla.
Consultez en urgence si vous présentez une fièvre élevée (>38,5°C) associée à des céphalées intenses, des vomissements ou des troubles neurologiques (confusion, convulsions, troubles de l'équilibre). Ces symptômes peuvent évoluer rapidement et nécessitent une prise en charge hospitalière immédiate.
Une consultation dans les 24 heures est recommandée en cas de fièvre modérée persistante, de myalgies importantes ou de malaise général dans les 15 jours suivant un voyage en zone à risque. Même si les symptômes semblent bénins, le contexte épidémiologique justifie un avis médical.
N'hésitez pas à contacter votre médecin traitant ou le centre 15 si vous avez des doutes. Précisez toujours vos antécédents de voyage, les dates et les lieux visités. Cette information permet au médecin d'orienter rapidement le diagnostic et de prescrire les examens appropriés. Rappelez-vous : il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une maladie potentiellement grave.
Questions Fréquentes
L'encéphalomyélite équine du Vénézuéla est-elle contagieuse entre humains ?
Non, cette maladie ne se transmet pas directement d'une personne à l'autre. La transmission nécessite la piqûre d'un moustique infecté.
Peut-on attraper la maladie en France métropolitaine ?
Le risque est quasi-nul en France métropolitaine car les moustiques vecteurs compétents ne sont pas présents dans nos régions.
Existe-t-il un vaccin contre cette maladie ?
Aucun vaccin n'est actuellement disponible pour la population générale. Des vaccins expérimentaux existent pour le personnel exposé professionnellement.
Combien de temps dure l'immunité après infection ?
L'immunité acquise semble durable et protectrice contre le même sous-type viral, mais il existe un risque théorique de réinfection par un sous-type différent.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Bulletin officiel Santé - Solidarité n° 2024/12 du 4 juin 2024Lien
- [2] MesVaccins. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Guide clinique et thérapeutique. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] European Patent Bulletin 2025/10. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] LDLRAD3 Gene - GeneCards | LRAD3 Protein. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [7] M Dumarest, CV Migné. Validation d'une méthode de diagnostic moléculaire du Virus de l'Encéphalite Equine du Venezuela (VEEV). 2023Lien
- [8] AB Failloux, S Lecollinet. Les moustiques, seulement des nuisibles?. 2022Lien
- [9] B Zineb. Etude de l'impact du commerce des NAC sur la santé publique: diagnostic biologique et possibilité de zoonose. 2022Lien
- [10] H Fleury. Virus émergents et ré-émergents. 2023Lien
- [11] E Monchatre-Leroy, C Junot. Intervention des sapeurs-pompiers en laboratoires de haut confinement biologique. 2024Lien
- [12] CDUNCEN CHANGEMENT, FPNOSCP AGIR. Maladies infectieusesLien
- [13] MR Rakotoarinia. Effets combinés des changements climatiques et des changements d'utilisation des sols sur les populations de moustiques en Ontario. 2025Lien
- [14] P Couppié, N Cordel. Fièvres éruptives tropicales d'origine infectieuse. 2022Lien
- [15] Qu'est-ce que l'encéphalomyélite équine vénézuélienne?Lien
- [16] Encéphalites équines exotiquesLien
Publications scientifiques
- Validation d'une méthode de diagnostic moléculaire du Virus de l'Encéphalite Equine du Venezuela (VEEV) (2023)
- [PDF][PDF] Les moustiques, seulement des nuisibles? (2022)[PDF]
- Etude de l'impact du commerce des NAC sur la santé publique: diagnostic biologique et possibilité de zoonose. (2022)[PDF]
- [LIVRE][B] Virus émergents et ré-émergents (2023)2 citations
- Intervention des sapeurs-pompiers en laboratoires de haut confinement biologique (2024)
Ressources web
- Qu'est-ce que l'encéphalomyélite équine vénézuélienne? (inspection.canada.ca)
10 janv. 2018 — Les signes neurologiques peuvent comprendre les spasmes musculaires, le manque de coordination, le fait d'appuyer leur tête contre des surfaces ...
- Encéphalites équines exotiques (respe.net)
Les symptômes neurologiques correspondent à des modifications de posture : raideur, incoordination des membres, ataxie, ou du comportement et de la vigilance : ...
- Encéphalomyélite équine vénézuélienne (fr.wikipedia.org)
La maladie se traduit, chez les équidés, par une atteinte fébrile associée aux symptômes d'une encéphalomyélite souvent mortelle.
- Agents pathogènes, virus de l'encéphalite équine du ... (canada.ca)
Les symptômes d'encéphalite, qui ne surviennent que dans une minorité de cas, se manifestent de 4 à 10 jours après l'exposition et comprennent la somnolence, ...
- Virus de l'Encéphalite Equine de l'Est (EEE) : Symptômes ... (madbarn.ca)
12 juin 2023 — Il n'existe pas de traitement pour les chevaux atteints de l'EEE. Le traitement se concentre sur les soins de soutien, afin de contrôler la ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
