Encéphalomyélite Équine de l'Est : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
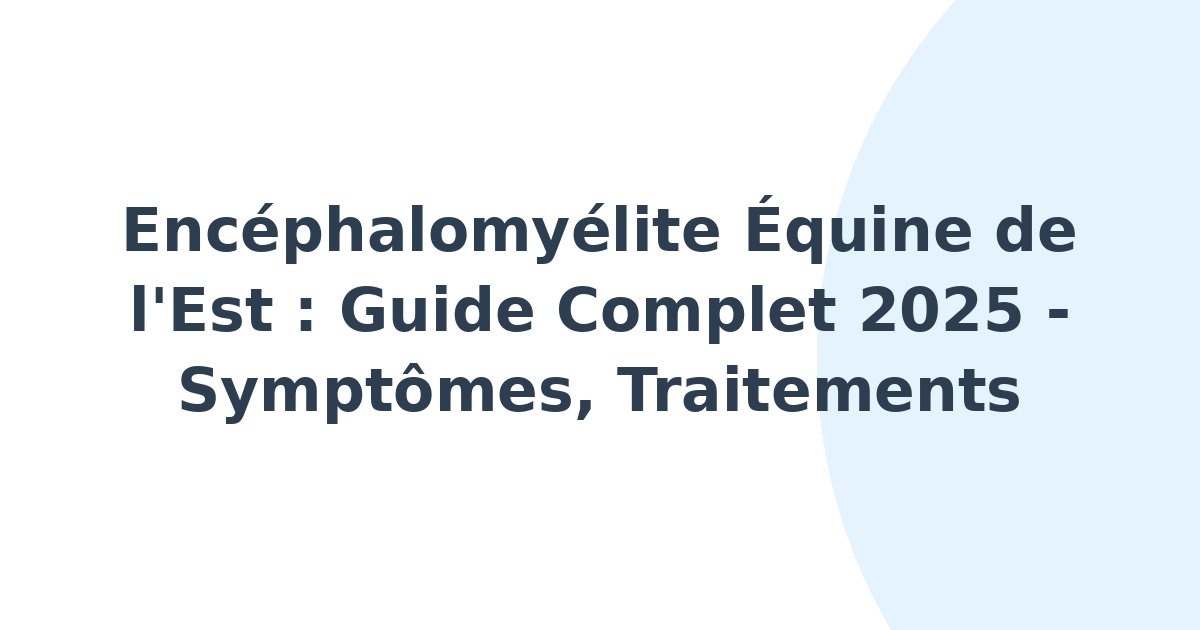
L'encéphalomyélite équine de l'Est représente une maladie virale rare mais grave, transmise par les moustiques. Cette pathologie neurologique touche principalement les chevaux, mais peut également affecter l'homme. Bien que les cas humains restent exceptionnels en France, cette maladie mérite votre attention en raison de sa gravité potentielle et des récentes évolutions épidémiologiques mondiales.
Téléconsultation et Encéphalomyélite équine de l'Est
Téléconsultation non recommandéeL'encéphalomyélite équine de l'Est est une maladie virale rare et grave transmise par les moustiques, nécessitant une prise en charge neurologique spécialisée urgente. Le diagnostic repose sur des examens neurologiques approfondis, une ponction lombaire et des analyses biologiques spécialisées qui ne peuvent être réalisés qu'en milieu hospitalier.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation de l'historique d'exposition dans les zones endémiques et des piqûres de moustiques récentes. Description des premiers symptômes neurologiques et de leur évolution temporelle. Analyse des antécédents de voyage dans les régions à risque. Orientation diagnostique préliminaire en cas de suspicion clinique.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation des réflexes, de la conscience et des fonctions cognitives. Ponction lombaire pour analyse du liquide céphalorachidien. Examens d'imagerie cérébrale (IRM, scanner). Sérologies spécialisées et tests de biologie moléculaire pour confirmation diagnostique.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Évaluation neurologique complète nécessaire pour détecter les signes de localisation cérébrale. Surveillance de l'évolution de l'état de conscience et des fonctions neurologiques. Réalisation d'examens complémentaires spécialisés (ponction lombaire, IRM cérébrale). Mise en place d'un traitement symptomatique adapté en milieu spécialisé.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Détérioration rapide de l'état neurologique avec troubles de la conscience. Apparition de convulsions ou de signes d'hypertension intracrânienne. Suspicion de complications respiratoires ou cardiovasculaires nécessitant une réanimation.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Altération de la conscience, confusion, désorientation ou perte de connaissance
- Convulsions généralisées ou focales
- Raideur de nuque associée à une fièvre élevée et des maux de tête intenses
- Paralysies ou déficits neurologiques focaux (troubles de la parole, de la motricité)
- Difficultés respiratoires ou troubles du rythme cardiaque
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
L'encéphalomyélite équine de l'Est nécessite impérativement une prise en charge neurologique spécialisée en milieu hospitalier pour le diagnostic, la surveillance et le traitement des complications neurologiques graves qui peuvent survenir.
Encéphalomyélite Équine de l'Est : Définition et Vue d'Ensemble
L'encéphalomyélite équine de l'Est (EEE) est une maladie virale causée par un alphavirus appartenant à la famille des Togaviridae [1,4]. Ce virus neurotrope provoque une inflammation sévère du cerveau et de la moelle épinière, d'où son nom d'encéphalomyélite.
Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, cette pathologie ne se limite pas aux équidés. Elle peut toucher l'homme, bien que les cas humains demeurent rares. Le virus circule naturellement entre les oiseaux sauvages et certaines espèces de moustiques, créant ce qu'on appelle un cycle enzootique [2].
La maladie tire son nom de sa première identification sur la côte Est des États-Unis dans les années 1930. Depuis, elle a été documentée dans diverses régions d'Amérique du Nord et du Sud. En Europe, les cas restent exceptionnels, mais la surveillance s'intensifie face aux changements climatiques qui pourraient favoriser l'expansion de son aire de répartition .
L'importance de cette pathologie réside dans son taux de mortalité élevé chez l'homme, pouvant atteindre 30 à 90% selon les études. Heureusement, les infections humaines restent très rares, avec seulement quelques cas rapportés annuellement en Amérique du Nord [1].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'encéphalomyélite équine de l'Est demeure une maladie exotique non endémique. Aucun cas autochtone n'a été rapporté à ce jour sur le territoire métropolitain [4]. Cette situation s'explique par l'absence des vecteurs spécifiques et des réservoirs aviaires nécessaires au maintien du cycle viral.
À l'échelle mondiale, la répartition géographique reste principalement limitée aux Amériques. Les États-Unis enregistrent en moyenne 5 à 10 cas humains par an, avec des variations importantes selon les années et les régions . Les États de la côte atlantique, notamment la Floride, le Massachusetts et la Caroline du Nord, concentrent la majorité des cas.
Les données épidémiologiques récentes montrent une tendance préoccupante. Entre 2019 et 2023, plusieurs États américains ont signalé une recrudescence des cas, avec 38 infections humaines confirmées en 2019, soit le nombre le plus élevé depuis 2012 . Cette augmentation pourrait être liée aux modifications climatiques favorisant l'expansion des populations de moustiques vecteurs.
Concernant les équidés, la surveillance vétérinaire révèle des centaines de cas annuels en Amérique du Nord. Au Canada, entre 2003 et 2020, la surveillance équine a permis d'identifier des patterns saisonniers marqués, avec un pic d'activité entre juillet et septembre . Ces données sont cruciales pour anticiper les risques de transmission à l'homme.
Les Causes et Facteurs de Risque
Le virus de l'encéphalomyélite équine de l'Est appartient au complexe des alphavirus du Nouveau Monde. Sa structure génétique a été largement étudiée, révélant des variations géographiques importantes qui influencent sa virulence [2,3].
Le cycle de transmission implique trois acteurs principaux : les oiseaux sauvages (réservoirs), les moustiques (vecteurs) et les mammifères (hôtes accidentels). Les moustiques du genre Culiseta, particulièrement Culiseta melanura, jouent un rôle central dans le maintien du cycle enzootique . Ces moustiques ornithophiles se nourrissent préférentiellement sur les oiseaux dans les zones marécageuses.
Plusieurs facteurs environnementaux influencent le risque de transmission. L'humidité élevée, les températures chaudes et la présence de zones humides créent des maladies optimales pour la reproduction des moustiques vecteurs . Les changements climatiques actuels pourraient modifier ces paramètres et étendre l'aire de répartition du virus.
Chez l'homme, certains facteurs augmentent le risque d'exposition. L'âge constitue un facteur important, les personnes de plus de 50 ans présentant un risque accru de formes sévères. Les activités de plein air dans les zones endémiques, particulièrement près des marécages et en fin de journée, exposent davantage aux piqûres de moustiques infectés [1].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'encéphalomyélite équine de l'Est chez l'homme évoluent généralement en deux phases distinctes. La phase initiale, appelée phase virémique, survient 4 à 10 jours après la piqûre infectante [1].
Durant cette première phase, vous pourriez ressentir des symptômes similaires à ceux d'une grippe : fièvre élevée (souvent supérieure à 39°C), maux de tête intenses, frissons, douleurs musculaires et fatigue extrême. Ces signes, bien que préoccupants, restent non spécifiques et peuvent facilement être confondus avec d'autres infections virales.
La phase neurologique, plus grave, se développe chez environ 5% des personnes infectées. Elle se caractérise par l'apparition de signes neurologiques sévères : confusion, désorientation, convulsions, paralysies partielles et troubles de la conscience pouvant aller jusqu'au coma . Cette progression peut être très rapide, parfois en quelques heures.
Chez les enfants, les symptômes peuvent différer légèrement. On observe souvent une irritabilité marquée, des pleurs inconsolables, une raideur de la nuque et parfois des vomissements en jet. Ces signes doivent alerter immédiatement les parents et conduire à une consultation d'urgence.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'encéphalomyélite équine de l'Est représente un défi médical en raison de la rareté de la maladie et de la non-spécificité des symptômes initiaux. La démarche diagnostique s'appuie sur plusieurs éléments complémentaires [1,3].
L'interrogatoire médical revêt une importance cruciale. Votre médecin recherchera notamment vos antécédents de voyage dans les zones endémiques, vos activités de plein air récentes et la période d'exposition aux moustiques. Ces informations épidémiologiques orientent fortement le diagnostic différentiel.
Les examens biologiques constituent l'étape suivante. La ponction lombaire permet d'analyser le liquide céphalorachidien, qui montre typiquement une pléocytose (augmentation du nombre de cellules) avec prédominance lymphocytaire et une élévation des protéines. Ces anomalies, bien que suggestives, ne sont pas spécifiques de l'EEE.
Le diagnostic de certitude repose sur des tests sérologiques spécialisés. La recherche d'anticorps IgM et IgG spécifiques du virus, ainsi que la RT-PCR pour détecter l'ARN viral, constituent les méthodes de référence. Ces analyses sont réalisées dans des laboratoires spécialisés, ce qui peut retarder le diagnostic de quelques jours [3].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Actuellement, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre l'encéphalomyélite équine de l'Est. Cette réalité peut sembler décourageante, mais la prise en charge médicale moderne permet néanmoins d'améliorer significativement le pronostic [1,3].
Le traitement repose essentiellement sur des mesures de soutien intensives. En cas d'atteinte neurologique sévère, l'hospitalisation en unité de soins intensifs devient nécessaire. Les médecins se concentrent alors sur le maintien des fonctions vitales : ventilation assistée si besoin, surveillance de la pression intracrânienne et prévention des complications.
La gestion des convulsions constitue un aspect crucial du traitement. Les antiépileptiques, notamment le phénobarbital ou la phénytoïne, sont utilisés pour contrôler l'activité épileptique. Dans certains cas sévères, des protocoles de coma barbiturique peuvent être mis en œuvre pour protéger le cerveau.
Les corticostéroïdes font l'objet de débats dans la communauté médicale. Bien qu'ils puissent théoriquement réduire l'inflammation cérébrale, leur efficacité dans l'EEE n'est pas clairement établie. Certains centres les utilisent dans les formes les plus sévères, mais cette approche reste controversée [3].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur l'encéphalomyélite équine de l'Est connaît un regain d'intérêt notable en 2024-2025, stimulée par les récentes épidémies et les avancées technologiques [1]. Plusieurs pistes thérapeutiques prometteuses émergent des laboratoires de recherche internationaux.
Les travaux récents sur les modèles cellulaires neuraux équins ouvrent de nouvelles perspectives. Une thèse française de 2023 a développé des modèles d'infection in vitro permettant de tester l'efficacité de molécules antivirales potentielles [3]. Ces modèles facilitent grandement le criblage de nouveaux composés thérapeutiques.
Du côté de la génétique, les recherches sur les gènes TOR2A et MXRA8 révèlent des mécanismes moléculaires inédits [4]. Le gène MXRA8, impliqué dans le remodelage de la matrice extracellulaire, pourrait constituer une cible thérapeutique intéressante pour limiter la neuroinvasion virale.
L'Académie Vétérinaire de France a présenté en 2024 des données encourageantes sur de nouveaux protocoles vaccinaux . Bien que ces vaccins soient initialement destinés aux équidés, ils pourraient servir de base au développement de vaccins humains. Les essais précliniques montrent une immunogénécité prometteuse avec des profils de sécurité acceptables.
Vivre au Quotidien avec l'Encéphalomyélite Équine de l'Est
Vivre avec les séquelles de l'encéphalomyélite équine de l'Est représente un défi majeur pour les patients et leurs familles. Les survivants de cette maladie font souvent face à des handicaps neurologiques permanents qui transforment radicalement leur quotidien [1].
Les séquelles les plus fréquentes incluent des troubles cognitifs, des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire et des changements de personnalité. Ces manifestations peuvent persister des mois, voire des années après l'infection aiguë. Il est important de comprendre que chaque personne réagit différemment et que l'évolution reste imprévisible.
La rééducation neurologique joue un rôle central dans la récupération. Les séances de kinésithérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie aident à retrouver certaines capacités perdues. Bien sûr, les progrès sont souvent lents et demandent une patience considérable de la part du patient et de son entourage.
L'adaptation du domicile devient parfois nécessaire. Des aménagements simples comme l'installation de barres d'appui, l'élimination des obstacles ou l'amélioration de l'éclairage peuvent considérablement faciliter la vie quotidienne. N'hésitez pas à faire appel à un ergothérapeute pour évaluer vos besoins spécifiques.
Les Complications Possibles
L'encéphalomyélite équine de l'Est peut entraîner de nombreuses complications, tant pendant la phase aiguë qu'à long terme. La compréhension de ces risques permet une meilleure prise en charge et une surveillance adaptée [1].
Durant la phase aiguë, les complications neurologiques dominent le tableau clinique. L'œdème cérébral représente la complication la plus redoutable, pouvant conduire à une hypertension intracrânienne fatale. Les convulsions généralisées, parfois réfractaires aux traitements habituels, constituent également un défi thérapeutique majeur.
Les complications respiratoires surviennent fréquemment chez les patients les plus sévères. L'atteinte du centre respiratoire bulbaire peut nécessiter une ventilation mécanique prolongée. Ces patients présentent également un risque élevé de pneumonies nosocomiales et d'infections secondaires.
À long terme, les séquelles neurologiques persistent chez la majorité des survivants. Les troubles cognitifs, incluant des difficultés de mémoire, d'attention et de fonctions exécutives, affectent significativement la qualité de vie. Des troubles moteurs, allant de la simple faiblesse musculaire aux paralysies partielles, peuvent également persister .
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'encéphalomyélite équine de l'Est demeure sombre, particulièrement pour les formes neurologiques. Cette réalité, bien que difficile à accepter, doit être connue pour permettre une prise de décision éclairée [1].
Le taux de mortalité varie considérablement selon les études et les populations étudiées. Globalement, il oscille entre 30 et 90%, avec une moyenne autour de 50-70% pour les cas confirmés d'encéphalite. Ces chiffres, impressionnants, cachent néanmoins une réalité plus nuancée selon l'âge et la rapidité de prise en charge.
L'âge constitue un facteur pronostique majeur. Les enfants de moins de 15 ans et les adultes de plus de 50 ans présentent les taux de mortalité les plus élevés. À l'inverse, les jeunes adultes en bonne santé ont de meilleures chances de survie, bien que les séquelles restent fréquentes [1].
Parmi les survivants, moins de 20% récupèrent complètement leurs fonctions neurologiques antérieures. La majorité conserve des séquelles variables : troubles cognitifs légers à sévères, déficits moteurs, troubles de l'humeur ou épilepsie séquellaire. Cependant, des cas de récupération remarquable ont été documentés, particulièrement chez les patients jeunes bénéficiant d'une rééducation intensive précoce.
Peut-on Prévenir l'Encéphalomyélite Équine de l'Est ?
La prévention de l'encéphalomyélite équine de l'Est repose actuellement exclusivement sur la protection contre les piqûres de moustiques. En l'absence de vaccin humain disponible, ces mesures préventives constituent votre seule ligne de défense [1].
Les mesures de protection individuelle s'avèrent particulièrement importantes dans les zones endémiques. L'utilisation de répulsifs contenant du DEET, de la picaridine ou de l'huile d'eucalyptus citronné offre une protection efficace. Il est recommandé d'appliquer ces produits sur toutes les zones de peau exposées, en suivant scrupuleusement les instructions du fabricant.
Les vêtements protecteurs constituent un complément indispensable. Privilégiez les manches longues, les pantalons longs et les chaussures fermées, particulièrement en fin de journée et au petit matin quand les moustiques sont les plus actifs. Les vêtements de couleur claire sont préférables car ils attirent moins les insectes.
L'aménagement de l'environnement joue également un rôle crucial. Éliminez tous les points d'eau stagnante autour de votre domicile : soucoupes de pots de fleurs, gouttières obstruées, pneus usagés. Ces gîtes larvaires favorisent la reproduction des moustiques vecteurs .
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises et internationales ont établi des recommandations spécifiques concernant l'encéphalomyélite équine de l'Est, particulièrement pour les voyageurs se rendant dans les zones endémiques [1,4].
Le ministère de la Santé français classe cette maladie parmi les pathologies à déclaration obligatoire en cas d'importation. Tout cas suspect doit être immédiatement signalé aux autorités sanitaires locales pour permettre une investigation épidémiologique rapide et éviter une éventuelle propagation [4].
Pour les voyageurs, les recommandations sont claires : évitez les activités de plein air dans les zones marécageuses des régions endémiques, particulièrement entre le coucher et le lever du soleil. Si ces activités sont inévitables, une protection maximale contre les moustiques devient impérative [1].
Les professionnels de santé doivent maintenir un niveau de vigilance élevé. Devant tout syndrome fébrile chez un patient revenant d'une zone endémique, l'EEE doit figurer dans le diagnostic différentiel, même si la probabilité reste faible. La précocité du diagnostic peut influencer la prise en charge et le pronostic.
Les autorités vétérinaires recommandent également la vaccination systématique des équidés dans les zones à risque. Cette mesure, bien qu'elle ne protège pas directement l'homme, contribue à réduire la circulation virale et donc le risque de transmission [4].
Ressources et Associations de Patients
Bien que l'encéphalomyélite équine de l'Est soit rare, plusieurs ressources peuvent vous accompagner si vous êtes confronté à cette maladie. L'isolement face à une pathologie méconnue peut être particulièrement difficile à vivre.
En France, l'absence de cas autochtones limite les ressources spécialisées locales. Cependant, les associations de patients atteints d'encéphalites virales peuvent offrir un soutien précieux. Ces organisations comprennent les défis spécifiques liés aux séquelles neurologiques et proposent souvent des groupes de parole et des conseils pratiques.
Les centres de référence pour les maladies rares neurologiques constituent des ressources expertes. Bien que l'EEE ne figure pas parmi les maladies rares officiellement reconnues en France, ces centres possèdent l'expertise nécessaire pour orienter les patients et leurs familles.
Au niveau international, plusieurs organisations américaines se consacrent aux encéphalites virales. Leurs sites web proposent des informations actualisées, des témoignages de patients et des conseils pour la vie quotidienne. Ces ressources, bien qu'en anglais, peuvent s'avérer très utiles pour comprendre la maladie et ses implications.
N'oubliez pas que votre médecin traitant reste votre interlocuteur privilégié. Il peut vous orienter vers les spécialistes appropriés et vous aider à naviguer dans le système de soins français.
Nos Conseils Pratiques
Face à l'encéphalomyélite équine de l'Est, quelques conseils pratiques peuvent faire la différence, que ce soit en prévention ou en accompagnement d'un proche atteint [1].
Pour la prévention, planifiez soigneusement vos voyages dans les zones endémiques. Consultez les bulletins épidémiologiques locaux avant votre départ et adaptez vos activités en conséquence. Évitez les excursions dans les zones marécageuses en fin de journée, période de plus grande activité des moustiques vecteurs.
Si vous accompagnez un proche malade, préparez-vous à un parcours long et difficile. La rééducation neurologique demande du temps, de la patience et beaucoup d'encouragements. Documentez les progrès, même minimes, car ils constituent autant de victoires importantes dans ce combat.
Adaptez l'environnement familial aux nouvelles capacités du patient. Des modifications simples comme l'installation d'un éclairage adapté, la suppression des tapis glissants ou l'organisation différente des espaces peuvent considérablement améliorer l'autonomie et la sécurité.
Enfin, n'hésitez pas à solliciter l'aide des professionnels de santé. Ergothérapeutes, psychologues, assistants sociaux... Chaque spécialiste apporte son expertise pour optimiser la prise en charge globale. Votre médecin traitant peut coordonner ces interventions et vous orienter vers les ressources appropriées.
Quand Consulter un Médecin ?
Reconnaître les situations nécessitant une consultation médicale urgente peut sauver des vies dans le contexte de l'encéphalomyélite équine de l'Est. La rapidité d'évolution de cette maladie rend crucial le diagnostic précoce [1].
Consultez immédiatement si vous développez une fièvre élevée accompagnée de maux de tête sévères dans les 15 jours suivant un séjour dans une zone endémique. Ces symptômes, bien que non spécifiques, justifient une évaluation médicale approfondie compte tenu de la gravité potentielle de la maladie.
Les signes neurologiques constituent des urgences absolues : confusion, désorientation, troubles de l'élocution, convulsions ou diminution de la vigilance. N'attendez pas que ces symptômes s'aggravent, appelez immédiatement les services d'urgence. Chaque minute compte dans ce contexte.
Pour les enfants, soyez particulièrement vigilant aux changements de comportement : irritabilité inhabituelle, pleurs inconsolables, refus de s'alimenter ou somnolence excessive. Ces signes, parfois subtils, peuvent précéder l'apparition de complications neurologiques graves.
Même en l'absence de voyage récent, consultez si vous présentez des symptômes évocateurs d'encéphalite après une exposition aux moustiques dans des zones humides. Bien que l'EEE soit rare en France, la surveillance reste importante face aux changements climatiques et à la mondialisation des échanges .
Questions Fréquentes
L'encéphalomyélite équine de l'Est peut-elle se transmettre d'homme à homme ?
Non, cette maladie ne se transmet pas directement entre humains. La transmission nécessite obligatoirement la piqûre d'un moustique infecté.
Existe-t-il un vaccin pour l'homme ?
Actuellement, aucun vaccin humain n'est disponible. Seuls les vaccins vétérinaires existent pour protéger les chevaux.
Le changement climatique augmente-t-il les risques ?
Les modifications climatiques pourraient favoriser l'expansion des moustiques vecteurs vers de nouvelles régions, augmentant potentiellement les risques.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Publications Encéphalite équine de l'Est : fiche d'information. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [2] MesVaccins. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Séances AVF 2024 - Académie Vétérinaire de France. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] C Wilzius. Virus de l'encéphalite équine: une histoire de moustiques, d'oiseaux, de poneys et d'armes biologiques sans contre-mesures. 2022.Lien
- [8] M Cochet-Bernoin. Développement de modèles d'infection de cellules neurales équines par des arbovirus neurotropes. 2023.Lien
- [15] Encéphalite équine de l'Est. Gouvernement du Québec.Lien
Publications scientifiques
- Virus de l'encéphalite équine: une histoire de moustiques, d'oiseaux, de poneys et d'armes biologiques sans contre-mesures: une émergence rapide ou un lent déclin … (2022)
- [PDF][PDF] Développement, calcul et validation d'indices de risque pour les dyades moustique-virus en Afrique de l'Est et au Canada [PDF]
- Développement de modèles d'infection de cellules neurales équines par des arbovirus neurotropes et contribution à l'identification de molécules antivirales pour le … (2023)
- [PDF][PDF] Contributions à la santé publique de la surveillance entomologique du virus du Nil occidental (VNO) et autres arbovirus transmis par les moustiques dans un … (2024)[PDF]
- Effets combinés des changements climatiques et des changements d'utilisation des sols sur les populations de moustiques en Ontario (2025)
Ressources web
- Virus de l'Encéphalite Equine de l'Est (EEE) : Symptômes ... (madbarn.ca)
12 juin 2023 — En cas d'épidémie d'encéphalite chez les chevaux ou le bétail, il convient de rechercher une infection virale comme cause première. La présence ...
- Encéphalite équine de l'Est (quebec.ca)
27 nov. 2024 — Une période de fièvre et d'anorexie est l'un des premiers symptômes qui peuvent être observés. Par la suite, des symptômes neurologiques ...
- Encéphalites équines exotiques (respe.net)
Les symptômes neurologiques correspondent à des modifications de posture : raideur, incoordination des membres, ataxie, ou du comportement et de la vigilance : ...
- Agents Pathogènes – Virus de l'encéphalite équine de l'Est ... (canada.ca)
1 juin 2024 — L'infection systémique se caractérise par l'apparition soudaine de fièvre, de frissons, d'un malaise, de myalgie et d'arthralgie Note de bas de ...
- Encéphalite équine de l'Est (inspq.qc.ca)
L'infection par le virus de l'encéphalite équine de l'Est (VEEE) est une maladie rare causée par un Alphavirus transmis principalement par le moustique Culiseta ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
