Encéphalite Virale : Symptômes, Traitements et Guide Complet 2025
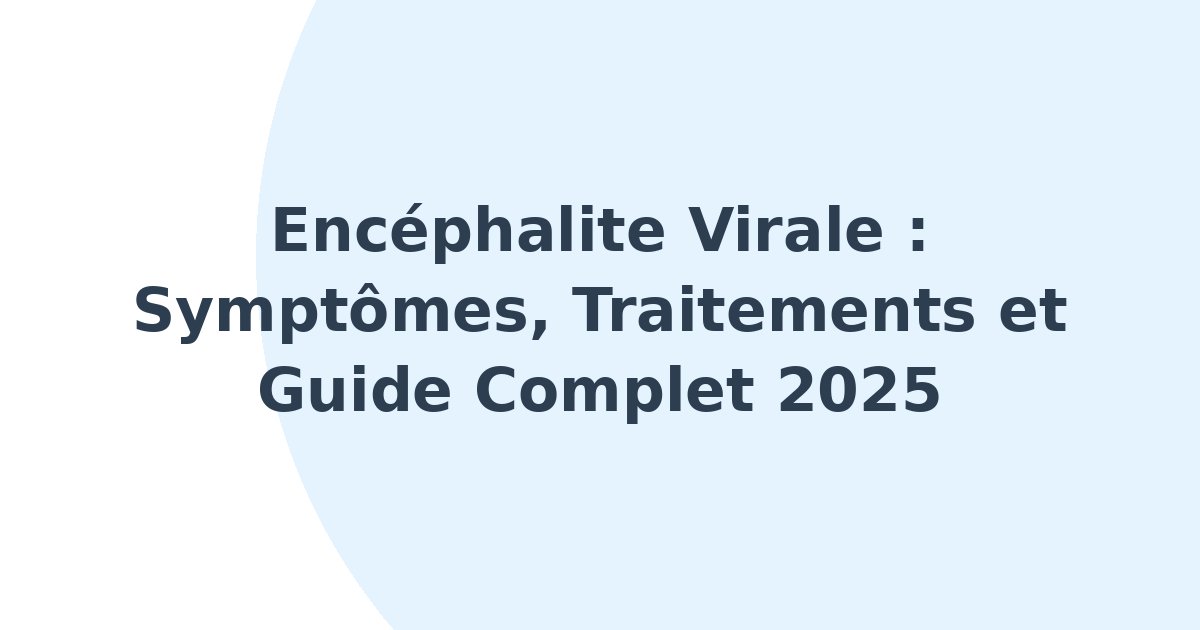
L'encéphalite virale représente une inflammation du cerveau causée par différents virus. Cette pathologie neurologique grave touche environ 1 500 personnes par an en France selon Santé Publique France [1,2]. Bien que rare, elle nécessite une prise en charge médicale urgente. Les symptômes peuvent évoluer rapidement, allant de simples maux de tête à des troubles neurologiques sévères. Heureusement, les avancées thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs aux patients.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Encéphalite virale : Définition et Vue d'Ensemble
L'encéphalite virale désigne une inflammation aiguë du tissu cérébral provoquée par une infection virale. Contrairement à la méningite qui affecte les enveloppes du cerveau, cette pathologie touche directement le parenchyme cérébral.
Mais qu'est-ce qui rend cette maladie si particulière ? En fait, les virus responsables peuvent atteindre le cerveau par différentes voies : sanguine, nerveuse ou par propagation directe depuis les sinus ou l'oreille moyenne [19]. Cette diversité d'accès explique pourquoi les symptômes varient tant d'un patient à l'autre.
D'ailleurs, il faut distinguer l'encéphalite primaire (infection directe du cerveau) de l'encéphalite secondaire (réaction auto-immune post-infectieuse). Cette distinction est cruciale car elle influence directement le choix thérapeutique [20].
L'important à retenir : cette pathologie constitue une urgence médicale absolue. Chaque heure compte pour limiter les séquelles neurologiques potentielles.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'incidence de l'encéphalite virale s'établit à environ 2,3 cas pour 100 000 habitants selon les dernières données de Santé Publique France [1,2]. Cette prévalence reste stable depuis 2020, mais certaines régions montrent des variations significatives.
La surveillance épidémiologique en Bretagne révèle une incidence légèrement supérieure à la moyenne nationale, avec 2,8 cas pour 100 000 habitants [3,5]. Cette différence s'explique notamment par une meilleure détection des cas liés aux entérovirus, particulièrement fréquents dans cette région [2].
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec l'Allemagne (2,1/100 000) et l'Italie (2,5/100 000). Cependant, les pays nordiques affichent des taux plus élevés, principalement dus à l'encéphalite à tiques [4]. D'un autre côté, les pays méditerranéens présentent davantage de cas liés au virus West Nile.
Concernant la répartition par âge, deux pics d'incidence se dessinent : les enfants de moins de 5 ans (4,2/100 000) et les adultes de plus de 65 ans (3,8/100 000) [1,2]. Cette bimodalité reflète la vulnérabilité des systèmes immunitaires immatures et affaiblis.
Les projections pour 2025-2030 suggèrent une augmentation modérée de 15% liée au vieillissement de la population et aux changements climatiques favorisant certains vecteurs [4]. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à 45 millions d'euros annuels, incluant les hospitalisations et la rééducation [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les virus responsables d'encéphalite sont nombreux et variés. Le virus de l'herpès simplex (HSV-1 et HSV-2) représente la cause la plus fréquente chez l'adulte, responsable de 40% des cas [11,12]. Chez l'enfant, les entérovirus dominent avec 35% des encéphalites virales [2].
Mais d'autres agents pathogènes méritent attention. Le virus varicelle-zona (VZV) peut provoquer des méningo-encéphalites sévères, même chez l'adulte immunocompétent [18]. Les arbovirus, transmis par les moustiques et tiques, gagnent du terrain avec le réchauffement climatique [13].
Certains facteurs augmentent significativement le risque. L'immunodépression, qu'elle soit liée à une maladie ou à un traitement, multiplie par 8 le risque d'encéphalite virale [16]. L'âge constitue également un facteur majeur : les très jeunes enfants et les personnes âgées présentent une vulnérabilité accrue.
Les voyages en zones endémiques exposent à des virus spécifiques comme celui de l'encéphalite japonaise ou de la fièvre du Nil occidental. La consommation de produits laitiers non pasteurisés peut transmettre le virus de l'encéphalite à tiques [13,17]. Concrètement, ces modes de transmission restent rares mais méritent d'être connus.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes d'encéphalite virale ressemblent souvent à une grippe banale. Fièvre, maux de tête et fatigue constituent la triade initiale dans 85% des cas [19]. Mais attention, cette phase peut évoluer rapidement vers des symptômes neurologiques plus inquiétants.
Les troubles de la conscience représentent un signal d'alarme majeur. Confusion, désorientation ou somnolence excessive doivent alerter immédiatement [16,20]. D'ailleurs, ces symptômes peuvent apparaître en quelques heures seulement, d'où l'importance de ne pas attendre.
Chez l'enfant, les manifestations diffèrent légèrement. Irritabilité excessive, refus de s'alimenter et convulsions sont plus fréquentes [2]. Les parents décrivent souvent un changement brutal du comportement : "Il n'était plus le même enfant".
Les symptômes neurologiques focaux varient selon la zone cérébrale atteinte. Troubles du langage, paralysies partielles ou troubles visuels peuvent survenir [21]. Certains patients développent des hallucinations ou des troubles psychiatriques aigus, rendant le diagnostic plus complexe [15].
Il faut savoir que l'évolution peut être imprévisible. Certains patients présentent une amélioration temporaire avant une aggravation secondaire. Cette "lune de miel" trompeuse ne doit pas rassurer : la surveillance médicale reste indispensable.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'encéphalite virale repose sur une démarche méthodique et urgente. L'examen clinique initial évalue l'état de conscience, recherche des signes neurologiques focaux et apprécie la gravité [21]. Mais c'est l'imagerie cérébrale qui apporte les premiers éléments objectifs.
L'IRM cérébrale constitue l'examen de référence. Elle révèle des lésions inflammatoires caractéristiques, notamment au niveau des lobes temporaux dans l'encéphalite herpétique [11]. Les séquences FLAIR et de diffusion permettent de détecter précocement l'œdème cérébral.
La ponction lombaire reste incontournable malgré son caractère invasif. L'analyse du liquide céphalorachidien (LCR) montre typiquement une pléocytose lymphocytaire avec hyperprotéinorachie modérée [19,21]. Les techniques de PCR permettent d'identifier le virus responsable en quelques heures.
Cependant, certaines situations compliquent le diagnostic. L'encéphalite auto-immune post-infectieuse peut mimer parfaitement une encéphalite virale [14]. Les coronavirus, notamment depuis la pandémie COVID-19, peuvent également provoquer des atteintes neurologiques similaires [14].
L'électroencéphalogramme (EEG) apporte des informations complémentaires précieuses. Il détecte les décharges épileptiques infracliniques et guide la surveillance neurologique. Bon à savoir : des anomalies EEG peuvent persister plusieurs mois après la guérison.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'encéphalite virale combine thérapie spécifique et prise en charge symptomatique. L'aciclovir intraveineux reste le traitement de référence pour l'encéphalite herpétique, avec une efficacité prouvée si administré précocement [12,19].
Pour les autres virus, les options thérapeutiques demeurent limitées. Les antiviraux comme le ganciclovir peuvent être utilisés dans certaines encéphalites à cytomégalovirus [20]. Malheureusement, la plupart des encéphalites virales ne disposent pas de traitement spécifique éprouvé.
La prise en charge symptomatique revêt donc une importance cruciale. Le contrôle de l'hypertension intracrânienne utilise le mannitol ou les solutés salés hypertoniques [19]. Les antiépileptiques préviennent et traitent les crises convulsives, fréquentes dans cette pathologie.
En réanimation, la surveillance neurologique rapprochée guide les décisions thérapeutiques. Certains patients nécessitent une ventilation assistée ou des mesures de neuroprotection [16]. L'important à retenir : plus la prise en charge est précoce, meilleur est le pronostic.
Les corticoïdes font débat dans cette pathologie. Ils peuvent réduire l'inflammation mais risquent d'aggraver l'infection virale. Leur utilisation reste donc réservée à des cas très spécifiques, sous surveillance étroite.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes en immunoinformatique ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. La recherche sur la "reverse vaccinology" permet d'identifier rapidement de nouvelles cibles vaccinales contre les virus émergents [9]. Cette approche révolutionnaire pourrait accélérer le développement de vaccins spécifiques.
Les travaux présentés lors du congrès Encéphale 2025 révèlent des pistes prometteuses [6]. Notamment, l'utilisation de neuroprotecteurs combinés aux antiviraux montre des résultats encourageants dans les modèles expérimentaux. Ces molécules limitent les dommages neuronaux secondaires à l'inflammation.
Une découverte majeure concerne le rôle du foie comme porte d'entrée vers le cerveau pour certains virus encéphalitiques [10]. Cette compréhension nouvelle ouvre la voie à des stratégies thérapeutiques ciblant cette voie de dissémination. Concrètement, des hépatoprotecteurs pourraient limiter la propagation virale.
Les centres de vaccination internationaux développent de nouveaux protocoles préventifs [8]. L'adaptation des schémas vaccinaux selon les zones géographiques et les populations à risque s'affine grâce aux données épidémiologiques récentes [7].
L'étude des microglies dans la pathogenèse révèle leur double rôle : protecteur initial puis délétère en cas d'activation excessive [11]. Cette compréhension guide le développement de modulateurs microglials, véritables espoirs thérapeutiques pour 2025-2026.
Vivre au Quotidien avec Encéphalite virale
La récupération après une encéphalite virale varie considérablement d'un patient à l'autre. Certains retrouvent leurs capacités antérieures en quelques semaines, tandis que d'autres conservent des séquelles durables [15,19]. Cette imprévisibilité rend l'accompagnement psychologique essentiel.
Les troubles cognitifs représentent les séquelles les plus fréquentes. Difficultés de concentration, troubles de la mémoire et fatigue chronique affectent 40% des survivants [20]. Heureusement, la rééducation neuropsychologique montre des résultats encourageants, même plusieurs mois après l'épisode aigu.
L'adaptation professionnelle constitue souvent un défi majeur. Beaucoup de patients doivent modifier leurs activités ou bénéficier d'aménagements de poste. Les troubles de l'humeur, fréquents dans les suites, nécessitent parfois un suivi psychiatrique spécialisé [15].
Mais il existe des stratégies d'adaptation efficaces. La reprise progressive d'activités, l'établissement de routines et le maintien des liens sociaux favorisent la récupération. Les associations de patients offrent un soutien précieux et des conseils pratiques basés sur l'expérience vécue.
Les Complications Possibles
L'encéphalite virale peut entraîner diverses complications, tant en phase aiguë qu'à distance. L'œdème cérébral représente la complication la plus redoutable, pouvant conduire à un engagement cérébral fatal [19]. Cette urgence neurochirurgicale nécessite parfois une décompression chirurgicale.
Les crises épileptiques surviennent chez 60% des patients en phase aiguë [21]. Elles peuvent persister après la guérison, nécessitant un traitement antiépileptique au long cours. Certains patients développent une épilepsie chronique, particulièrement après une encéphalite temporale.
Les complications psychiatriques méritent une attention particulière. Troubles de l'humeur, anxiété et parfois psychose peuvent apparaître des mois après l'épisode initial [15]. Ces manifestations, souvent méconnues, impactent significativement la qualité de vie.
D'un point de vue cognitif, les séquelles touchent principalement la mémoire et les fonctions exécutives. Les troubles du langage, bien que moins fréquents, peuvent persister chez certains patients [20]. Heureusement, la plasticité cérébrale permet souvent une récupération partielle, même tardive.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'encéphalite virale dépend de multiples facteurs, notamment le virus responsable et la précocité du traitement. L'encéphalite herpétique non traitée présente une mortalité de 70%, réduite à 15% avec un traitement précoce par aciclovir [12,19].
L'âge influence considérablement l'évolution. Les enfants de moins de 2 ans et les adultes de plus de 65 ans présentent un risque accru de séquelles neurologiques [2]. Cependant, la capacité de récupération des jeunes patients reste remarquable, même après des atteintes sévères.
Les facteurs pronostiques incluent le niveau de conscience initial, la présence de crises épileptiques et l'étendue des lésions à l'IRM [21]. Un score de Glasgow inférieur à 8 à l'admission constitue un facteur de mauvais pronostic. Néanmoins, des récupérations spectaculaires restent possibles, même dans les cas graves.
À long terme, 60% des patients récupèrent complètement ou conservent des séquelles mineures [20]. Les 40% restants présentent des handicaps variables, nécessitant un accompagnement spécialisé. L'important à retenir : chaque cas est unique et l'évolution peut surprendre positivement.
Peut-on Prévenir Encéphalite virale ?
La prévention de l'encéphalite virale repose sur plusieurs stratégies complémentaires. La vaccination constitue l'arme la plus efficace contre certains virus spécifiques [7,8]. Le vaccin contre l'encéphalite japonaise est recommandé pour les voyageurs en zone endémique, tandis que celui contre l'encéphalite à tiques protège les populations exposées.
Les mesures d'hygiène générale limitent la transmission de nombreux virus. Le lavage fréquent des mains, l'éviction des contacts avec les personnes malades et la désinfection des surfaces réduisent significativement les risques [2]. Ces gestes simples s'avèrent particulièrement efficaces contre les entérovirus.
Pour les virus transmis par vecteurs, la protection individuelle devient cruciale. Répulsifs, vêtements couvrants et moustiquaires constituent la première ligne de défense [13]. L'évitement des zones à risque pendant les périodes d'activité maximale des vecteurs complète cette approche.
Concernant l'alimentation, la pasteurisation des produits laitiers élimine le risque de transmission du virus de l'encéphalite à tiques [13,17]. Cette mesure préventive simple mais efficace mérite d'être connue, particulièrement dans les régions endémiques.
Enfin, la surveillance épidémiologique permet d'adapter les mesures préventives aux évolutions du risque [1,4]. Les systèmes d'alerte précoce, développés par Santé Publique France, orientent les recommandations de santé publique en temps réel.
Recommandations des Autorités de Santé
Santé Publique France a publié en 2024 des recommandations actualisées concernant la surveillance et la prise en charge de l'encéphalite virale [1,2]. Ces guidelines intègrent les dernières données épidémiologiques et les innovations thérapeutiques récentes.
La déclaration obligatoire de certaines encéphalites virales permet un suivi épidémiologique précis. Les encéphalites à virus West Nile, à virus de l'encéphalite japonaise et à virus de l'encéphalite à tiques font l'objet d'une surveillance renforcée [4]. Cette démarche vise à détecter précocement les émergences ou réémergences virales.
Les recommandations vaccinales évoluent selon les données de terrain. Le Centre de Vaccinations Internationales adapte ses protocoles aux zones géographiques et aux populations spécifiques [8]. Les voyageurs, travailleurs forestiers et populations immunodéprimées bénéficient de recommandations personnalisées.
En matière de diagnostic, les autorités préconisent une approche standardisée [21]. L'utilisation systématique de la PCR multiplex permet d'identifier rapidement les virus responsables. Cette technique, généralisée depuis 2023, améliore significativement la prise en charge thérapeutique.
Concernant la prévention, l'accent est mis sur l'information du public et la formation des professionnels de santé [3,5]. Les campagnes de sensibilisation ciblent particulièrement les populations à risque et les zones géographiques sensibles.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints d'encéphalite virale et leurs familles. L'Association Française des Traumatisés Crâniens propose un soutien spécialisé pour les séquelles neurologiques. Bien que non spécifique à l'encéphalite, elle offre des ressources précieuses pour la réadaptation.
Les centres de référence maladies rares neurologiques disposent d'équipes expertes dans la prise en charge des encéphalites. Ces structures, réparties sur le territoire national, coordonnent les soins complexes et participent à la recherche clinique.
Les plateformes d'information médicale fiables incluent le site de l'INSERM et celui de la Société Française de Neurologie. Ces ressources, validées scientifiquement, permettent aux patients de s'informer correctement sur leur pathologie.
D'ailleurs, les réseaux sociaux hébergent des groupes d'entraide entre patients. Ces communautés virtuelles, bien que non médicales, offrent un soutien psychologique précieux. L'échange d'expériences et de conseils pratiques aide à mieux vivre avec les séquelles.
Les services sociaux hospitaliers orientent vers les aides disponibles : reconnaissance de handicap, aménagements professionnels et soutien financier. Cette approche globale facilite la réinsertion sociale et professionnelle des patients.
Nos Conseils Pratiques
Face à une suspicion d'encéphalite virale, certains réflexes peuvent faire la différence. Ne minimisez jamais l'association fièvre-troubles neurologiques, même légers. Cette combinaison justifie toujours une consultation médicale urgente, particulièrement chez l'enfant et la personne âgée.
Pendant l'hospitalisation, maintenez un carnet de suivi détaillé. Notez l'évolution des symptômes, les traitements administrés et les questions à poser à l'équipe médicale. Cette démarche facilite la communication avec les soignants et aide à mieux comprendre la maladie.
Pour les proches, l'accompagnement psychologique s'avère souvent nécessaire. Voir un être cher transformé par la maladie génère stress et anxiété légitimes. N'hésitez pas à solliciter l'aide des psychologues hospitaliers ou des associations de familles.
Lors de la sortie d'hospitalisation, organisez progressivement le retour à domicile. Aménagez l'environnement si nécessaire, préparez les médicaments et planifiez les rendez-vous de suivi. Cette anticipation évite les complications et rassure le patient.
Enfin, restez vigilant aux signes de récidive ou de complications tardives. Maux de tête persistants, troubles cognitifs nouveaux ou crises épileptiques nécessitent une réévaluation médicale rapide. La surveillance reste importante plusieurs mois après l'épisode aigu.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains symptômes imposent une consultation médicale immédiate. La fièvre associée à des troubles neurologiques constitue le signal d'alarme principal. Confusion, désorientation, troubles de la parole ou de la vision nécessitent une évaluation urgente [19,20].
Chez l'enfant, soyez particulièrement attentif aux changements comportementaux. Irritabilité excessive, somnolence inhabituelle ou refus alimentaire peuvent révéler une encéphalite débutante [2]. Les convulsions, même brèves, justifient toujours un avis médical urgent.
Les maux de tête intenses et inhabituels, surtout s'ils s'accompagnent de nausées et de photophobie, doivent alerter. Cette triade évoque une atteinte méningée ou encéphalitique nécessitant une prise en charge spécialisée [21].
Pour les patients ayant des antécédents d'encéphalite, certains signes imposent une réévaluation. Réapparition de troubles cognitifs, crises épileptiques nouvelles ou aggravation de séquelles existantes nécessitent un bilan neurologique [15].
En cas de doute, privilégiez toujours la prudence. L'encéphalite virale constitue une urgence médicale où chaque heure compte. Mieux vaut une consultation "pour rien" qu'un retard de prise en charge aux conséquences potentiellement dramatiques.
Questions Fréquentes
L'encéphalite virale est-elle contagieuse ?
La contagiosité dépend du virus responsable. Les encéphalites à entérovirus peuvent se transmettre par contact direct, tandis que l'encéphalite herpétique n'est généralement pas contagieuse dans sa forme encéphalitique. Les précautions d'hygiène restent recommandées.
Combien de temps dure la récupération ?
La récupération varie de quelques semaines à plusieurs mois, voire années. 60% des patients récupèrent complètement ou conservent des séquelles mineures. La rééducation neuropsychologique peut améliorer les capacités même longtemps après l'épisode aigu.
Peut-on avoir plusieurs fois une encéphalite virale ?
Les récidives sont rares mais possibles, particulièrement avec le virus de l'herpès. La plupart des patients développent une immunité protectrice. Cependant, l'immunodépression peut favoriser les réactivations virales.
Les enfants sont-ils plus à risque ?
Les enfants de moins de 5 ans présentent effectivement un risque accru (4,2/100 000) en raison de leur système immunitaire immature. Cependant, leur capacité de récupération neurologique est souvent supérieure à celle des adultes.
Existe-t-il des séquelles invisibles ?
Oui, les troubles cognitifs légers, la fatigue chronique et les troubles de l'humeur peuvent passer inaperçus mais impacter significativement la qualité de vie. Un suivi neuropsychologique permet de les détecter et de les prendre en charge.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] ANALYSE DU RISQUE D'ÉMERGENCE DU VIRUS - Santé Publique France, 2024-2025Lien
- [2] Infections à entérovirus - Santé Publique France, 2024-2025Lien
- [3] Surveillance épidémiologique en région Bretagne - Santé Publique France, 2024-2025Lien
- [4] ANALYSE DU RISQUE D'ÉMERGENCE DU VIRUS - Santé Publique France, 2024-2025Lien
- [5] Bretagne - Santé Publique France, 2024-2025Lien
- [6] E-abstracts | Encephale 2025 - SoumissionsLien
- [7] MesVaccins - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [8] Centre de Vaccinations Internationales (CVI)Lien
- [9] Unveiling reverse vaccinology and immunoinformaticsLien
- [10] The liver as a potential gate to the brain for encephaliticLien
- [11] Étude de l'implication des microglies dans la pathogenèse de l'encéphalite herpétique expérimentale - O Uyar, 2022Lien
- [12] Deux cas d'encéphalite compliquant un zona ophtalmique - P Boitez, P Danneels, 2023Lien
- [13] Vers une meilleure compréhension du risque de transmission alimentaire du virus de l'encéphalite à tiques - L Mathews, 2024Lien
- [14] Des rhumes à la Covid-19: conséquences neurologiques potentielles d'une infection par les coronavirus - PJ Talbot, M Desforges, 2022Lien
- [15] Comment les Annales Médico-Psychologiques parlaient-elles de l'encéphalite léthargique voici cent ans? - O Walusinski, 2022Lien
- [16] Épisode de confusion aiguë chez un homme de 55 ans souffrant d'insuffisance rénale au stade terminal - S Halani, N Andany, 2022Lien
- [17] VERS UNE MEILLEURE COMPREHENSION DU RISQUE DE TRANSMISSION ALIMENTAIRE DU VIRUS DE L'ENCEPHALITE A TIQUES - L MATHEWS-MARTIN, 2024Lien
- [18] Méningo-encéphalite à VZV de l'adulte immunocompétent - SM Tiekwe, J Delforge, 2024Lien
- [19] Encéphalite - Troubles du cerveau, de la moelle épinière - MSD ManualsLien
- [20] Encéphalite : définition, causes et traitements - ElsanLien
- [21] Encéphalites infectieuses : quels outils pour le diagnostic - NeurologiesLien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Étude de l'implication des microglies dans la pathogenèse de l'encéphalite herpétique expérimentale (2022)[PDF]
- Deux cas d'encéphalite compliquant un zona ophtalmique. (2023)
- Vers une meilleure compréhension du risque de transmission alimentaire du virus de l'encéphalite à tiques par la consommation de produits laitiers non pasteurisés … (2024)
- Des rhumes à la Covid-19: conséquences neurologiques potentielles d'une infection par les coronavirus (2022)3 citations
- Comment les Annales Médico-Psychologiques parlaient-elles de l'encéphalite léthargique voici cent ans? (2022)
Ressources web
- Encéphalite - Troubles du cerveau, de la moelle épinière et ... (msdmanuals.com)
Symptômes de l'encéphalite · Fièvre · Céphalées · Modifications de la personnalité ou confusion · Convulsions · Paralysie ou engourdissement · Somnolence qui peut ...
- Encéphalite : définition, causes et traitements (elsan.care)
L'encéphalite est responsable de symptômes comme une fièvre accompagnée de céphalées. Ces signes sont accompagnés d'une altération de l'état de conscience ( ...
- Encéphalites infectieuses : quels outils pour le diagnostic (neurologies.fr)
31 janv. 2024 — Les encéphalites se manifestent par une encéphalopathie d'installation aiguë ou subaiguë (troubles du comportement, confusion, coma) et des ...
- Encéphalites virales (revmed.ch)
Les moyens permettant de poser le diagnostic d'une encéphalite virale, en plus des éléments cliniques, radiologiques (IRM), électrophysiologiques (EEG) et ...
- Encéphalites - Troubles neurologiques (msdmanuals.com)
Le diagnostic exige l'analyse du liquide céphalorachidien et une neuro-imagerie. Le traitement comprend des médicaments antiviraux lorsqu'ils sont indiqués (p.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
