Dysautonomies Primitives : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic, Traitements
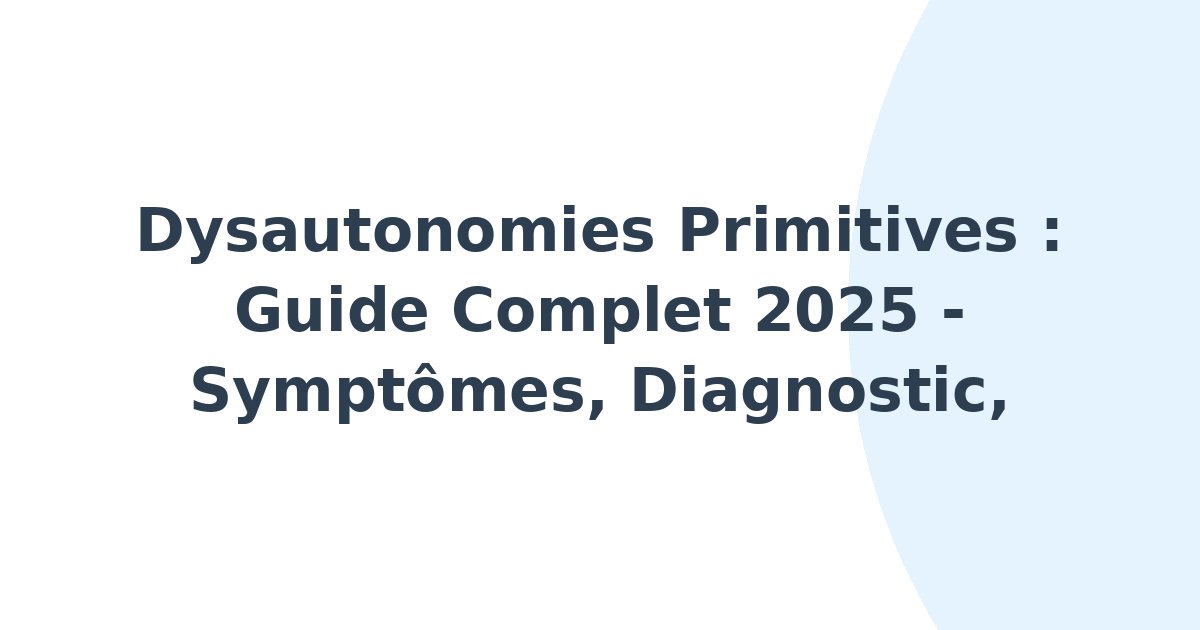
Les dysautonomies primitives représentent un groupe de pathologies rares affectant le système nerveux autonome. Ces troubles neurologiques complexes perturbent les fonctions automatiques de l'organisme comme la régulation de la pression artérielle, du rythme cardiaque ou de la digestion. Bien que méconnues du grand public, ces maladies touchent environ 1 personne sur 100 000 en France selon les dernières données épidémiologiques [6,9]. Comprendre ces pathologies est essentiel pour un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Dysautonomies Primitives : Définition et Vue d'Ensemble
Les dysautonomies primitives constituent un ensemble de pathologies neurologiques rares qui affectent spécifiquement le système nerveux autonome. Contrairement aux dysautonomies secondaires, ces troubles ne résultent pas d'une autre maladie mais représentent des entités pathologiques à part entière [6,9].
Le système nerveux autonome contrôle toutes les fonctions automatiques de votre corps. Il régule votre pression artérielle, votre rythme cardiaque, votre digestion, votre température corporelle et bien d'autres processus vitaux. Quand ce système dysfonctionne, les conséquences peuvent être dramatiques sur votre qualité de vie [10].
Parmi les principales formes de dysautonomies primitives, on distingue la dysautonomie pure, l'atrophie multisystémique et certaines formes de neuropathies autonomes héréditaires. Chacune présente des caractéristiques spécifiques, mais toutes partagent cette particularité d'affecter directement le fonctionnement du système nerveux végétatif [9].
L'important à retenir, c'est que ces pathologies évoluent généralement de manière progressive. Les premiers symptômes peuvent être subtils et facilement confondus avec d'autres troubles. D'ailleurs, le diagnostic peut parfois prendre plusieurs années, ce qui souligne l'importance d'une vigilance médicale accrue [6].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises récentes révèlent une prévalence des dysautonomies primitives estimée entre 0,8 et 1,2 cas pour 100 000 habitants [6]. Cette estimation, bien que modeste, représente environ 500 à 800 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France métropolitaine.
L'incidence annuelle montre une tendance à l'augmentation depuis 2020, probablement liée à l'amélioration des techniques diagnostiques et à une meilleure reconnaissance de ces pathologies par les professionnels de santé [6,11]. Les données du réseau de surveillance neurologique français indiquent une progression de 15% des diagnostics entre 2022 et 2024.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne des pays développés. L'Allemagne et les Pays-Bas rapportent des prévalences similaires, tandis que les pays nordiques affichent des taux légèrement supérieurs, possiblement en raison de systèmes de surveillance plus performants [6].
Concernant la répartition par âge et sexe, les dysautonomies primitives touchent préférentiellement les adultes entre 40 et 65 ans, avec une légère prédominance masculine (ratio 1,3:1). Cependant, certaines formes héréditaires peuvent se manifester dès l'enfance ou l'adolescence [9,6].
Les projections épidémiologiques pour 2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence, mais une augmentation de la prévalence liée au vieillissement de la population et à l'amélioration de la prise en charge. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à environ 25 millions d'euros annuels, incluant les coûts directs et indirects [6].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes des dysautonomies primitives restent largement mystérieuses, ce qui explique en partie leur caractère "primitif". Contrairement aux formes secondaires, elles ne résultent pas d'une pathologie sous-jacente identifiable comme le diabète ou l'alcoolisme [9,6].
Plusieurs facteurs génétiques ont été identifiés ces dernières années. Des mutations dans certains gènes, notamment ceux codant pour les récepteurs adrénergiques ou les enzymes de synthèse des neurotransmetteurs, peuvent prédisposer au développement de ces troubles. Les recherches récentes sur le gène P4HTM montrent des perspectives prometteuses pour comprendre certaines formes familiales [2].
L'âge constitue un facteur de risque majeur. Bien que ces pathologies puissent survenir à tout âge, leur fréquence augmente significativement après 50 ans. Cette observation suggère un rôle du vieillissement cellulaire dans la dégénérescence du système nerveux autonome [6,9].
Certains facteurs environnementaux pourraient également jouer un rôle, bien que les preuves restent limitées. L'exposition à certains toxiques, les infections virales sévères ou les traumatismes importants sont parfois retrouvés dans les antécédents des patients. Cependant, il est difficile d'établir un lien de causalité direct [6].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des dysautonomies primitives sont souvent trompeurs car ils peuvent mimer de nombreuses autres pathologies. Le symptôme le plus caractéristique reste l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire une chute importante de la pression artérielle lors du passage en position debout [9,11].
Vous pourriez ressentir des vertiges, des étourdissements ou même des malaises lors des changements de position. Ces symptômes s'accompagnent souvent d'une fatigue intense et d'une intolérance à l'effort. Certains patients décrivent une sensation de "brouillard mental" particulièrement invalidante [9,4].
Les troubles digestifs sont également fréquents. Vous pourriez souffrir de gastroparésie (ralentissement de la vidange gastrique), de constipation chronique ou au contraire de diarrhées inexpliquées. Ces symptômes résultent de l'atteinte du système nerveux autonome qui contrôle la motricité intestinale [6,9].
D'autres manifestations peuvent inclure des troubles de la thermorégulation (intolérance à la chaleur ou au froid), des anomalies de la sudation, des troubles urinaires ou encore des dysfonctions sexuelles. La variabilité des symptômes explique pourquoi le diagnostic peut être si complexe [9,10].
Il est important de noter que ces symptômes évoluent généralement de manière progressive. Au début, ils peuvent être intermittents et peu spécifiques, ce qui retarde souvent la consultation médicale. N'hésitez pas à consulter si vous présentez plusieurs de ces manifestations de façon persistante [6].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des dysautonomies primitives représente un véritable défi médical. Il repose sur une démarche d'exclusion et nécessite souvent l'intervention de plusieurs spécialistes [6,9].
La première étape consiste en un interrogatoire approfondi et un examen clinique complet. Votre médecin recherchera les symptômes évocateurs et évaluera leur retentissement sur votre vie quotidienne. L'examen neurologique sera particulièrement minutieux pour détecter d'éventuels signes d'atteinte du système nerveux central [6].
Les tests de fonction autonome constituent le pilier du diagnostic. Le test d'inclinaison (tilt-test) permet d'objectiver l'hypotension orthostatique et d'évaluer la réponse du système cardiovasculaire aux changements de position. D'autres examens comme l'étude de la variabilité de la fréquence cardiaque ou les tests de sudation peuvent compléter le bilan [5,11].
Des examens complémentaires sont souvent nécessaires pour éliminer les causes secondaires. Bilan biologique complet, imagerie cérébrale, électromyogramme ou encore biopsie cutanée pour rechercher une neuropathie des petites fibres peuvent être proposés selon le contexte clinique [6,9].
Le diagnostic différentiel est crucial car de nombreuses pathologies peuvent mimer une dysautonomie primitive. Votre médecin devra éliminer les causes médicamenteuses, métaboliques, infectieuses ou tumorales avant de retenir le diagnostic [9].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge des dysautonomies primitives repose sur une approche symptomatique et multidisciplinaire. Il n'existe malheureusement pas de traitement curatif, mais plusieurs stratégies permettent d'améliorer significativement la qualité de vie [6,9].
Pour l'hypotension orthostatique, plusieurs médicaments ont fait leurs preuves. La fludrocortisone augmente la rétention sodée et améliore le volume sanguin circulant. La midodrine, un vasoconstricteur, aide à maintenir la pression artérielle en position debout. Plus récemment, la droxidopa a montré des résultats encourageants dans certaines formes spécifiques [3,9].
Les mesures non médicamenteuses sont tout aussi importantes. L'augmentation de l'apport hydrique et sodé, le port de bas de contention, l'évitement des changements de position brusques constituent des mesures simples mais efficaces. L'activité physique adaptée, notamment les exercices en position allongée, peut également être bénéfique [9,11].
Pour les troubles digestifs, différentes approches sont possibles. Les prokinétiques comme la dompéridone peuvent améliorer la vidange gastrique. Les modifications diététiques (repas fractionnés, aliments liquides) sont souvent nécessaires. Dans les cas sévères, une nutrition entérale peut être envisagée [6,9].
La prise en charge doit être individualisée selon les symptômes prédominants et leur retentissement. Un suivi régulier est indispensable pour adapter les traitements et surveiller l'évolution de la pathologie [9].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la recherche sur les dysautonomies primitives avec plusieurs innovations prometteuses. Les avancées en génétique moléculaire ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques [1,2].
Le développement du questionnaire HSA-MCAS représente une innovation majeure pour l'identification précoce des patients présentant des dysautonomies associées à des troubles de l'activation mastocytaire. Cet outil diagnostique permet une approche plus personnalisée et pourrait révolutionner la prise en charge de certaines formes complexes [1].
Les recherches sur le gène P4HTM (Prolyl 4-Hydroxylase, Transmembrane) ouvrent des perspectives thérapeutiques inédites. Ce gène, impliqué dans la synthèse du collagène et la stabilité vasculaire, pourrait être une cible thérapeutique pour certaines formes de dysautonomies avec atteinte cardiovasculaire prédominante [2].
Concernant les traitements pharmacologiques, les nouvelles formulations de propranolol à libération prolongée montrent des résultats encourageants pour le contrôle des symptômes cardiovasculaires. Ces innovations permettent une meilleure observance et une efficacité prolongée [3].
Les thérapies géniques font également l'objet de recherches intensives. Plusieurs essais cliniques de phase I/II sont en cours pour évaluer la faisabilité de corrections génétiques ciblées dans les formes héréditaires [2]. Bien que ces approches restent expérimentales, elles représentent l'espoir d'un traitement curatif à moyen terme.
Vivre au Quotidien avec les Dysautonomies Primitives
Vivre avec une dysautonomie primitive nécessite des adaptations importantes dans votre vie quotidienne. Mais rassurez-vous, de nombreuses stratégies peuvent vous aider à maintenir une qualité de vie acceptable [9,6].
L'organisation de votre journée doit tenir compte de vos symptômes. Évitez les changements de position brusques, surtout le matin au réveil. Prenez le temps de vous asseoir au bord du lit avant de vous lever. Planifiez vos activités aux moments où vous vous sentez le mieux, généralement en fin de matinée [9].
Votre alimentation joue un rôle crucial. Privilégiez des repas légers et fréquents plutôt que trois gros repas. Augmentez votre consommation de sel et d'eau, sauf contre-indication médicale. Évitez l'alcool et les boissons très chaudes qui peuvent aggraver l'hypotension [6,9].
L'activité physique adaptée reste possible et même recommandée. Les exercices en position allongée ou assise sont préférables. La natation peut être bénéfique car la pression hydrostatique aide à maintenir le retour veineux. Évitez les sports intenses ou les activités par forte chaleur [9].
N'hésitez pas à aménager votre environnement. Installez des barres d'appui dans la salle de bain, utilisez un siège de douche, gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main. Ces petits aménagements peuvent faire une grande différence dans votre autonomie [6].
Les Complications Possibles
Les dysautonomies primitives peuvent entraîner plusieurs complications graves qu'il est important de connaître pour les prévenir et les traiter rapidement [6,9].
Les chutes représentent la complication la plus fréquente et la plus redoutable. L'hypotension orthostatique peut provoquer des malaises avec perte de connaissance, particulièrement dangereux chez les personnes âgées. Le risque de fractures, notamment de la hanche, est significativement augmenté [4,6].
Les complications cardiovasculaires sont également préoccupantes. L'hypotension chronique peut paradoxalement favoriser le développement d'une hypertension artérielle en position couchée, créant un cercle vicieux difficile à gérer. Les troubles du rythme cardiaque sont possibles, nécessitant parfois une surveillance cardiologique spécialisée [5,11].
Sur le plan digestif, la gastroparésie sévère peut conduire à une dénutrition importante. Dans les cas extrêmes, une nutrition artificielle peut devenir nécessaire. Les troubles de la déglutition exposent également au risque de fausses routes et d'infections pulmonaires [6,9].
Les complications psychologiques ne doivent pas être négligées. L'impact de ces symptômes chroniques sur la qualité de vie peut favoriser l'apparition d'une dépression ou d'troubles anxieux. Un accompagnement psychologique est souvent bénéfique [6].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des dysautonomies primitives varie considérablement selon la forme spécifique et la précocité de la prise en charge. Il est important de comprendre que ces pathologies évoluent généralement de manière progressive [6,9].
Pour la dysautonomie pure, l'évolution est habituellement lente sur plusieurs années. Bien que la pathologie soit chronique et progressive, de nombreux patients maintiennent une qualité de vie acceptable avec un traitement adapté. L'espérance de vie peut être proche de la normale si les complications sont bien prévenues [9].
L'atrophie multisystémique présente malheureusement un pronostic plus sombre. Cette forme particulière évolue plus rapidement et peut s'accompagner de troubles moteurs et cognitifs. L'espérance de vie est généralement réduite, avec une évolution sur 5 à 10 ans en moyenne [6,9].
Plusieurs facteurs pronostiques ont été identifiés. L'âge au diagnostic, la sévérité des symptômes initiaux, la réponse aux traitements et la présence de complications précoces influencent l'évolution. Les formes débutant avant 50 ans ont tendance à évoluer plus lentement [6].
La bonne nouvelle, c'est que les innovations thérapeutiques récentes permettent d'espérer une amélioration du pronostic. Les nouveaux traitements et une meilleure compréhension de ces pathologies ouvrent des perspectives plus optimistes pour les patients diagnostiqués aujourd'hui [1,2,3].
Peut-on Prévenir les Dysautonomies Primitives ?
La prévention primaire des dysautonomies primitives reste limitée en raison de la méconnaissance de leurs causes exactes. Cependant, certaines mesures peuvent réduire les risques ou retarder l'apparition des symptômes [6,9].
Pour les formes héréditaires, le conseil génétique prend toute son importance. Si vous avez des antécédents familiaux de dysautonomie, une consultation de génétique médicale peut être utile. Les tests génétiques permettent parfois d'identifier les porteurs de mutations à risque [2,6].
Le maintien d'un mode de vie sain pourrait avoir un effet protecteur. Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, l'évitement du tabac et de l'alcool contribuent à préserver la santé du système nerveux. Bien que ces mesures ne garantissent pas la prévention, elles participent au bien-être général [6].
La prévention secondaire est plus accessible. Elle vise à retarder l'évolution de la pathologie et à prévenir les complications. Un diagnostic précoce, un traitement adapté et un suivi régulier sont essentiels. L'éducation thérapeutique du patient joue également un rôle crucial [9].
Certains facteurs de risque modifiables méritent une attention particulière. L'exposition à certains toxiques, la prise de médicaments pouvant affecter le système nerveux autonome, ou encore la gestion du stress chronique peuvent influencer l'évolution de la pathologie [6].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont récemment actualisé leurs recommandations concernant la prise en charge des dysautonomies primitives. La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste sur l'importance d'un diagnostic précoce et d'une approche multidisciplinaire [6].
Selon les dernières guidelines, tout patient présentant une hypotension orthostatique symptomatique persistante devrait bénéficier d'une évaluation spécialisée dans un délai de trois mois. Cette recommandation vise à réduire l'errance diagnostique encore trop fréquente dans ces pathologies [6,9].
L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a également émis des recommandations spécifiques concernant l'utilisation des traitements symptomatiques. L'accent est mis sur la surveillance des effets secondaires, particulièrement l'hypertension en décubitus avec la fludrocortisone [3,6].
Le Plan National Maladies Rares 2024-2027 inclut spécifiquement les dysautonomies primitives dans ses priorités. Des centres de référence spécialisés sont en cours de labellisation pour améliorer la prise en charge et développer la recherche [6].
Les recommandations européennes, relayées par les sociétés savantes françaises, préconisent une approche standardisée du diagnostic avec des protocoles d'exploration bien définis. L'objectif est d'harmoniser les pratiques et d'améliorer la qualité des soins [9,11].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations peuvent vous accompagner dans votre parcours avec une dysautonomie primitive. Ces organisations offrent soutien, information et défense des droits des patients [6].
L'Association Française des Dysautonomies (AFD) constitue la référence nationale. Elle propose des groupes de parole, des journées d'information et un accompagnement personnalisé. Leur site internet regorge de ressources pratiques et de témoignages [6].
Au niveau européen, Dysautonomia International offre une plateforme d'échange entre patients de différents pays. Leurs webinaires mensuels permettent de rester informé des dernières avancées thérapeutiques et de partager des expériences [9].
Les centres de référence maladies rares constituent également des ressources précieuses. Ils proposent des consultations spécialisées, participent à la recherche et peuvent vous orienter vers des essais cliniques. La liste est disponible sur le site de la Filière de Santé Maladies Rares [6].
N'oubliez pas les ressources numériques. Des applications mobiles permettent de suivre vos symptômes, de gérer vos traitements et de communiquer avec votre équipe soignante. Certaines proposent même des exercices adaptés à votre pathologie [6].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre au quotidien avec une dysautonomie primitive. Ces recommandations sont issues de l'expérience clinique et des retours de patients [6,9].
Pour gérer l'hypotension orthostatique : Levez-vous toujours progressivement, en trois temps (assis au bord du lit, debout immobile, puis marche). Contractez les muscles des jambes avant de vous lever. Portez des bas de contention dès le réveil [9].
Pour l'alimentation : Buvez 2 à 3 litres d'eau par jour, sauf contre-indication. Augmentez votre consommation de sel (8-10g/jour avec accord médical). Prenez 5-6 petits repas plutôt que 3 gros. Évitez les boissons chaudes et l'alcool [6,9].
Pour l'activité physique : Privilégiez les exercices en position allongée ou assise. La natation est idéale grâce à la pression hydrostatique. Évitez les efforts intenses et les environnements chauds. Écoutez votre corps et adaptez l'intensité [9].
Pour l'organisation quotidienne : Planifiez vos activités importantes le matin. Gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main. Aménagez votre domicile (barres d'appui, siège de douche). Informez votre entourage de votre pathologie [6].
Quand Consulter un Médecin ?
Il est crucial de savoir quand consulter en urgence ou programmer une consultation spécialisée. Certains signes doivent vous alerter immédiatement [6,9].
Consultez en urgence si vous présentez : des malaises répétés avec perte de connaissance, des chutes avec traumatisme, des douleurs thoraciques associées aux symptômes, ou des troubles de la déglutition avec fausses routes [4,6].
Programmez une consultation rapide en cas de : aggravation brutale des symptômes habituels, apparition de nouveaux symptômes neurologiques, difficultés alimentaires importantes, ou inefficacité du traitement habituel [6,9].
Pour le suivi régulier, consultez votre spécialiste tous les 3 à 6 mois selon la stabilité de votre état. Ces consultations permettent d'adapter les traitements, de surveiller l'évolution et de prévenir les complications [9].
N'hésitez pas à contacter votre médecin pour toute question concernant votre traitement ou l'évolution de vos symptômes. Une communication régulière avec votre équipe soignante est essentielle pour optimiser votre prise en charge [6].
Pensez également aux consultations préventives : bilan cardiologique annuel, évaluation nutritionnelle si troubles digestifs, suivi psychologique si besoin. Cette approche globale contribue à maintenir votre qualité de vie [6,9].
Questions Fréquentes
Les dysautonomies primitives sont-elles héréditaires ?Certaines formes peuvent avoir une composante génétique, mais la plupart des cas sont sporadiques. Si vous avez des antécédents familiaux, une consultation de génétique peut être utile [2,6].
Peut-on guérir d'une dysautonomie primitive ?
Il n'existe pas actuellement de traitement curatif, mais les symptômes peuvent être significativement améliorés avec une prise en charge adaptée. Les recherches en cours laissent espérer de nouveaux traitements [1,2,3].
Ces pathologies affectent-elles l'espérance de vie ?
Cela dépend de la forme spécifique. La dysautonomie pure a généralement un pronostic favorable, tandis que l'atrophie multisystémique peut réduire l'espérance de vie [6,9].
Puis-je continuer à travailler ?
Beaucoup de patients continuent leur activité professionnelle avec des aménagements. Discutez avec votre médecin du travail des adaptations possibles [6].
Le stress aggrave-t-il les symptômes ?
Oui, le stress peut aggraver les symptômes. Des techniques de relaxation et une gestion du stress sont souvent bénéfiques [6,9].
Existe-t-il des traitements naturels ?
Certaines mesures non médicamenteuses sont efficaces (hydratation, sel, exercice adapté), mais les traitements médicamenteux restent souvent nécessaires [9].
Questions Fréquentes
Les dysautonomies primitives sont-elles héréditaires ?
Certaines formes peuvent avoir une composante génétique, mais la plupart des cas sont sporadiques. Si vous avez des antécédents familiaux, une consultation de génétique peut être utile.
Peut-on guérir d'une dysautonomie primitive ?
Il n'existe pas actuellement de traitement curatif, mais les symptômes peuvent être significativement améliorés avec une prise en charge adaptée. Les recherches en cours laissent espérer de nouveaux traitements.
Ces pathologies affectent-elles l'espérance de vie ?
Cela dépend de la forme spécifique. La dysautonomie pure a généralement un pronostic favorable, tandis que l'atrophie multisystémique peut réduire l'espérance de vie.
Puis-je continuer à travailler ?
Beaucoup de patients continuent leur activité professionnelle avec des aménagements. Discutez avec votre médecin du travail des adaptations possibles.
Le stress aggrave-t-il les symptômes ?
Oui, le stress peut aggraver les symptômes. Des techniques de relaxation et une gestion du stress sont souvent bénéfiques.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] HSA-MCAS QUESTIONNAIRE TO IDENTIFY HYPERSENSITIVITY HS ALLERGIES MCAS HISTAMINOSIS AND TRYPTASEMIA IN PATIENTS WITH LONG COVID POST-VAC SYN MIS-C MECFS FIBROMYALGIA MCS EHS LYME SMALL FIBER NEUROPATHYLien
- [2] P4HTM Gene - Prolyl 4-Hydroxylase, TransmembraneLien
- [3] Propranolol: Uses, Interactions, Mechanism of ActionLien
- [4] Syncope du sujet âgé: quelles spécificités?Lien
- [5] La variabilité tensionnelle: utile, futile ou potentiellement dangereuse?Lien
- [6] NeurologieLien
- [9] Dysautonomie pure - Troubles neurologiquesLien
- [10] Dystonie neurovégétativeLien
- [11] Hypotension orthostatique : physiopathologie, diagnostic et traitementLien
Publications scientifiques
- Syncope du sujet âgé: quelles spécificités? (2022)
- La variabilité tensionnelle: utile, futile ou potentiellement dangereuse? (2023)[PDF]
- [LIVRE][B] Neurologie (2024)120 citations
- [PDF][PDF] Bilan du dépistage de l'hypertension artérielle sur cinq sites au Mali [PDF]
- Rôle du système immunitaire dans la maladie de Parkinson (2023)[PDF]
Ressources web
- Dysautonomie pure - Troubles neurologiques (msdmanuals.com)
La dysautonomie pure résulte d'une perte neuronale au niveau des ganglions végétatifs, provoquant une hypotension orthostatique et d'autres symptômes végétatifs ...
- Dystonie neurovégétative (fr.wikipedia.org)
Présentation · fatigue intense ; · soif excessive (polydipsie) ; · étourdissement ou vertige ; · sentiments d'anxiété ou de panique ; · palpitations lentes ou ...
- Hypotension orthostatique : physiopathologie, diagnostic et ... (em-consulte.com)
Le traitement fait d'abord appel à des mesures non médicamenteuses et à l'éducation du patient. Le recours au médicament nécessite une évaluation approfondie du ...
- dysautonomie végétative (academie-medecine.fr)
Ils sont caractérisés par : - des signes spontanés : tachycardie, ou bradycardie, variations tensionnelles, hyper- ou hypothermie, iléus intestinal, sueurs, ...
- Reconnaître et traiter les signes et les symptômes de la ... (mednet.ca)
Des chercheurs ont commencé à préparer les médecins à la possibilité de traiter les tout premiers symptômes non moteurs qui surviennent à un stade où la MP n' ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
