Atrophie Multisystématisée : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
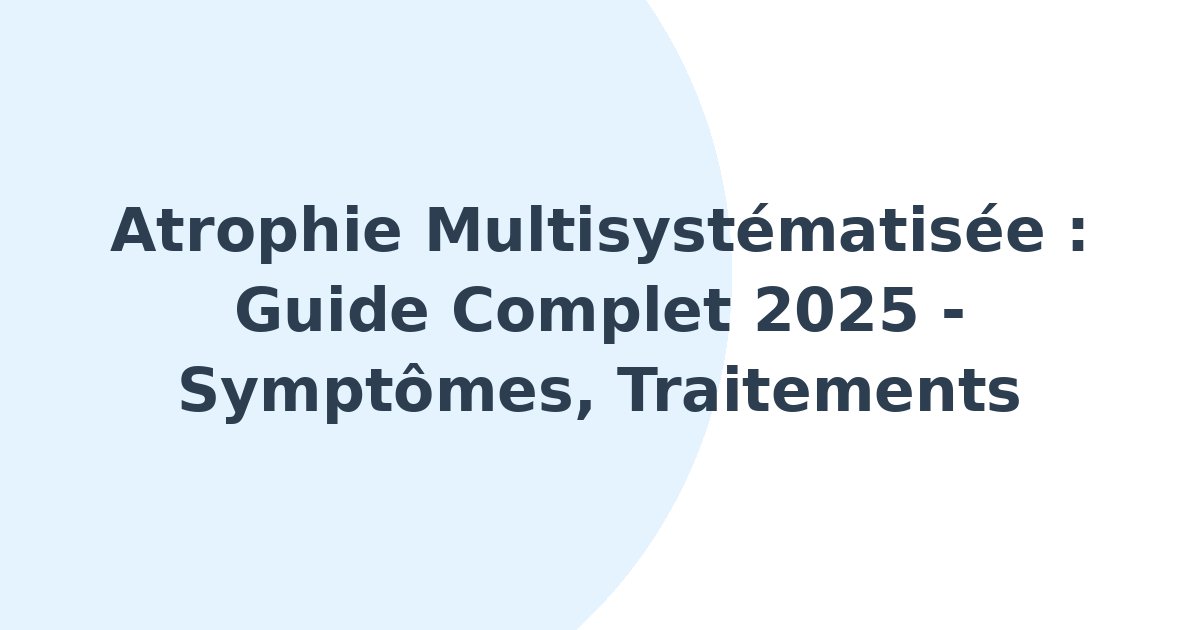
L'atrophie multisystématisée (AMS) est une maladie neurodégénérative rare qui affecte plusieurs systèmes de l'organisme. Cette pathologie progressive touche principalement les adultes après 50 ans et se caractérise par une dégénérescence des neurones dans différentes régions du cerveau. Bien que rare, l'AMS nécessite une prise en charge spécialisée pour améliorer la qualité de vie des patients.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Atrophie multisystématisée : Définition et Vue d'Ensemble
L'atrophie multisystématisée est une maladie neurodégénérative complexe qui affecte simultanément plusieurs systèmes neurologiques [1,16]. Cette pathologie rare se caractérise par une accumulation anormale d'une protéine appelée alpha-synucléine dans les cellules gliales du cerveau [7].
Contrairement à d'autres maladies neurodégénératives, l'AMS présente la particularité d'atteindre à la fois le système nerveux autonome, le système moteur et parfois les fonctions cognitives. Les recherches récentes suggèrent une propagation de type prion-like de l'alpha-synucléine au sein des structures cérébrales [7].
On distingue deux formes principales d'AMS selon les symptômes prédominants : l'AMS-P (forme parkinsonienne) et l'AMS-C (forme cérébelleuse). Cette classification aide les médecins à adapter la prise en charge selon le profil clinique de chaque patient [1,16].
L'évolution de cette maladie est généralement progressive et irréversible. Cependant, les avancées thérapeutiques récentes offrent de nouveaux espoirs pour ralentir sa progression et améliorer les symptômes [2,3].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'atrophie multisystématisée touche environ 4 à 5 personnes sur 100 000 habitants selon les données du PNDS de la HAS [1]. Cette prévalence relativement faible classe l'AMS parmi les maladies rares, mais son impact sur les patients et leurs familles reste considérable.
L'incidence annuelle est estimée à 0,6 à 0,7 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an [1]. Ces chiffres montrent une stabilité relative sur les dernières années, mais les techniques diagnostiques améliorées permettent aujourd'hui une meilleure détection des cas.
Au niveau international, la prévalence varie légèrement selon les régions. Les pays européens rapportent des taux similaires à la France, tandis que certaines études asiatiques suggèrent une prévalence légèrement inférieure [1]. Cette variation pourrait s'expliquer par des facteurs génétiques ou environnementaux encore mal compris.
L'âge moyen au diagnostic se situe autour de 60 ans, avec une légère prédominance masculine (ratio 1,3:1) [1,10]. Bon à savoir : les formes précoces avant 40 ans restent exceptionnelles et nécessitent des investigations génétiques approfondies [8].
Les projections épidémiologiques pour les prochaines décennies suggèrent une augmentation modérée du nombre de cas, principalement liée au vieillissement de la population française [1].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes exactes de l'atrophie multisystématisée restent largement mystérieuses. Contrairement à d'autres maladies neurodégénératives, l'AMS ne présente pas de forme héréditaire clairement établie [1,16]. Cependant, des recherches récentes explorent le rôle potentiel de certaines variations génétiques.
Une étude française de 2025 s'intéresse notamment à l'expansion GAA dans le gène FGF14 et son association possible avec l'AMS [8]. Bien que ces travaux soient encore préliminaires, ils ouvrent de nouvelles pistes de compréhension des mécanismes sous-jacents.
Les facteurs environnementaux font également l'objet d'investigations. Certains chercheurs évoquent l'exposition à des toxines ou des infections virales comme déclencheurs potentiels, mais aucune preuve formelle n'a été établie [16].
L'âge reste le principal facteur de risque identifié. La maladie survient exceptionnellement avant 40 ans et son incidence augmente progressivement avec l'âge [1]. D'autres facteurs comme le stress oxydatif ou l'inflammation chronique sont également étudiés.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'atrophie multisystématisée sont variés et évoluent progressivement. Ils se regroupent en trois grandes catégories : les troubles moteurs, les dysfonctionnements autonomes et parfois les atteintes cognitives [1,16].
Les troubles moteurs incluent une rigidité musculaire, des tremblements et une lenteur des mouvements similaires à ceux de la maladie de Parkinson. Dans la forme cérébelleuse, vous pourriez observer des troubles de l'équilibre, une démarche instable et des difficultés de coordination [16].
Les dysfonctionnements autonomes sont souvent les premiers à apparaître. L'hypotension orthostatique (chute de tension en se levant) est particulièrement fréquente et peut provoquer des malaises [1]. Les troubles urinaires, la constipation et les dysfonctionnements sexuels font également partie du tableau clinique.
Certains patients développent des troubles du sommeil, notamment des comportements anormaux pendant le sommeil paradoxal. Ces symptômes peuvent précéder de plusieurs années les autres manifestations de la maladie [16].
Il est important de noter que chaque personne présente une combinaison unique de symptômes. L'évolution peut être rapide chez certains patients, plus lente chez d'autres [10].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'atrophie multisystématisée repose sur une démarche clinique rigoureuse, car aucun test unique ne permet de confirmer la maladie [1]. Les médecins s'appuient sur des critères diagnostiques précis établis par les sociétés savantes internationales.
La première étape consiste en un examen neurologique complet évaluant les fonctions motrices, l'équilibre et les réflexes autonomes. Le test d'hypotension orthostatique est systématiquement réalisé : une chute de tension de plus de 20 mmHg en position debout oriente vers le diagnostic [1].
L'IRM cérébrale joue un rôle crucial dans le diagnostic différentiel. Elle peut révéler des signes caractéristiques comme l'atrophie du pont, du cervelet ou des noyaux gris centraux [9,11]. Le "signe de la phalange" observé à l'IRM aide à distinguer l'AMS d'autres ataxies [9].
Des examens complémentaires peuvent être nécessaires : scintigraphie cardiaque au MIBG, polysomnographie pour les troubles du sommeil, ou encore tests autonomes spécialisés [1]. Ces investigations permettent d'écarter d'autres pathologies et de préciser le sous-type d'AMS.
Le diagnostic définitif ne peut être posé qu'après plusieurs mois d'évolution, car il faut observer la progression des symptômes [16]. Cette attente peut être difficile à vivre, mais elle est nécessaire pour garantir la précision du diagnostic.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Actuellement, il n'existe pas de traitement curatif pour l'atrophie multisystématisée, mais plusieurs approches thérapeutiques permettent d'améliorer significativement la qualité de vie [1,16]. La prise en charge est multidisciplinaire et personnalisée selon les symptômes de chaque patient.
Pour les troubles moteurs, la lévodopa peut être tentée, bien qu'elle soit moins efficace que dans la maladie de Parkinson. Environ 30% des patients montrent une amélioration partielle [1]. Les kinésithérapeutes jouent un rôle essentiel pour maintenir la mobilité et prévenir les chutes.
L'hypotension orthostatique nécessite une approche spécifique : augmentation des apports en sel et en eau, port de bas de contention, et parfois prescription de fludrocortisone ou de midodrine [1]. Ces mesures peuvent considérablement réduire les malaises.
Les troubles urinaires bénéficient de traitements symptomatiques adaptés : anticholinergiques pour l'hyperactivité vésicale, auto-sondages en cas de rétention [16]. Un suivi urologique régulier est recommandé.
La prise en charge nutritionnelle est cruciale, car les troubles de déglutition peuvent survenir. L'orthophoniste intervient pour maintenir les capacités de communication et prévenir les fausses routes [1].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la recherche sur l'atrophie multisystématisée avec plusieurs innovations prometteuses [2,3]. Les essais cliniques se multiplient et explorent de nouvelles approches thérapeutiques ciblant les mécanismes fondamentaux de la maladie.
L'ATH434 d'Alterity Therapeutics fait l'objet d'un essai de phase 2 particulièrement encourageant [6]. Ce composé vise à réduire l'accumulation de fer dans le cerveau, un mécanisme potentiellement impliqué dans la progression de l'AMS. Les premiers résultats présentés en 2025 montrent des signaux positifs sur le ralentissement de la progression.
Une innovation diagnostique remarquable émerge avec les recherches sur l'odeur corporelle des patients [4]. Cette approche révolutionnaire pourrait permettre un diagnostic précoce basé sur l'analyse olfactive, ouvrant la voie à une détection plus rapide de la maladie.
Les essais cliniques de l'UCSD pour 2025 explorent plusieurs pistes thérapeutiques simultanément [5]. Ces études incluent des approches neuroprotectrices, des thérapies géniques et des traitements immunomodulateurs.
Les données présentées aux JNLF 2024 révèlent également des avancées dans la compréhension des biomarqueurs de progression [3]. Ces outils permettront bientôt de mieux suivre l'évolution de la maladie et d'adapter les traitements en conséquence.
Vivre au Quotidien avec Atrophie multisystématisée
Vivre avec une atrophie multisystématisée nécessite des adaptations importantes, mais de nombreuses stratégies permettent de maintenir une bonne qualité de vie [1,16]. L'organisation du quotidien devient essentielle pour gérer les symptômes et préserver l'autonomie le plus longtemps possible.
L'aménagement du domicile constitue une priorité. Installer des barres d'appui dans la salle de bain, éliminer les tapis glissants et améliorer l'éclairage réduisent considérablement les risques de chute [16]. Ces modifications simples peuvent faire une grande différence au quotidien.
La gestion de l'hypotension orthostatique demande des précautions particulières : se lever lentement, éviter les stations debout prolongées, porter des bas de contention [1]. Beaucoup de patients apprennent à reconnaître les signes avant-coureurs des malaises.
L'activité physique adaptée reste bénéfique malgré les limitations. La kinésithérapie, la balnéothérapie ou le tai-chi peuvent aider à maintenir l'équilibre et la force musculaire [16]. L'important est de rester actif dans la mesure de ses possibilités.
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Rejoindre des groupes de patients ou consulter un psychologue aide à mieux accepter la maladie et à développer des stratégies d'adaptation [1].
Les Complications Possibles
L'atrophie multisystématisée peut entraîner diverses complications qui nécessitent une surveillance médicale régulière [1,16]. La connaissance de ces risques permet une prise en charge préventive et une meilleure qualité de vie.
Les troubles respiratoires représentent l'une des complications les plus sérieuses. Le stridor nocturne (bruit respiratoire anormal) peut survenir et nécessiter parfois une trachéotomie [1]. Une surveillance pneumologique régulière est donc recommandée.
Les chutes constituent un risque majeur en raison des troubles de l'équilibre et de l'hypotension orthostatique. Elles peuvent entraîner des fractures, notamment de la hanche, particulièrement graves chez ces patients [16]. La prévention reste la meilleure stratégie.
Les complications urologiques incluent les infections urinaires récurrentes et la rétention chronique d'urine [1]. Un suivi urologique permet de prévenir l'insuffisance rénale et d'adapter les traitements.
Sur le plan nutritionnel, les troubles de déglutition peuvent conduire à la dénutrition ou aux pneumopathies d'inhalation [16]. L'intervention précoce d'une équipe spécialisée (orthophoniste, diététicien) est cruciale.
Enfin, l'impact psychologique ne doit pas être sous-estimé. La dépression et l'anxiété sont fréquentes et peuvent aggraver les symptômes physiques [1].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'atrophie multisystématisée reste malheureusement sombre, avec une évolution généralement progressive et irréversible [1,16]. Cependant, la variabilité individuelle est importante et certains patients maintiennent une qualité de vie acceptable pendant plusieurs années.
L'espérance de vie moyenne après le diagnostic se situe entre 6 et 10 ans, mais cette donnée cache de grandes disparités [1]. Certains patients évoluent rapidement en quelques années, tandis que d'autres conservent une autonomie relative pendant une décennie ou plus.
Les études de cohorte françaises récentes, notamment celle du centre de référence national, apportent des données plus précises sur la progression de la maladie [10]. Ces travaux permettent de mieux informer les patients et d'adapter les prises en charge.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic : l'âge au diagnostic, le sous-type d'AMS, la rapidité d'évolution initiale et la réponse aux traitements [1]. Les formes à prédominance cérébelleuse semblent parfois évoluer plus lentement que les formes parkinsoniennes.
Il est important de souligner que les innovations thérapeutiques récentes pourraient modifier ces données pronostiques dans les années à venir [2,6]. L'espoir réside dans les traitements neuroprotecteurs en développement.
Peut-on Prévenir Atrophie multisystématisée ?
Actuellement, il n'existe aucun moyen prouvé de prévenir l'atrophie multisystématisée [1,16]. Cette situation s'explique par la méconnaissance des causes exactes de la maladie et l'absence de facteurs de risque modifiables clairement identifiés.
Cependant, certaines mesures de santé générale pourraient théoriquement avoir un effet protecteur. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et la limitation de l'exposition aux toxines environnementales sont toujours bénéfiques pour la santé neurologique [16].
Les recherches actuelles sur les biomarqueurs précoces pourraient un jour permettre une détection avant l'apparition des symptômes [4,11]. Cette approche préventive secondaire ouvrirait la voie à des interventions thérapeutiques plus précoces et potentiellement plus efficaces.
Pour les familles concernées, il est important de savoir que l'AMS n'est pas héréditaire dans la grande majorité des cas [1]. Les formes familiales sont exceptionnelles et font l'objet de recherches génétiques spécialisées [8].
L'avenir de la prévention réside probablement dans une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires de la maladie et l'identification de cibles thérapeutiques précoces [2,3].
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024-2025 un protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) spécifiquement dédié à l'atrophie multisystématisée [1]. Ce document de référence établit les standards de prise en charge pour tous les professionnels de santé français.
Le PNDS recommande une approche multidisciplinaire coordonnée impliquant neurologues, cardiologues, urologues, kinésithérapeutes et autres spécialistes selon les besoins [1]. Cette coordination est essentielle pour optimiser la prise en charge globale du patient.
Concernant le diagnostic, les autorités insistent sur l'importance d'un bilan complet incluant l'IRM cérébrale, les tests autonomes et l'évaluation neuropsychologique [1]. Le diagnostic différentiel avec d'autres syndromes parkinsoniens atypiques doit être rigoureux.
Pour le suivi, la HAS recommande des consultations spécialisées au moins tous les 6 mois, avec adaptation de la fréquence selon l'évolution [1]. L'évaluation régulière des fonctions respiratoires, urinaires et de la déglutition fait partie intégrante du suivi.
Les recommandations soulignent également l'importance de l'information du patient et de sa famille, ainsi que l'orientation vers les associations de patients et les dispositifs d'aide sociale [1].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients atteints d'atrophie multisystématisée et leurs familles [16]. Ces structures offrent un soutien précieux, des informations actualisées et facilitent les échanges entre patients.
L'Association France Parkinson inclut dans ses missions l'accompagnement des patients avec syndromes parkinsoniens atypiques, dont l'AMS. Elle propose des groupes de parole, des formations pour les aidants et des informations sur les dernières avancées thérapeutiques.
La Fondation pour la Recherche sur le Cerveau finance des projets de recherche spécifiquement dédiés à l'AMS [17]. Elle constitue une source d'information fiable sur les avancées scientifiques et les essais cliniques en cours.
Au niveau européen, plusieurs réseaux de recherche coordonnent les efforts internationaux. Ces collaborations permettent d'accélérer le développement de nouveaux traitements et d'harmoniser les pratiques de prise en charge.
Les plateformes en ligne spécialisées offrent également des ressources précieuses : forums de discussion, webinaires éducatifs, et mise en relation avec des centres experts [16]. Ces outils numériques complètent l'accompagnement traditionnel.
Nos Conseils Pratiques
Gérer au quotidien une atrophie multisystématisée demande de l'organisation et des adaptations concrètes. Voici nos conseils pratiques basés sur l'expérience des patients et les recommandations médicales [1,16].
Pour l'hypotension orthostatique : Levez-vous toujours lentement, en plusieurs étapes. Asseyez-vous d'abord au bord du lit, attendez quelques secondes, puis levez-vous progressivement. Gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main [1].
Pour prévenir les chutes : Portez des chaussures antidérapantes, éliminez les obstacles au sol, installez des éclairages automatiques dans les couloirs. N'hésitez pas à utiliser une canne ou un déambulateur si nécessaire [16].
Pour l'alimentation : Privilégiez les repas fractionnés, riches en sel si votre médecin l'autorise. Évitez les aliments trop chauds qui peuvent aggraver l'hypotension. Restez hydraté tout au long de la journée [1].
Pour le sommeil : Surélevez la tête de votre lit de 10-15 cm pour réduire l'hypotension matinale. Maintenez des horaires réguliers et créez un environnement propice au repos [16].
Enfin, n'oubliez pas de communiquer régulièrement avec votre équipe médicale. Tenez un carnet de bord de vos symptômes pour faciliter le suivi [1].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et justifier une consultation médicale rapide, que vous soyez déjà suivi pour une AMS ou que vous présentiez des symptômes évocateurs [1,16].
Consultez en urgence si vous présentez des difficultés respiratoires, notamment un bruit anormal lors de la respiration (stridor). Ces symptômes peuvent nécessiter une prise en charge immédiate [1].
Consultez rapidement en cas de chutes répétées, de malaises fréquents ou de troubles de la déglutition avec fausses routes. Ces complications peuvent s'aggraver rapidement et nécessitent une adaptation du traitement [16].
Pour un premier diagnostic, consultez votre médecin traitant si vous présentez une association de symptômes évocateurs : vertiges en se levant, troubles de l'équilibre, rigidité musculaire, troubles urinaires [1]. Il vous orientera vers un neurologue spécialisé.
Les patients déjà diagnostiqués doivent maintenir un suivi régulier même en l'absence de nouveaux symptômes. L'évolution de l'AMS peut être insidieuse et nécessiter des ajustements thérapeutiques [1].
N'hésitez jamais à contacter votre équipe médicale en cas de doute ou d'inquiétude. Une prise en charge précoce des complications améliore toujours le pronostic [16].
Questions Fréquentes
L'atrophie multisystématisée est-elle héréditaire ?Non, dans la grande majorité des cas, l'AMS n'est pas héréditaire [1]. Les formes familiales sont exceptionnelles et font l'objet de recherches génétiques spécialisées.
Peut-on confondre l'AMS avec la maladie de Parkinson ?
Oui, au début de l'évolution, la distinction peut être difficile [16]. C'est pourquoi le diagnostic nécessite plusieurs mois d'observation et des examens spécialisés.
Les traitements de la maladie de Parkinson sont-ils efficaces dans l'AMS ?
Partiellement. Environ 30% des patients répondent à la lévodopa, mais l'effet est généralement moins marqué et moins durable que dans la maladie de Parkinson [1].
Existe-t-il des essais cliniques en France ?
Oui, plusieurs centres français participent à des essais internationaux [2,3]. Renseignez-vous auprès de votre neurologue ou consultez les registres d'essais cliniques.
Comment expliquer la maladie à ses proches ?
Utilisez des termes simples : "C'est une maladie qui affecte plusieurs systèmes du corps, notamment l'équilibre et la tension artérielle" [16]. Les associations de patients proposent des brochures explicatives.
Peut-on continuer à travailler avec une AMS ?
Cela dépend de l'évolution et du type d'activité professionnelle. Des aménagements de poste ou une reconversion peuvent être envisagés [1].
Questions Fréquentes
L'atrophie multisystématisée est-elle héréditaire ?
Non, dans la grande majorité des cas, l'AMS n'est pas héréditaire. Les formes familiales sont exceptionnelles.
Peut-on confondre l'AMS avec la maladie de Parkinson ?
Oui, au début de l'évolution, la distinction peut être difficile. Le diagnostic nécessite plusieurs mois d'observation.
Les traitements de Parkinson sont-ils efficaces dans l'AMS ?
Partiellement. Environ 30% des patients répondent à la lévodopa, mais l'effet est moins marqué.
Existe-t-il des essais cliniques en France ?
Oui, plusieurs centres français participent à des essais internationaux. Consultez votre neurologue.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Texte du PNDS. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Études cliniques | Utilisation des données pour la recherche. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] JNLF 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] L'ODEUR DES PATIENTS, PISTE P - DUMAS. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] UCSD Multiple System Atrophy Clinical Trials for 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Alterity Therapeutics Presents Encouraging New Data from ATH434 Phase 2 Trial. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] B Vovard, A Chevrollier. L'étude de l'ultrastructure des inclusions protéiques dans l'atrophie multi-systématisée suggère une propagation prion-like de l'α-synucléine. 2023.Lien
- [8] T Wirth, C Delvallée. L'expansion GAA dans FGF14 est-elle associée à l'atrophie multisystématisée ou aux ataxies cérébelleuses précoces? 2025.Lien
- [9] V Schneider, T Wirth. Intérêt du «signe de la phalange» pour distinguer l'atrophie multi-systématisée de l'ataxie sporadique tardive. 2022.Lien
- [10] T Saulnier. Étude de la progression de l'Atrophie Multi-Systématisée dans la cohorte française du centre de référence national. 2024.Lien
- [11] F Marchand, R Viard. Étude prospective des biomarqueurs de marche et d'IRM multimodale chez les patients de la cohorte GAIT'N'PARK. 2024.Lien
- [16] Atrophie multisystématisée. Orphanet.Lien
- [17] L'atrophie multisystématisée. Fondation pour la Recherche sur le Cerveau.Lien
Publications scientifiques
- L'étude de l'ultrastructure des inclusions protéiques dans l'atrophie multi-systématisée suggère une propagation prion-like de l'α-synucléine au sein des … (2023)
- L'expansion GAA dans FGF14 est-elle associée à l'atrophie multisystématisée ou aux ataxies cérébelleuses précoces? (2025)
- Intérêt du «signe de la phalange» pour distinguer l'atrophie multi-systématisée de l'ataxie sporadique tardive d'étiologie indéterminée (2022)
- Étude de la progression de l'Atrophie Multi-Systématisée dans la cohorte française du centre de référence national: approche statistique longitudinale et … (2024)
- Étude prospective des biomarqueurs de marche et d'IRM multimodale chez les patients de la cohorte GAIT'N'PARK présentant une atrophie multisystématisée (2024)
Ressources web
- Atrophie multisystémique (AMS) - Troubles du cerveau, de ... (msdmanuals.com)
Les symptômes comprennent des symptômes ressemblant à ceux de la maladie de Parkinson, une perte de coordination, une hypotension artérielle en position debout ...
- Atrophie multisystématisée (orpha.net)
Les manifestations cliniques comprennent une défaillance autonomique (hypotension orthostatique, syncope, troubles respiratoires (apnée du sommeil, stridor, ...
- L'atrophie multisystématisée (frcneurodon.org)
Il s'agit d'une maladie débutant à l'âge adulte, caractérisée par un syndrome parkinsonien (lenteur, rigidité, tremblement), une ataxie (déséquilibre, ...
- Atrophie multi systématisée : définition, symptômes et ... (sante-sur-le-net.com)
17 mars 2020 — Elle se traduit par l'association de divers symptômes comme : une hypotension, une rétention urinaire, une ataxie (trouble de la coordination ...
- Centre de référence de l'Atrophie multisystématisée (AMS) (chu-bordeaux.fr)
L' AMS est due à une perte progressive de neurones (cellules nerveuses) dans plusieurs zones du cerveau (plusieurs systèmes d'où le nom). La cause exacte de ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
