Douleur Chronique : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Innovations
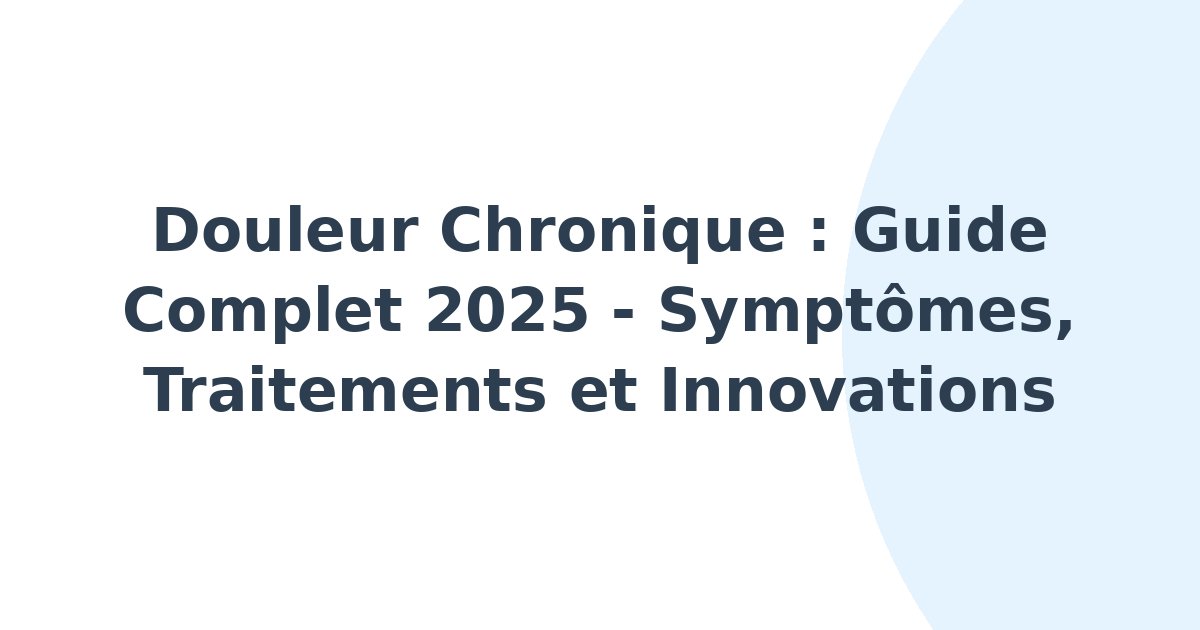
La douleur chronique représente aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique en France. Cette pathologie complexe, qui persiste au-delà de 3 mois, affecte près de 12 millions de personnes dans notre pays [1]. Contrairement à la douleur aiguë qui constitue un signal d'alarme utile, la douleur chronique devient une maladie à part entière. Elle impacte profondément la qualité de vie, les relations sociales et l'activité professionnelle des patients.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Douleur chronique : Définition et Vue d'Ensemble
La douleur chronique se définit médicalement comme une douleur qui persiste ou récidive pendant plus de 3 mois [18]. Mais cette définition temporelle ne suffit pas à saisir toute la complexité de cette pathologie.
En réalité, la douleur chronique se distingue fondamentalement de la douleur aiguë par ses mécanismes. Alors que la douleur aiguë joue un rôle protecteur en signalant une lésion, la douleur chronique perd cette fonction d'alarme pour devenir une maladie en soi [10]. Elle résulte de modifications durables du système nerveux qui amplifient et perpétuent les signaux douloureux.
Cette pathologie peut toucher n'importe quelle partie du corps. Les localisations les plus fréquentes incluent le dos, les articulations, la tête et les membres [1]. D'ailleurs, certaines formes comme la fibromyalgie ou les douleurs neuropathiques présentent des caractéristiques particulières qui nécessitent une approche spécialisée [2,3].
L'important à retenir, c'est que la douleur chronique n'est pas "dans la tête" du patient. Il s'agit d'une pathologie réelle avec des bases neurobiologiques démontrées [11]. Les récentes avancées en imagerie cérébrale ont d'ailleurs permis de visualiser les modifications structurelles et fonctionnelles du cerveau chez les patients souffrant de douleur chronique.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les chiffres de la douleur chronique en France sont impressionnants et révèlent l'ampleur de ce problème de santé publique. Selon les données les plus récentes de la HAS, environ 12 millions de Français vivent avec une douleur chronique, soit près de 18% de la population adulte [1].
Cette prévalence varie significativement selon l'âge et le sexe. Les femmes sont davantage touchées avec un taux de 20,5% contre 15,2% chez les hommes [1]. L'âge constitue également un facteur déterminant : la prévalence passe de 8% chez les 18-30 ans à plus de 35% après 65 ans [4].
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute. L'Allemagne affiche des taux similaires (19%), tandis que les pays nordiques comme la Suède présentent des prévalences légèrement inférieures (14-16%) [1]. Ces différences s'expliquent en partie par les variations dans les systèmes de soins et les approches thérapeutiques.
L'évolution temporelle est particulièrement préoccupante. Entre 2015 et 2024, on observe une augmentation de 15% des cas de douleur chronique en France [4]. Cette progression s'explique par le vieillissement de la population, mais aussi par une meilleure reconnaissance et un diagnostic plus fréquent de cette pathologie.
L'impact économique est considérable. Le coût direct et indirect de la douleur chronique représente environ 2,5% du PIB français, soit plus de 60 milliards d'euros annuels [15]. Ces chiffres incluent les dépenses de santé, les arrêts de travail et la perte de productivité.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de la douleur chronique sont multiples et souvent intriquées. Comprendre ces mécanismes vous aide à mieux appréhender votre pathologie et les options thérapeutiques disponibles.
Les causes médicales représentent le premier groupe. L'arthrose, les hernies discales, la fibromyalgie, les neuropathies diabétiques ou encore les séquelles de traumatismes constituent les étiologies les plus fréquentes [18]. Mais attention, parfois aucune cause organique précise n'est identifiée, ce qui ne remet pas en question la réalité de votre douleur.
Les facteurs génétiques jouent un rôle important que la recherche commence à élucider. Des études récentes montrent que certaines variations génétiques influencent la sensibilité à la douleur et le risque de chronicisation [11]. Par exemple, des polymorphismes du gène COMT affectent le métabolisme des neurotransmetteurs impliqués dans la modulation douloureuse.
Les facteurs psychosociaux ne doivent pas être négligés. Le stress chronique, l'anxiété, la dépression ou les traumatismes psychiques peuvent favoriser l'apparition et la persistance de douleurs chroniques [10]. Il ne s'agit pas de dire que "c'est psychologique", mais plutôt de reconnaître l'interaction complexe entre corps et esprit.
Certains facteurs de risque augmentent la probabilité de développer une douleur chronique après une blessure ou une intervention chirurgicale. L'âge avancé, le sexe féminin, l'intensité de la douleur initiale et la présence d'une anxiété préopératoire constituent des prédicteurs reconnus [12].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les symptômes de la douleur chronique n'est pas toujours évident, car cette pathologie se manifeste de façon très variable d'une personne à l'autre. Néanmoins, certains signes doivent vous alerter.
Le critère temporel reste fondamental : une douleur qui persiste au-delà de 3 mois, malgré les traitements appropriés, doit faire suspecter une chronicisation [18]. Mais la durée seule ne suffit pas. L'intensité, les caractéristiques et l'impact fonctionnel sont tout aussi importants.
Les caractéristiques de la douleur varient selon son origine. Une douleur neuropathique se manifeste souvent par des sensations de brûlure, de décharges électriques ou d'engourdissements [2]. À l'inverse, une douleur inflammatoire chronique présente plutôt un caractère lancinant avec une raideur matinale marquée.
L'impact fonctionnel constitue un élément clé du diagnostic. La douleur chronique altère significativement les activités quotidiennes, le sommeil, l'humeur et les relations sociales [1]. Vous pourriez remarquer une diminution de vos performances au travail, des difficultés à maintenir vos loisirs ou une tendance à l'isolement social.
Attention aux symptômes associés qui accompagnent souvent la douleur chronique. La fatigue chronique, les troubles du sommeil, l'anxiété ou les épisodes dépressifs sont fréquents [10]. Ces manifestations ne sont pas des "complications" mais font partie intégrante du tableau clinique de la douleur chronique.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de douleur chronique suit un parcours structuré que les professionnels de santé ont standardisé pour optimiser votre prise en charge [1]. Cette approche méthodique permet d'identifier les causes, d'évaluer l'impact et de proposer un traitement adapté.
La première consultation avec votre médecin traitant constitue l'étape initiale. Il réalisera un interrogatoire détaillé sur vos antécédents, les caractéristiques de votre douleur et son évolution. L'examen clinique recherchera des signes objectifs et évaluera votre état général. Cette première approche permet d'orienter les investigations complémentaires.
Les examens complémentaires dépendent de la localisation et des caractéristiques de votre douleur. Une imagerie (radiographie, IRM, scanner) peut être nécessaire pour rechercher une cause structurelle [18]. Des analyses biologiques complètent parfois le bilan, notamment pour éliminer une cause inflammatoire ou métabolique.
L'évaluation spécialisée intervient souvent dans un second temps. Les centres de la douleur, présents dans la plupart des hôpitaux français, proposent une approche multidisciplinaire [15]. L'équipe comprend généralement un médecin algologue, un psychologue, un kinésithérapeute et parfois d'autres spécialistes selon vos besoins.
Des outils d'évaluation standardisés permettent de quantifier votre douleur et son impact. L'échelle numérique (de 0 à 10), le questionnaire DN4 pour les douleurs neuropathiques ou encore l'échelle HAD pour l'anxiété et la dépression font partie de l'arsenal diagnostique [2]. Ces outils guident les décisions thérapeutiques et permettent de suivre l'évolution.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la douleur chronique repose sur une approche multimodale qui combine plusieurs stratégies thérapeutiques [17]. Cette diversité d'options vous offre de réelles perspectives d'amélioration, même si le chemin vers le soulagement peut parfois sembler long.
Les traitements médicamenteux constituent souvent la première ligne thérapeutique. Les antalgiques classiques (paracétamol, anti-inflammatoires) gardent leur place, mais leur efficacité reste limitée dans la douleur chronique [17]. Les antiépileptiques comme la gabapentine ou la prégabaline montrent une efficacité particulière dans les douleurs neuropathiques [18].
Les antidépresseurs ne sont pas prescrits pour traiter une dépression, mais pour leur effet antalgique propre. L'amitriptyline ou la duloxétine agissent sur les voies de modulation de la douleur au niveau central [17]. Leur efficacité est démontrée dans de nombreuses pathologies douloureuses chroniques.
Les approches non médicamenteuses prennent une place croissante dans l'arsenal thérapeutique. La kinésithérapie, l'activité physique adaptée, la relaxation ou encore les thérapies cognitivo-comportementales montrent des résultats encourageants [1]. Ces approches vous permettent de devenir acteur de votre traitement.
Les techniques interventionnelles représentent un recours pour certaines situations. Les infiltrations, la neurostimulation ou encore la radiofréquence peuvent apporter un soulagement durable [14]. Ces techniques nécessitent une évaluation spécialisée et une sélection rigoureuse des patients.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de la douleur chronique avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses [5]. Ces innovations offrent de nouveaux espoirs aux patients qui ne répondent pas aux traitements conventionnels.
Les thérapies non-opioïdes représentent une avancée majeure. Des essais cliniques de phase 3 montrent des résultats positifs pour de nouvelles molécules qui ciblent spécifiquement les mécanismes de la douleur chronique sans risque de dépendance [8,9]. Ces médicaments pourraient révolutionner la prise en charge en offrant une efficacité comparable aux opioïdes sans leurs effets secondaires.
La médecine personnalisée fait son entrée dans le domaine de la douleur. Les tests génétiques permettent désormais d'identifier les patients qui répondront le mieux à certains traitements [11]. Cette approche sur mesure optimise l'efficacité thérapeutique tout en réduisant les effets indésirables.
Les programmes d'autogestion en ligne se développent rapidement. Une étude canadienne de 2024 montre l'efficacité de plateformes numériques qui permettent aux patients de mieux gérer leur douleur au quotidien [13]. Ces outils combinent éducation thérapeutique, exercices personnalisés et suivi à distance.
Les réseaux d'investigation clinique se structurent pour accélérer la recherche. De nouveaux dispositifs médicaux et des approches diagnostiques innovantes sont actuellement testés dans plusieurs centres français [7]. Ces recherches pourraient déboucher sur des solutions thérapeutiques révolutionnaires dans les prochaines années.
Vivre au Quotidien avec Douleur chronique
Vivre avec une douleur chronique nécessite des adaptations importantes dans votre quotidien. Mais rassurez-vous, de nombreuses stratégies peuvent vous aider à maintenir une qualité de vie satisfaisante malgré cette pathologie [1].
L'organisation de vos activités devient cruciale. Apprenez à écouter votre corps et à adapter vos efforts selon l'intensité de votre douleur. Le principe du "pacing" consiste à fractionner vos tâches et à alterner activité et repos. Cette approche vous permet de rester actif sans aggraver votre état.
Le maintien d'une activité physique adaptée constitue un pilier de votre prise en charge. Contrairement aux idées reçues, l'immobilité aggrave souvent la douleur chronique [1]. Des exercices doux comme la marche, la natation ou le yoga peuvent considérablement améliorer votre état. Votre kinésithérapeute vous guidera dans le choix des activités les plus appropriées.
La gestion du stress et des émotions joue un rôle fondamental. La douleur chronique génère souvent anxiété et frustration, ce qui peut amplifier les sensations douloureuses [10]. Les techniques de relaxation, la méditation ou encore les thérapies cognitivo-comportementales vous aident à briser ce cercle vicieux.
N'hésitez pas à solliciter le soutien de vos proches et à rejoindre des groupes de patients. Partager votre expérience avec d'autres personnes qui vivent la même situation peut être très bénéfique. De nombreuses associations proposent des groupes de parole et des activités adaptées.
Les Complications Possibles
La douleur chronique peut entraîner diverses complications qui dépassent le simple aspect douloureux [16]. Connaître ces risques vous permet de les prévenir et de réagir rapidement si ils surviennent.
Les complications psychologiques représentent un risque majeur. L'anxiété et la dépression touchent respectivement 40% et 25% des patients souffrant de douleur chronique [10]. Ces troubles ne sont pas une faiblesse de votre part, mais une conséquence directe des modifications neurobiologiques induites par la douleur persistante.
Le démaladienement physique constitue une autre complication fréquente. La tendance naturelle à éviter les mouvements douloureux peut conduire à une perte de masse musculaire et à une diminution des capacités cardiovasculaires [1]. Ce cercle vicieux aggrave paradoxalement la douleur et limite vos capacités fonctionnelles.
Les troubles du sommeil affectent plus de 70% des patients [18]. La douleur perturbe l'architecture du sommeil, ce qui diminue le seuil de tolérance à la douleur le lendemain. Cette interaction crée un cercle vicieux qu'il faut briser par une prise en charge spécifique.
L'isolement social représente une complication sous-estimée mais majeure. La douleur chronique peut vous conduire à réduire vos activités sociales et professionnelles [1]. Cet isolement aggrave les troubles de l'humeur et peut compromettre votre adhésion aux traitements. Il est important de maintenir vos liens sociaux et de ne pas hésiter à expliquer votre situation à vos proches.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la douleur chronique varie considérablement selon de nombreux facteurs, mais il faut savoir qu'une amélioration significative est possible dans la majorité des cas [1]. L'évolution dépend largement de la précocité et de la qualité de la prise en charge.
Les facteurs pronostiques favorables incluent un diagnostic précoce, une prise en charge multidisciplinaire rapide, le maintien d'une activité physique et un bon soutien social [12]. Les patients qui s'impliquent activement dans leur traitement et adoptent des stratégies d'adaptation efficaces ont généralement une meilleure évolution.
À l'inverse, certains facteurs péjoratifs peuvent compliquer l'évolution. L'âge avancé, la présence de comorbidités psychiatriques, l'isolement social ou encore les conflits médico-légaux constituent des éléments défavorables [12]. Cependant, même en présence de ces facteurs, une amélioration reste possible avec une prise en charge adaptée.
Les objectifs thérapeutiques doivent être réalistes. Il s'agit rarement d'obtenir une disparition complète de la douleur, mais plutôt d'améliorer votre qualité de vie et votre fonctionnement au quotidien [1]. Une réduction de 30 à 50% de l'intensité douloureuse est considérée comme un succès thérapeutique significatif.
L'évolution à long terme montre que la plupart des patients apprennent à mieux gérer leur douleur avec le temps. Les stratégies d'adaptation se développent, l'acceptation de la pathologie progresse et la qualité de vie s'améliore progressivement [10]. Il est important de garder espoir et de persévérer dans votre prise en charge.
Peut-on Prévenir Douleur chronique ?
La prévention de la douleur chronique constitue un enjeu majeur de santé publique, et plusieurs stratégies ont prouvé leur efficacité [12]. Bien qu'on ne puisse pas toujours éviter sa survenue, certaines mesures réduisent significativement le risque de chronicisation.
La prévention primaire vise à éviter l'apparition de la douleur chronique. Elle repose sur la promotion d'un mode de vie sain : activité physique régulière, maintien d'un poids optimal, gestion du stress et évitement des facteurs de risque professionnels [1]. Ces mesures générales contribuent à maintenir un système musculo-squelettique en bonne santé.
La prévention secondaire intervient après l'apparition d'une douleur aiguë pour éviter sa chronicisation. Une prise en charge précoce et adaptée de la douleur post-traumatique ou post-chirurgicale réduit considérablement le risque d'évolution chronique [12]. L'identification des patients à risque permet une surveillance renforcée.
Les facteurs de risque modifiables constituent des cibles privilégiées de prévention. L'anxiété préopératoire, les troubles du sommeil, la sédentarité ou encore l'isolement social peuvent être pris en charge spécifiquement [12]. Des programmes d'éducation thérapeutique aident les patients à identifier et modifier ces facteurs.
Au niveau professionnel, la prévention des troubles musculo-squelettiques passe par l'amélioration des maladies de travail, la formation aux gestes et postures, et la mise en place d'équipements ergonomiques [1]. Les entreprises ont un rôle important à jouer dans cette prévention collective.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié des recommandations précises pour optimiser la prise en charge de la douleur chronique [1]. Ces guidelines, régulièrement mises à jour, constituent la référence pour les professionnels de santé et garantissent une prise en charge de qualité.
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche multidisciplinaire dès le diagnostic de douleur chronique [1]. Cette recommandation souligne l'importance de ne pas se limiter aux seuls traitements médicamenteux, mais d'intégrer des approches psychologiques, physiques et sociales dans votre prise en charge.
Le parcours de soins recommandé débute par votre médecin traitant qui coordonne les différentes interventions [1]. En cas de douleur persistante malgré un traitement bien conduit, l'orientation vers une consultation spécialisée de la douleur est recommandée dans un délai de 3 mois maximum.
Les structures spécialisées font l'objet de recommandations spécifiques. La France compte aujourd'hui plus de 260 structures de prise en charge de la douleur chronique, réparties sur l'ensemble du territoire [15]. Ces centres doivent respecter des critères de qualité stricts et proposer une approche multidisciplinaire.
Les indicateurs de qualité permettent d'évaluer la prise en charge. La HAS recommande de mesurer régulièrement l'intensité de la douleur, l'impact fonctionnel et la qualité de vie [1]. Ces évaluations guident les adaptations thérapeutiques et permettent de s'assurer de l'efficacité des traitements proposés.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour vous accompagner dans votre parcours avec la douleur chronique. Ces structures offrent information, soutien et entraide entre patients confrontés aux mêmes difficultés.
L'Association Française pour l'Étude de la Douleur (AFED) constitue la référence scientifique dans le domaine. Elle propose des informations actualisées sur les avancées thérapeutiques et organise régulièrement des journées d'information destinées aux patients et aux familles.
Les associations spécialisées par pathologie offrent un soutien ciblé. L'Association Fibromyalgie France pour la fibromyalgie, l'Association Française contre les Myopathies pour les douleurs musculaires, ou encore France Rhumatismes pour les douleurs articulaires proposent des services adaptés à chaque situation.
Les plateformes numériques se développent rapidement. Des applications mobiles permettent de suivre l'évolution de votre douleur, de pratiquer des exercices de relaxation ou encore d'accéder à des programmes d'éducation thérapeutique [13]. Ces outils complètent utilement votre prise en charge traditionnelle.
Les groupes de parole et les forums en ligne offrent un espace d'échange précieux. Partager votre expérience avec d'autres patients qui vivent des situations similaires peut considérablement vous aider à mieux accepter et gérer votre pathologie. Ces échanges permettent aussi de découvrir des stratégies d'adaptation efficaces.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre au quotidien avec votre douleur chronique. Ces recommandations, issues de l'expérience clinique et des témoignages de patients, peuvent considérablement améliorer votre qualité de vie.
Tenez un carnet de douleur pour identifier les facteurs déclenchants et les stratégies efficaces. Notez quotidiennement l'intensité de votre douleur, les activités réalisées, votre humeur et les traitements pris. Cette démarche vous aide à mieux comprendre votre pathologie et facilite le dialogue avec vos soignants.
Planifiez vos activités en fonction de votre niveau d'énergie. Répartissez les tâches importantes sur plusieurs jours et n'hésitez pas à déléguer certaines activités. L'objectif n'est pas de tout faire, mais de faire ce qui est essentiel pour vous en préservant votre énergie.
Maintenez une activité physique adaptée, même modeste. Quelques minutes de marche quotidienne, des étirements doux ou des exercices en piscine peuvent faire une réelle différence [1]. Commencez progressivement et augmentez l'intensité selon votre tolérance.
Cultivez vos relations sociales malgré les difficultés. Expliquez votre situation à vos proches, acceptez leur aide quand c'est nécessaire, et maintenez des activités sociales adaptées à vos capacités. L'isolement aggrave souvent la perception de la douleur [10].
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter un médecin pour une douleur chronique peut parfois sembler évident, mais certaines situations nécessitent une attention particulière et une consultation en urgence.
Consultez rapidement si votre douleur s'aggrave brutalement ou change de caractère. Une douleur qui devient pulsatile, s'accompagne de fièvre ou de signes neurologiques nouveaux nécessite une évaluation médicale sans délai [18]. Ces modifications peuvent signaler une complication ou une pathologie associée.
N'attendez pas si votre douleur s'accompagne de symptômes inquiétants : difficultés respiratoires, troubles de la conscience, paralysie ou perte de sensibilité. Ces signes peuvent révéler une urgence médicale qui nécessite une prise en charge immédiate [18].
Prenez rendez-vous si vos traitements habituels deviennent inefficaces ou si vous ressentez des effets secondaires importants. Une adaptation thérapeutique peut être nécessaire, et il est important de ne pas rester dans une situation d'échec thérapeutique [16].
Consultez votre médecin traitant si votre douleur impacte significativement votre sommeil, votre humeur ou vos activités quotidiennes. Ces retentissements justifient une réévaluation de votre prise en charge et éventuellement une orientation vers une consultation spécialisée [1].
En cas de pensées suicidaires ou de détresse psychologique majeure, n'hésitez pas à contacter immédiatement votre médecin, les services d'urgence ou une ligne d'écoute spécialisée. La douleur chronique peut parfois conduire à un désespoir qu'il faut prendre très au sérieux [10].
Questions Fréquentes
La douleur chronique peut-elle guérir complètement ?La guérison complète est possible dans certains cas, mais l'objectif principal est souvent d'améliorer significativement votre qualité de vie. Une réduction de 30 à 50% de l'intensité douloureuse constitue déjà un succès thérapeutique majeur [1].
Les médicaments contre la douleur créent-ils une dépendance ?
Les antalgiques classiques et les médicaments spécifiques de la douleur chronique (antiépileptiques, antidépresseurs) ne créent pas de dépendance physique. Seuls les opioïdes présentent ce risque, c'est pourquoi leur utilisation est encadrée [17].
L'activité physique peut-elle aggraver ma douleur ?
Au contraire, l'activité physique adaptée constitue l'un des traitements les plus efficaces de la douleur chronique. Il faut commencer progressivement et choisir des activités adaptées à votre état [1].
Dois-je arrêter de travailler à cause de ma douleur chronique ?
L'arrêt de travail n'est pas systématique. Des aménagements de poste, un temps partiel thérapeutique ou une reconversion professionnelle peuvent permettre de maintenir une activité professionnelle [1].
Les thérapies alternatives sont-elles efficaces ?
Certaines approches comme l'acupuncture, l'ostéopathie ou la sophrologie peuvent apporter un bénéfice en complément des traitements conventionnels. Il est important d'en discuter avec votre médecin [18].
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Douleur chronique :
Questions Fréquentes
La douleur chronique peut-elle guérir complètement ?
La guérison complète est possible dans certains cas, mais l'objectif principal est souvent d'améliorer significativement votre qualité de vie. Une réduction de 30 à 50% de l'intensité douloureuse constitue déjà un succès thérapeutique majeur.
Les médicaments contre la douleur créent-ils une dépendance ?
Les antalgiques classiques et les médicaments spécifiques de la douleur chronique (antiépileptiques, antidépresseurs) ne créent pas de dépendance physique. Seuls les opioïdes présentent ce risque, c'est pourquoi leur utilisation est encadrée.
L'activité physique peut-elle aggraver ma douleur ?
Au contraire, l'activité physique adaptée constitue l'un des traitements les plus efficaces de la douleur chronique. Il faut commencer progressivement et choisir des activités adaptées à votre état.
Dois-je arrêter de travailler à cause de ma douleur chronique ?
L'arrêt de travail n'est pas systématique. Des aménagements de poste, un temps partiel thérapeutique ou une reconversion professionnelle peuvent permettre de maintenir une activité professionnelle.
Les thérapies alternatives sont-elles efficaces ?
Certaines approches comme l'acupuncture, l'ostéopathie ou la sophrologie peuvent apporter un bénéfice en complément des traitements conventionnels. Il est important d'en discuter avec votre médecin.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Symptômes et diagnostic de la fibromyalgie. www.ameli.fr.Lien
- [3] La fibromyalgie - Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [4] Les établissements de santé en 2022 - Drees. drees.solidarites-sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [5] Douleur Chronique : Vers des Solutions Innovantes. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Innovation "réseaux d'investigations cliniques, dispositifs médicaux" - CHU Bordeaux. 2024-2025.Lien
- [8] Nonopioid Therapy For Acute Pain Shows Positive Results in Phase 3 Trial. 2024-2025.Lien
- [9] New non-opioid pain medication: What is in the pipeline. 2024-2025.Lien
- [10] MCD Catteau, V Barfety-Servignat. Douleur chronique et répétition. 2025.Lien
- [11] C Dualé, P Blanc. Génétique de la douleur chronique—Une revue narrative illustrée par les exemples de la fibromyalgie et de la douleur chronique postchirurgicale. 2023.Lien
- [12] B Leroy, L Aubel. Identification de facteurs prédictifs de l'apparition de douleurs chroniques postchirurgicales (DCPC). 2024.Lien
- [13] P Marier-Deschenes, AM Pinard. Codéveloppement d'un programme d'autogestion de la douleur chronique en ligne. Canadian Journal of Pain. 2024.Lien
- [14] C Quémeneur, DDV y Fuentes. Douleur chronique du genou: radiofréquence des nerfs géniculés. Le Praticien en Anesthésie Réanimation. 2024.Lien
- [15] F Aubrun. Structures douleur chronique en France. Douleur et analgésie. 2025.Lien
- [16] JM Mrozovski. Insuffisance de prise en charge d'une douleur chronique. Actualités Pharmaceutiques. 2024.Lien
- [17] B Gérard, F Bailly. Le traitement pharmacologique de la douleur chronique dans les rhumatismes et les maladies musculosquelettiques est-il encore justifié? Revue narrative. 2024.Lien
- [18] Douleur chronique - Troubles du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs. MSD Manuals.Lien
Publications scientifiques
- Douleur chronique et répétition (2025)7 citations
- Génétique de la douleur chronique—Une revue narrative illustrée par les exemples de la fibromyalgie et de la douleur chronique postchirurgicale (2023)2 citations
- Identification de facteurs prédictifs de l'apparition de douleurs chroniques postchirurgicales (DCPC) (2024)2 citations
- Codéveloppement d'un programme d'autogestion de la douleur chronique en ligne: un projet de recherche basé sur la conception et axé sur l'engagement des … (2024)2 citations
- Douleur chronique du genou: radiofréquence des nerfs géniculés (2024)1 citations
Ressources web
- Douleur chronique - Troubles du cerveau, de la moelle ... (msdmanuals.com)
La douleur chronique est une douleur qui dure ou récidive pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Symptômes|; Diagnostic|; Traitement|.
- Douleur chronique - Troubles neurologiques (msdmanuals.com)
La douleur chronique est une douleur qui persiste ou récidive pendant > 3 mois, qui persiste > 1 mois après guérison d'une lésion tissulaire aiguë ou qui est ...
- Symptômes et diagnostic de la fibromyalgie (ameli.fr)
26 févr. 2025 — La douleur chronique est le symptôme principal de la fibromyalgie. Le diagnostic repose sur une évaluation et un examen clinique.
- LA DOULEUR CHRONIQUE (fo-rothschild.fr)
Une douleur chronique signifie parfois qu'il existe un problème physiologique persistant non réglé, comme par exemple dans les maladies chroniques comme l' ...
- Parcours de santé d'une personne présentant une douleur ... (has-sante.fr)
11 janv. 2023 — La douleur chronique primaire (CIM-11) est définie comme « une douleur dans une ou plusieurs régions anatomiques qui persiste ou se reproduit ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
