Déficit d'adhérence leucocytaire : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
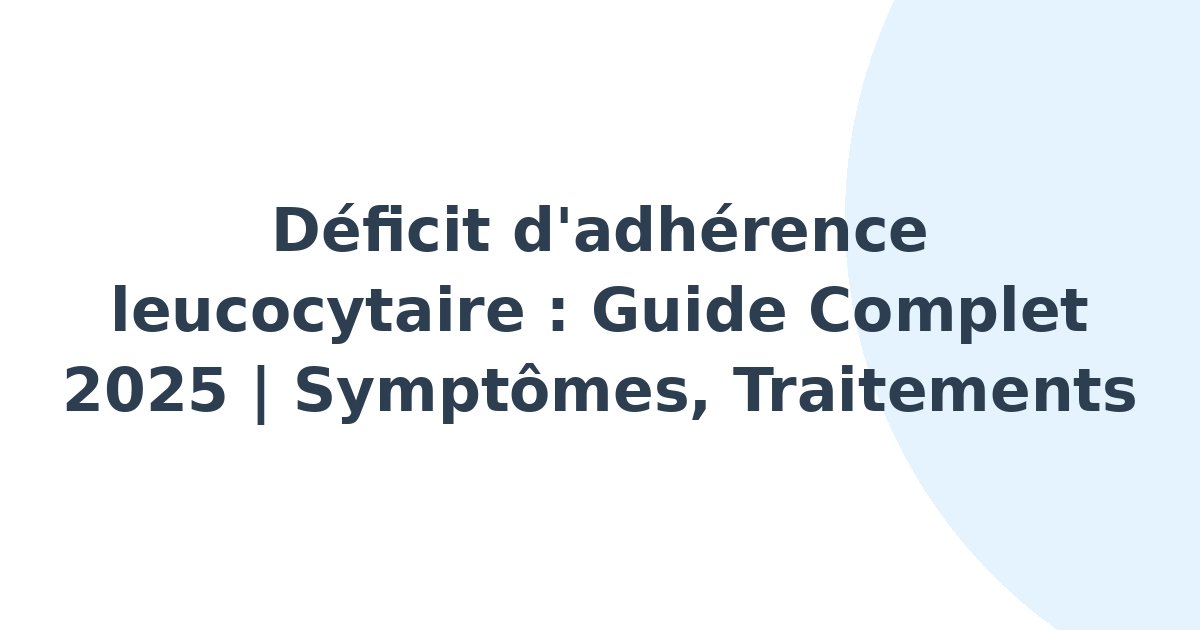
Le déficit d'adhérence leucocytaire est une maladie génétique rare qui affecte le système immunitaire. Cette pathologie empêche les globules blancs de migrer efficacement vers les sites d'infection, compromettant ainsi les défenses naturelles de l'organisme. Bien que rare, cette maladie nécessite une prise en charge spécialisée et précoce pour éviter les complications graves.
Téléconsultation et Déficit d'adhérence leucocytaire
Téléconsultation non recommandéeLe déficit d'adhérence leucocytaire est une immunodéficience primitive rare nécessitant un diagnostic spécialisé par des examens biologiques complexes et une prise en charge hospitalière multidisciplinaire. Les complications infectieuses graves et récurrentes requièrent une évaluation clinique approfondie et des examens complémentaires spécialisés qui ne peuvent être réalisés à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique des infections récurrentes et de leur fréquence, description des symptômes cutanés et des retards de cicatrisation, évaluation de l'impact sur la qualité de vie, orientation vers une prise en charge spécialisée, suivi de l'observance thérapeutique une fois le diagnostic établi.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet pour rechercher des signes d'infection active, réalisation d'examens biologiques spécialisés (cytométrie de flux, tests fonctionnels leucocytaires), biopsies cutanées si nécessaire, évaluation immunologique complète par un spécialiste en immunologie clinique.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de nouvelle infection grave nécessitant une antibiothérapie urgente, évaluation de l'efficacité d'un traitement immunosuppresseur, surveillance des effets secondaires d'une greffe de moelle osseuse, bilan pré-thérapeutique avant un traitement de fond.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Fièvre élevée avec signes de sepsis, infection cutanée extensive ou nécrosante, détresse respiratoire suggérant une pneumonie grave, signes neurologiques évoquant une méningite ou un abcès cérébral.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée persistante avec frissons et altération de l'état général
- Infection cutanée extensive, purulente ou nécrosante
- Difficultés respiratoires ou signes de pneumonie sévère
- Signes neurologiques (convulsions, troubles de la conscience, raideur de nuque)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Immunologue ou hématologue pédiatre — consultation en présentiel indispensable
Cette pathologie rare nécessite une expertise spécialisée en immunologie clinique pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique complexe. Une consultation en présentiel est indispensable pour réaliser les examens biologiques spécialisés et établir un plan de traitement adapté.
Déficit d'adhérence leucocytaire : Définition et Vue d'Ensemble
Le déficit d'adhérence leucocytaire (DAL) représente un groupe de maladies génétiques rares qui perturbent la capacité des globules blancs à adhérer aux parois des vaisseaux sanguins et à migrer vers les tissus infectés [6,7]. Cette pathologie compromet gravement la réponse immunitaire innée.
Concrètement, imaginez vos globules blancs comme des soldats qui ne peuvent pas sortir de leur caserne pour combattre l'ennemi. C'est exactement ce qui se passe dans cette maladie : les leucocytes restent piégés dans la circulation sanguine, incapables de rejoindre les sites d'infection [8].
Il existe trois types principaux de DAL. Le type 1, le plus fréquent, résulte d'un déficit en intégrines β2. Le type 2 affecte la sélectine E, tandis que le type 3, découvert plus récemment, implique la kindline-3 [2]. Chaque forme présente des caractéristiques cliniques distinctes, mais toutes partagent cette incapacité fondamentale des leucocytes à migrer efficacement.
L'important à retenir : cette pathologie n'est pas contagieuse. Elle se transmet selon un mode autosomique récessif, ce qui signifie que les deux parents doivent être porteurs du gène défaillant pour que leur enfant développe la maladie [4,5].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes révèlent que le déficit d'adhérence leucocytaire touche environ 1 naissance sur 1 million dans le monde [8]. En France, selon les dernières estimations de la HAS, on compte approximativement 60 à 80 cas diagnostiqués, avec une incidence annuelle de 2 à 3 nouveaux cas par an .
Mais ces chiffres cachent probablement une réalité plus complexe. D'ailleurs, les experts suspectent un sous-diagnostic important, particulièrement dans les formes moins sévères du DAL de type 2 [4]. Les registres européens montrent des variations géographiques intéressantes : l'Allemagne et les Pays-Bas rapportent des prévalences légèrement supérieures, possiblement liées à de meilleures capacités diagnostiques .
L'analyse par sexe ne révèle pas de différence significative, ce qui confirme le mode de transmission autosomique récessif [5]. Cependant, l'âge au diagnostic varie considérablement : 70% des cas sont identifiés avant l'âge de 2 ans pour le type 1, contre seulement 40% pour le type 2 [4,8].
Les projections pour 2025-2030 suggèrent une augmentation du nombre de cas diagnostiqués, non pas par augmentation de l'incidence, mais grâce à l'amélioration des techniques diagnostiques et à la sensibilisation accrue des professionnels de santé [1]. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à environ 2,5 millions d'euros annuels, incluant les coûts de diagnostic, de traitement et de suivi .
Les Causes et Facteurs de Risque
Le déficit d'adhérence leucocytaire résulte de mutations génétiques qui affectent différentes protéines essentielles à l'adhésion cellulaire [6,7]. Pour le DAL de type 1, les mutations touchent le gène ITGB2 qui code pour la sous-unité β2 des intégrines. Ces protéines agissent comme des "crochets" permettant aux globules blancs de s'accrocher aux parois vasculaires.
Le type 2, plus rare, implique des anomalies du gène SLC35C1, responsable de la synthèse du GDP-fucose [8]. Cette molécule est cruciale pour la formation des sélectines, autres protéines d'adhésion. Quant au type 3, découvert récemment, il résulte de mutations du gène FERMT3 codant pour la kindline-3 .
Bon à savoir : il n'existe pas de facteurs de risque environnementaux pour développer cette pathologie. La consanguinité augmente cependant le risque de transmission, particulièrement dans certaines populations où les mariages entre cousins sont fréquents [4,5]. Les études génétiques récentes montrent que certaines mutations sont plus fréquentes dans des populations spécifiques, comme les mutations du gène ITGB2 chez les populations du Moyen-Orient [3].
L'hérédité suit un schéma autosomique récessif strict. Cela signifie que si les deux parents sont porteurs sains, chaque grossesse présente 25% de risque d'avoir un enfant atteint, 50% de risque d'avoir un enfant porteur sain, et 25% de chance d'avoir un enfant non porteur [5].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du déficit d'adhérence leucocytaire apparaissent généralement très tôt dans la vie, souvent dès les premiers mois [8]. Le signe le plus caractéristique ? Des infections récurrentes et inhabituellement sévères, qui résistent aux traitements antibiotiques classiques.
Chez les nourrissons, vous pourriez observer un retard de chute du cordon ombilical, qui persiste au-delà de 3-4 semaines au lieu des 7-10 jours habituels [6,7]. C'est souvent le premier indice qui alerte les pédiatres. Les infections cutanées sont également fréquentes : abcès, cellulites, plaies qui cicatrisent mal [3].
Les infections touchent principalement la peau, les muqueuses et le tractus gastro-intestinal. Mais attention, ces infections présentent une particularité troublante : elles ne s'accompagnent pas de la formation de pus habituelle [8]. En effet, sans leucocytes capables de migrer vers le site infectieux, l'inflammation classique ne peut pas se développer.
D'autres signes peuvent vous alerter : une leucocytose persistante (augmentation anormale des globules blancs dans le sang), des gingivites sévères, ou encore des infections respiratoires à répétition [4]. Chez les enfants plus grands, on observe parfois un retard de croissance et des difficultés de cicatrisation après des blessures mineures.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du déficit d'adhérence leucocytaire nécessite une approche méthodique et spécialisée [5]. La première étape consiste en une numération formule sanguine qui révèle typiquement une leucocytose importante, souvent supérieure à 20 000/mm³, même en l'absence d'infection active [6,7].
L'examen clé reste l'étude de l'adhérence leucocytaire par cytométrie en flux. Cette technique permet de mesurer l'expression des intégrines β2 à la surface des neutrophiles [8]. Dans le DAL de type 1, cette expression est soit absente (forme sévère), soit diminuée (forme modérée). Pour le type 2, on recherche plutôt l'expression de la sélectine E [4].
Concrètement, votre médecin pourra également demander des tests fonctionnels. Le test de migration leucocytaire in vitro évalue la capacité des globules blancs à traverser une membrane artificielle en réponse à des signaux chimiques [5]. Ce test est particulièrement utile pour confirmer le diagnostic et évaluer la sévérité de la pathologie.
L'analyse génétique représente l'étape finale du diagnostic. Elle permet d'identifier précisément la mutation responsable et de confirmer le type de DAL [3]. Cette information est cruciale pour le conseil génétique et la prise en charge thérapeutique. Les nouvelles techniques de séquençage haut débit, disponibles depuis 2024, permettent un diagnostic plus rapide et moins coûteux .
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du déficit d'adhérence leucocytaire repose sur plusieurs piliers thérapeutiques [5]. Le traitement de référence pour les formes sévères reste la greffe de cellules souches hématopoïétiques, qui permet de restaurer un système immunitaire fonctionnel [1,6].
Pour les infections aiguës, une antibiothérapie précoce et adaptée est essentielle. Mais attention, le choix des antibiotiques doit tenir compte de l'absence de migration leucocytaire : les molécules qui pénètrent bien dans les tissus sont privilégiées [7,8]. Les fluoroquinolones et certaines bêta-lactamines montrent une efficacité particulière dans ce contexte.
La prophylaxie anti-infectieuse constitue un autre volet crucial. Elle peut inclure des antibiotiques au long cours, des antifongiques, et parfois des antiviraux selon le profil de risque du patient [4]. L'hygiène rigoureuse et l'éviction des sources d'infection sont également primordiales.
Récemment, l'utilisation d'immunoglobulines intraveineuses a montré des résultats prometteurs, particulièrement chez les patients en attente de greffe [1,5]. Ces perfusions permettent de renforcer temporairement les défenses immunitaires et de réduire la fréquence des infections. Le dosage et la fréquence sont adaptés individuellement selon la réponse clinique.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la recherche sur le déficit d'adhérence leucocytaire . Les thérapies géniques émergent comme une alternative prometteuse à la greffe de moelle osseuse, particulièrement pour les patients sans donneur compatible [2].
Les dernières avancées portent sur la thérapie génique par vecteurs lentiviraux. Cette approche consiste à introduire une copie fonctionnelle du gène défaillant dans les cellules souches du patient . Les premiers essais cliniques, menés en 2024, montrent des résultats encourageants avec une restauration partielle de la fonction leucocytaire .
D'ailleurs, la recherche sur la kindline-3 ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques . Les études récentes démontrent que la phosphorylation de cette protéine joue un rôle crucial dans l'adhésion cellulaire, ouvrant la voie à des traitements pharmacologiques ciblés. Ces découvertes pourraient révolutionner la prise en charge du DAL de type 3.
Les immunomodulateurs de nouvelle génération font également l'objet d'investigations poussées [1]. Certaines molécules, comme les inhibiteurs sélectifs de kinases, pourraient améliorer la fonction résiduelle des leucocytes chez les patients avec des formes modérées. Les résultats préliminaires des études de phase II sont attendus pour fin 2025.
Enfin, l'intelligence artificielle transforme le diagnostic précoce. Les algorithmes développés en 2024 permettent d'identifier les patients à risque dès les premiers signes cliniques, réduisant le délai diagnostique de plusieurs mois .
Vivre au Quotidien avec Déficit d'adhérence leucocytaire
Vivre avec un déficit d'adhérence leucocytaire nécessite des adaptations importantes, mais une vie épanouie reste tout à fait possible [4,5]. L'hygiène constitue votre première ligne de défense : lavage fréquent des mains, désinfection des plaies même mineures, éviction des foules pendant les épidémies.
L'alimentation joue également un rôle crucial. Privilégiez les aliments bien cuits, évitez les produits laitiers non pasteurisés et les viandes crues [8]. Certains patients développent des stratégies personnalisées : préparation des repas à domicile, choix minutieux des restaurants, emport systématique de gel hydroalcoolique.
La vie sociale ne doit pas être sacrifiée pour autant. Il s'agit plutôt d'apprendre à évaluer les risques et à prendre des précautions adaptées [6,7]. Les voyages restent possibles avec une préparation médicale appropriée : trousse de premiers secours, antibiotiques de réserve, coordonnées de centres médicaux spécialisés.
L'activité physique, souvent négligée, présente des bénéfices importants. Elle renforce le système immunitaire résiduel et améliore la qualité de vie [4]. Bien sûr, certains sports à risque de blessure sont déconseillés, mais la marche, la natation en piscine traitée, ou le vélo restent excellents pour la santé.
Le soutien psychologique ne doit pas être sous-estimé. Cette pathologie chronique peut générer anxiété et isolement social. L'accompagnement par un psychologue spécialisé dans les maladies rares aide de nombreux patients à mieux accepter leur maladie [5].
Les Complications Possibles
Le déficit d'adhérence leucocytaire peut entraîner diverses complications, dont la gravité dépend du type et de la sévérité de la pathologie [6,7]. Les infections récurrentes représentent la complication la plus fréquente et la plus redoutable, pouvant mettre en jeu le pronostic vital si elles ne sont pas traitées rapidement.
Les complications cutanées méritent une attention particulière. Le pyoderma gangrenosum, une ulcération cutanée sévère et récalcitrante, peut survenir chez certains patients [3]. Cette complication, récemment décrite dans la littérature 2024, nécessite une prise en charge dermatologique spécialisée et peut laisser des séquelles esthétiques importantes.
Au niveau digestif, les patients peuvent développer des entérocolites nécrosantes, particulièrement chez les nourrissons [8]. Cette complication grave nécessite souvent une hospitalisation en urgence et peut nécessiter une intervention chirurgicale. Les troubles de la cicatrisation compliquent également la prise en charge chirurgicale de ces patients.
Les complications respiratoires incluent pneumonies récurrentes et bronchectasies [4]. Ces dernières résultent d'infections pulmonaires répétées qui finissent par endommager définitivement les bronches. Un suivi pneumologique régulier est donc indispensable.
Enfin, certains patients développent des complications auto-immunes paradoxales [5]. Bien que le système immunitaire soit défaillant, il peut parfois s'emballer et attaquer les propres tissus de l'organisme, nécessitant alors un traitement immunosuppresseur délicat à équilibrer.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du déficit d'adhérence leucocytaire varie considérablement selon le type et la sévérité de la pathologie [6,7]. Pour les formes sévères de DAL de type 1, le pronostic était historiquement sombre, avec un décès dans la première année de vie en l'absence de greffe de cellules souches [8].
Heureusement, les avancées thérapeutiques ont transformé cette perspective. Aujourd'hui, la greffe de cellules souches hématopoïétiques offre un taux de survie supérieur à 80% lorsqu'elle est réalisée précocement et avec un donneur compatible [1,5]. Les patients greffés avec succès peuvent mener une vie quasi-normale.
Les formes modérées présentent un pronostic nettement plus favorable [4]. Avec une prise en charge adaptée incluant prophylaxie anti-infectieuse et suivi spécialisé, la plupart des patients atteignent l'âge adulte sans complications majeures. Leur espérance de vie peut être proche de la normale, bien qu'un suivi médical à vie reste nécessaire.
Le DAL de type 2 présente généralement un pronostic intermédiaire [8]. Les patients peuvent vivre plusieurs décennies, mais restent exposés à des complications infectieuses récurrentes. Les nouvelles approches thérapeutiques développées en 2024-2025 laissent espérer une amélioration significative de leur qualité de vie .
L'important à retenir : un diagnostic précoce et une prise en charge spécialisée transforment radicalement le pronostic. Les enfants diagnostiqués aujourd'hui bénéficient d'options thérapeutiques impensables il y a encore dix ans [2].
Peut-on Prévenir Déficit d'adhérence leucocytaire ?
La prévention du déficit d'adhérence leucocytaire relève essentiellement du conseil génétique et du diagnostic prénatal [5]. Puisqu'il s'agit d'une maladie génétique héréditaire, la prévention primaire consiste à identifier les couples à risque avant la conception.
Si vous avez des antécédents familiaux de DAL ou si vous êtes issus d'une population à risque élevé, une consultation de génétique médicale est recommandée [4]. Le généticien pourra évaluer votre risque de transmission et vous proposer un test de porteur. Ce test, simple et fiable, permet de détecter les mutations responsables de la maladie.
Pour les couples où les deux partenaires sont porteurs, plusieurs options s'offrent à eux [8]. Le diagnostic prénatal par amniocentèse ou biopsie de trophoblaste permet de détecter la maladie chez le fœtus dès le premier trimestre de grossesse. Plus récemment, le diagnostic préimplantatoire (DPI) offre une alternative pour les couples ayant recours à la fécondation in vitro.
Bon à savoir : la prévention secondaire, une fois la maladie déclarée, repose sur la prévention des complications [6,7]. Cela inclut la vaccination adaptée aux patients immunodéprimés, la prophylaxie anti-infectieuse, et l'éducation thérapeutique des familles [1].
Les nouvelles recommandations 2024 insistent sur l'importance du dépistage néonatal dans les familles à risque . Un diagnostic très précoce permet d'initier immédiatement les mesures préventives et d'améliorer significativement le pronostic.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées pour la prise en charge du déficit d'adhérence leucocytaire . Ces guidelines, élaborées en collaboration avec les sociétés savantes européennes, définissent les standards de soins pour cette pathologie rare.
Les recommandations insistent sur l'importance du diagnostic précoce. Tout nourrisson présentant un retard de chute du cordon ombilical associé à des infections récurrentes doit bénéficier d'un bilan immunologique spécialisé . Le délai diagnostique ne devrait pas excéder 3 mois après l'apparition des premiers symptômes.
Concernant le traitement, la HAS recommande une prise en charge dans des centres de référence pour les déficits immunitaires héréditaires [1]. Ces centres disposent de l'expertise nécessaire pour optimiser les traitements et coordonner les soins multidisciplinaires. La greffe de cellules souches reste le traitement de référence pour les formes sévères, idéalement avant l'âge de 2 ans.
Les nouvelles recommandations 2024 intègrent également les innovations thérapeutiques récentes . L'utilisation des immunoglobulines intraveineuses est désormais codifiée, avec des protocoles précis selon l'âge et la sévérité. Les thérapies géniques expérimentales peuvent être proposées dans le cadre d'essais cliniques pour les patients sans donneur compatible.
Enfin, la HAS souligne l'importance du suivi à long terme et de l'éducation thérapeutique des familles [1]. Un carnet de suivi personnalisé doit être remis à chaque patient, facilitant la coordination entre les différents professionnels de santé.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients atteints de déficit d'adhérence leucocytaire et leurs familles [4,5]. L'Association Française des Déficits Immunitaires Primitifs (AFIDP) constitue la référence nationale, offrant information, soutien et plaidoyer pour améliorer la prise en charge.
L'AFIDP organise régulièrement des journées d'information où patients, familles et professionnels de santé se rencontrent. Ces événements permettent de partager les dernières avancées thérapeutiques et de créer des liens entre les familles confrontées aux mêmes défis [8]. Leur site internet propose également une documentation complète et régulièrement mise à jour.
Au niveau européen, l'European Society for Primary Immunodeficiencies (ESID) coordonne la recherche et harmonise les pratiques de soins [6,7]. Cette organisation publie des registres épidémiologiques précieux et facilite l'accès aux essais cliniques internationaux.
Les centres de référence constituent également des ressources essentielles. En France, le Centre de Référence des Déficits Immunitaires Héréditaires (CEREDIH) coordonne un réseau de centres experts répartis sur tout le territoire . Ces centres proposent consultations spécialisées, bilans diagnostiques et coordination des soins.
N'oubliez pas les ressources numériques : forums de patients, groupes Facebook dédiés, applications mobiles pour le suivi médical. Ces outils modernes facilitent l'échange d'expériences et le maintien du lien social, particulièrement précieux pour les familles isolées géographiquement [5].
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec un déficit d'adhérence leucocytaire nécessite une organisation rigoureuse, mais quelques astuces peuvent grandement faciliter le quotidien [4,5]. Constituez une trousse de soins d'urgence que vous emporterez partout : antiseptique, pansements stériles, thermomètre, et bien sûr vos antibiotiques de réserve prescrits par votre médecin.
Pour l'hygiène quotidienne, adoptez la règle des "3 fois" : lavage des mains 3 fois plus fréquent qu'une personne normale, désinfection 3 fois par jour des objets fréquemment touchés (téléphone, clés, poignées de porte), et changement de vêtements 3 fois par semaine minimum [8]. Ces gestes simples réduisent significativement le risque infectieux.
Côté alimentation, privilégiez le "fait maison" autant que possible [6,7]. Cuisinez vos légumes, évitez les crudités en restaurant, méfiez-vous des buffets où les aliments restent exposés. Une astuce pratique : préparez des portions individuelles que vous congelerez, attendussant ainsi des repas sains même lors des périodes difficiles.
Organisez votre suivi médical avec méthode. Tenez un carnet de bord détaillé : température quotidienne, épisodes infectieux, traitements pris, effets secondaires observés [5]. Ces informations sont précieuses pour votre équipe médicale et facilitent l'adaptation des traitements.
Enfin, n'hésitez pas à informer votre entourage proche : famille, amis, collègues, enseignants. Une personne informée sera plus vigilante et pourra vous aider en cas de besoin. Préparez un petit document explicatif simple que vous pourrez distribuer facilement [4].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter en urgence, même si vous êtes habitué à gérer votre déficit d'adhérence leucocytaire [6,7]. Une fièvre supérieure à 38,5°C nécessite une consultation immédiate, car elle peut signaler une infection grave nécessitant un traitement antibiotique intraveineux.
Les signes cutanés méritent également une attention particulière. Toute plaie qui ne cicatrise pas normalement, tout érythème qui s'étend rapidement, ou l'apparition d'abcès doivent vous conduire chez votre médecin [3,8]. N'attendez pas que la situation s'aggrave : dans votre cas, la précocité du traitement est cruciale.
Au niveau respiratoire, une toux persistante, des difficultés respiratoires, ou des douleurs thoraciques imposent une consultation rapide [4]. Ces symptômes peuvent révéler une pneumonie, complication potentiellement grave chez les patients immunodéprimés. De même, des troubles digestifs sévères (diarrhées sanglantes, douleurs abdominales intenses) nécessitent une évaluation médicale urgente.
Pour le suivi de routine, respectez scrupuleusement le calendrier établi avec votre équipe médicale [5]. Les consultations de contrôle permettent d'adapter les traitements préventifs et de dépister précocement d'éventuelles complications. N'hésitez jamais à contacter votre médecin référent en cas de doute : il préfère être consulté "pour rien" que de passer à côté d'une complication.
Bon à savoir : la plupart des centres spécialisés proposent une ligne téléphonique dédiée aux urgences. Gardez ce numéro toujours accessible et n'hésitez pas à l'utiliser [1].
Questions Fréquentes
Mon enfant peut-il aller à l'école normalement ?
Oui, avec quelques précautions. Informez l'équipe éducative de la pathologie, établissez un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) avec le médecin scolaire, et prévoyez une trousse de soins d'urgence. Évitez simplement l'école pendant les épidémies.
Les vaccins sont-ils contre-indiqués ?
Au contraire, la vaccination est encore plus importante chez les patients immunodéprimés. Cependant, seuls les vaccins inactivés sont autorisés. Les vaccins vivants atténués sont formellement contre-indiqués.
Peut-on avoir des enfants quand on a un DAL ?
Oui, mais un conseil génétique est indispensable. Si votre partenaire n'est pas porteur, vos enfants seront porteurs sains. Un diagnostic prénatal peut être proposé si nécessaire.
Le sport est-il autorisé ?
L'activité physique est même recommandée pour renforcer l'immunité résiduelle. Évitez simplement les sports de contact avec risque de blessure et privilégiez les activités en milieu contrôlé.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Recommandations de prise en charge des personnes - HAS 2024-2025Lien
- [2] Immunisation des sujets immunodéprimés - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] NOS PROJETS DE RECHERCHE - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Bulletin de recherche ERS 2024 - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Leukocyte Adhesion Deficiency - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] Kindlin-3 Phosphorylation is Crucial for Thrombosis and Hemostasis In Vivo - 2024-2025Lien
- [7] Un déficit d'adhésion leucocytaire associé à un pyoderma gangrenosum-like extensif et récalcitrant - 2024Lien
- [11] Les déficits immunitaires chez les enfants - 2022Lien
- [12] Hématologie-Immunologie et Biothérapie 2024-2025: L'enseignement en fichesLien
- [15] Déficit d'adhésion leucocytaire - Troubles immunitaires - MSD ManualsLien
- [16] Syndrome de déficit d'adhésion des leucocytes - MSD Manuals ProfessionalLien
- [17] Déficit d'adhésion leucocytaire - OrphanetLien
Publications scientifiques
- Un déficit d'adhésion leucocytaire associé à un pyoderma gangrenosum-like extensif et récalcitrant (2024)
- Le glomérule dans tous ses états. (2022)2 citations[PDF]
- Evaluation de l'effet de l'extrait Hydro-éthanolique des feuilles d'olivier sur l'adhérence et la production d'espèces réactives de l'oxygène par les polynucléaires … (2024)
- [HTML][HTML] Prise en charge initiale d'une leucémie aiguë et de ses complications (2025)
- Les déficits immunitaires chez les enfants (2022)[PDF]
Ressources web
- Déficit d'adhésion leucocytaire - Troubles immunitaires (msdmanuals.com)
Le traitement du déficit d'adhésion leucocytaire comprend des antibiotiques, souvent administrés de façon continue, pour prévenir les infections. Des ...
- Syndrome de déficit d'adhésion des leucocytes (msdmanuals.com)
Le diagnostic repose sur la recherche de glycoprotéines adhésives à la surface des globules blancs. Le traitement est symptomatique, qui utilise des ...
- Déficit d'adhésion leucocytaire (orpha.net)
Le DAL-II se manifeste par une leucocytose, des infections récurrentes, un retard de croissance sévère et un déficit intellectuel sévère.
- Déficit d'adhérence des leucocytes : causes, symptômes et ... (medicoverhospitals.in)
Le diagnostic implique des analyses sanguines et des tests génétiques pour évaluer la fonction des globules blancs. 4. Quels sont les traitements disponibles ?
- Déficit d'adhésion leucocytaire (fr.wikipedia.org)
Le déficit d'adhérence des leucocytes (DAL) (LAD en anglais) est un trouble rare autosomique récessif caractérisé par un déficit immunitaire entraînant des ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
