Décès Maternel : Guide Complet 2025 - Prévention et Prise en Charge
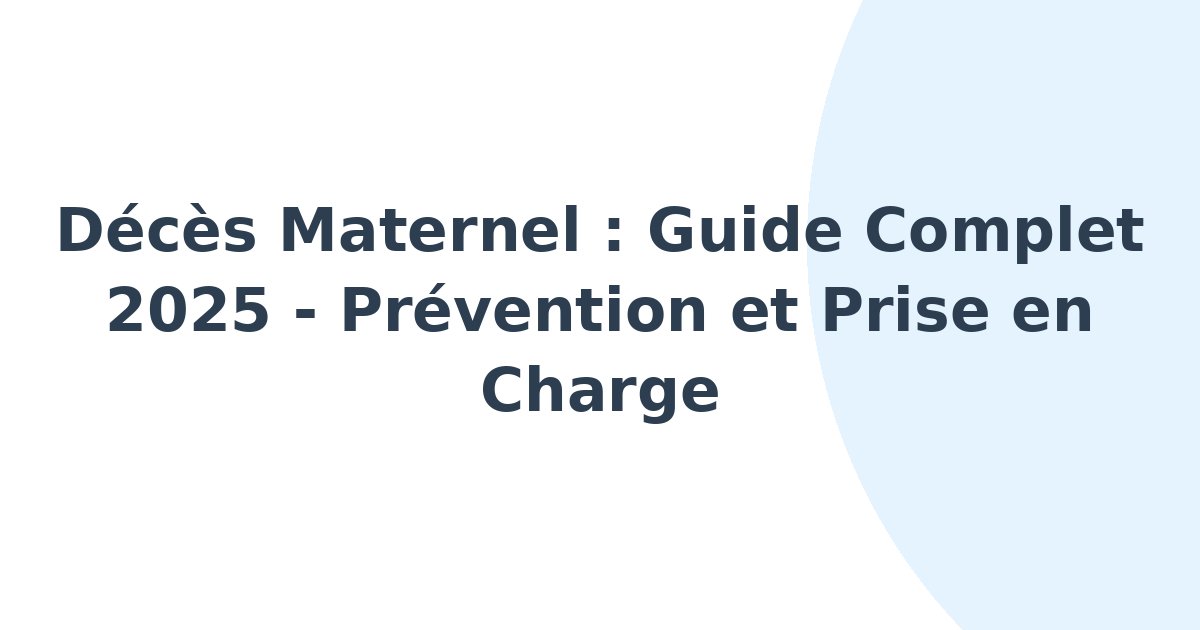
Le décès maternel représente l'une des tragédies les plus évitables de notre système de santé moderne. En France, cette pathologie touche encore trop de familles, malgré les progrès considérables de la médecine obstétricale. Comprendre les causes, reconnaître les signaux d'alarme et connaître les innovations thérapeutiques 2024-2025 peut sauver des vies. Ce guide vous accompagne dans cette démarche essentielle.
Téléconsultation et Décès maternel
Téléconsultation non recommandéeLe décès maternel constitue une urgence vitale absolue nécessitant une prise en charge immédiate et spécialisée en milieu hospitalier. La téléconsultation ne peut en aucun cas remplacer l'intervention médicale directe et les mesures de réanimation qui peuvent être requises dans cette situation critique.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation initiale des circonstances et des symptômes précédant la situation critique, recueil de l'historique obstétrical et médical, analyse des facteurs de risque maternels préexistants, orientation vers une prise en charge d'urgence appropriée, coordination avec les services d'urgence.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet et surveillance des signes vitaux, réanimation cardio-respiratoire si nécessaire, examens biologiques et d'imagerie urgents, prise en charge multidisciplinaire en milieu hospitalier spécialisé.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Toute situation de détresse maternelle nécessite une prise en charge hospitalière immédiate, l'évaluation des signes vitaux et de l'état hémodynamique ne peut se faire qu'en présentiel, la surveillance fœtale simultanée requiert un équipement spécialisé, les mesures de réanimation ne peuvent être mises en œuvre qu'en milieu hospitalier.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Hémorragie du post-partum massive, éclampsie avec convulsions, embolie pulmonaire ou amniotique, choc septique post-partum, détresse respiratoire aiguë.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Hémorragie génitale massive avec signes de choc (pâleur, sueurs froides, pouls rapide)
- Convulsions ou troubles de la conscience chez une femme enceinte ou en post-partum
- Difficultés respiratoires sévères avec cyanose ou détresse respiratoire
- Douleurs thoraciques brutales avec malaise ou perte de connaissance
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Gynécologue-obstétricien — consultation en présentiel indispensable
La prise en charge du décès maternel nécessite impérativement une équipe multidisciplinaire spécialisée en obstétrique et réanimation. Une consultation en présentiel en milieu hospitalier est absolument indispensable pour cette urgence vitale.
Décès maternel : Définition et Vue d'Ensemble
Le décès maternel se définit comme le décès d'une femme survenant pendant la grossesse ou dans les 42 jours suivant sa terminaison, quelle qu'en soit la durée ou la localisation [4]. Cette définition, établie par l'Organisation mondiale de la santé, englobe tous les décès dus à des causes liées ou aggravées par la grossesse ou sa prise en charge.
Mais il faut distinguer deux types de décès maternels. D'une part, les décès maternels directs résultent de complications obstétricales pendant la grossesse, l'accouchement ou le post-partum. D'autre part, les décès maternels indirects sont causés par une maladie préexistante ou développée pendant la grossesse, aggravée par les effets physiologiques de celle-ci [2].
L'important à retenir, c'est que la plupart de ces décès sont évitables. En fait, selon les données de l'OMS, environ 94% des décès maternels surviennent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, soulignant l'importance cruciale de l'accès aux soins de qualité [2]. En France, nous bénéficions d'un système de santé performant, mais la vigilance reste de mise.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les chiffres français révèlent une réalité contrastée mais encourageante. Selon les dernières données de Santé publique France, le ratio de mortalité maternelle en France s'établit à environ 8,8 décès pour 100 000 naissances vivantes, plaçant notre pays parmi les plus performants au monde [3]. Cette performance remarquable résulte de décennies d'amélioration continue de notre système de soins périnatals.
Cependant, ces moyennes nationales masquent des disparités importantes. L'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles révèle que certaines régions présentent des taux supérieurs à la moyenne, notamment en raison de l'éloignement géographique des centres spécialisés [3,8]. D'ailleurs, l'âge maternel joue un rôle déterminant : le risque double après 35 ans et triple après 40 ans.
À l'échelle mondiale, les contrastes sont saisissants. Tandis que les pays nordiques affichent des ratios inférieurs à 5 pour 100 000, certaines régions d'Afrique subsaharienne dépassent les 500 décès maternels pour 100 000 naissances [2]. Cette disparité illustre l'impact majeur de l'accès aux soins de qualité sur la survie maternelle.
Les hémorragies du post-partum représentent la première cause de décès maternel en France, comptant pour environ 18% des cas selon les données HAS 2024-2025 [1]. Viennent ensuite les embolies pulmonaires et les complications hypertensives de la grossesse. Bon à savoir : ces trois causes principales sont toutes accessibles à une prévention et une prise en charge efficaces.
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre les causes du décès maternel, c'est d'abord identifier les mécanismes qui peuvent transformer une grossesse normale en situation critique. Les hémorragies obstétricales dominent le tableau, qu'elles surviennent pendant la grossesse, l'accouchement ou le post-partum immédiat [1,3]. Ces saignements massifs peuvent rapidement conduire à un choc hémorragique fatal si la prise en charge n'est pas immédiate.
Les troubles hypertensifs constituent la deuxième grande famille de causes. La pré-éclampsie et l'éclampsie peuvent évoluer vers des complications neurologiques ou hépatiques gravissimes. Et puis il y a les embolies, notamment l'embolie pulmonaire et l'embolie amniotique, cette dernière étant particulièrement redoutable par sa soudaineté et sa gravité [3,8].
Mais certains facteurs augmentent significativement les risques. L'âge maternel avancé (plus de 35 ans) multiplie les complications, tout comme l'obésité, le diabète gestationnel ou les antécédents de césarienne [8,10]. Les grossesses multiples et certaines pathologies préexistantes comme les cardiopathies ou les troubles de la coagulation nécessitent une surveillance renforcée.
Il faut aussi mentionner les facteurs socio-économiques. L'isolement social, les difficultés d'accès aux soins ou le suivi prénatal insuffisant peuvent retarder la détection de complications pourtant curables [3,9]. C'est pourquoi la prévention passe aussi par une approche globale de la santé maternelle.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les signaux d'alarme peut littéralement sauver une vie. Pendant la grossesse, certains symptômes doivent immédiatement alerter. Les maux de tête intenses et persistants, surtout s'ils s'accompagnent de troubles visuels ou de douleurs épigastriques, peuvent signaler une pré-éclampsie évoluant vers l'éclampsie [3].
Les saignements vaginaux abondants constituent toujours une urgence, qu'ils surviennent pendant la grossesse ou après l'accouchement. Mais attention : un saignement peut parfois être discret au début, masqué par une hémorragie interne. C'est pourquoi toute douleur abdominale intense, tout malaise ou toute chute de tension doit faire consulter en urgence [1,3].
Après l'accouchement, la vigilance doit se maintenir. Une dyspnée brutale (difficulté respiratoire), des douleurs thoraciques ou une toux avec expectoration sanglante peuvent révéler une embolie pulmonaire. De même, des convulsions, une confusion ou des troubles de la conscience nécessitent une prise en charge immédiate [8].
L'entourage joue un rôle crucial dans cette détection précoce. Il est normal de s'inquiéter face à des symptômes inhabituels chez une femme enceinte ou qui vient d'accoucher. Mieux vaut consulter pour rien que passer à côté d'une complication grave.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Face à une suspicion de complication maternelle grave, chaque minute compte. Le diagnostic repose d'abord sur l'évaluation clinique rapide : prise des constantes vitales, examen obstétrical complet et recherche de signes de gravité [3,8]. Les équipes médicales utilisent des scores de gravité standardisés pour orienter rapidement la prise en charge.
Les examens complémentaires s'adaptent à la situation clinique. En cas de suspicion d'hémorragie, un bilan de coagulation complet et une numération formule sanguine permettent d'évaluer l'importance du saignement et les troubles de l'hémostase associés [1]. Pour les complications hypertensives, le dosage des protéines urinaires et le bilan hépatique orientent vers une pré-éclampsie.
L'imagerie joue un rôle déterminant. L'échographie permet de localiser une hémorragie interne ou d'évaluer l'état fœtal. Le scanner thoracique avec injection reste l'examen de référence pour diagnostiquer une embolie pulmonaire, même chez la femme enceinte [8]. D'ailleurs, les nouvelles techniques d'imagerie 2024-2025 permettent de réduire l'irradiation tout en améliorant la précision diagnostique.
Concrètement, ce parcours diagnostic s'organise autour d'une approche multidisciplinaire. Obstétriciens, anesthésistes-réanimateurs, biologistes et radiologues collaborent étroitement pour poser un diagnostic rapide et précis, maladie sine qua non d'une prise en charge efficace.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du décès maternel, c'est avant tout la prévention et le traitement des complications qui y conduisent. Pour les hémorragies obstétricales, l'arsenal thérapeutique s'est considérablement enrichi ces dernières années. Les utérotoniques (ocytocine, ergométrine) constituent la première ligne, complétés si nécessaire par l'acide tranexamique pour limiter la fibrinolyse [1].
Quand les traitements médicamenteux ne suffisent pas, les techniques interventionnelles prennent le relais. L'embolisation artérielle par voie endovasculaire permet de contrôler efficacement les hémorragies réfractaires, évitant souvent l'hystérectomie d'hémostase [1,3]. Cette technique, maîtrisée dans la plupart des centres de référence, a révolutionné la prise en charge des hémorragies sévères.
Pour les complications hypertensives, le traitement repose sur le contrôle tensionnel et la prévention des convulsions. Le sulfate de magnésium reste le traitement de référence de l'éclampsie, tandis que les antihypertenseurs comme la nicardipine permettent de contrôler les poussées hypertensives [8]. L'important, c'est de trouver l'équilibre entre efficacité maternelle et sécurité fœtale.
Les embolies pulmonaires nécessitent une anticoagulation immédiate, généralement par héparine de bas poids moléculaire. Dans les formes les plus graves, la thrombolyse ou l'embolectomie chirurgicale peuvent être nécessaires [8]. Heureusement, les nouveaux protocoles de prise en charge ont considérablement amélioré le pronostic de ces complications redoutables.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2025 marque un tournant dans la prévention du décès maternel avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses. Le rapport "State of Maternal Health 2025" met en lumière des innovations révolutionnaires qui transforment déjà la prise en charge obstétricale [5]. Ces avancées offrent un espoir considérable pour réduire encore la mortalité maternelle.
L'une des innovations les plus remarquables concerne l'utilisation de l'azithromycine en per-partum. Une étude récente publiée dans The Lancet démontre l'efficacité coût-bénéfice de cet antibiotique pour prévenir les infections maternelles et néonatales [6]. Cette approche prophylactique simple pourrait révolutionner la prévention des sepsis post-partum, particulièrement dans les contextes à ressources limitées.
Les recherches cliniques 2024-2025 explorent également de nouvelles voies thérapeutiques pour améliorer la santé maternelle et périnatale [7]. Les thérapies ciblées, l'utilisation de biomarqueurs prédictifs et les approches personnalisées de la médecine de précision ouvrent des perspectives inédites. D'ailleurs, l'intelligence artificielle commence à être intégrée dans les algorithmes de détection précoce des complications.
Mais l'innovation ne se limite pas aux traitements. Les nouveaux dispositifs de monitoring continu, les applications de télémédecine et les systèmes d'alerte précoce transforment la surveillance maternelle. Ces outils permettent une détection plus rapide des complications et une intervention plus précoce, facteurs clés de la réduction de la mortalité maternelle.
Vivre au Quotidien avec le Risque de Décès Maternel
Aborder la question du décès maternel avec les femmes enceintes et leur entourage nécessite une approche délicate et bienveillante. Il ne s'agit pas de créer une anxiété inutile, mais plutôt d'informer et de responsabiliser. La plupart des grossesses se déroulent sans complication majeure, mais connaître les signaux d'alarme peut faire la différence [3].
Pour les femmes présentant des facteurs de risque élevés, un suivi spécialisé s'impose. Cela implique des consultations plus fréquentes, des examens complémentaires réguliers et parfois une hospitalisation préventive en fin de grossesse [8,10]. Cette surveillance renforcée, loin d'être contraignante, constitue un filet de sécurité indispensable.
L'entourage familial joue un rôle crucial dans cette démarche préventive. Conjoints, parents et proches doivent être sensibilisés aux signes d'alarme et savoir réagir en cas d'urgence. Des formations aux gestes de premiers secours spécifiques à la grossesse sont d'ailleurs proposées dans certaines maternités [3].
Il faut aussi parler de l'impact psychologique. La peur du décès maternel peut générer une anxiété importante chez certaines femmes. Un accompagnement psychologique, parfois nécessaire, aide à gérer ces craintes légitimes tout en maintenant une grossesse sereine. L'important, c'est de trouver l'équilibre entre vigilance nécessaire et sérénité préservée.
Les Complications Possibles
Les complications menant au décès maternel suivent souvent une cascade d'événements qu'il est crucial de comprendre pour mieux les prévenir. L'hémorragie massive peut rapidement évoluer vers un choc hémorragique, avec chute de la tension artérielle, accélération du rythme cardiaque et altération de la conscience [1,3]. Sans prise en charge immédiate, l'hypoperfusion des organes vitaux peut conduire à une défaillance multiviscérale.
Les complications hypertensives présentent leur propre spectre de gravité. La pré-éclampsie peut évoluer vers le syndrome HELLP (hémolyse, élévation des enzymes hépatiques, thrombopénie), une complication redoutable qui menace à la fois la mère et l'enfant [8]. L'éclampsie, caractérisée par des convulsions, peut entraîner des lésions cérébrales permanentes ou un coma.
L'embolie amniotique représente l'une des complications les plus dramatiques de l'obstétrique. Cette pathologie rare mais gravissime survient lorsque le liquide amniotique pénètre dans la circulation maternelle, déclenchant une réaction anaphylactoïde massive [3,8]. Le pronostic reste sombre malgré les progrès de la réanimation.
Il faut également mentionner les complications infectieuses. Le sepsis puerpéral, bien que moins fréquent aujourd'hui grâce à l'antibiothérapie, peut encore évoluer vers un choc septique fatal. C'est pourquoi la surveillance post-partum reste essentielle, même après un accouchement apparemment normal [9,10].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du décès maternel dépend essentiellement de la rapidité de la prise en charge et de la nature de la complication. En France, grâce à notre système de soins performant, la plupart des complications obstétricales graves peuvent être maîtrisées si elles sont détectées et traitées précocement [3,8]. Cette réalité explique en grande partie notre excellent ratio de mortalité maternelle comparé aux standards internationaux.
Pour les hémorragies obstétricales, le pronostic s'est considérablement amélioré avec les nouvelles techniques d'embolisation et les protocoles de transfusion massive. Aujourd'hui, plus de 95% des hémorragies sévères peuvent être contrôlées sans séquelles majeures pour la mère [1]. Cependant, le délai d'intervention reste déterminant : chaque minute compte dans ces situations critiques.
Les complications hypertensives offrent également un pronostic favorable lorsqu'elles sont prises en charge dans des centres spécialisés. La pré-éclampsie, même sévère, peut être stabilisée dans la majorité des cas, permettant un accouchement dans de bonnes maladies [8]. Néanmoins, certaines formes fulminantes restent redoutables et nécessitent une expertise particulière.
L'évolution à long terme mérite aussi d'être considérée. Les femmes ayant présenté une complication maternelle grave gardent parfois des séquelles physiques ou psychologiques. Un suivi spécialisé post-partum permet de dépister et traiter ces complications tardives, améliorant ainsi la qualité de vie à long terme [10].
Peut-on Prévenir le Décès Maternel ?
La prévention du décès maternel repose sur une approche globale qui commence bien avant la grossesse. Le suivi prénatal régulier constitue le pilier de cette prévention, permettant de dépister précocement les facteurs de risque et les complications naissantes [3,8]. En France, le calendrier de suivi recommandé comprend au minimum sept consultations et trois échographies, mais ce rythme peut être intensifié selon les situations.
L'identification des femmes à haut risque permet d'adapter la surveillance et la prise en charge. Les antécédents médicaux, l'âge maternel, l'indice de masse corporelle et les pathologies associées orientent vers un suivi spécialisé [8,10]. Cette stratification du risque, codifiée dans les recommandations professionnelles, améliore significativement le pronostic maternel.
La formation des professionnels de santé joue un rôle déterminant dans cette prévention. Les programmes de formation continue, les simulations d'urgences obstétricales et les audits de pratiques contribuent à maintenir un haut niveau de compétence [3]. D'ailleurs, les nouvelles technologies de formation par réalité virtuelle révolutionnent l'apprentissage de la gestion des urgences.
Mais la prévention ne s'arrête pas à la naissance. Le suivi post-partum, souvent négligé, reste crucial pour dépister les complications tardives. La consultation post-natale, programmée 6 à 8 semaines après l'accouchement, doit être systématique et approfondie. Cette vigilance prolongée permet de prévenir de nombreux décès maternels tardifs [9,10].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont développé un arsenal de recommandations pour lutter contre le décès maternel. La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024-2025 des indicateurs spécifiques pour mesurer et améliorer la prise en charge des hémorragies du post-partum, première cause de mortalité maternelle en France [1]. Ces indicateurs permettent aux établissements d'évaluer leurs pratiques et de les améliorer continuellement.
Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) actualise régulièrement ses recommandations pour la pratique clinique. Les dernières guidelines 2024 insistent particulièrement sur la prise en charge multidisciplinaire des urgences obstétricales et l'importance de la simulation en formation [8]. Ces recommandations, basées sur les preuves scientifiques les plus récentes, guident la pratique quotidienne des professionnels.
Santé publique France coordonne la surveillance épidémiologique à travers l'Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM). Cette surveillance, unique en Europe par sa exhaustivité, permet d'identifier les facteurs de risque émergents et d'adapter les stratégies de prévention [3,8]. Chaque décès maternel fait l'objet d'une analyse approfondie pour en tirer des enseignements préventifs.
Au niveau européen, les recommandations convergent vers une approche standardisée de la prise en charge des urgences obstétricales. L'harmonisation des protocoles, la formation des équipes et l'amélioration de l'accès aux soins constituent les axes prioritaires de cette politique de santé publique [2,5].
Ressources et Associations de Patients
Face au décès maternel, les familles ne sont pas seules. Plusieurs associations françaises accompagnent les proches endeuillés et militent pour l'amélioration de la sécurité maternelle. L'association "Maman Blues" propose un soutien psychologique spécialisé pour les femmes en difficulté pendant la grossesse et après l'accouchement. Leur ligne d'écoute gratuite offre une aide précieuse dans les moments difficiles.
L'association "CIANE" (Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE) milite pour l'amélioration des maladies de naissance et la réduction des violences obstétricales. Leurs actions de sensibilisation et leurs publications contribuent à faire évoluer les pratiques professionnelles vers plus de bienveillance et de sécurité [3].
Pour les professionnels de santé, la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation (SFAR) et le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) proposent des formations continues et des référentiels de bonnes pratiques. Ces sociétés savantes jouent un rôle essentiel dans la diffusion des connaissances et l'amélioration des pratiques [8].
Les ressources en ligne se multiplient également. Le site "Périnatalité France" centralise les informations officielles sur la grossesse et l'accouchement. Les applications mobiles de suivi de grossesse intègrent désormais des alertes sur les signes de danger, contribuant à la prévention des complications graves.
Nos Conseils Pratiques
Prévenir le décès maternel commence par des gestes simples mais essentiels. Respectez scrupuleusement le calendrier de suivi prénatal recommandé par votre médecin ou sage-femme. Ces consultations régulières permettent de dépister précocement les complications et d'adapter la prise en charge si nécessaire [3,8]. N'hésitez jamais à reporter un rendez-vous manqué plutôt que de l'annuler définitivement.
Apprenez à reconnaître les signaux d'alarme et n'hésitez pas à consulter en urgence si vous ressentez des symptômes inquiétants. Maux de tête intenses, troubles visuels, douleurs abdominales sévères ou saignements anormaux doivent vous amener immédiatement aux urgences [1,3]. Il vaut mieux consulter pour rien que passer à côté d'une complication grave.
Préparez votre accouchement en choisissant une maternité adaptée à votre niveau de risque. Les femmes présentant des facteurs de risque particuliers doivent accoucher dans des centres de niveau II ou III, équipés pour gérer les complications [8,10]. Cette orientation, décidée avec votre équipe médicale, constitue un gage de sécurité supplémentaire.
Après l'accouchement, maintenez votre vigilance. Les complications peuvent survenir jusqu'à 42 jours après la naissance, d'où l'importance de la consultation post-natale et du suivi à domicile par une sage-femme [9,10]. Signalez immédiatement tout symptôme anormal : fièvre, saignements importants, douleurs inhabituelles ou difficultés respiratoires.
Quand Consulter un Médecin ?
Certaines situations imposent une consultation médicale immédiate, sans délai ni hésitation. Pendant la grossesse, des maux de tête sévères accompagnés de troubles visuels (points lumineux, vision floue) ou de douleurs épigastriques peuvent signaler une pré-éclampsie évolutive [3,8]. Ces symptômes nécessitent une évaluation urgente en milieu hospitalier.
Tout saignement vaginal abondant, qu'il survienne pendant la grossesse ou après l'accouchement, constitue une urgence absolue. Même si le saignement semble se tarir, une consultation s'impose pour éliminer une hémorragie interne [1,3]. De même, des douleurs abdominales intenses, surtout si elles s'accompagnent de malaise ou de pâleur, doivent alerter.
Après l'accouchement, plusieurs signes doivent vous amener à consulter rapidement. Une dyspnée brutale (essoufflement soudain), des douleurs thoraciques ou une toux avec crachats sanglants peuvent révéler une embolie pulmonaire [8]. Une fièvre élevée, des frissons ou des douleurs pelviennes peuvent signaler une infection post-partum.
N'attendez jamais que les symptômes s'aggravent. En obstétrique, la règle d'or reste : "dans le doute, consultez". Les équipes des urgences obstétricales sont formées pour évaluer rapidement la gravité d'une situation et orienter vers la prise en charge appropriée. Votre vie et celle de votre enfant peuvent en dépendre [3,9].
Questions Fréquentes
Le décès maternel est-il fréquent en France ?
Non, le décès maternel reste heureusement rare en France avec un ratio de 8,8 décès pour 100 000 naissances vivantes, plaçant notre pays parmi les plus sûrs au monde. Cependant, chaque décès évitable justifie une vigilance constante.
Quels sont les principaux facteurs de risque ?
L'âge maternel avancé (plus de 35 ans), l'obésité, les antécédents de césarienne, les grossesses multiples et certaines pathologies comme l'hypertension ou le diabète augmentent les risques. Un suivi adapté permet de gérer ces facteurs efficacement.
Comment reconnaître une urgence obstétricale ?
Les signaux d'alarme incluent : maux de tête intenses avec troubles visuels, saignements vaginaux abondants, douleurs abdominales sévères, dyspnée brutale ou convulsions. Face à ces symptômes, consultez immédiatement aux urgences.
Les innovations 2024-2025 améliorent-elles le pronostic ?
Oui, les nouvelles approches thérapeutiques comme l'azithromycine prophylactique et les techniques de monitoring avancé révolutionnent la prévention. Ces innovations promettent une réduction significative de la mortalité maternelle.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Mesure des hémorragies du post-partum. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Mortalité maternelle. www.who.int.Lien
- [3] Les morts maternelles en France : mieux comprendre pour mieux prévenir. www.santepubliquefrance.fr.Lien
- [4] Définitions et recommandations | CépiDc - Inserm. cepidc.inserm.fr.Lien
- [5] State of Maternal Health 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Cost-effectiveness of intrapartum azithromycin to prevent maternal and neonatal sepsis. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Advancing maternal and perinatal health through clinical research. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Surveillance des morts maternelles en France, un système de surveillance améliorée depuis 25 ans. 2024.Lien
- [11] Caractéristiques épidémiologiques des décès maternels dans le département du Couffo, Bénin. 2025.Lien
- [13] Les déterminants de décès maternel en milieu hospitalier à Madagascar. 2024.Lien
Publications scientifiques
- … sur les morts maternelles en France, un système de surveillance améliorée depuis 25 ans, indispensable pour la caractérisation fiable des décès maternels (2024)26 citations
- [PDF][PDF] Décès Maternel chez les patientes évacuées à l'hôpital Fousseyni DAOU de Kayes sur une décennie (2022)2 citations[PDF]
- Analyse des données de surveillance des décès maternels de la région ME, Côte d'Ivoire, Janvier 2020 à Décembre 2023 (2025)
- [HTML][HTML] Caractéristiques épidémiologiques des décès maternels dans le département du Couffo, Bénin, janvier 2018-juin 2022 (2025)
- Évaluation du système de surveillance des Décès Maternels, Région Sanitaire du Guémon, Côte d'Ivoire, 31 octobre au 30 novembre 2022. (2025)
Ressources web
- Mortalité maternelle (who.int)
7 avr. 2025 — hémorragies graves (principalement après l'accouchement) ; · infections (généralement après l'accouchement) ; · hypertension artérielle pendant la ...
- Les morts maternelles en France : mieux comprendre pour ... (santepubliquefrance.fr)
3 avr. 2024 — Les maladies cardiovasculaires sont la 2e cause de mortalité maternelle (MM) jusqu'à un an (14 %) et la première cause de MM jusqu'à quarante- ...
- Définitions et recommandations | CépiDc - Inserm (cepidc.inserm.fr)
La mort maternelle se définit comme le décès d'une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu'en soit ...
- Mortalité maternelle par pathologies cardiovasculaires en ... (sciencedirect.com)
de M Bruyère · 2024 · Cité 2 fois — L'échographie de débrouillage « au lit » (épanchements liquidiens, dysfonction cardiaque) et le dosage des enzymes cardiaques peuvent aider au diagnostic. Enfin ...
- les morts maternelles en france : mieux comprendre pour ... (cress-umr1153.fr)
Un défaut d'organisation des soins est retenu comme facteur d'évitabilité dans 24 % des décès ; et un défaut d'interaction entre la femme et le système de soins ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
