Mort périnatale : Guide Complet 2025 - Causes, Prévention et Accompagnement
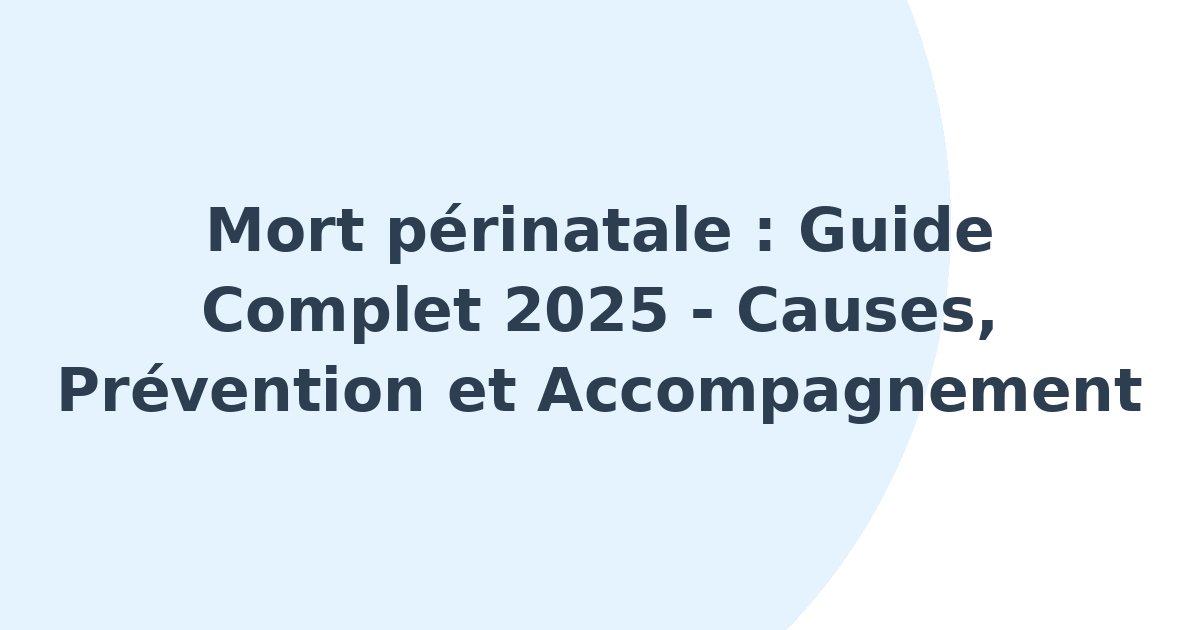
La mort périnatale représente l'une des épreuves les plus difficiles qu'un couple puisse traverser. Cette pathologie, définie par le décès d'un fœtus ou d'un nouveau-né entre 22 semaines de grossesse et 7 jours après la naissance, touche environ 10 pour 1000 naissances en France [1]. Comprendre ses causes, reconnaître les signes d'alerte et connaître les possibilités d'accompagnement peut vous aider à mieux appréhender cette réalité médicale complexe.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Mort périnatale : Définition et Vue d'Ensemble
La mort périnatale englobe deux situations distinctes mais liées : la mort fœtale in utero (mortinaissance) et la mort néonatale précoce. Cette définition médicale précise permet aux professionnels de santé d'établir des statistiques fiables et d'adapter leur prise en charge [1,13].
Concrètement, on parle de mort fœtale lorsque le décès survient après 22 semaines d'aménorrhée ou pour un poids fœtal supérieur à 500 grammes. La mort néonatale précoce concerne quant à elle les décès survenant dans les 7 premiers jours de vie. Cette distinction peut sembler technique, mais elle influence directement l'accompagnement médical et psychologique proposé aux familles.
L'important à retenir, c'est que chaque situation est unique. Les causes peuvent être multiples : malformations congénitales, infections, problèmes placentaires ou complications maternelles. D'ailleurs, dans environ 25% des cas, aucune cause précise n'est identifiée, ce qui peut rendre l'épreuve encore plus difficile à accepter pour les parents [13,14].
Bon à savoir : les équipes médicales sont aujourd'hui mieux formées pour accompagner les familles dans ces moments difficiles. Des protocoles spécifiques existent pour préserver la dignité du bébé et permettre aux parents de faire leur deuil dans les meilleures maladies possibles.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la mortalité périnatale touche environ 10,4 pour 1000 naissances selon les dernières données de l'INSERM [1]. Ce chiffre peut paraître abstrait, mais il représente concrètement près de 8000 familles touchées chaque année sur notre territoire. Ces statistiques montrent une légère amélioration par rapport aux années précédentes, grâce notamment aux progrès de la médecine périnatale.
Mais les disparités régionales restent importantes. Les départements d'outre-mer affichent des taux supérieurs à la moyenne métropolitaine, avec des variations pouvant atteindre 15 pour 1000 naissances dans certaines zones. Cette différence s'explique par des facteurs socio-économiques, l'accès aux soins et les spécificités démographiques locales [5,10].
Au niveau international, la France se situe dans la moyenne européenne. Les pays nordiques comme la Finlande ou la Norvège affichent des taux légèrement inférieurs (8-9 pour 1000), tandis que certains pays d'Europe de l'Est dépassent les 12 pour 1000 naissances. Ces écarts reflètent les différences dans l'organisation des systèmes de santé et l'accès aux soins prénataux [2].
L'évolution temporelle est encourageante : depuis 2010, on observe une diminution progressive de la mortalité périnatale en France, passant de 11,2 à 10,4 pour 1000 naissances. Cette amélioration résulte des progrès en médecine fœtale, de l'amélioration du suivi prénatal et de la formation des équipes obstétricales [1,2].
Concernant les projections futures, les experts estiment qu'une stabilisation autour de 9-10 pour 1000 naissances est réaliste d'ici 2030, à maladie de maintenir les efforts de prévention et d'améliorer l'accès aux soins dans les zones défavorisées.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de mort périnatale sont multiples et souvent intriquées. Les malformations congénitales représentent environ 20% des cas, suivies par les infections materno-fœtales (15%) et les complications placentaires comme le décollement ou l'insuffisance placentaire (18%) [5,13]. Ces chiffres peuvent varier selon les études, mais ils donnent une idée de la complexité du problème.
Parmi les facteurs de risque maternels, l'âge joue un rôle important. Les femmes de moins de 18 ans ou de plus de 35 ans présentent un risque accru. Le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle et les maladies auto-immunes multiplient également les risques. D'ailleurs, certaines infections comme la toxoplasmose, la listériose ou les infections à streptocoque B peuvent avoir des conséquences dramatiques si elles ne sont pas dépistées et traitées à temps [5,14].
Les facteurs environnementaux ne sont pas à négliger. Le tabagisme maternel double le risque de mort fœtale, tandis que la consommation d'alcool peut provoquer des malformations incompatibles avec la vie. L'exposition à certains toxiques professionnels ou environnementaux fait également l'objet d'études approfondies [8].
Mais attention, il est crucial de comprendre que la présence d'un facteur de risque ne signifie pas automatiquement qu'un drame va survenir. La plupart des grossesses se déroulent normalement, même en présence de certains facteurs de risque. L'important est d'assurer un suivi médical adapté et de respecter les recommandations de votre équipe soignante.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les signes d'alerte de la mort périnatale peut parfois sauver une vie. Le symptôme le plus inquiétant est l'arrêt brutal des mouvements fœtaux après 22 semaines de grossesse. Normalement, vous devriez sentir votre bébé bouger régulièrement, surtout après les repas ou en position allongée [13,14].
D'autres signaux doivent vous alerter : des saignements vaginaux importants, des douleurs abdominales intenses et persistantes, ou une diminution notable de la hauteur utérine lors des consultations. Certaines femmes rapportent également une sensation de "ventre qui se vide" ou une disparition soudaine des nausées en début de grossesse.
Mais il faut savoir que la mort fœtale peut aussi survenir sans aucun signe précurseur. C'est pourquoi le suivi médical régulier est si important. Les examens échographiques permettent de vérifier la vitalité fœtale, le rythme cardiaque et la croissance du bébé. En cas de doute, n'hésitez jamais à consulter, même si cela peut paraître excessif.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de mort périnatale commence souvent par une échographie d'urgence lorsque les parents consultent pour absence de mouvements fœtaux. Cette première étape, bien qu'angoissante, permet de confirmer ou d'infirmer rapidement les craintes. L'absence d'activité cardiaque fœtale signe malheureusement le diagnostic [13].
Une fois le diagnostic posé, l'équipe médicale propose généralement un bilan étiologique complet. Cela inclut des examens sanguins maternels pour rechercher des infections, des troubles de la coagulation ou des maladies auto-immunes. L'examen du placenta et du cordon ombilical fournit également des informations précieuses sur les causes possibles [5].
L'autopsie fœtale, bien que difficile à accepter pour les parents, reste l'examen le plus informatif. Elle permet d'identifier des malformations non visibles à l'échographie et d'orienter le conseil génétique pour les grossesses futures. Rassurez-vous, cet examen est réalisé avec le plus grand respect et n'empêche pas les obsèques si les parents le souhaitent.
Concrètement, ce bilan peut prendre plusieurs semaines. Les résultats sont ensuite expliqués lors d'une consultation dédiée, souvent appelée "consultation de deuil". Cette rencontre permet de faire le point sur les causes identifiées et de discuter des perspectives pour l'avenir.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Quand on parle de "traitement" de la mort périnatale, il s'agit plutôt de prise en charge et d'accompagnement. Une fois le diagnostic confirmé, plusieurs options s'offrent aux parents selon le terme de la grossesse et leur état psychologique. L'accouchement peut être déclenché médicalement ou attendre qu'il se produise naturellement [13].
Le déclenchement médical utilise généralement des prostaglandines pour provoquer les contractions utérines. Cette approche permet de programmer l'accouchement et de s'assurer de la présence de l'équipe soignante formée à ces situations particulières. L'anesthésie péridurale est bien sûr proposée pour soulager la douleur physique.
L'accompagnement psychologique fait partie intégrante de la prise en charge. Des psychologues spécialisés en périnatalité sont disponibles dès l'annonce du diagnostic. Ils aident les parents à traverser cette épreuve et à prendre les décisions importantes concernant les obsèques et les souvenirs qu'ils souhaitent garder de leur bébé.
Certaines maternités proposent également des soins de développement pour le bébé décédé : habillage, photographies, empreintes des mains et des pieds. Ces gestes peuvent paraître anecdotiques, mais ils aident souvent les parents dans leur processus de deuil.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations en matière de mort périnatale se concentrent principalement sur la prévention et l'amélioration de la surveillance. Le projet "Optimising Maternal and Perinatal Death Surveillance" développé en 2024 propose de nouveaux outils de monitoring pour identifier plus précocement les grossesses à risque [2].
Une avancée majeure concerne les soins palliatifs périnataux. Un programme innovant développé en 2024-2025 permet d'accompagner les familles dès le diagnostic prénatal de pathologies létales. Cette approche humanise la prise en charge et aide les parents à prendre des décisions éclairées concernant la poursuite ou l'interruption de la grossesse [4].
La recherche fondamentale progresse également. Des études récentes sur des modèles animaux permettent de mieux comprendre les mécanismes de la mort périnatale, notamment dans les cas d'hypertrophie cardiaque fœtale. Ces travaux ouvrent la voie à de nouvelles stratégies préventives [3].
En France, l'étude de Yakini et Amane (2023) a identifié de nouveaux facteurs prédicteurs de mortalité périnatale liés à l'asphyxie et à l'environnement de naissance. Ces découvertes permettent d'adapter les protocoles de prise en charge dans les maternités [5].
L'intelligence artificielle fait également son entrée dans ce domaine. Des algorithmes d'analyse des tracés cardiotocographiques sont en cours de développement pour détecter plus précocement les signes de souffrance fœtale.
Vivre au Quotidien avec Mort périnatale
Vivre après une mort périnatale représente un défi quotidien immense. Le deuil périnatal a ses spécificités : il s'agit de faire le deuil d'un enfant que l'on n'a pas eu le temps de connaître, mais pour lequel on avait déjà tant de projets et d'amour [7,9].
Les premiers mois sont souvent les plus difficiles. Vous pourriez ressentir une grande fatigue, des troubles du sommeil, ou au contraire une hyperactivité pour "oublier". Ces réactions sont normales et font partie du processus de deuil. Il est important de ne pas vous isoler et d'accepter l'aide de vos proches.
Le retour au travail pose souvent question. Certaines personnes préfèrent reprendre rapidement leurs activités pour se "changer les idées", d'autres ont besoin de plus de temps. Votre médecin peut vous prescrire un arrêt de travail si nécessaire. N'hésitez pas à en parler avec votre employeur pour adapter votre charge de travail.
Les réseaux sociaux peuvent être à la fois une aide et une source de souffrance supplémentaire. Voir des annonces de naissances ou des photos de bébés peut raviver la douleur. Certains parents trouvent du réconfort dans des groupes de soutien en ligne, d'autres préfèrent s'en éloigner temporairement [12].
Les Complications Possibles
Après une mort périnatale, plusieurs complications peuvent survenir, tant sur le plan physique que psychologique. Sur le plan médical, le risque d'infection utérine existe, surtout si l'accouchement tarde à se déclencher naturellement. C'est pourquoi un suivi médical rapproché est indispensable [13].
Les complications hémorragiques représentent également un risque, particulièrement en cas de décollement placentaire ou de troubles de la coagulation associés. L'équipe médicale surveille attentivement ces paramètres et dispose de protocoles spécifiques pour gérer ces situations d'urgence.
Sur le plan psychologique, le risque de dépression post-partum est majoré après une mort périnatale. Environ 40% des mères développent des symptômes dépressifs dans les mois qui suivent, contre 10-15% après un accouchement normal. Les pères ne sont pas épargnés, avec un taux de dépression paternelle atteignant 25% [9].
Certaines femmes développent également un syndrome de stress post-traumatique, avec des flashbacks, des cauchemars et une anxiété importante. Ces symptômes nécessitent une prise en charge psychologique spécialisée et parfois un traitement médicamenteux.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic après une mort périnatale dépend largement des causes identifiées et de la prise en charge proposée. Quand aucune cause n'est retrouvée (25% des cas), le risque de récidive lors d'une grossesse ultérieure reste faible, autour de 2-3% [13,14].
Lorsqu'une cause précise est identifiée, le pronostic varie considérablement. Les malformations génétiques peuvent nécessiter un conseil génétique et des examens prénataux spécifiques lors des grossesses suivantes. Les causes infectieuses ou liées à des pathologies maternelles peuvent souvent être prévenues ou mieux surveillées.
Sur le plan psychologique, la plupart des couples parviennent à surmonter cette épreuve, même si le processus de deuil peut prendre plusieurs années. L'accompagnement psychologique améliore significativement le pronostic et réduit le risque de complications psychiatriques à long terme [9].
Concernant les grossesses ultérieures, environ 85% des couples qui le souhaitent parviennent à avoir un enfant vivant. Cependant, ces grossesses sont souvent vécues avec beaucoup d'anxiété et nécessitent un suivi médical et psychologique renforcé.
Peut-on Prévenir Mort périnatale ?
La prévention de la mort périnatale repose sur plusieurs piliers. Le suivi prénatal régulier reste la base de cette prévention. Les consultations mensuelles, puis bimensuelles en fin de grossesse, permettent de dépister précocement les complications et d'adapter la prise en charge [5,14].
Le dépistage des infections joue un rôle crucial. La recherche systématique du streptocoque B en fin de grossesse, le suivi sérologique de la toxoplasmose chez les femmes non immunisées, et la vaccination contre la grippe et la coqueluche contribuent à réduire les risques infectieux.
L'hygiène de vie pendant la grossesse influence également le pronostic. L'arrêt du tabac divise par deux le risque de mort fœtale, tandis que la limitation de la consommation d'alcool prévient les malformations. Une alimentation équilibrée et une activité physique adaptée participent également à la prévention [8].
Les innovations technologiques ouvrent de nouvelles perspectives. Les applications de comptage des mouvements fœtaux aident les femmes à surveiller l'activité de leur bébé. Les montres connectées capables de détecter les contractions utérines sont également en développement.
Enfin, l'amélioration de l'accès aux soins dans les zones défavorisées reste un enjeu majeur. Les consultations de télémédecine et les maisons de naissance se développent pour rapprocher les soins des populations éloignées des centres hospitaliers.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont émis des recommandations précises concernant la prise en charge de la mort périnatale. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise un accompagnement multidisciplinaire associant obstétriciens, sages-femmes, psychologues et assistantes sociales [1].
Le protocole de prise en charge recommande de laisser le choix aux parents concernant le mode d'accouchement, tout en privilégiant la voie basse quand c'est possible. L'anesthésie péridurale doit être systématiquement proposée, et la présence d'un proche autorisée en permanence.
Concernant les examens post-mortem, les recommandations insistent sur l'importance d'expliquer clairement leur intérêt aux parents. L'autopsie fœtale, bien que non obligatoire, fournit des informations cruciales dans 30% des cas où aucune cause n'était suspectée initialement [1].
La consultation de deuil doit être programmée 6 à 8 semaines après l'accouchement. Cette rencontre permet de faire le point sur les résultats des examens, de répondre aux questions des parents et de discuter des perspectives d'avenir. Un suivi psychologique doit être proposé systématiquement.
Les recommandations européennes, alignées sur celles de l'OMS, insistent sur l'importance de la formation des équipes soignantes. Des programmes de formation spécifiques à l'annonce de mauvaises nouvelles et à l'accompagnement du deuil périnatal sont désormais obligatoires dans les maternités [2].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses associations accompagnent les familles touchées par la mort périnatale. L'association "Nos Anges" propose un soutien psychologique gratuit et organise des groupes de parole dans toute la France. Leur site internet offre également des ressources documentaires et des témoignages [12].
"Petite Emilie" est une autre association reconnue qui se spécialise dans l'accompagnement du deuil périnatal. Elle propose des formations pour les professionnels de santé et milite pour l'amélioration de la prise en charge hospitalière. Leurs bénévoles, souvent des parents ayant vécu cette épreuve, offrent un soutien par téléphone ou par mail.
Au niveau régional, de nombreuses initiatives existent. Les maisons des parents dans les hôpitaux proposent des espaces d'accueil et d'écoute. Certaines maternités ont créé des jardins du souvenir où les familles peuvent se recueillir.
Les réseaux sociaux hébergent également des communautés de soutien. Le groupe Facebook "Deuil périnatal - Soutien et partage" compte plus de 15000 membres et propose un espace d'échange bienveillant. Attention cependant à vérifier la fiabilité des informations partagées [12].
Pour les professionnels, la Société Française de Médecine Périnatale propose des formations continues et des recommandations de bonnes pratiques. Elle organise également un congrès annuel où sont présentées les dernières avancées dans ce domaine.
Nos Conseils Pratiques
Face à une mort périnatale, quelques conseils pratiques peuvent vous aider à traverser cette épreuve. Tout d'abord, ne restez pas seuls. Acceptez l'aide de vos proches, même si vous avez l'impression qu'ils ne peuvent pas comprendre votre douleur. Leur présence, même silencieuse, peut être réconfortante.
Prenez le temps de créer des souvenirs tangibles si vous le souhaitez : photos, empreintes, mèche de cheveux. Ces objets peuvent sembler dérisoires sur le moment, mais ils prennent souvent une valeur inestimable avec le temps. N'hésitez pas à demander à l'équipe soignante de vous aider dans ces démarches.
Concernant les formalités administratives, sachez que vous avez droit à un congé maternité complet, même en cas de mort périnatale. Les démarches pour l'état civil peuvent être complexes selon le terme de la grossesse. N'hésitez pas à vous faire accompagner par une assistante sociale.
Pour les frères et sœurs, adaptez votre discours à leur âge. Les enfants ont besoin d'explications simples et honnêtes. Ils peuvent également bénéficier d'un soutien psychologique spécialisé si nécessaire.
Enfin, respectez votre rythme de deuil. Il n'y a pas de "bon" moment pour aller mieux. Certaines personnes se sentent prêtes à reprendre une vie normale après quelques mois, d'autres ont besoin de plusieurs années. Les deux sont normaux.
Quand Consulter un Médecin ?
Plusieurs situations doivent vous amener à consulter rapidement pendant la grossesse. L'arrêt des mouvements fœtaux après 22 semaines constitue une urgence absolue. N'attendez pas le lendemain, rendez-vous immédiatement aux urgences obstétricales [13,14].
Des saignements vaginaux abondants, surtout s'ils s'accompagnent de douleurs abdominales intenses, nécessitent également une consultation en urgence. De même, une perte de liquide amniotique ("perte des eaux") avant terme doit vous conduire rapidement à la maternité.
Après une mort périnatale, consultez si vous présentez des signes d'infection : fièvre, frissons, écoulements vaginaux malodorants. Ces symptômes peuvent indiquer une complication qui nécessite un traitement antibiotique.
Sur le plan psychologique, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous ressentez des idées suicidaires, une tristesse persistante qui vous empêche de fonctionner au quotidien, ou des symptômes de stress post-traumatique (cauchemars, flashbacks, évitement).
Pour une grossesse ultérieure, une consultation préconceptionnelle est recommandée. Elle permet de faire le point sur les causes de la mort périnatale précédente et d'adapter le suivi de la nouvelle grossesse.
Questions Fréquentes
Pourrai-je avoir d'autres enfants après une mort périnatale ? Dans la grande majorité des cas, oui. Environ 85% des couples qui le souhaitent parviennent à avoir un enfant vivant par la suite. Le délai recommandé entre deux grossesses est généralement de 6 mois à 1 an, le temps de faire le bilan et de récupérer physiquement et psychologiquement [13,14].Faut-il faire une autopsie ? L'autopsie n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée car elle permet d'identifier une cause dans 30% des cas où aucune explication n'était évidente. Ces informations peuvent être cruciales pour les grossesses futures et pour votre compréhension de ce qui s'est passé [1].
Combien de temps dure le deuil périnatal ? Il n'y a pas de durée "normale" pour un deuil. Certaines personnes se sentent mieux après quelques mois, d'autres ont besoin de plusieurs années. L'important est de ne pas rester seul et de demander de l'aide si la souffrance devient trop importante [9].
Puis-je voir et tenir mon bébé ? Oui, c'est même recommandé si vous le souhaitez. Ces moments peuvent être précieux pour votre processus de deuil. L'équipe soignante peut vous aider à préparer ces instants et à créer des souvenirs si vous le désirez.
Que dire aux autres enfants de la famille ? Adaptez votre discours à leur âge. Les enfants ont besoin d'explications simples et honnêtes. Évitez les euphémismes comme "le bébé dort" qui peuvent créer des angoisses. Un soutien psychologique peut être bénéfique pour eux aussi.
Questions Fréquentes
Pourrai-je avoir d'autres enfants après une mort périnatale ?
Dans la grande majorité des cas, oui. Environ 85% des couples qui le souhaitent parviennent à avoir un enfant vivant par la suite. Le délai recommandé entre deux grossesses est généralement de 6 mois à 1 an.
Faut-il faire une autopsie ?
L'autopsie n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée car elle permet d'identifier une cause dans 30% des cas où aucune explication n'était évidente.
Combien de temps dure le deuil périnatal ?
Il n'y a pas de durée "normale" pour un deuil. Certaines personnes se sentent mieux après quelques mois, d'autres ont besoin de plusieurs années. L'important est de ne pas rester seul.
Puis-je voir et tenir mon bébé ?
Oui, c'est même recommandé si vous le souhaitez. Ces moments peuvent être précieux pour votre processus de deuil. L'équipe soignante peut vous aider à créer des souvenirs.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Mortalité périnatale - CépiDc - InsermLien
- [2] Optimising Maternal and Perinatal Death Surveillance - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Perinatal death in pig models of hypertrophic - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Development and results of perinatal palliative care program - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Facteurs prédicteurs de la mortalité périnatale suite à l'asphyxie & environnement de naissance: étude cas-témoinsLien
- [7] Morts avant de naître. La mort périnatale - Histoire, médecine et santéLien
- [8] Comment étudier les discriminations en santé périnatale d'un point de vue socio-anthropologique?Lien
- [9] MORT ET DEUIL PERINATAL EN MATERNITES CAMEROUNAISESLien
- [10] Facteurs associés à la mortalité périnatale à l'Hôpital de Zone de Comè au BéninLien
- [12] Deuil périnatal et réseaux sociaux - Études sur la mortLien
- [13] Mort in utero - Problèmes de santé de la femme - MSD ManualsLien
- [14] Mortinatalité : types, symptômes, causes, facteurs de risque - Apollo HospitalsLien
Publications scientifiques
- Facteurs prédicteurs de la mortalité périnatale suite à l'asphyxie & environnement de naissance: étude cas-témoins (2023)2 citations[PDF]
- Etude de la mortalité périnatale chez le rat gravide de souche Wistar exposé aux extraits de Sida acuta Burm. f. et Ageratum conyzoïdes L (2025)
- [HTML][HTML] … Gaëlle Clavandier, Vincent Gourdon, Catherine Rollet, Nathalie Sage Pranchère (dir.), Morts avant de naître. La mort périnatale. Tours, Presses universitaires … (2022)
- [HTML][HTML] Comment étudier les discriminations en santé périnatale d'un point de vue socio-anthropologique? (2022)6 citations
- [PDF][PDF] MORT ET DEUIL PERINATAL EN MATERNITES CAMEROUNAISES. [PDF]
Ressources web
- Mort in utero - Problèmes de santé de la femme (msdmanuals.com)
Diagnostic de la mort in utero · Un examen de réactivité fœtale : Le rythme cardiaque du fœtus est suivi lorsque le fœtus est au repos et en mouvement. · Profil ...
- Mortalité périnatale - CépiDc - Inserm (cepidc.inserm.fr)
Apparition d'un syndrome de détresse respiratoire qui répond au traitement. Mais l'enfant meurt subitement le troisième jour. L'autopsie révèle la présence ...
- Mortinatalité : types, symptômes, causes, facteurs de risque ... (apollohospitals.com)
19 févr. 2025 — Si un bébé meurt avant ou pendant l'accouchement, il s'agit d'une mortinatalité. Les médecins détectent généralement une mortinatalité lorsque ...
- Le Deuil Périnatal (mypa.fr)
Elle se manifeste par des saignements vaginaux accompagnés de douleurs dans la partie basse du ventre. Ces symptômes doivent conduire à consulter un médecin.
- Dossier Face à la mort périnatale et au deuil : d'autres enjeux (espace-ethique.org)
Le diagnostic prénatal suscitait bien des cas de conscience, des conflits psychiques. Mais ceux-ci s'exprimaient dans l'intimité des couples et dans le ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
