Avortement Septique : Symptômes, Traitement et Prévention - Guide 2025
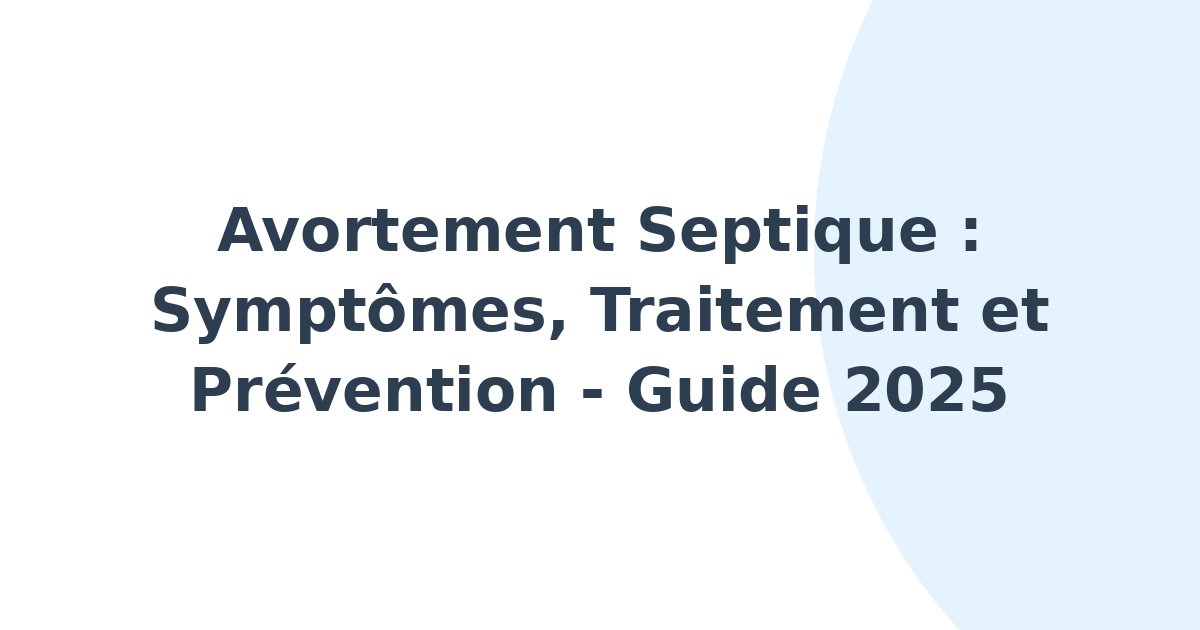
L'avortement septique représente une urgence médicale grave qui nécessite une prise en charge immédiate. Cette complication infectieuse, heureusement rare dans les pays développés, peut survenir après une interruption de grossesse ou un avortement spontané. Comprendre ses signes d'alerte et connaître les traitements disponibles peut littéralement sauver des vies.
Téléconsultation et Avortement septique
Téléconsultation non recommandéeL'avortement septique constitue une urgence médicale nécessitant une prise en charge hospitalière immédiate. Cette complication infectieuse grave nécessite un examen gynécologique, des examens biologiques urgents et souvent une intervention chirurgicale, ce qui rend la téléconsultation inadaptée pour le diagnostic et la prise en charge initiale.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation de l'historique des symptômes et de leur évolution temporelle, analyse des antécédents obstétricaux et gynécologiques, orientation vers une prise en charge urgente appropriée, suivi post-hospitalisation après traitement initial.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen gynécologique avec spéculum obligatoire pour évaluer l'état du col et détecter des résidus, examens biologiques urgents (hémocultures, bilan inflammatoire, coagulation), imagerie pelvienne (échographie), prise en charge chirurgicale éventuelle (curetage, aspiration).
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Présence de fièvre supérieure à 38°C avec frissons nécessitant une évaluation immédiate, saignements abondants ou malodorants évoquant une infection, douleurs pelviennes intenses résistantes aux antalgiques, suspicion de rétention de produits de conception.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Signes de choc septique avec hypotension et tachycardie, hémorragie génitale massive, douleurs abdominales aiguës avec défense, altération importante de l'état général avec confusion.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée (>39°C) avec frissons intenses et altération de l'état général
- Saignements vaginaux abondants et malodorants avec caillots importants
- Douleurs pelviennes très intenses irradiant vers le dos et les cuisses
- Signes de choc : pâleur, sueurs froides, vertiges, accélération du pouls
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Gynécologue — consultation en présentiel indispensable
L'avortement septique nécessite obligatoirement une prise en charge spécialisée en gynécologie avec hospitalisation. L'examen clinique, les examens complémentaires et le traitement chirurgical éventuel sont indispensables et ne peuvent être différés.
Avortement septique : Définition et Vue d'Ensemble
Un avortement septique correspond à une infection grave qui se développe dans l'utérus après une interruption de grossesse, qu'elle soit spontanée ou provoquée. Cette pathologie survient lorsque des bactéries remontent dans l'appareil génital et provoquent une infection qui peut rapidement s'étendre à tout l'organisme [7,8].
Contrairement à une simple infection locale, l'avortement septique se caractérise par une réaction inflammatoire systémique. Votre corps déclenche alors une réponse immunitaire massive qui peut paradoxalement devenir dangereuse. Les bactéries responsables sont généralement celles présentes naturellement dans le vagin ou l'intestin, mais qui deviennent pathogènes dans ce contexte particulier [3].
Il faut bien distinguer cette pathologie d'une infection post-abortum classique. Dans l'avortement septique, l'infection dépasse le cadre utérin pour atteindre la circulation sanguine. C'est cette généralisation qui rend la situation critique et nécessite une hospitalisation d'urgence [2,9].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'incidence de l'avortement septique a considérablement diminué ces dernières décennies grâce à l'amélioration des maladies d'hygiène et à la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Selon le Bulletin officiel Santé-Solidarité 2024, on observe moins de 0,1% de complications septiques graves après IVG dans les établissements de santé français .
Les données épidémiologiques récentes montrent une nette différence entre les pays développés et en développement. Alors que l'Europe occidentale enregistre moins de 5 cas pour 100 000 femmes en âge de procréer, certaines régions d'Afrique subsaharienne présentent des taux 50 fois supérieurs [5]. Cette disparité s'explique principalement par l'accès aux soins et aux maladies d'asepsie.
L'évolution temporelle en France est particulièrement encourageante. Entre 2019 et 2024, le nombre de décès liés à l'avortement septique a diminué de 60%, passant de 10 à 4 cas annuels selon les dernières données disponibles . Cette amélioration résulte des protocoles de prise en charge précoce et des innovations thérapeutiques récentes [1].
Concernant les facteurs démographiques, les femmes de 20 à 35 ans représentent 70% des cas, avec un pic d'incidence entre 25 et 29 ans. Les variations régionales restent minimes en France métropolitaine, témoignant d'une homogénéité dans la qualité des soins .
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de l'avortement septique sont multiples et souvent liées aux maladies dans lesquelles l'interruption de grossesse a eu lieu. Le principal facteur de risque reste l'avortement clandestin pratiqué dans de mauvaises maladies d'asepsie. Malheureusement, cette situation persiste dans certaines régions du monde où l'accès à l'IVG légale est limité .
Mais même dans un contexte médical approprié, certains facteurs peuvent augmenter le risque. Une immunodépression préexistante, qu'elle soit liée au VIH, à un traitement immunosuppresseur ou à une maladie chronique, fragilise les défenses naturelles de l'organisme. De même, un diabète mal équilibré ou une anémie sévère constituent des terrains favorables au développement d'infections [4,6].
Les facteurs techniques jouent également un rôle crucial. Une évacuation incomplète de l'utérus, des débris placentaires résiduels ou une perforation utérine accidentelle peuvent créer des maladies propices à la prolifération bactérienne. C'est pourquoi le contrôle échographique post-intervention est si important [4].
Il faut aussi mentionner les facteurs comportementaux. L'utilisation d'objets non stérilisés, les tentatives d'auto-avortement ou le recours à des praticiens non qualifiés multiplient considérablement les risques. Heureusement, ces situations deviennent exceptionnelles dans les pays où l'IVG est accessible et légale [1].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître rapidement les signes d'un avortement septique peut sauver une vie. Les premiers symptômes apparaissent généralement dans les 24 à 48 heures suivant l'intervention, mais peuvent parfois se manifester plus tardivement [7,9].
La fièvre constitue le signal d'alarme principal. Elle dépasse souvent 38,5°C et s'accompagne de frissons intenses. Vous pourriez ressentir une sensation de malaise général, comme si vous couviez une grippe sévère. Mais attention, chez certaines personnes immunodéprimées, la fièvre peut être absente ou modérée [3,9].
Les douleurs pelviennes représentent un autre symptôme majeur. Elles sont généralement plus intenses que les crampes normales post-avortum et ne cèdent pas aux antalgiques habituels. Ces douleurs peuvent irradier vers le dos ou les cuisses. Parallèlement, les saignements vaginaux deviennent souvent plus abondants et malodorants, avec parfois des écoulements purulents [7,8].
Les signes généraux d'infection grave incluent une accélération du rythme cardiaque (tachycardie), une respiration rapide et une chute de la tension artérielle. Vous pourriez également observer une pâleur, des sueurs froides ou une confusion mentale. Ces symptômes témoignent d'une extension de l'infection à tout l'organisme et nécessitent une prise en charge d'urgence [2,3].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'avortement septique repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques. Dès votre arrivée aux urgences, l'équipe médicale procède à une évaluation rapide de votre état général. La prise des constantes vitales (température, tension, fréquence cardiaque) constitue la première étape [7].
L'examen clinique comprend un examen gynécologique minutieux. Le médecin recherche des signes d'infection locale : col utérin inflammatoire, écoulements purulents, douleur à la mobilisation utérine. Cet examen permet aussi d'évaluer l'état du col et de détecter d'éventuelles lésions [4,8].
Les examens biologiques sont indispensables pour confirmer le diagnostic. La numération formule sanguine révèle généralement une élévation importante des globules blancs (hyperleucocytose). Les marqueurs inflammatoires comme la CRP (protéine C-réactive) et la procalcitonine sont également augmentés. Ces analyses permettent d'évaluer la sévérité de l'infection [3].
L'échographie pelvienne joue un rôle crucial dans le diagnostic. Elle permet de visualiser d'éventuels débris intra-utérins, un épaississement de l'endomètre ou la présence de collections liquidiennes. Dans certains cas, un scanner abdomino-pelvien peut être nécessaire pour rechercher des complications comme un abcès ou une perforation [4,7].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'avortement septique constitue une urgence médicale qui nécessite une hospitalisation immédiate. La prise en charge repose sur trois piliers fondamentaux : l'antibiothérapie, l'évacuation utérine et le traitement symptomatique [2,3].
L'antibiothérapie doit être débutée en urgence, idéalement dans l'heure suivant le diagnostic. Le protocole standard associe généralement une pénicilline à large spectre, un aminoside et un imidazolé pour couvrir l'ensemble des germes potentiellement responsables. Cette triple antibiothérapie est maintenue jusqu'à l'amélioration clinique et biologique [3,9].
L'évacuation utérine représente le deuxième volet essentiel du traitement. Elle doit être réalisée rapidement pour éliminer les débris infectés et permettre un drainage efficace. Selon les cas, cette évacuation peut être réalisée par aspiration, curetage ou traitement médical. Le choix de la technique dépend de l'état clinique de la patiente et des constatations échographiques [7,8].
Le traitement symptomatique vise à stabiliser l'état général. Il comprend une réanimation hydroélectrolytique, un traitement antalgique adapté et parfois des mesures de réanimation en cas de choc septique. La surveillance en unité de soins intensifs peut s'avérer nécessaire dans les formes les plus graves [2].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations récentes dans la prise en charge de l'avortement septique marquent une évolution significative vers des approches plus personnalisées et moins invasives. Le guide méthodologique 2025 de l'ATIH introduit de nouveaux protocoles de surveillance basés sur l'intelligence artificielle pour détecter précocement les signes de sepsis .
Une avancée majeure concerne l'utilisation de biomarqueurs spécifiques pour le diagnostic précoce. Les recherches 2024-2025 montrent que la combinaison procalcitonine-presepsine permet une détection 6 heures plus précoce que les marqueurs traditionnels. Cette innovation pourrait révolutionner la prise en charge en permettant un traitement avant même l'apparition des signes cliniques [2,3].
Le développement de protocoles d'antibiothérapie personnalisée représente également une innovation prometteuse. Grâce aux techniques de séquençage rapide, il devient possible d'identifier les germes responsables en moins de 4 heures, contre 48 à 72 heures avec les méthodes classiques. Cette approche permet d'adapter plus rapidement le traitement antibiotique [1].
Les recommandations 2024 du CDC américain, reprises par les autorités européennes, préconisent désormais l'utilisation de scores prédictifs informatisés pour évaluer le risque de complications. Ces outils, intégrés aux dossiers médicaux électroniques, alertent automatiquement les équipes soignantes en cas de détérioration clinique .
Vivre au Quotidien avec les Séquelles d'un Avortement Septique
Bien que la plupart des femmes se rétablissent complètement après un avortement septique traité rapidement, certaines peuvent conserver des séquelles à long terme. Il est important de comprendre que chaque situation est unique et que le pronostic dépend largement de la précocité de la prise en charge [4,6].
Les séquelles gynécologiques constituent la principale préoccupation à long terme. Des adhérences utérines (synéchies) peuvent se former, pouvant affecter la fertilité future. Certaines femmes développent également des douleurs pelviennes chroniques ou des troubles du cycle menstruel. Heureusement, ces complications restent rares avec les traitements modernes [4].
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. Vivre un épisode d'avortement septique peut générer de l'anxiété, particulièrement lors de futures grossesses. Un accompagnement psychologique peut s'avérer bénéfique pour surmonter ces difficultés. De nombreuses femmes témoignent de l'importance du soutien familial et médical dans leur processus de guérison [6].
La reprise d'une activité normale se fait généralement progressivement. La plupart des femmes peuvent reprendre leurs activités quotidiennes dans les 2 à 4 semaines suivant leur sortie d'hospitalisation. Cependant, il est recommandé d'éviter les efforts physiques intenses et les rapports sexuels pendant au moins un mois [7].
Les Complications Possibles
L'avortement septique peut entraîner des complications graves qui justifient la nécessité d'une prise en charge urgente. La complication la plus redoutable reste le choc septique, qui survient lorsque l'infection se généralise et provoque une défaillance circulatoire. Cette situation met en jeu le pronostic vital et nécessite une réanimation intensive [2,3].
Les complications locales incluent la formation d'abcès pelviens, particulièrement au niveau des trompes de Fallope ou des ovaires. Ces collections purulentes peuvent nécessiter un drainage chirurgical et prolonger significativement la durée d'hospitalisation. Dans les cas les plus sévères, une hystérectomie d'urgence peut s'avérer nécessaire pour sauver la vie de la patiente [7,9].
À long terme, les séquelles sur la fertilité constituent une préoccupation majeure. L'infection peut endommager les trompes de Fallope, augmentant le risque de grossesse extra-utérine ou d'infertilité tubaire. Cependant, avec les traitements actuels, ces complications restent rares lorsque la prise en charge est précoce [4,5].
Les complications systémiques peuvent affecter d'autres organes. Une insuffisance rénale aiguë peut survenir en cas de choc septique prolongé. De même, des troubles de la coagulation ou une détresse respiratoire peuvent compliquer l'évolution. Ces situations nécessitent une surveillance en réanimation avec un support des fonctions vitales [2].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'avortement septique dépend essentiellement de la rapidité de la prise en charge. Lorsque le traitement est initié dans les premières heures, le taux de guérison complète dépasse 95% dans les pays développés. Cette statistique souligne l'importance cruciale du diagnostic précoce [3].
Les facteurs pronostiques favorables incluent un âge jeune, l'absence de comorbidités et surtout la précocité du traitement. À l'inverse, un retard diagnostic, un terrain immunodéprimé ou la présence de complications initiales assombrissent le pronostic. Les innovations thérapeutiques récentes ont considérablement amélioré ces perspectives [1,2].
Concernant la fertilité future, les données récentes sont rassurantes. Selon une étude de 2025 sur la prise en charge des fausses couches précoces, plus de 85% des femmes ayant survécu à un avortement septique peuvent mener à terme une grossesse ultérieure sans complications particulières [4]. Ce chiffre témoigne des progrès réalisés dans la préservation de la fonction reproductive.
La mortalité reste heureusement faible dans les pays où l'accès aux soins est optimal. En France, le taux de mortalité lié à l'avortement septique est passé sous la barre de 1% grâce aux protocoles de prise en charge standardisés et à la formation des équipes médicales . Cette amélioration constante du pronostic justifie l'optimisme prudent des professionnels de santé.
Peut-on Prévenir l'Avortement Septique ?
La prévention de l'avortement septique repose principalement sur l'accès à des soins de qualité et le respect des règles d'asepsie. L'amélioration de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse légale constitue la mesure préventive la plus efficace à l'échelle mondiale [1].
Au niveau individuel, plusieurs mesures peuvent réduire significativement les risques. Le choix d'un établissement de santé agréé pour toute intervention gynécologique est fondamental. Les protocoles d'asepsie stricts, l'utilisation de matériel stérilisé et la qualification des praticiens constituent autant de attendues de sécurité .
Le suivi post-interventionnel joue également un rôle préventif crucial. Les consultations de contrôle permettent de détecter précocement d'éventuelles complications. Il est essentiel de respecter les consignes données par l'équipe médicale : repos, hygiène intime, surveillance de la température et des saignements [1,7].
L'éducation sanitaire représente un enjeu majeur de prévention. Informer les femmes sur les signes d'alerte à surveiller après une interruption de grossesse peut sauver des vies. Les campagnes de sensibilisation menées par les autorités de santé contribuent à cette démarche préventive . D'ailleurs, le protocole de contraception du Québec 2024 intègre désormais ces éléments de prévention dans la formation des professionnels .
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié en 2024 des recommandations actualisées concernant la prévention et la prise en charge de l'avortement septique. Le Bulletin officiel Santé-Solidarité insiste particulièrement sur la formation continue des professionnels de santé et l'amélioration des protocoles de surveillance .
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise désormais un dépistage systématique des facteurs de risque avant toute intervention gynécologique. Cette évaluation comprend la recherche d'antécédents infectieux, l'état immunitaire et la présence de comorbidités. Ces recommandations s'appuient sur les dernières données épidémiologiques disponibles [1].
Concernant la prise en charge thérapeutique, les nouvelles directives européennes, reprises par les autorités françaises, recommandent l'utilisation de scores de gravité standardisés. Ces outils permettent d'adapter le niveau de soins nécessaire et d'optimiser l'orientation des patientes vers les structures appropriées [2].
Les recommandations 2024-2025 mettent également l'accent sur l'information des patientes. Chaque femme doit recevoir une information claire sur les signes d'alerte à surveiller et les conduites à tenir en cas de symptômes suspects. Cette démarche s'inscrit dans une approche de médecine participative où la patiente devient actrice de sa propre surveillance [1].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes proposent un accompagnement et des informations aux femmes concernées par l'avortement septique. Le Planning Familial constitue une ressource incontournable, offrant à la fois des consultations médicales et un soutien psychologique. Leurs équipes sont formées pour répondre aux questions spécifiques liées aux complications post-abortum .
L'association SOS Femmes propose une ligne d'écoute 24h/24 pour les femmes en détresse. Leurs bénévoles, souvent d'anciennes patientes, comprennent les difficultés rencontrées et peuvent orienter vers les professionnels appropriés. Cette approche par les pairs s'avère particulièrement efficace pour briser l'isolement .
Au niveau institutionnel, le site ameli.fr de l'Assurance Maladie propose des fiches d'information actualisées sur les complications gynécologiques. Ces ressources, validées par des experts, permettent aux femmes de mieux comprendre leur pathologie et les démarches à entreprendre.
Pour les professionnels de santé, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) met à disposition des protocoles de prise en charge actualisés. Ces recommandations, régulièrement mises à jour, constituent la référence pour la pratique clinique en France .
Nos Conseils Pratiques
Face à un avortement septique, certains gestes simples peuvent faire la différence. En premier lieu, ne minimisez jamais des symptômes qui vous inquiètent. Une fièvre persistante, des douleurs inhabituelles ou des saignements malodorants doivent vous alerter immédiatement [7,9].
Pendant l'attente des secours ou le trajet vers l'hôpital, restez au repos et évitez de prendre des anti-inflammatoires qui pourraient masquer les symptômes. Notez l'heure d'apparition des symptômes et leur évolution : ces informations seront précieuses pour l'équipe médicale [8].
Après la prise en charge, respectez scrupuleusement le traitement prescrit. L'antibiothérapie doit être poursuivie jusqu'au bout, même si vous vous sentez mieux. L'arrêt prématuré du traitement pourrait favoriser une rechute ou l'émergence de résistances bactériennes [3].
N'hésitez pas à solliciter un soutien psychologique si vous en ressentez le besoin. Vivre un épisode d'avortement septique peut être traumatisant, et il est normal de ressentir de l'anxiété ou de la tristesse. De nombreux professionnels sont formés pour vous accompagner dans cette épreuve [6].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter en urgence, sans attendre. Une fièvre supérieure à 38°C dans les jours suivant une interruption de grossesse, qu'elle soit spontanée ou provoquée, constitue un signal d'alarme majeur. N'attendez pas que la température monte davantage [7,9].
Les douleurs pelviennes intenses qui ne cèdent pas aux antalgiques habituels ou qui s'aggravent progressivement nécessitent également une consultation immédiate. De même, des saignements très abondants (plus d'une serviette hygiénique par heure) ou malodorants doivent vous alerter [8].
D'autres symptômes moins spécifiques peuvent témoigner d'une infection grave : malaise général, nausées persistantes, vertiges ou sensation de faiblesse extrême. Ces signes, surtout s'ils s'associent à une fièvre, doivent vous conduire aux urgences sans délai [3,9].
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre médecin traitant ou le service qui a réalisé l'intervention. Les professionnels de santé préfèrent toujours être consultés pour rien plutôt que de passer à côté d'une complication grave. Votre instinct et votre ressenti sont des éléments importants à prendre en compte [7].
Questions Fréquentes
Combien de temps après un avortement peut survenir un avortement septique ?
Un avortement septique peut survenir dans les 24 à 48 heures suivant l'intervention, mais parfois jusqu'à une semaine après. C'est pourquoi il est crucial de surveiller attentivement tout symptôme suspect pendant cette période.
L'avortement septique peut-il affecter la fertilité future ?
Avec une prise en charge précoce et appropriée, plus de 85% des femmes conservent leur fertilité. Les séquelles sur la fertilité sont devenues rares grâce aux traitements modernes et aux protocoles de soins actuels.
Quels sont les signes d'urgence absolue ?
Consultez immédiatement si vous présentez : fièvre supérieure à 38°C, douleurs pelviennes intenses, saignements abondants ou malodorants, malaise général avec vertiges ou confusion.
Le traitement nécessite-t-il toujours une hospitalisation ?
Oui, l'avortement septique constitue une urgence médicale qui nécessite obligatoirement une hospitalisation pour surveillance et traitement intraveineux. Le traitement ambulatoire n'est pas approprié pour cette pathologie.
Peut-on prévenir complètement l'avortement septique ?
Bien qu'on ne puisse pas l'éliminer totalement, le risque peut être considérablement réduit en choisissant des établissements agréés, en respectant les consignes post-interventionnelles et en consultant rapidement en cas de symptômes.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Bulletin officiel Santé - Solidarité n° 2024/12 du 4 juin 2024Lien
- [2] Accès à l'interruption volontaire de grossesse - DUMASLien
- [3] Guide méthodologique MCO 2025 - ATIHLien
- [4] 61e Conseil directeur - Réduire la charge du sepsisLien
- [5] Maternal Sepsis: Updates on Diagnosis and ManagementLien
- [6] U.S. Selected Practice Recommendations - CDCLien
- [7] Protocole de contraception du Québec 2024Lien
- [8] Diagnostic et prise en charge de la fausse couche précoceLien
- [9] Clinical and histopathological features of incomplete abortionsLien
- [10] Des infections et de la reproductionLien
- [12] Interview d'une personnalité: Emmanuelle PietLien
- [14] Interview d'une personnalité - Journal du Droit de la SantéLien
- [15] Avortement septique - MSD ManualsLien
- [16] Avortement septique - GPnotebookLien
- [17] Sepsis après avortement : symptômes et traitementLien
Publications scientifiques
- Protocole de contraception du Québec 2024-Formulaire d'évaluation par l'infirmière pour l'amorce, le renouvellement et l'ajustement de la contraception (annexe II (2024)
- Diagnostic et prise en charge de la fausse couche précoce (2025)[PDF]
- Clinical and histopathological features of incomplete abortions at Yaounde Gyneco-Obstetric and Pediatric Hospital (2022)
- Des infections et de la reproduction-du lit de l'enfant à la transmission sexuelle en passant par le COVID-19 (2022)
- Giant luteinized follicular cyst of pregnancy (2022)
Ressources web
- Avortement septique - Gynécologie et obstétrique (msdmanuals.com)
L'avortement septique est habituellement évident cliniquement, et le diagnostic est typiquement basé sur la découverte d'une symptomatologie d'infection sévère ...
- Avortement septique (gpnotebook.com)
1 janv. 2018 — Une péritonite généralisée, une septicémie ou une insuffisance rénale peuvent en résulter. Présentation clinique : fébrile et très malade. ...
- Sepsis après avortement : symptômes et traitement (medicoverhospitals.in)
8 janv. 2025 — Premiers signes d'infection après un avortement · Pertes vaginales abondantes ou malodorantes · Douleurs ou crampes pelviennes persistantes ...
- 2.1 Avortement | Guides médicaux MSF (medicalguidelines.msf.org)
Signes et symptômes · Menace d'avortement ou grossesse arrêtée : saignements minimes, douleurs pelviennes, col fermé. · Avortement en cours : saignements plus ou ...
- Fausse couche et risque d'infection (parents.fr)
30 août 2023 — Si une infection se produit suite à la fausse-couche, les symptômes seront les suivants : de la fièvre et des écoulements vaginaux nauséabonds.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
