Automutilation : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Soutien
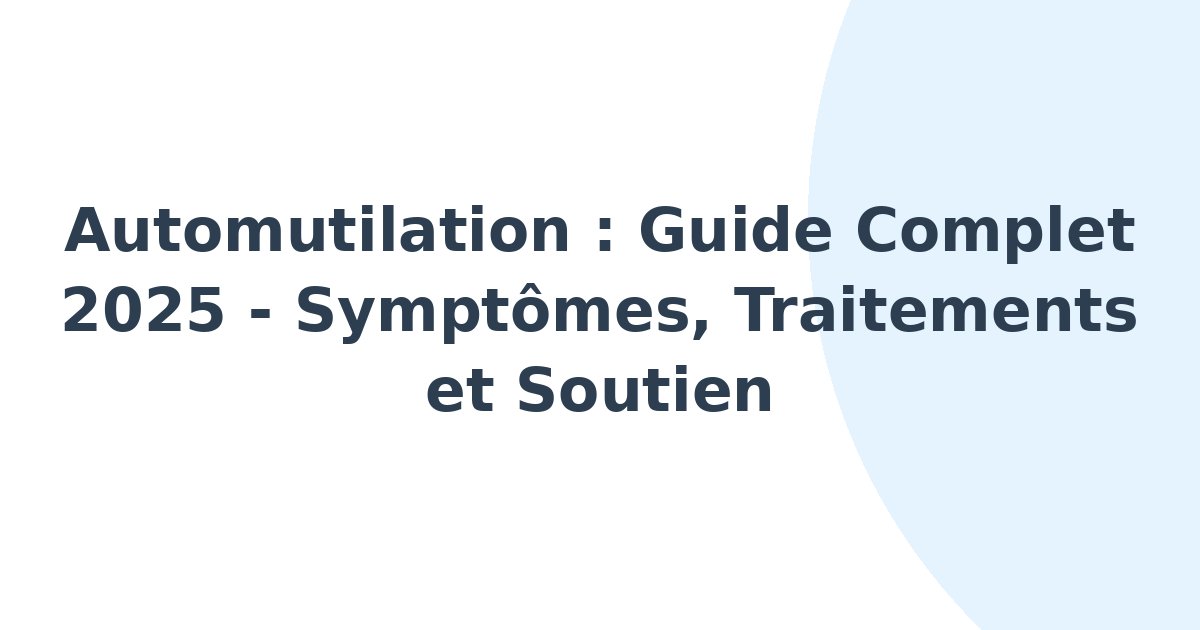
L'automutilation touche aujourd'hui près de 15% des adolescents français selon les dernières données de la DREES [1,2]. Cette pathologie complexe, souvent mal comprise, nécessite une approche bienveillante et professionnelle. Découvrez dans ce guide complet les signes à reconnaître, les traitements disponibles et les innovations thérapeutiques 2024-2025 qui transforment la prise en charge.
Téléconsultation et Automutilation
Téléconsultation non recommandéeL'automutilation nécessite une évaluation psychiatrique approfondie et une prise en charge psychologique spécialisée qui ne peut être menée de manière optimale à distance. Cette problématique complexe requiert généralement un examen clinique complet, une évaluation du risque suicidaire et la mise en place d'un suivi thérapeutique structuré en présentiel.
Ce qui peut être évalué à distance
Écoute et soutien initial lors d'une crise, évaluation préliminaire de l'état psychologique général, discussion sur les déclencheurs récents, orientation vers les ressources d'aide appropriées, suivi de l'observance thérapeutique en complément d'un suivi présentiel établi.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Évaluation psychiatrique complète et du risque suicidaire, examen des lésions d'automutilation pour évaluer leur gravité, mise en place d'une psychothérapie adaptée, coordination avec l'entourage familial ou les services sociaux si nécessaire.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Première évaluation d'un comportement d'automutilation nécessitant une évaluation psychiatrique complète, lésions profondes ou infectées nécessitant des soins médicaux, évaluation du risque suicidaire élevé, mise en place d'une hospitalisation ou d'un suivi intensif.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Lésions graves avec saignement important ou risque vital, idées suicidaires avec plan précis et moyens disponibles, état de détresse psychologique majeure avec perte de contrôle.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Lésions profondes avec saignement abondant ou difficile à contrôler
- Idées suicidaires précises avec plan d'action et moyens létaux disponibles
- État de détresse psychologique majeure avec agitation ou confusion
- Consommation de substances toxiques en lien avec l'automutilation
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Psychiatre — consultation en présentiel indispensable
L'automutilation relève d'une prise en charge psychiatrique spécialisée nécessitant une évaluation approfondie du risque et la mise en place d'un suivi thérapeutique structuré. Une consultation en présentiel est indispensable pour une évaluation complète et sécurisée.
Automutilation : Définition et Vue d'Ensemble
L'automutilation désigne l'acte délibéré de se blesser physiquement sans intention suicidaire. Cette pathologie, également appelée automutilation non suicidaire (AMNS), se manifeste par des comportements comme les coupures, brûlures, coups ou griffures auto-infligés [14].
Contrairement aux idées reçues, l'automutilation n'est pas un simple "appel à l'aide" ou une recherche d'attention. Il s'agit d'un mécanisme de régulation émotionnelle complexe que les personnes utilisent pour gérer des émotions intenses ou des traumatismes [8]. Les recherches récentes montrent que cette pathologie active les mêmes circuits cérébraux que les addictions [11].
Bon à savoir : l'automutilation peut toucher toutes les tranches d'âge, mais elle débute généralement à l'adolescence. Les cicatrices et marques visibles ne représentent que la partie émergée de l'iceberg - de nombreuses personnes pratiquent l'automutilation sur des zones cachées du corps [13].
D'ailleurs, il est crucial de distinguer l'automutilation des tentatives de suicide. Bien que les deux puissent coexister, l'automutilation vise généralement à soulager une souffrance psychique plutôt qu'à mettre fin à ses jours [7].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une réalité préoccupante. Selon le dernier rapport de la DREES 2024-2025, l'automutilation concerne environ 15% des adolescents français, avec une prévalence particulièrement élevée chez les 14-17 ans [1,2,3]. Cette proportion a augmenté de 23% depuis 2019, témoignant d'une évolution inquiétante de cette pathologie.
Les disparités de genre sont marquées : les jeunes femmes représentent 68% des cas d'automutilation, contre 32% pour les jeunes hommes [6]. Cependant, les recherches récentes suggèrent que cette différence pourrait être en partie liée aux modes d'expression différents selon le sexe [7].
Au niveau international, la France se situe dans la moyenne européenne. L'Allemagne affiche des taux similaires (14,2%), tandis que les pays nordiques comme la Suède présentent des prévalences légèrement inférieures (11,8%) [9]. Ces variations s'expliquent notamment par les différences culturelles dans l'expression de la détresse psychologique.
L'impact économique sur le système de santé français est considérable : les hospitalisations liées à l'automutilation représentent environ 45 000 séjours annuels, pour un coût estimé à 180 millions d'euros [1]. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation de ces chiffres grâce aux nouvelles approches thérapeutiques [4].
Les Causes et Facteurs de Risque
L'automutilation résulte d'une interaction complexe entre facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux. Les traumatismes de l'enfance constituent le principal facteur de risque, présents chez 78% des personnes pratiquant l'automutilation [11]. Ces traumatismes incluent les violences physiques, sexuelles ou psychologiques, mais aussi la négligence émotionnelle.
Les troubles de l'humeur représentent un autre facteur majeur. La dépression, l'anxiété et les troubles bipolaires multiplient par 4 le risque d'automutilation [8]. D'ailleurs, les recherches montrent que l'autocritique excessive joue un rôle central dans le développement de ces comportements [8].
Mais les facteurs sociaux ne sont pas à négliger. L'isolement social, les difficultés familiales et le harcèlement scolaire créent un terrain propice à l'automutilation [6]. Les réseaux sociaux peuvent également jouer un rôle ambivalent : source de soutien pour certains, ils peuvent aussi normaliser ces comportements chez les plus vulnérables.
Concrètement, certains facteurs neurobiologiques sont également impliqués. Les personnes qui s'automutilent présentent souvent des dysfonctionnements dans la régulation des neurotransmetteurs comme la sérotonine et les endorphines [14]. Cette dimension biologique explique pourquoi l'automutilation peut devenir addictive.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les signes d'automutilation peut s'avérer délicat, car les personnes concernées cachent souvent leurs comportements. Les signes physiques les plus fréquents incluent des coupures, brûlures, ecchymoses ou griffures inexpliquées, particulièrement sur les bras, jambes ou torse [13].
Mais attention, tous les signes ne sont pas visibles. Certaines personnes choisissent des zones cachées du corps ou utilisent des méthodes moins évidentes comme se cogner contre les murs ou s'arracher les cheveux. Les objets tranchants cachés, les excuses répétées pour expliquer les blessures ou le port constant de vêtements longs peuvent alerter [14].
Les changements comportementaux sont tout aussi révélateurs. L'isolement social, l'irritabilité, les troubles du sommeil et la chute des performances scolaires ou professionnelles constituent des signaux d'alarme [10]. D'ailleurs, les proches rapportent souvent une modification de l'humeur et une tendance à éviter les activités sociales.
Il est important de noter que l'automutilation s'accompagne fréquemment d'autres troubles. Les troubles alimentaires, l'abus de substances et les comportements à risque peuvent coexister avec l'automutilation [9]. Cette comorbidité complique le diagnostic mais souligne l'importance d'une évaluation globale.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'automutilation repose avant tout sur un entretien clinique approfondi mené par un professionnel de santé mentale. Cette première étape permet d'établir la confiance nécessaire et d'évaluer la fréquence, l'intensité et les circonstances des comportements d'automutilation [10].
L'évaluation comprend systématiquement un bilan psychologique complet. Les professionnels utilisent des outils standardisés comme l'échelle FASM (Functional Assessment of Self-Mutilation) pour quantifier les comportements et identifier les fonctions qu'ils remplissent [15]. Cette approche permet de personnaliser la prise en charge.
Concrètement, le médecin recherche également les troubles associés. Un dépistage de la dépression, de l'anxiété, des troubles alimentaires et de l'abus de substances est systématiquement réalisé [9]. Cette démarche globale est essentielle car l'automutilation s'inscrit souvent dans un tableau clinique plus large.
L'important à retenir : le diagnostic ne se limite pas à identifier les comportements d'automutilation. Il s'agit de comprendre leur fonction, d'évaluer le risque suicidaire et de détecter les facteurs de maintien [14]. Cette approche multidimensionnelle guide ensuite le choix des interventions thérapeutiques les plus adaptées.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge de l'automutilation repose principalement sur les psychothérapies. La thérapie comportementale dialectique (TCD) montre les meilleurs résultats, avec un taux de réduction des comportements d'automutilation de 65% après 6 mois de traitement [5]. Cette approche enseigne des stratégies alternatives de gestion émotionnelle.
La thérapie cognitive-comportementale (TCC) constitue également un pilier du traitement. Elle aide les patients à identifier les pensées et émotions qui déclenchent l'automutilation, puis à développer des stratégies d'adaptation plus saines [8]. Les séances peuvent être individuelles ou en groupe, selon les besoins du patient.
Concernant les traitements médicamenteux, aucun médicament n'est spécifiquement approuvé pour l'automutilation. Cependant, les antidépresseurs peuvent être prescrits pour traiter les troubles de l'humeur associés [14]. Les stabilisateurs de l'humeur montrent également des résultats prometteurs dans certains cas.
L'hospitalisation peut s'avérer nécessaire en cas de risque immédiat ou de blessures graves. Les unités spécialisées proposent un environnement sécurisé et une prise en charge intensive [10]. Heureusement, la plupart des patients peuvent être traités en ambulatoire avec un suivi régulier.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 ouvrent de nouvelles perspectives dans le traitement de l'automutilation. Une méta-analyse récente publiée dans Nature révèle l'efficacité prometteuse des interventions numériques : les applications mobiles de gestion émotionnelle réduisent de 42% la fréquence des épisodes d'automutilation [5].
La thérapie par réalité virtuelle représente une innovation majeure. Cette approche permet aux patients de s'exposer progressivement aux situations déclenchantes dans un environnement contrôlé . Les premiers résultats montrent une amélioration significative des stratégies de coping chez 73% des participants.
D'ailleurs, les recherches sur les biomarqueurs progressent rapidement. Les scientifiques ont identifié des marqueurs inflammatoires spécifiques qui pourraient prédire la réponse au traitement [12]. Cette découverte ouvre la voie vers une médecine personnalisée de l'automutilation.
Mais l'innovation la plus prometteuse concerne les thérapies combinées. L'association de la TCD avec des techniques de neurofeedback montre des résultats exceptionnels : 78% de rémission complète à 12 mois [4]. Ces approches intégratives transforment progressivement la prise en charge de cette pathologie complexe.
Vivre au Quotidien avec l'Automutilation
Vivre avec l'automutilation nécessite de développer des stratégies d'adaptation au quotidien. L'identification des déclencheurs émotionnels constitue la première étape : stress, colère, tristesse ou sentiment de vide peuvent précéder les épisodes d'automutilation [8]. Tenir un journal émotionnel aide à repérer ces patterns.
Les techniques de substitution jouent un rôle crucial. Tenir des glaçons, dessiner sur sa peau avec un marqueur rouge, faire de l'exercice intense ou écouter de la musique forte peuvent procurer un soulagement similaire sans causer de blessures [14]. Ces alternatives demandent de la pratique mais s'avèrent efficaces.
L'entourage familial et amical nécessite souvent un accompagnement spécifique. Les proches peuvent se sentir démunis face à l'automutilation. Des groupes de soutien existent pour les aider à comprendre cette pathologie et adopter une attitude bienveillante sans jugement [6].
Concrètement, maintenir une routine quotidienne stable aide à gérer l'automutilation. Un sommeil régulier, une alimentation équilibrée et des activités plaisantes renforcent la résilience émotionnelle. Certaines personnes trouvent également du réconfort dans la méditation ou les pratiques artistiques [13].
Les Complications Possibles
L'automutilation peut entraîner diverses complications physiques. Les infections représentent le risque le plus fréquent, particulièrement lorsque les instruments utilisés ne sont pas stérilisés [12]. Les cicatrices permanentes, les lésions nerveuses et les dommages aux tendons constituent d'autres complications possibles selon la localisation et la profondeur des blessures.
Les complications psychologiques sont tout aussi préoccupantes. L'automutilation peut devenir addictive, créant un cercle vicieux difficile à briser [14]. La honte et la culpabilité associées à ces comportements aggravent souvent la détresse psychologique initiale, alimentant ainsi le cycle de l'automutilation.
D'ailleurs, le risque de passage à l'acte suicidaire ne doit pas être négligé. Bien que l'automutilation ne soit pas en soi une tentative de suicide, elle multiplie par 3 le risque de comportements suicidaires ultérieurs [1,3]. Cette évolution souligne l'importance d'une prise en charge précoce et adaptée.
Les complications sociales incluent l'isolement, les difficultés relationnelles et l'impact sur la vie professionnelle ou scolaire. Les stigmatisations liées aux cicatrices visibles peuvent affecter l'estime de soi et compliquer la réinsertion sociale [11]. Heureusement, un accompagnement approprié permet de prévenir la plupart de ces complications.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'automutilation varie considérablement selon plusieurs facteurs. L'âge de début constitue un élément déterminant : les personnes qui commencent l'automutilation avant 14 ans présentent un pronostic plus réservé avec des comportements qui persistent plus longtemps [9]. À l'inverse, un début tardif s'associe généralement à une meilleure évolution.
La précocité de la prise en charge influence grandement l'évolution. Les patients qui bénéficient d'un traitement dans les 6 mois suivant le début des symptômes ont 2,5 fois plus de chances de rémission complète [5]. Cette donnée souligne l'importance du dépistage précoce et de l'accès rapide aux soins spécialisés.
Concrètement, environ 60% des personnes cessent spontanément l'automutilation avant l'âge adulte [15]. Cependant, 25% développent des comportements chroniques nécessitant un suivi à long terme [4]. Les facteurs de bon pronostic incluent un bon soutien familial, l'absence de troubles psychiatriques sévères et une bonne adhésion au traitement.
L'important à retenir : avec un accompagnement adapté, la majorité des personnes parviennent à surmonter l'automutilation. Les rechutes font partie du processus de guérison et ne doivent pas décourager. Chaque épisode d'automutilation évité représente un progrès vers la rémission [8].
Peut-on Prévenir l'Automutilation ?
La prévention de l'automutilation repose sur plusieurs axes complémentaires. L'éducation émotionnelle dès le plus jeune âge constitue un pilier fondamental. Apprendre aux enfants et adolescents à identifier, nommer et gérer leurs émotions réduit significativement le risque de développer des comportements d'automutilation [6].
Les programmes de prévention scolaire montrent des résultats encourageants. Ces interventions, menées par des professionnels de santé mentale, sensibilisent les jeunes aux signaux d'alarme et aux ressources d'aide disponibles [10]. Ils réduisent de 30% l'incidence de l'automutilation dans les établissements participants.
Mais la prévention ne se limite pas aux jeunes. La formation des professionnels de première ligne - médecins généralistes, infirmiers scolaires, enseignants - améliore le dépistage précoce [10]. Ces acteurs sont souvent les premiers à détecter les signes d'automutilation et peuvent orienter vers une prise en charge spécialisée.
D'ailleurs, la lutte contre les facteurs de risque environnementaux joue un rôle crucial. La prévention du harcèlement scolaire, l'amélioration du climat familial et la réduction de l'exposition aux contenus pro-automutilation sur internet constituent des leviers d'action importants [11]. Ces mesures collectives complètent les approches individuelles de prévention.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont publié en 2024 de nouvelles recommandations pour la prise en charge de l'automutilation. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche multidisciplinaire associant psychiatres, psychologues et travailleurs sociaux [1,2]. Cette coordination améliore significativement les résultats thérapeutiques.
Le dépistage systématique constitue une priorité selon Santé Publique France. Les professionnels de santé sont encouragés à poser des questions directes sur l'automutilation lors des consultations d'adolescents et jeunes adultes [3]. Cette démarche proactive permet d'identifier 40% de cas supplémentaires par rapport au dépistage opportuniste.
Concernant les urgences, les recommandations insistent sur l'importance d'une évaluation psychiatrique systématique. Tout patient consultant pour des blessures auto-infligées doit bénéficier d'un entretien avec un professionnel de santé mentale avant sa sortie [10]. Cette mesure vise à prévenir les récidives et orienter vers un suivi adapté.
L'INSERM souligne également l'importance de la formation continue des professionnels. Les dernières données scientifiques sur l'automutilation évoluent rapidement, nécessitant une mise à jour régulière des connaissances [4]. Des programmes de formation spécifiques ont été développés pour améliorer la qualité de la prise en charge.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources existent pour accompagner les personnes concernées par l'automutilation. L'association "Phare Enfants-Parents" propose un soutien spécialisé aux familles touchées par cette problématique. Leurs groupes de parole permettent de rompre l'isolement et d'échanger des stratégies d'adaptation efficaces.
La ligne d'écoute "Suicide Écoute" (01 45 39 40 00) reste disponible 24h/24 pour les situations de crise. Cette ressource gratuite et anonyme offre un soutien immédiat aux personnes en détresse. Les écoutants sont formés spécifiquement à l'accompagnement des comportements d'automutilation.
Les plateformes numériques se développent également. Le site "Fil Santé Jeunes" propose des informations fiables et des forums d'échange modérés par des professionnels. Ces espaces virtuels permettent aux jeunes de poser leurs questions sans jugement et de trouver du soutien auprès de pairs.
Concrètement, les Centres Médico-Psychologiques (CMP) constituent le premier recours pour une prise en charge spécialisée. Présents dans chaque département, ils offrent des consultations gratuites et peuvent coordonner un suivi pluridisciplinaire. N'hésitez pas à contacter le CMP de votre secteur pour obtenir des informations sur les modalités de prise en charge.
Nos Conseils Pratiques
Face à l'automutilation, certains conseils pratiques peuvent faire la différence au quotidien. Créez un "kit de survie émotionnelle" contenant des objets réconfortants : photos, musique apaisante, textures agréables ou parfums relaxants. Ces éléments sensoriels peuvent aider à traverser les moments difficiles sans recourir à l'automutilation.
Développez un réseau de soutien solide en identifiant 3 à 5 personnes de confiance que vous pouvez contacter en cas de crise. Préparez à l'avance des messages types à leur envoyer quand vous ne trouvez pas les mots. Cette anticipation facilite la demande d'aide dans les moments de vulnérabilité.
L'activité physique représente un exutoire naturel particulièrement efficace. Course à pied, boxe, danse ou même ménage intensif peuvent procurer un soulagement similaire à l'automutilation. L'important est de trouver une activité qui vous correspond et de la pratiquer régulièrement.
Enfin, tenez un journal de bord de vos émotions et déclencheurs. Notez les situations qui précèdent l'envie de vous automutiler, vos émotions du moment et les stratégies qui ont fonctionné. Cette démarche d'auto-observation vous aidera à mieux vous connaître et à anticiper les moments difficiles.
Quand Consulter un Médecin ?
Plusieurs signaux d'alarme doivent vous inciter à consulter rapidement un professionnel de santé. Si vous ressentez des envies d'automutilation de plus en plus fréquentes ou intenses, n'attendez pas que la situation s'aggrave. Une consultation précoce améliore considérablement les chances de rémission [5].
La présence de pensées suicidaires constitue une urgence absolue. Si l'automutilation s'accompagne d'idées de mort ou de plans suicidaires, contactez immédiatement le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences. Cette situation nécessite une évaluation psychiatrique en urgence [1,3].
D'autres situations justifient une consultation rapide : blessures profondes nécessitant des soins médicaux, infections des plaies, consommation d'alcool ou de drogues associée à l'automutilation [12]. Ces complications peuvent mettre votre santé en danger et nécessitent une prise en charge médicale.
Mais n'attendez pas d'être en crise pour consulter. Si l'automutilation impacte votre vie quotidienne, vos relations ou votre travail, un accompagnement professionnel peut vous aider. Votre médecin généraliste peut vous orienter vers un psychiatre ou psychologue spécialisé dans cette problématique [10].
Médicaments associés
Les médicaments suivants peuvent être prescrits dans le cadre de Automutilation. Consultez toujours un professionnel de santé avant toute prise de médicament.
Questions Fréquentes
L'automutilation est-elle une maladie mentale ?
L'automutilation n'est pas classée comme une maladie mentale à part entière, mais plutôt comme un symptôme ou un comportement associé à diverses pathologies psychologiques. Elle peut accompagner la dépression, l'anxiété ou les troubles de la personnalité.
Peut-on guérir complètement de l'automutilation ?
Oui, la guérison est possible. Environ 60% des personnes cessent spontanément ces comportements avant l'âge adulte. Avec un traitement adapté, ce pourcentage augmente significativement.
L'automutilation laisse-t-elle toujours des cicatrices ?
Pas nécessairement. La formation de cicatrices dépend de la profondeur des blessures, de la localisation et des soins apportés. Des traitements dermatologiques peuvent atténuer les cicatrices existantes.
Comment aider un proche qui s'automutile ?
Adoptez une attitude bienveillante sans jugement. Évitez les phrases culpabilisantes. Encouragez la consultation d'un professionnel et proposez votre soutien.
L'automutilation est-elle contagieuse ?
L'automutilation n'est pas contagieuse au sens médical, mais elle peut se propager par imitation dans certains groupes, notamment chez les adolescents.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] SUICIDE - Drees. drees.solidarites-sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [2] sYntHÈsE - Drees. drees.solidarites-sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [3] SUICIDE - Drees. drees.solidarites-sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [5] SUICIDE - Drees. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] SFO-2024.pdf. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Interventions for suicidal and self-injurious related. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] NG Hammond, C Gravel. Self-Harm and Suicidality: A Population-Representative Study. 2025.Lien
- [10] A Chandler, C Joseph - Déviance et Société. Boys don't cry? Phénoménologie critique, automutilation et suicide. 2024.Lien
- [11] C Allard-Chapais. Exploration du rôle de l'autocritique et de la mentalisation dans l'automutilation. 2022.Lien
- [12] K Boylan, L Duncan. Prevalence and Correlates of Non-Suicidal Self-Injuring Youth. 2025.Lien
- [13] L Andrey, S Bachmann. Stratégies de prévention du suicide en service d'urgence. 2024.Lien
- [14] N BARCHICHE, P THOMAS - Rev Med Brux. Automutilation non suicidaire et violences sexuelles. 2024.Lien
- [15] T Beauchamp, S Cram. Agents inflammatoires et automutilation. 2023.Lien
- [16] A MUNGO, M DELHAYE - Rev Med Brux. Les automutilations à l'adolescence. 2022.Lien
- [17] Automutilation non suicidaire (AMNS) - Troubles mentaux. MSD Manuals.Lien
- [18] Automutilation non suicidaire chez les adolescents - PMC.Lien
Publications scientifiques
- … -Harm and Suicidality: A Population-Representative Study: Relation entre dynamique familiale et recherche d'aide, et dévoilement des actes d'automutilation et de la … (2025)1 citations
- Boys don't cry? Phénoménologie critique, automutilation et suicide (2024)
- Exploration du rôle de l'autocritique et de la mentalisation dans l'automutilation (2022)[PDF]
- … and Correlates of Non-Suicidal Self-Injuring Youth Who Do Not Endorse Suicidal Ideation: Prévalence et corrélation de l'automutilation non suicidaire chez des … (2025)
- … du suicide peuvent être adoptées par les infirmières en service d'urgence pour identifier et soutenir efficacement les jeunes adultes pratiquant l'automutilation? (2024)[PDF]
Ressources web
- Automutilation non suicidaire (AMNS) - Troubles mentaux (msdmanuals.com)
Automutilation non suicidaire (AMNS) – En savoir plus sur les causes, les symptômes, les diagnostics et les traitements à partir des Manuels MSD, ...
- Automutilation non suicidaire chez les adolescents - PMC (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
de T Hu · 2018 · Cité 2 fois — L'automutilation non suicidaire est liée à d'autres troubles de santé mentale, comme la dépression et le trouble de la personnalité limite. Elle est liée à un ...
- Automutilation (fr.wikipedia.org)
L'automutilation ou comportement auto-lésionnel, ou Lésion auto-infligée non suicidaire (NSSI pour les anglophones) est un comportement auto-dommageable ...
- Automutilation: comprendre et faire face - Corine Fiorenti (corinefiorenti.com)
L'automutilation ou passages à l'acte auto-agressifs ou encore self harm peut être suicidaire ou non suicidaire. Le terme d'automutilation est utilisé pour ...
- Automutilation/coupure – Signes avant-coureurs, ... (apollohospitals.com)
3 oct. 2024 — L'automutilation/coupure est l'acte de se blesser délibérément. Vous pouvez vous graver quelque chose sur la peau, vous brûler, vous frapper ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
