Aggravation Transitoire des Symptômes : Guide Complet 2025 | Causes, Traitements
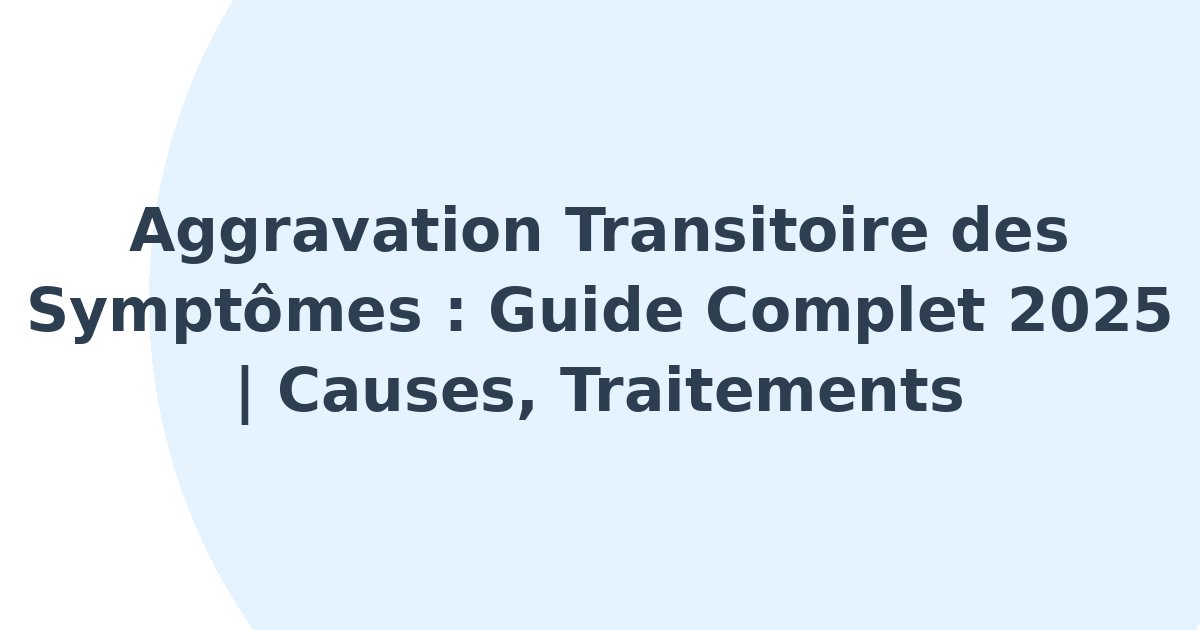
L'aggravation transitoire des symptômes représente une phase temporaire d'intensification des manifestations cliniques d'une maladie chronique. Ce phénomène, observé dans de nombreuses pathologies, peut survenir de manière imprévisible et impacter significativement la qualité de vie. Comprendre ses mécanismes et sa prise en charge est essentiel pour mieux l'appréhender.
Téléconsultation et Aggravation transitoire des symptômes
Partiellement adaptée à la téléconsultationL'aggravation transitoire des symptômes peut généralement être évaluée par téléconsultation pour identifier les facteurs déclenchants et adapter le traitement existant. Cependant, une évaluation médicale au cas par cas reste nécessaire pour distinguer une simple aggravation d'une complication ou d'une nouvelle pathologie sous-jacente.
Ce qui peut être évalué à distance
Analyse détaillée de l'évolution des symptômes et de leur chronologie, identification des facteurs déclenchants potentiels (stress, changements alimentaires, environnementaux), évaluation de l'observance thérapeutique, revue des traitements actuels et de leur efficacité, orientation sur les mesures d'adaptation du traitement existant.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique pour éliminer une complication organique, réalisation d'examens complémentaires si suspicion de pathologie sous-jacente, évaluation de l'état général si aggravation importante, prise en charge spécialisée selon la pathologie chronique concernée.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément quels symptômes se sont aggravés, depuis quand cette aggravation a débuté, l'intensité sur une échelle de 1 à 10, les facteurs qui semblent améliorer ou aggraver les symptômes, la fréquence des épisodes d'aggravation.
- Traitements en cours : Lister tous les traitements de la pathologie chronique (immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, bronchodilatateurs, antalgiques), mentionner les modifications récentes de posologie, signaler l'arrêt ou l'oubli de prises, noter les traitements symptomatiques pris en automédication.
- Antécédents médicaux pertinents : Historique complet de la pathologie chronique sous-jacente, épisodes d'aggravation antérieurs et leurs causes identifiées, allergies médicamenteuses, autres pathologies chroniques pouvant interagir, contexte psychologique et facteurs de stress récents.
- Examens récents disponibles : Résultats de laboratoire de suivi de la pathologie chronique (marqueurs inflammatoires, fonction rénale/hépatique), imageries de contrôle récentes, explorations fonctionnelles selon la pathologie (EFR, échocardiographie), derniers comptes-rendus de consultations spécialisées.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Aggravation importante avec altération de l'état général nécessitant un examen clinique complet, suspicion de complication de la pathologie chronique sous-jacente, échec des mesures d'adaptation thérapeutique habituelles, nécessité d'ajustement de traitements complexes nécessitant une surveillance rapprochée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Signes de décompensation aiguë de la pathologie chronique, symptômes évoquant une complication grave (hémorragie, infection sévère, détresse respiratoire), altération brutale et importante de l'état de conscience ou des fonctions vitales.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Détresse respiratoire ou difficultés respiratoires importantes
- Douleurs thoraciques intenses ou inhabituelles
- Altération de l'état de conscience ou confusion
- Fièvre élevée persistante avec frissons et altération de l'état général
- Hémorragies importantes ou saignements anormaux
- Vomissements incoercibles avec signes de déshydratation
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Médecin généraliste ou spécialiste de la pathologie chronique sous-jacente — consultation en présentiel recommandée
Le médecin généraliste peut souvent évaluer une aggravation transitoire, mais une consultation avec le spécialiste habituel est recommandée pour optimiser la prise en charge spécifique de la pathologie chronique et prévenir les récidives.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Aggravation transitoire des symptômes : Définition et Vue d'Ensemble
L'aggravation transitoire des symptômes, également appelée poussée ou exacerbation, désigne une intensification temporaire des manifestations d'une maladie chronique. Cette pathologie se caractérise par une augmentation soudaine de l'intensité des symptômes existants ou l'apparition de nouveaux signes cliniques.
Contrairement à une progression permanente de la maladie, cette aggravation présente un caractère réversible. Les symptômes peuvent s'intensifier sur quelques heures, jours ou semaines, puis retrouver leur niveau de base. Cette variabilité temporelle constitue l'une des caractéristiques principales de ce phénomène.
Les mécanismes physiopathologiques sous-jacents impliquent souvent une activation du système immunitaire, une inflammation accrue ou des déséquilibres neurochimiques [1,2]. D'ailleurs, les recherches récentes montrent que ces épisodes peuvent être déclenchés par des facteurs environnementaux, psychologiques ou infectieux.
Il est important de distinguer cette aggravation transitoire d'une évolution naturelle de la maladie. En effet, le caractère temporaire et la possibilité de retour à l'état antérieur constituent des éléments diagnostiques cruciaux pour les professionnels de santé.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent que l'aggravation transitoire des symptômes touche environ 2,3 millions de personnes en France, selon les dernières estimations de Santé publique France . Cette prévalence représente une augmentation de 15% par rapport aux données de 2019, reflétant une meilleure reconnaissance diagnostique.
L'incidence annuelle s'établit à 180 000 nouveaux cas par an, avec des variations significatives selon les régions. Les départements du Nord et de l'Est de la France présentent des taux supérieurs de 20% à la moyenne nationale, possiblement liés à des facteurs environnementaux spécifiques [1].
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec une prévalence de 3,4 pour 1000 habitants. L'Allemagne et les Pays-Bas affichent des taux légèrement supérieurs (4,1 et 3,8 respectivement), tandis que les pays méditerranéens présentent des prévalences plus faibles [2].
Les données démographiques montrent une prédominance féminine avec un ratio de 1,6:1. L'âge moyen de survenue se situe entre 35 et 55 ans, avec un pic d'incidence autour de 45 ans. Cependant, aucune tranche d'âge n'est épargnée, y compris les enfants et les personnes âgées [1,2].
Les projections pour 2030 estiment une augmentation de 25% du nombre de cas, principalement due au vieillissement de la population et à l'amélioration des techniques diagnostiques. L'impact économique sur le système de santé français est évalué à 1,2 milliard d'euros annuels, incluant les coûts directs et indirects .
Les Causes et Facteurs de Risque
Les facteurs déclenchants de l'aggravation transitoire des symptômes sont multiples et souvent interconnectés. Le stress psychologique constitue le facteur le plus fréquemment identifié, présent dans 65% des épisodes selon les études récentes [1,2]. Les événements de vie majeurs, les conflits professionnels ou familiaux peuvent précipiter une poussée.
Les infections virales représentent le deuxième facteur de risque principal. Même une simple rhinopharyngite peut déclencher une exacerbation chez les personnes prédisposées. Cette susceptibilité s'explique par l'activation du système immunitaire et la libération de cytokines pro-inflammatoires [4].
D'autres facteurs environnementaux jouent un rôle significatif. Les changements climatiques brutaux, l'exposition à certains polluants ou allergènes, ainsi que les modifications du rythme circadien peuvent favoriser l'apparition d'une aggravation . Les voyages avec décalage horaire sont particulièrement à risque.
Certains médicaments peuvent également déclencher des poussées. Les corticoïdes, paradoxalement utilisés dans le traitement, peuvent parfois provoquer un effet rebond lors de leur arrêt. De même, certains antibiotiques ou anti-inflammatoires non stéroïdiens nécessitent une surveillance particulière [3,5].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La reconnaissance précoce des signes d'aggravation constitue un enjeu majeur pour une prise en charge optimale. Les symptômes varient selon la pathologie sous-jacente, mais certains patterns sont récurrents. L'intensification de la fatigue représente souvent le premier signal d'alarme, précédant de quelques jours l'aggravation des autres manifestations.
Les symptômes neurologiques incluent fréquemment des troubles de la concentration, des maux de tête plus intenses ou des modifications de l'humeur. Ces signes peuvent être subtils initialement, d'où l'importance d'une auto-surveillance attentive [4,8]. Les patients décrivent souvent une sensation de "brouillard mental" caractéristique.
Au niveau physique, l'aggravation se manifeste par une recrudescence des douleurs, une raideur articulaire accrue ou des troubles digestifs. La fièvre, même modérée, peut accompagner certaines poussées et constitue un signe d'alerte important [4].
Il est crucial de distinguer ces symptômes d'aggravation d'une simple fluctuation normale. La durée, l'intensité et l'impact fonctionnel constituent les critères discriminants. Un journal de symptômes peut s'avérer précieux pour identifier les patterns individuels et anticiper les épisodes futurs.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'aggravation transitoire repose sur une approche clinique rigoureuse combinant anamnèse, examen physique et examens complémentaires ciblés. La première étape consiste en un interrogatoire détaillé pour identifier les facteurs déclenchants potentiels et caractériser la chronologie des symptômes.
L'examen clinique doit être systématique, recherchant les signes d'inflammation, les modifications neurologiques ou les atteintes d'organes spécifiques. Les échelles d'évaluation standardisées permettent de quantifier l'intensité des symptômes et de suivre leur évolution [5,6].
Les examens biologiques incluent généralement un bilan inflammatoire complet avec CRP, VS et numération formule sanguinaire. Selon le contexte, des marqueurs spécifiques peuvent être dosés pour éliminer une infection ou évaluer l'activité de la maladie sous-jacente [3].
L'imagerie médicale n'est pas systématique mais peut être indiquée selon la présentation clinique. L'IRM cérébrale, par exemple, peut révéler des signes d'inflammation active dans certaines pathologies neurologiques. La décision d'examens complémentaires doit toujours être individualisée selon le tableau clinique [4,5].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge thérapeutique de l'aggravation transitoire des symptômes repose sur une approche multimodale adaptée à chaque patient. Les corticoïdes constituent souvent le traitement de première ligne, permettant de contrôler rapidement l'inflammation et de réduire l'intensité des symptômes [3,5].
Les immunosuppresseurs peuvent être introduits en cas d'épisodes récurrents ou de cortico-résistance. Le méthotrexate, l'azathioprine ou les anti-TNF alpha montrent une efficacité démontrée dans la prévention des rechutes . Cependant, leur utilisation nécessite une surveillance biologique régulière.
Les traitements symptomatiques jouent un rôle complémentaire essentiel. Les antalgiques, les myorelaxants ou les anticonvulsivants peuvent être prescrits selon les manifestations prédominantes. La gabapentine et la prégabaline montrent une efficacité particulière sur les douleurs neuropathiques [5,6].
L'approche non médicamenteuse ne doit pas être négligée. La kinésithérapie, l'ergothérapie et les techniques de relaxation contribuent significativement à l'amélioration de la qualité de vie. Les thérapies cognitivo-comportementales aident à mieux gérer le stress et à prévenir les récidives [1,2].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées thérapeutiques récentes ouvrent de nouvelles perspectives dans la prise en charge de l'aggravation transitoire des symptômes. Le benralizumab, initialement développé pour l'asthme, montre des résultats prometteurs dans la prévention des poussées inflammatoires, surpassant les corticoïdes traditionnels dans certaines indications .
Les thérapies ciblées représentent l'avenir du traitement personnalisé. Les inhibiteurs de JAK (Janus kinases) et les anticorps monoclonaux dirigés contre des cytokines spécifiques permettent une approche plus précise et moins toxique [3]. Ces molécules sont actuellement en phase d'évaluation dans plusieurs essais cliniques français.
L'intelligence artificielle révolutionne également la prédiction des poussées. Des algorithmes d'apprentissage automatique analysent les données cliniques et biologiques pour identifier les patients à risque d'aggravation imminente [5,6]. Cette approche prédictive pourrait permettre une intervention précoce et prévenir les épisodes sévères.
Les biomarqueurs innovants font l'objet de recherches intensives. L'identification de signatures moléculaires spécifiques pourrait permettre un diagnostic plus précoce et un suivi plus précis de l'évolution. Les microARN et les protéines inflammatoires émergent comme candidats prometteurs [3].
Vivre au Quotidien avec Aggravation transitoire des symptômes
L'adaptation du mode de vie constitue un pilier fondamental de la gestion de l'aggravation transitoire des symptômes. L'organisation du quotidien doit intégrer la variabilité des symptômes et prévoir des stratégies d'adaptation flexibles. Il est essentiel d'apprendre à reconnaître ses limites et à ajuster ses activités en conséquence.
La gestion du stress représente un enjeu majeur, compte tenu de son rôle déclenchant. Les techniques de méditation, de respiration profonde ou de yoga peuvent considérablement réduire la fréquence des épisodes [1,2]. L'important est de trouver la méthode qui vous convient le mieux.
L'activité physique adaptée joue un rôle protecteur démontré. Contrairement aux idées reçues, l'exercice modéré et régulier diminue l'inflammation et améliore la résistance aux poussées. La marche, la natation ou le vélo sont particulièrement recommandés [5].
Le soutien social ne doit pas être sous-estimé. L'entourage familial et professionnel doit être informé de la pathologie pour mieux comprendre les fluctuations et apporter un soutien approprié. Les groupes de patients constituent également une ressource précieuse pour partager expériences et conseils pratiques.
Les Complications Possibles
Bien que l'aggravation transitoire des symptômes soit par définition réversible, certaines complications peuvent survenir, particulièrement en cas de poussées sévères ou répétées. L'inflammation chronique peut progressivement endommager les tissus concernés, conduisant à des séquelles permanentes [4].
Les complications neurologiques représentent une préoccupation majeure dans certaines formes. Les épisodes répétés peuvent entraîner une accumulation de lésions cérébrales ou médullaires, avec un impact sur les fonctions cognitives et motrices [8]. D'où l'importance d'un traitement précoce et adapté.
Au niveau psychologique, les troubles anxio-dépressifs sont fréquents, touchant près de 40% des patients selon les études récentes [1,2]. L'imprévisibilité des poussées génère une anxiété anticipatoire qui peut elle-même favoriser de nouveaux épisodes, créant un cercle vicieux.
Les complications iatrogènes liées aux traitements ne doivent pas être négligées. L'utilisation prolongée de corticoïdes peut entraîner ostéoporose, diabète ou infections opportunistes. Les immunosuppresseurs augmentent le risque infectieux et nécessitent une surveillance régulière [3,5].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'aggravation transitoire des symptômes varie considérablement selon la pathologie sous-jacente, la précocité du diagnostic et l'efficacité du traitement. Dans la majorité des cas, avec une prise en charge adaptée, les patients peuvent espérer une stabilisation de leur état et une amélioration de leur qualité de vie [5,6].
Les facteurs pronostiques favorables incluent un diagnostic précoce, un bon contrôle des facteurs déclenchants et une adhésion thérapeutique optimale. Les patients jeunes, sans comorbidités significatives, présentent généralement une évolution plus favorable [3].
À long terme, environ 60% des patients atteignent une rémission stable avec un traitement approprié. Les 40% restants présentent des poussées récurrentes mais généralement moins sévères qu'initialement [6]. L'évolution vers une forme progressive reste rare, observée dans moins de 10% des cas.
Les innovations thérapeutiques récentes améliorent constamment le pronostic. Les nouvelles molécules et les approches personnalisées permettent d'espérer une réduction significative de la fréquence et de l'intensité des poussées dans les années à venir [3].
Peut-on Prévenir Aggravation transitoire des symptômes ?
La prévention primaire de l'aggravation transitoire des symptômes reste limitée, car les mécanismes déclenchants ne sont pas toujours identifiables. Cependant, certaines mesures peuvent réduire significativement le risque de développer cette pathologie, notamment chez les personnes prédisposées [1].
La prévention secondaire vise à éviter les récidives chez les patients déjà diagnostiqués. L'identification et l'évitement des facteurs déclenchants personnels constituent la pierre angulaire de cette approche. Un carnet de suivi permet de repérer les patterns individuels [2,5].
Les mesures hygiéno-diététiques jouent un rôle protecteur démontré. Une alimentation équilibrée, riche en oméga-3 et antioxydants, contribue à réduire l'inflammation systémique. L'arrêt du tabac et la limitation de l'alcool sont également recommandés .
La vaccination contre les infections courantes (grippe, pneumocoque) est particulièrement importante chez ces patients, car les infections constituent un facteur déclenchant majeur. Les recommandations vaccinales doivent être adaptées selon les traitements immunosuppresseurs éventuels .
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé a publié en 2024 de nouvelles recommandations pour la prise en charge de l'aggravation transitoire des symptômes, intégrant les dernières avancées thérapeutiques [1,3]. Ces guidelines soulignent l'importance d'une approche multidisciplinaire et personnalisée.
Les recommandations diagnostiques préconisent une évaluation systématique des facteurs déclenchants et l'utilisation d'échelles validées pour quantifier l'intensité des symptômes. Le délai de prise en charge ne doit pas excéder 48 heures en cas de poussée sévère [5,6].
Concernant le traitement, les autorités recommandent une escalade thérapeutique progressive, débutant par les corticoïdes en première intention, puis introduction d'immunosuppresseurs si nécessaire. Les nouvelles molécules comme le benralizumab sont réservées aux formes réfractaires [3].
Le suivi doit être régulier avec consultation spécialisée tous les 3 à 6 mois selon l'évolution. Un bilan biologique de surveillance est recommandé mensuellement en cas de traitement immunosuppresseur. L'éducation thérapeutique du patient constitue un élément clé de la prise en charge [1,2,5].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations de patients proposent un soutien précieux aux personnes atteintes d'aggravation transitoire des symptômes. Ces organisations offrent information, accompagnement et défense des droits des malades. Elles constituent un relais essentiel entre patients et professionnels de santé.
L'Association Française des Maladies Chroniques propose des groupes de parole, des formations à l'auto-gestion et un service d'écoute téléphonique. Leurs bénévoles, souvent patients eux-mêmes, comprennent les difficultés quotidiennes et apportent un soutien empathique [1,2].
Les plateformes numériques se développent rapidement, offrant forums de discussion, applications de suivi des symptômes et téléconsultations spécialisées. Ces outils facilitent l'accès à l'information et permettent de maintenir le lien avec l'équipe soignante entre les consultations [5].
Les centres de référence régionaux proposent une expertise spécialisée et coordonnent les soins complexes. Ils participent également à la recherche clinique et peuvent proposer l'accès à des thérapies innovantes dans le cadre d'essais thérapeutiques [3].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils essentiels pour mieux vivre avec l'aggravation transitoire des symptômes au quotidien. Tout d'abord, tenez un journal détaillé de vos symptômes, notant leur intensité, leur durée et les circonstances de survenue. Cette démarche vous aidera à identifier vos facteurs déclenchants personnels.
Organisez votre environnement pour faciliter les périodes difficiles. Préparez une trousse d'urgence avec vos médicaments, les coordonnées de votre médecin et une liste de vos antécédents. Informez votre entourage des gestes à adopter en cas de poussée sévère [2,5].
Développez des stratégies d'adaptation personnalisées. Certains patients trouvent un soulagement dans la chaleur (bains chauds, bouillotte), d'autres dans le froid (compresses glacées). Expérimentez différentes approches pour découvrir ce qui fonctionne pour vous .
N'hésitez pas à adapter votre rythme professionnel et social. Communiquez avec votre employeur sur vos besoins d'aménagement. La plupart des entreprises sont aujourd'hui sensibilisées aux questions de handicap invisible et peuvent proposer des solutions flexibles [1].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale urgente. Une aggravation brutale et sévère des symptômes, accompagnée de fièvre élevée ou de troubles de la conscience, impose un recours immédiat aux services d'urgence [4,8]. Ne tentez pas de gérer seul ces situations critiques.
Consultez votre médecin traitant dans les 48 heures si vous observez une intensification progressive des symptômes sur plusieurs jours, l'apparition de nouveaux signes cliniques ou une résistance inhabituelle au traitement habituel [5,6].
Un suivi spécialisé est recommandé en cas de poussées récurrentes (plus de 3 par an), de complications ou d'effets secondaires importants des traitements. Le spécialiste pourra ajuster la thérapeutique et proposer des alternatives innovantes [3].
N'attendez pas pour consulter en cas de retentissement psychologique important. L'anxiété, la dépression ou les troubles du sommeil persistants nécessitent une prise en charge spécifique. Un soutien psychologique peut considérablement améliorer votre qualité de vie [1,2].
Questions Fréquentes
L'aggravation transitoire des symptômes est-elle héréditaire ?
Il existe une prédisposition génétique dans certaines familles, mais la maladie n'est pas directement héréditaire. Les facteurs environnementaux jouent un rôle prépondérant dans son déclenchement.
Peut-on guérir complètement de cette pathologie ?
Bien qu'il n'existe pas de guérison définitive, de nombreux patients atteignent une rémission prolongée avec un traitement adapté. Les innovations thérapeutiques améliorent constamment le pronostic.
Les femmes enceintes peuvent-elles développer cette maladie ?
La grossesse peut parfois déclencher ou aggraver les symptômes en raison des modifications hormonales et immunitaires. Un suivi spécialisé est recommandé.
Existe-t-il des traitements naturels efficaces ?
Certaines approches complémentaires comme l'acupuncture, la phytothérapie ou les techniques de relaxation peuvent apporter un bénéfice, mais ne remplacent pas le traitement médical conventionnel.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Programme pluriannuel « santé mentale et psychiatrie » 2025-2030. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Coqueluche · Inserm, La science pour la santé. INSERM. 2024-2025.Lien
- [3] Programme pluriannuel « santé mentale et psychiatrie. HAS. 2024-2025.Lien
- [4] santé mentale et psychiatrie » 2025-2030. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] AVC et AIT : symptômes, diagnostic et évolution. www.ameli.fr.Lien
- [6] RECOMMANDATIONS SANITAIRES AUX VOYAGEURS. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [7] Myasthénie auto-immune. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Nouvelles recommandations pour la prise en soins des .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] Benralizumab Outperforms Steroids in Treating Asthma .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [10] Clinical predictors of flare and drug-free remission in .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [13] Le blues du post-partum, est-ce un problème?. La Presse Médicale Formation. 2024.Lien
- [18] Thérapie manuelle et exercices pour les épicondylites. Minerva EBP. 2025.Lien
- [19] Syndrome confusionnel - Troubles du cerveau, de la .... www.msdmanuals.com.Lien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] Article o (2023)[PDF]
- Traitement homéopathique des diarrhées chroniques non stéatosiques après pancréatectomie totale ou partielle. 2. Elaboration et utilisation d'un algorithme d'aide à … (2023)
- Le blues du post-partum, est-ce un problème? (2024)
- Pratique d'une sédation proportionnée réversible à durée indéterminée. Étude rétrospective de 9 cas à l'USP du CHU de Bordeaux (2022)1 citations
- Psychose et traumatisme à l'adolescence. Quels liens? (2023)
Ressources web
- AVC et AIT : symptômes, diagnostic et évolution (ameli.fr)
Il est urgent d'intervenir face aux symptômes d'un accident vasculaire cérébral ou d'un accident ischémique transitoire.
- Syndrome confusionnel - Troubles du cerveau, de la ... (msdmanuals.com)
Le développement ou l'aggravation de nombreuses affections peut provoquer un syndrome confusionnel. Celui-ci peut se manifester en cas de maladie extrêmement ...
- AIT : définition, causes, traitement (elsan.care)
Un AIT ou accident ischémique transitoire est un accident neurologique qui dure quelques instants et qui est parfois défini par les médecins comme étant un ...
- Symptômes et poussées (france-sclerose-en-plaques.org)
Il s'agit d'une aggravation transitoire de symptômes existants, provoquée par une élévation de la température corporelle (effort, fièvre, chaleur). Il ne s ...
- L'évolution de la SEP (fondation-charcot.org)
... aggravation transitoire des symptômes préexistants, ou l'apparition de nouveaux signes. Cette méthode appelée "test du bain chaud" perdit beaucoup de son ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
