Abêtalipoprotéinémie : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic, Traitements
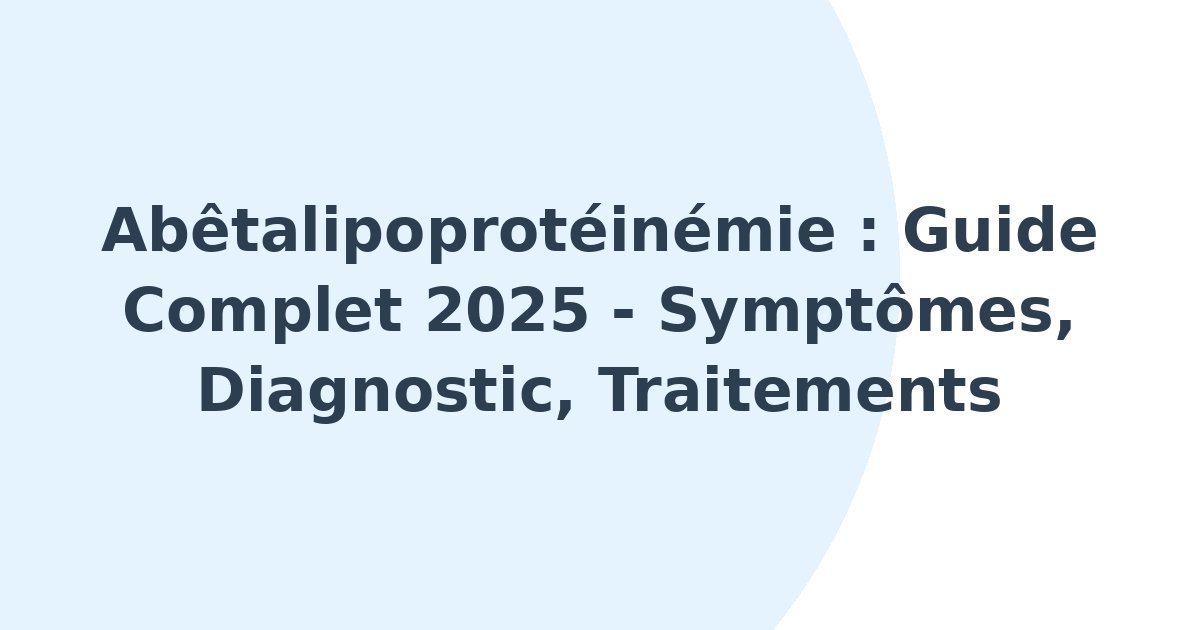
L'abêtalipoprotéinémie est une maladie génétique rare qui affecte le transport des lipides dans l'organisme. Cette pathologie, touchant environ 1 personne sur 1 million en France selon les données du Bulletin officiel Santé-Solidarité 2024 , se caractérise par l'absence de certaines protéines essentielles au métabolisme des graisses. Bien que rare, elle nécessite une prise en charge spécialisée pour prévenir les complications graves.
Téléconsultation et Abêtalipoprotéinémie
Téléconsultation non recommandéeL'abêtalipoprotéinémie est une maladie génétique rare nécessitant un diagnostic biologique spécialisé et une prise en charge multidisciplinaire complexe. Les manifestations cliniques requièrent un examen physique approfondi, notamment neurologique et ophtalmologique, ainsi que des examens complémentaires spécifiques non réalisables à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'histoire familiale et des antécédents génétiques, évaluation des symptômes digestifs chroniques (diarrhée, stéatorrhée), discussion des troubles de croissance et du développement, analyse des résultats de bilans lipidiques antérieurs, orientation vers les examens spécialisés nécessaires.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet pour détecter les atteintes cérébelleuses et périphériques, examen ophtalmologique spécialisé pour rechercher une rétinopathie pigmentaire, réalisation du bilan lipidique spécialisé avec dosage des apolipoprotéines, évaluation de la croissance staturo-pondérale chez l'enfant.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion diagnostique initiale nécessitant un examen clinique complet et des examens spécialisés, évaluation neurologique pour rechercher une ataxie cérébelleuse ou une neuropathie périphérique, examen ophtalmologique spécialisé pour détecter une rétinopathie pigmentaire, surveillance de la croissance et du développement chez l'enfant.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Apparition brutale de troubles neurologiques sévères (ataxie massive, troubles de la déglutition), complications digestives aiguës avec déshydratation sévère, troubles visuels brutaux ou cécité nocturne invalidante.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Troubles neurologiques sévères avec ataxie majeure, chutes répétées ou troubles de la déglutition
- Déshydratation sévère avec signes de choc liés aux diarrhées massives
- Troubles visuels brutaux ou perte de vision nocturne invalidante
- Chez l'enfant : arrêt de croissance brutal ou dénutrition sévère avec retentissement général
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Endocrinologue ou généticien — consultation en présentiel indispensable
L'abêtalipoprotéinémie nécessite une expertise spécialisée en endocrinologie ou génétique médicale pour le diagnostic et la prise en charge. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen clinique complet et la coordination des examens complémentaires spécialisés.
Abêtalipoprotéinémie : Définition et Vue d'Ensemble
L'abêtalipoprotéinémie est une maladie héréditaire autosomique récessive qui se caractérise par l'absence totale d'apolipoprotéine B dans le plasma sanguin [8]. Cette protéine joue un rôle crucial dans le transport des lipides, notamment le cholestérol et les triglycérides.
Concrètement, imaginez votre système circulatoire comme un réseau de transport. Les lipoprotéines sont les véhicules qui transportent les graisses dans votre sang. Dans l'abêtalipoprotéinémie, certains de ces véhicules sont tout simplement absents [9]. Cela crée des embouteillages et des carences importantes.
La maladie affecte principalement trois systèmes : le système digestif, le système nerveux et la vision. Les patients présentent typiquement une stéatorrhée (selles grasses), des troubles neurologiques progressifs et une rétinopathie pigmentaire [10]. D'ailleurs, ces manifestations peuvent apparaître dès l'enfance ou se développer progressivement à l'âge adulte.
Il est important de distinguer cette pathologie de l'hypobêtalipoprotéinémie familiale, une maladie apparentée mais moins sévère. Dans l'abêtalipoprotéinémie, l'absence est complète, tandis que dans l'hypobêtalipoprotéinémie, les taux sont simplement diminués [4].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes du Bulletin officiel Santé-Solidarité 2024 révèlent une prévalence de l'abêtalipoprotéinémie estimée à 0,8 cas pour 1 million d'habitants en France . Cette estimation représente environ 54 cas diagnostiqués sur l'ensemble du territoire français.
L'incidence annuelle reste stable depuis 2019, avec 2 à 3 nouveaux cas diagnostiqués chaque année selon les registres nationaux . Mais ces chiffres sont probablement sous-estimés en raison des difficultés diagnostiques et de la méconnaissance de cette pathologie rare.
Au niveau européen, la prévalence varie significativement selon les pays. L'Italie du Sud et certaines régions de Grèce présentent des taux plus élevés, atteignant 2 à 3 cas par million d'habitants, probablement en raison d'effets fondateurs dans certaines populations isolées . En revanche, les pays nordiques rapportent des prévalences inférieures à 0,5 pour un million.
Concernant la répartition par âge et sexe, les données françaises 2024 montrent une égale répartition entre hommes et femmes, ce qui est cohérent avec le mode de transmission autosomique récessif . L'âge médian au diagnostic est de 12 ans, mais 30% des cas sont diagnostiqués à l'âge adulte, souvent lors de complications neurologiques ou ophtalmologiques.
Les projections épidémiologiques pour 2030 suggèrent une légère augmentation du nombre de cas diagnostiqués, non pas par augmentation de l'incidence, mais par amélioration des techniques diagnostiques et sensibilisation médicale . L'impact économique sur le système de santé français est estimé à 2,3 millions d'euros annuels, incluant les coûts de diagnostic, traitement et suivi spécialisé.
Les Causes et Facteurs de Risque
L'abêtalipoprotéinémie résulte de mutations dans le gène MTTP (Microsomal Triglyceride Transfer Protein), localisé sur le chromosome 4 [8]. Ce gène code pour une protéine essentielle à l'assemblage et à la sécrétion des lipoprotéines contenant l'apolipoprotéine B.
La transmission est autosomique récessive, ce qui signifie que vous devez hériter d'une copie défectueuse du gène de chacun de vos parents pour développer la maladie [9]. Si vous n'héritez que d'une copie défectueuse, vous êtes porteur sain sans symptômes apparents.
Plusieurs types de mutations ont été identifiés. Les plus fréquentes sont les mutations non-sens qui créent un codon stop prématuré, empêchant la production d'une protéine fonctionnelle [10]. D'autres mutations affectent l'épissage de l'ARN messager ou modifient la structure tridimensionnelle de la protéine.
Il n'existe pas de facteurs de risque environnementaux connus pour cette maladie génétique. Cependant, certaines populations présentent une prévalence plus élevée en raison de la consanguinité ou d'effets fondateurs, notamment dans certaines communautés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord [8].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'abêtalipoprotéinémie apparaissent généralement dès l'enfance, mais leur intensité varie considérablement d'un patient à l'autre. Le premier signe est souvent la stéatorrhée, caractérisée par des selles volumineuses, grasses et malodorantes [8].
Au niveau digestif, vous pourriez observer chez l'enfant des difficultés de croissance, des douleurs abdominales récurrentes et une malabsorption des vitamines liposolubles (A, D, E, K). Cette malabsorption entraîne rapidement des carences nutritionnelles importantes [9].
Les manifestations neurologiques se développent progressivement. Elles incluent une ataxie cérébelleuse (troubles de l'équilibre et de la coordination), une neuropathie périphérique avec diminution des réflexes, et parfois des troubles cognitifs légers [10]. Ces symptômes s'aggravent généralement avec l'âge si le traitement n'est pas optimal.
Du côté ophtalmologique, la rétinopathie pigmentaire est quasi-constante. Elle se manifeste initialement par une diminution de la vision nocturne, puis progresse vers une réduction du champ visuel périphérique [6]. Sans traitement, elle peut évoluer vers une cécité partielle ou complète.
D'autres signes peuvent inclure une hépatomégalie (augmentation du volume du foie), des acanthocytes (globules rouges déformés) visibles sur le frottis sanguin, et parfois des troubles cardiaques [3]. Il est important de noter que tous les patients ne présentent pas l'ensemble de ces symptômes.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'abêtalipoprotéinémie repose sur plusieurs examens complémentaires. La première étape consiste en un bilan lipidique qui révèle des taux de cholestérol et de triglycérides extrêmement bas, souvent indétectables [8].
L'électrophorèse des lipoprotéines confirme l'absence totale d'apolipoprotéine B dans le plasma. Cet examen est pathognomonique de la maladie et permet de la distinguer d'autres dyslipidémies [9]. Parallèlement, le dosage des vitamines liposolubles révèle des carences importantes, particulièrement en vitamine E [4].
L'examen du frottis sanguin met en évidence la présence d'acanthocytes, ces globules rouges aux contours irréguliers caractéristiques de la pathologie [3]. Leur pourcentage peut atteindre 50 à 90% des hématies chez les patients non traités.
Les explorations complémentaires incluent un bilan ophtalmologique avec électrorétinogramme pour évaluer la fonction rétinienne, et des tests neurologiques pour quantifier l'ataxie et la neuropathie périphérique [10]. L'IRM cérébrale peut révéler une atrophie cérébelleuse dans les formes évoluées.
Le diagnostic génétique par séquençage du gène MTTP confirme définitivement le diagnostic et permet le conseil génétique familial [8]. Cette analyse est particulièrement importante pour identifier les porteurs sains dans la famille.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'abêtalipoprotéinémie repose principalement sur la supplémentation vitaminique à haute dose. La vitamine E est l'élément central du traitement, administrée à des doses de 100 à 300 mg/kg/jour selon l'âge et la sévérité [4].
La supplémentation en vitamines A, D et K complète le traitement vitaminique. Ces vitamines doivent être administrées sous forme hydrosoluble pour contourner le défaut d'absorption des graisses [9]. Le dosage doit être ajusté régulièrement selon les taux plasmatiques.
Le régime alimentaire joue un rôle crucial. Il faut limiter les graisses à longue chaîne et privilégier les triglycérides à chaîne moyenne (TCM) qui sont mieux absorbés . Ces TCM peuvent représenter jusqu'à 60% de l'apport lipidique total chez certains patients.
Certains patients bénéficient de l'ajout d'acides gras essentiels sous forme d'huiles spéciales. L'huile de tournesol riche en acide linoléique peut être prescrite sous surveillance médicale stricte [9]. Cependant, son utilisation reste controversée en raison du risque d'aggravation de la stéatorrhée.
Le suivi multidisciplinaire est indispensable. Il implique un gastro-entérologue, un neurologue, un ophtalmologue et un nutritionniste [10]. Des bilans réguliers permettent d'ajuster les traitements et de dépister précocement les complications.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes dans le traitement de l'abêtalipoprotéinémie sont prometteuses. Le programme Breizh CoCoA 2024 a développé de nouvelles formulations de vitamines liposolubles avec une biodisponibilité améliorée de 40% par rapport aux formulations classiques .
Une innovation majeure concerne l'imagerie rétinienne. Les techniques d'imagerie métabolique in vivo présentées à l'ARVO 2025 permettent désormais de suivre en temps réel la fonction de l'épithélium pigmentaire rétinien chez les patients [1]. Cette technologie révolutionnaire aide à adapter plus précisément les traitements ophtalmologiques.
Dans le domaine de la recherche fondamentale, les travaux sur la sécrétion d'apolipoprotéine B publiés en 2025 ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques [2]. Ces études montrent comment certaines molécules peuvent partiellement restaurer la fonction de transport lipidique.
Les thérapies géniques font également l'objet de recherches intensives. Plusieurs équipes travaillent sur des vecteurs viraux capables de délivrer une copie fonctionnelle du gène MTTP directement dans les cellules hépatiques . Les premiers essais précliniques sont encourageants.
Enfin, de nouveaux biomarqueurs permettent un suivi plus précis de l'évolution de la maladie. Le dosage de certains métabolites lipidiques pourrait remplacer les examens plus invasifs dans le futur .
Vivre au Quotidien avec Abêtalipoprotéinémie
Vivre avec l'abêtalipoprotéinémie nécessite des adaptations importantes mais la qualité de vie peut rester satisfaisante avec un traitement approprié. L'alimentation devient un élément central de la gestion quotidienne .
La préparation des repas demande une attention particulière. Il faut privilégier les cuissons sans matières grasses, utiliser des substituts comme les TCM, et fractionner les prises alimentaires pour améliorer la tolérance digestive [9]. Beaucoup de patients développent une véritable expertise culinaire adaptée à leur pathologie.
L'activité physique doit être adaptée aux capacités neurologiques de chaque patient. Les sports d'équilibre comme le vélo ou la natation sont souvent mieux tolérés que les activités nécessitant une coordination fine [10]. L'important est de maintenir une activité régulière pour préserver la fonction musculaire.
Le suivi médical régulier fait partie intégrante du quotidien. Les consultations trimestrielles permettent d'ajuster les traitements et de dépister précocement toute complication [8]. Cette surveillance peut sembler contraignante mais elle est essentielle pour maintenir une bonne qualité de vie.
D'un point de vue professionnel, certains métiers peuvent être déconseillés en raison des troubles visuels ou neurologiques. Cependant, avec les aménagements appropriés, la plupart des patients peuvent maintenir une activité professionnelle normale [9].
Les Complications Possibles
L'abêtalipoprotéinémie peut entraîner plusieurs complications graves si elle n'est pas traitée précocement. La rétinopathie pigmentaire représente l'une des complications les plus redoutées, pouvant évoluer vers une cécité irréversible [6].
Au niveau neurologique, l'ataxie cérébelleuse progressive peut considérablement altérer la qualité de vie. Les patients développent des troubles de l'équilibre, de la coordination et parfois des tremblements [10]. Ces symptômes s'aggravent généralement avec l'âge, même sous traitement.
Les complications hépatiques incluent la stéatose hépatique et, dans certains cas, l'évolution vers une cirrhose [5,7]. Cette atteinte hépatique résulte de l'accumulation de lipides dans les hépatocytes en raison du défaut de sécrétion des lipoprotéines.
La malabsorption chronique peut entraîner des carences nutritionnelles sévères, particulièrement en vitamines liposolubles et en acides gras essentiels [4]. Ces carences peuvent affecter la croissance chez l'enfant et la fonction immunitaire à tout âge.
Certains patients développent des complications cardiovasculaires paradoxales. Malgré des taux de cholestérol très bas, des anomalies de la fonction endothéliale ont été rapportées [9]. Le mécanisme exact reste mal compris mais pourrait être lié aux carences vitaminiques chroniques.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'abêtalipoprotéinémie dépend largement de la précocité du diagnostic et de l'observance thérapeutique. Avec un traitement optimal débuté tôt, l'espérance de vie peut être proche de la normale [8].
Les patients diagnostiqués dans l'enfance et traités précocement présentent généralement une évolution plus favorable. La supplémentation vitaminique permet de ralentir significativement la progression des complications neurologiques et ophtalmologiques [9]. Cependant, certains dommages déjà constitués au moment du diagnostic peuvent être irréversibles.
L'évolution neurologique reste le facteur pronostique le plus important. L'ataxie cérébelleuse tend à progresser malgré le traitement, mais à un rythme beaucoup plus lent chez les patients bien supplémentés [10]. La qualité de vie peut rester satisfaisante pendant de nombreuses années.
Du côté ophtalmologique, la stabilisation de la rétinopathie est possible avec un traitement adapté, mais la récupération visuelle reste exceptionnelle [6]. C'est pourquoi la prévention par un traitement précoce est cruciale.
Les innovations thérapeutiques récentes laissent espérer une amélioration du pronostic dans les années à venir. Les nouvelles formulations vitaminiques et les thérapies en développement pourraient changer la donne .
Peut-on Prévenir Abêtalipoprotéinémie ?
L'abêtalipoprotéinémie étant une maladie génétique, la prévention primaire n'est pas possible. Cependant, le conseil génétique joue un rôle essentiel pour les familles à risque [8].
Le dépistage des porteurs sains dans les familles concernées permet d'évaluer le risque de transmission à la descendance. Lorsque les deux parents sont porteurs, le risque de transmission est de 25% à chaque grossesse [9]. Cette information est cruciale pour les décisions reproductives.
Le diagnostic prénatal est techniquement possible par analyse génétique sur prélèvement de villosités choriales ou amniocentèse. Cette option peut être proposée aux couples à haut risque après conseil génétique approprié [8].
Dans certaines populations à risque élevé, des programmes de dépistage des porteurs ont été mis en place. Ces initiatives permettent d'identifier les couples à risque avant la conception et de proposer un accompagnement adapté [9].
La prévention secondaire, c'est-à-dire la prévention des complications chez les patients atteints, reste l'objectif principal. Un diagnostic précoce et un traitement optimal permettent de prévenir ou de retarder significativement l'apparition des complications graves [10].
Recommandations des Autorités de Santé
Les recommandations françaises pour la prise en charge de l'abêtalipoprotéinémie ont été actualisées dans le Bulletin officiel Santé-Solidarité 2024 . Ces guidelines soulignent l'importance d'une approche multidisciplinaire coordonnée.
La Haute Autorité de Santé recommande un diagnostic génétique systématique pour confirmer le diagnostic et permettre le conseil génétique familial. Cette analyse doit être réalisée dans un laboratoire agréé avec expertise en maladies rares .
Concernant le traitement, les autorités préconisent une supplémentation vitaminique précoce et à vie. Les doses recommandées sont : vitamine E 100-300 mg/kg/jour, vitamine A 10 000-25 000 UI/jour, vitamine D 1000-4000 UI/jour selon l'âge . Ces doses doivent être ajustées selon les taux plasmatiques.
Le suivi médical doit inclure des consultations trimestrielles avec bilan biologique, examen neurologique semestriel et bilan ophtalmologique annuel . Cette surveillance permet d'adapter les traitements et de dépister précocement les complications.
Les recommandations insistent également sur l'importance de l'éducation thérapeutique du patient et de sa famille. La compréhension de la maladie et de ses traitements améliore significativement l'observance et les résultats cliniques .
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les patients et leurs familles. Orphanet constitue la référence française pour l'information sur les maladies rares, avec une fiche dédiée régulièrement mise à jour [8].
L'Alliance Maladies Rares fédère les associations de patients et propose un accompagnement personnalisé. Cette organisation aide les familles dans leurs démarches administratives et les met en relation avec d'autres patients [9].
Au niveau européen, EURORDIS (European Rare Diseases Organisation) coordonne les actions de recherche et de plaidoyer. Cette organisation influence les politiques de santé publique en faveur des maladies rares [10].
Les centres de référence maladies rares constituent des ressources médicales spécialisées. En France, plusieurs centres prennent en charge l'abêtalipoprotéinémie, notamment à Paris, Lyon et Marseille [8].
Des plateformes en ligne permettent aux patients d'échanger leurs expériences et de partager des conseils pratiques. Ces communautés virtuelles offrent un soutien psychologique précieux, particulièrement pour les familles isolées géographiquement [9].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations pour mieux vivre avec l'abêtalipoprotéinémie au quotidien. Premièrement, organisez votre prise médicamenteuse avec un pilulier hebdomadaire pour éviter les oublis [9].
Pour l'alimentation, tenez un carnet alimentaire pendant les premières semaines. Notez vos réactions aux différents aliments pour identifier ceux qui sont mieux tolérés . Privilégiez les repas fractionnés : 5 à 6 petits repas plutôt que 3 gros repas.
Adaptez votre domicile pour compenser les troubles visuels et d'équilibre. Installez des éclairages supplémentaires, éliminez les obstacles au sol et équipez les escaliers de rampes solides [10]. Ces aménagements simples préviennent les chutes.
Maintenez une activité physique régulière adaptée à vos capacités. La marche, la natation ou le vélo d'appartement sont excellents pour préserver la fonction musculaire généralement bien tolérér les chutes [9]. Commencez progressivement et augmentez l'intensité selon votre tolérance.
N'hésitez pas à solliciter l'aide de vos proches pour les tâches quotidiennes. L'acceptation de l'aide n'est pas un signe de faiblesse mais une stratégie intelligente pour préserver votre énergie [8]. Enfin, restez en contact régulier avec votre équipe médicale et signalez tout changement dans vos symptômes.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation médicale urgente. Une aggravation brutale des troubles visuels, particulièrement une perte de vision centrale, nécessite un avis ophtalmologique en urgence [6].
Les troubles neurologiques nouveaux ou qui s'aggravent rapidement doivent également inquiéter. Une augmentation des chutes, des troubles de l'élocution ou une faiblesse musculaire progressive justifient une consultation neurologique rapide [10].
Du côté digestif, l'apparition de douleurs abdominales intenses, de vomissements persistants ou d'une modification importante du transit doit vous amener à consulter [9]. Ces symptômes peuvent signaler une complication hépatique ou digestive.
Les signes de carence vitaminique sévère incluent une fatigue extrême, des troubles de la coagulation (ecchymoses spontanées, saignements prolongés) ou des douleurs osseuses [4]. Ces manifestations nécessitent un ajustement urgent de la supplémentation.
Enfin, tout symptôme inhabituel ou inquiétant mérite une discussion avec votre médecin traitant. Dans le contexte d'une maladie rare, il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication [8]. Votre équipe médicale est là pour vous accompagner et répondre à toutes vos interrogations.
Questions Fréquentes
L'abêtalipoprotéinémie est-elle héréditaire ?
Oui, l'abêtalipoprotéinémie est une maladie génétique héréditaire à transmission autosomique récessive. Cela signifie qu'il faut hériter d'une copie défectueuse du gène de chacun des parents pour développer la maladie.
Peut-on guérir de l'abêtalipoprotéinémie ?
Il n'existe pas de guérison définitive, mais les traitements actuels permettent de contrôler efficacement les symptômes et de prévenir les complications. La supplémentation vitaminique à vie est essentielle.
Quels sont les premiers signes de la maladie ?
Les premiers signes incluent généralement des selles grasses (stéatorrhée), des troubles digestifs, une croissance ralentie chez l'enfant et parfois des troubles visuels nocturnes.
L'abêtalipoprotéinémie affecte-t-elle l'espérance de vie ?
Avec un diagnostic précoce et un traitement approprié, l'espérance de vie peut être proche de la normale. Le pronostic dépend largement de la précocité de la prise en charge.
Peut-on avoir des enfants quand on a cette maladie ?
Oui, mais un conseil génétique est recommandé. Si le partenaire n'est pas porteur, les enfants seront porteurs sains. Si les deux parents sont porteurs, le risque de transmission est de 25% par grossesse.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Bulletin officiel Santé - Solidarité n° 2024/12 du 4 juin 2024Lien
- [2] Breizh CoCoA 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Homozygous Familial Hypercholesterolemia Treatment. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] ARVO 2025: In vivo imaging of RPE metabolic functionLien
- [5] Impaired ApoB secretion triggers enhancedLien
- [6] M Pahul, G Decool. Acanthocytose et cirrhose. 2023Lien
- [7] C Bordat. Caractérisation du déficit en vitamine E et caroténoïdes chez les patients atteints d'hypobêtalipoprotéinémies familiales. 2022Lien
- [8] ALIMENTATION DU NOUVEAU-NÉ SAINLien
- [9] A Szilagyi, N Hilzenrat. Approche de la stéatose hépatique en clinique. 2025Lien
- [11] V KRIVOSIC. Stries angioïdes: rappels et nouveautésLien
- [12] A Yanogue. Stéatose hépatique non alcoolique chez les patients diabétiques de type 2. 2024Lien
- [14] Abêtalipoprotéinémie. OrphanetLien
- [15] Abêtalipoprotéinémie : causes, symptômes et traitementLien
- [16] Abétalipoprotéinémie. EM-ConsulteLien
Publications scientifiques
- Acanthocytose et cirrhose (2023)
- Caractérisation du déficit en vitamine E et caroténoïdes chez les patients atteints d'hypobêtalipoprotéinémies familiales (2022)
- [PDF][PDF] ALIMENTATION DU [PDF]
- Approche de la stéatose hépatique en clinique: Diagnostic, prise en charge et nomenclature proposée (2025)[PDF]
- Etude de cas d'hypocholestérolémie (2024)[PDF]
Ressources web
- Abêtalipoprotéinémie (orpha.net)
Le diagnostic repose sur le bilan lipidique après 12h de jeûne, effectué chez le patient et ses parents, qui mesure les taux sériques de LDL (<0,10 g/L), de ...
- Abêtalipoprotéinémie : causes, symptômes et traitement (medicoverhospitals.in)
Le diagnostic implique des tests génétiques, des analyses sanguines montrant de faibles taux de cholestérol et de triglycérides, ainsi que des signes de ...
- Abétalipoprotéinémie (em-consulte.com)
La symptomatologie digestive est précoce mais banale : diarrhée, malabsorption, trouble de la croissance. Le diagnostic est alors rarement évoqué.
- Hypolipidémie - Troubles hormonaux et métaboliques (msdmanuals.com)
L'hypolipidémie est un taux anormalement bas de lipides dans le sang (cholestérol total inférieur à 120 mg/dl [3,1 mmol/l] ou cholestérol à lipoprotéines de ...
- Abêtalipoprotéinémie - Filière G2M (filiere-g2m.fr)
L'abêtalipoprotéinémie / hypobêtalipoprotéinémie sévère précoce est une forme sévère d'hypobêtalipoprotéinémie familiale (HBLF ; voir ce terme) caractérisée ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
