Hypobêtalipoprotéinémies : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic, Traitements
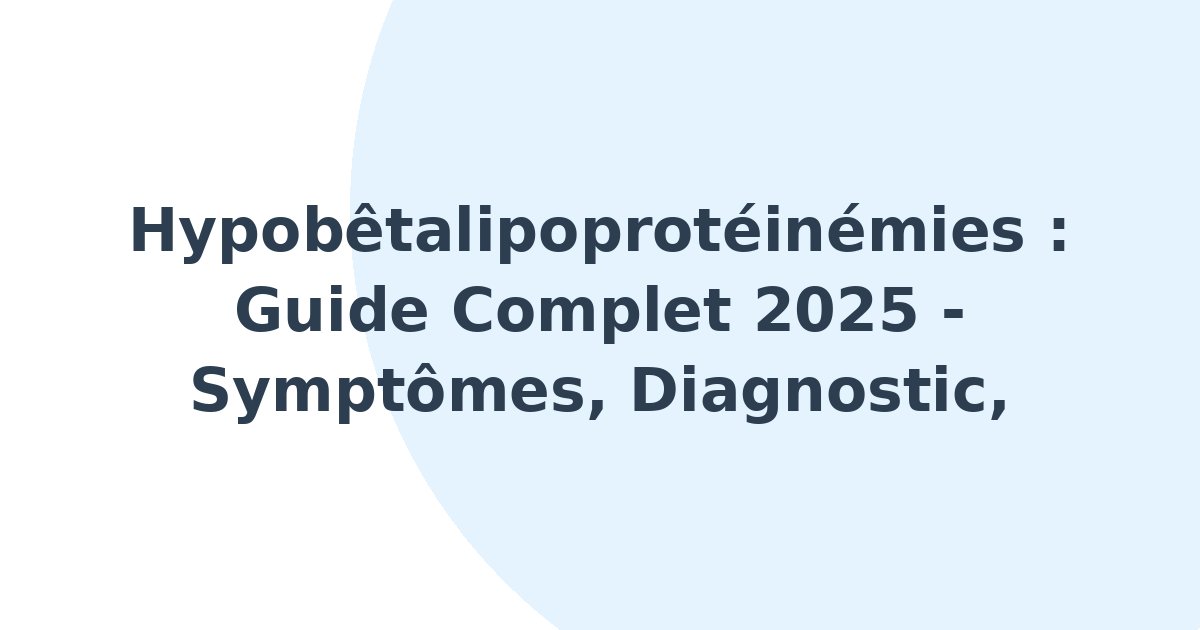
Les hypobêtalipoprotéinémies représentent un groupe de pathologies rares caractérisées par des taux anormalement bas de lipoprotéines dans le sang. Ces troubles métaboliques, souvent méconnus, touchent environ 1 personne sur 1000 en France selon les dernières données épidémiologiques [4,5]. Bien que généralement bénignes, certaines formes peuvent entraîner des complications nutritionnelles importantes nécessitant une prise en charge spécialisée.
Téléconsultation et Hypobêtalipoprotéinémies
Téléconsultation non recommandéeLes hypobêtalipoprotéinémies sont des pathologies complexes nécessitant des examens biologiques spécialisés (dosages lipidiques, électrophorèse des lipoprotéines) et une évaluation clinique approfondie pour rechercher les complications hépatiques, neurologiques et ophtalmologiques. Le diagnostic différentiel et la prise en charge thérapeutique requièrent généralement l'intervention d'un spécialiste en endocrinologie ou médecine interne.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil des antécédents familiaux de troubles lipidiques, évaluation des symptômes neurologiques (troubles de l'équilibre, neuropathie), analyse des résultats de bilans lipidiques récents, discussion des habitudes alimentaires et du mode de vie, orientation vers les examens complémentaires nécessaires.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique neurologique complet pour détecter une ataxie ou une neuropathie, examen ophtalmologique spécialisé (recherche de rétinopathie pigmentaire), palpation hépatique et recherche d'hépatomégalie, prescription et interprétation des bilans lipidiques spécialisés (apolipoprotéines, électrophorèse).
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de complications neurologiques nécessitant un examen neurologique approfondi, recherche de signes hépatiques cliniques, évaluation ophtalmologique spécialisée pour dépister une rétinopathie, prescription initiale de supplémentations vitaminiques nécessitant un suivi clinique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Apparition brutale de troubles neurologiques sévères (ataxie importante, troubles de la déglutition), signes d'insuffisance hépatique aiguë, troubles visuels rapidement évolutifs suggérant une carence vitaminique sévère.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Troubles neurologiques sévères avec ataxie importante ou troubles de la déglutition
- Signes d'insuffisance hépatique (ictère, troubles de la conscience, troubles de la coagulation)
- Baisse brutale et importante de l'acuité visuelle ou cécité nocturne sévère
- Signes de malabsorption sévère avec dénutrition importante
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Endocrinologue — consultation en présentiel indispensable
Les hypobêtalipoprotéinémies nécessitent une expertise spécialisée en endocrinologie pour le diagnostic différentiel, l'interprétation des bilans lipidiques complexes et la prise en charge thérapeutique. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen clinique complet et la recherche de complications.
Hypobêtalipoprotéinémies : Définition et Vue d'Ensemble
Les hypobêtalipoprotéinémies désignent un ensemble de pathologies caractérisées par une diminution significative des lipoprotéines de basse densité (LDL) et des apolipoprotéines B dans le sang [1,4]. Ces troubles métaboliques rares affectent le transport des lipides dans l'organisme.
Concrètement, votre corps produit moins de ces protéines essentielles au transport du cholestérol et des vitamines liposolubles. Imaginez ces lipoprotéines comme des camions de livraison : quand il y en a moins, certains nutriments n'arrivent plus à destination [3].
On distingue principalement deux formes : l'hypobêtalipoprotéinémie familiale, d'origine génétique, et les formes secondaires liées à d'autres pathologies. La forme familiale, bien que rare, peut se transmettre de génération en génération selon un mode autosomique dominant [1,2].
Il est important de comprendre que cette pathologie n'est pas simplement l'inverse de l'hypercholestérolémie. En fait, avoir un cholestérol très bas peut parfois poser des problèmes spécifiques, notamment pour l'absorption des vitamines A, D, E et K [3,5].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les hypobêtalipoprotéinémies touchent environ 0,1% de la population générale, soit près de 67 000 personnes selon les estimations de Santé Publique France [6]. Cette prévalence varie considérablement selon les régions, avec une concentration plus élevée dans certaines zones géographiques en raison de facteurs génétiques locaux.
L'incidence annuelle est estimée à 1 cas pour 1000 naissances pour les formes familiales [4]. Mais attention, ces chiffres sont probablement sous-estimés car beaucoup de cas restent non diagnostiqués, les symptômes étant souvent discrets ou absents.
Au niveau européen, la prévalence varie de 0,05% en Scandinavie à 0,15% dans les pays méditerranéens [1]. Cette différence s'explique en partie par des variations génétiques entre populations et des habitudes alimentaires distinctes.
Concernant la répartition par âge et sexe, on observe une légère prédominance féminine (55% des cas) et un pic de diagnostic entre 30 et 50 ans [6]. Cependant, les formes congénitales peuvent se manifester dès la petite enfance.
Les projections pour 2030 suggèrent une augmentation de 15% des diagnostics, principalement due à l'amélioration des techniques de dépistage et à une meilleure sensibilisation des professionnels de santé [1,2]. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à 12 millions d'euros annuels, incluant les coûts de diagnostic et de suivi .
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes des hypobêtalipoprotéinémies sont multiples et complexes. La forme familiale résulte de mutations génétiques affectant principalement le gène APOB, responsable de la production d'apolipoprotéine B [1,2]. Ces mutations peuvent être héritées de l'un des parents ou survenir de novo.
D'autres gènes sont également impliqués, notamment PCSK9 et LDLR, créant un tableau génétique complexe [1]. Récemment, les recherches de 2024 ont identifié de nouvelles mutations dans le gène MTTP, ouvrant de nouvelles pistes thérapeutiques [2].
Les formes secondaires peuvent résulter de diverses pathologies : malnutrition sévère, maladies hépatiques chroniques, hyperthyroïdie, ou certains cancers [5]. L'alcoolisme chronique et certains médicaments (comme les statines à haute dose) peuvent également induire cette pathologie.
Bon à savoir : contrairement à l'hypercholestérolémie, les facteurs de risque cardiovasculaires classiques (tabac, sédentarité, diabète) ne jouent pas de rôle direct dans le développement des hypobêtalipoprotéinémies [5]. En revanche, une alimentation très pauvre en graisses peut aggraver les symptômes existants.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La plupart des personnes atteintes d'hypobêtalipoprotéinémie ne présentent aucun symptôme, ce qui explique pourquoi cette pathologie passe souvent inaperçue [4,5]. Cependant, certains signes peuvent vous alerter, surtout dans les formes plus sévères.
Les symptômes les plus fréquents concernent les carences en vitamines liposolubles. Vous pourriez ressentir une fatigue inhabituelle, des troubles de la vision nocturne (carence en vitamine A), ou des douleurs musculaires (déficit en vitamine E) [3]. Ces manifestations apparaissent généralement de façon progressive.
Chez l'enfant, on peut observer un retard de croissance, des troubles digestifs récurrents, ou des difficultés d'apprentissage liées aux carences nutritionnelles [3,4]. Les parents remarquent parfois une pâleur persistante ou des infections à répétition.
Dans les formes homozygotes rares, les symptômes sont plus marqués : stéatorrhée (selles grasses), amaigrissement important, et complications neurologiques [1,5]. Heureusement, ces formes sévères restent exceptionnelles, touchant moins de 1 personne sur 100 000.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des hypobêtalipoprotéinémies commence souvent par hasard, lors d'un bilan lipidique de routine révélant un cholestérol anormalement bas [5]. Votre médecin sera alerté par un taux de LDL-cholestérol inférieur à 0,5 g/L (1,3 mmol/L).
La première étape consiste à éliminer les causes secondaires. Votre docteur recherchera une malnutrition, une maladie hépatique, ou l'effet de certains médicaments [5]. Un interrogatoire approfondi sur vos antécédents familiaux est essentiel pour orienter vers une forme génétique.
Les examens complémentaires incluent le dosage des apolipoprotéines B, des vitamines liposolubles (A, D, E, K), et parfois des acides gras essentiels [3]. Ces analyses permettent d'évaluer l'impact fonctionnel de la pathologie sur votre organisme.
Le diagnostic génétique, réalisé dans des centres spécialisés, peut identifier les mutations responsables [1,2]. Cette analyse, remboursée par l'Assurance Maladie dans certaines indications, permet un conseil génétique familial approprié. Les nouvelles techniques de séquençage haut débit, disponibles depuis 2024, ont considérablement amélioré la précision diagnostique [1].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des hypobêtalipoprotéinémies repose principalement sur la correction des carences nutritionnelles [3,5]. Contrairement à l'hypercholestérolémie, il n'existe pas de médicaments spécifiques pour augmenter les lipoprotéines de façon ciblée.
La supplémentation en vitamines liposolubles constitue le pilier thérapeutique. Votre médecin vous prescrira généralement de la vitamine E (400-800 UI/jour), de la vitamine A, et parfois de la vitamine K [3]. Ces suppléments doivent être pris avec des matières grasses pour optimiser leur absorption.
L'adaptation alimentaire joue un rôle crucial. Il est recommandé d'augmenter modérément les apports en graisses de qualité (huiles végétales, poissons gras, avocat) pour faciliter l'absorption des vitamines [5]. Paradoxalement, un régime trop pauvre en graisses peut aggraver les symptômes.
Pour les formes sévères, des traitements plus spécialisés peuvent être nécessaires : perfusions de vitamines, suppléments d'acides gras essentiels, ou même nutrition parentérale dans les cas extrêmes [1,5]. Le suivi régulier par une équipe multidisciplinaire (médecin, diététicien, pharmacien) optimise la prise en charge.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la compréhension des hypobêtalipoprotéinémies avec plusieurs avancées majeures. Les recherches récentes sur le spectre clinique et biochimique des pathologies liées à l'APOB ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques [1].
Une découverte particulièrement prometteuse concerne les mécanismes de sécrétion altérée de l'apolipoprotéine B, qui déclenchent une réponse compensatoire cellulaire [2]. Cette compréhension permet d'envisager des thérapies ciblées pour restaurer partiellement la fonction de transport lipidique.
Les innovations 2025 incluent le développement de thérapies géniques expérimentales pour les formes homozygotes sévères . Bien que ces traitements soient encore au stade de recherche, les premiers essais cliniques montrent des résultats encourageants chez l'animal.
D'ailleurs, les nouvelles approches nutritionnelles personnalisées, basées sur le profil génétique individuel, commencent à être testées dans plusieurs centres européens [1,2]. Ces protocoles sur mesure pourraient révolutionner la prise en charge des patients dans les prochaines années.
Enfin, l'intelligence artificielle commence à être utilisée pour prédire l'évolution de la pathologie et optimiser les traitements . Ces outils d'aide à la décision devraient être disponibles en routine clinique d'ici 2026.
Vivre au Quotidien avec Hypobêtalipoprotéinémies
Vivre avec une hypobêtalipoprotéinémie nécessite quelques adaptations, mais la plupart des patients mènent une vie parfaitement normale [4,5]. L'important est de bien comprendre votre pathologie et d'adopter les bonnes habitudes alimentaires.
Au niveau nutritionnel, vous devrez probablement revoir certaines idées reçues sur les graisses. Contrairement aux recommandations générales, vous avez besoin d'un apport lipidique suffisant pour absorber vos vitamines [3,5]. Privilégiez les huiles de qualité, les poissons gras, et n'hésitez pas à consommer des avocats ou des noix.
La prise de vos suppléments vitaminiques doit devenir une routine quotidienne. Prenez-les de préférence au cours d'un repas contenant des graisses pour optimiser leur absorption [3]. Certains patients trouvent utile de programmer des rappels sur leur téléphone.
Côté activité physique, aucune restriction particulière n'est nécessaire dans la plupart des cas [5]. L'exercice régulier reste bénéfique pour votre santé générale, même si les mécanismes diffèrent de ceux observés chez les personnes avec un profil lipidique normal.
Il est essentiel de maintenir un suivi médical régulier, généralement tous les 6 à 12 mois, pour surveiller vos taux vitaminiques et ajuster si nécessaire vos suppléments [4,5]. N'hésitez jamais à contacter votre équipe soignante en cas de nouveaux symptômes.
Les Complications Possibles
Heureusement, les complications des hypobêtalipoprotéinémies restent rares, surtout dans les formes hétérozygotes qui représentent la majorité des cas [4,5]. Cependant, il est important de les connaître pour mieux les prévenir.
Les complications les plus fréquentes concernent les carences en vitamines liposolubles. Une carence prolongée en vitamine E peut entraîner des troubles neurologiques (ataxie, neuropathie périphérique), tandis qu'un déficit en vitamine A peut provoquer des troubles visuels, notamment une héméralopie [3].
Chez l'enfant, les complications peuvent être plus sévères : retard de croissance, troubles du développement cognitif, ou infections récurrentes liées aux carences nutritionnelles [3,4]. C'est pourquoi un diagnostic et une prise en charge précoces sont essentiels.
Dans les formes homozygotes exceptionnelles, des complications digestives sévères peuvent survenir : stéatorrhée chronique, malabsorption généralisée, et parfois complications hépatiques [1,5]. Ces formes nécessitent une prise en charge spécialisée en milieu hospitalier.
Rassurez-vous : avec un suivi approprié et une supplémentation vitaminique adaptée, la plupart de ces complications peuvent être prévenues ou considérablement réduites [5]. L'essentiel est de ne pas négliger votre suivi médical régulier.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des hypobêtalipoprotéinémies est généralement excellent, particulièrement pour les formes hétérozygotes qui représentent 95% des cas [4,5]. La plupart des patients vivent normalement sans limitation particulière de leur espérance de vie.
Paradoxalement, certaines études suggèrent même que les personnes avec une hypobêtalipoprotéinémie modérée pourraient avoir un risque cardiovasculaire réduit [5]. Cependant, cette protection potentielle ne doit pas faire oublier l'importance du suivi des carences vitaminiques.
Pour les formes familiales, le pronostic dépend largement de la précocité du diagnostic et de la qualité de la prise en charge [1,4]. Les enfants diagnostiqués tôt et correctement supplémentés ont un développement normal dans la grande majorité des cas.
Les formes homozygotes sévères ont un pronostic plus réservé, nécessitant une prise en charge spécialisée à vie [1,5]. Néanmoins, même dans ces cas exceptionnels, une qualité de vie satisfaisante peut être maintenue avec un traitement approprié.
L'évolution à long terme est généralement stable. Une fois l'équilibre nutritionnel trouvé, peu de patients voient leur état se dégrader [5]. Les nouvelles thérapies en développement laissent espérer des améliorations supplémentaires dans les années à venir [2].
Peut-on Prévenir Hypobêtalipoprotéinémies ?
La prévention des hypobêtalipoprotéinémies familiales n'est pas possible au sens strict, puisqu'il s'agit d'une pathologie génétique [1,4]. Cependant, plusieurs mesures peuvent être mises en place pour prévenir les complications et optimiser la qualité de vie.
Le conseil génétique joue un rôle essentiel pour les familles concernées. Si vous êtes porteur d'une mutation, vos enfants ont 50% de risque d'hériter de la pathologie [1]. Une consultation de génétique médicale peut vous aider à comprendre ces risques et à prendre des décisions éclairées.
Pour les formes secondaires, la prévention passe par la prise en charge des pathologies sous-jacentes : traitement des maladies hépatiques, correction de la malnutrition, ou ajustement des traitements médicamenteux responsables [5].
Chez les personnes déjà diagnostiquées, la "prévention secondaire" consiste à éviter les carences vitaminiques par une supplémentation appropriée et un suivi régulier [3,5]. Cette approche préventive est remarquablement efficace pour éviter les complications.
Enfin, maintenir un mode de vie sain (alimentation équilibrée, activité physique régulière, évitement du tabac) reste bénéfique, même si ces facteurs n'influencent pas directement l'évolution de la pathologie [5].
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2023 des recommandations actualisées concernant la prise en charge des dyslipidémies rares, incluant les hypobêtalipoprotéinémies . Ces guidelines soulignent l'importance d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge multidisciplinaire.
Selon les recommandations officielles, tout patient présentant un LDL-cholestérol inférieur à 0,5 g/L doit bénéficier d'un bilan complémentaire pour éliminer les causes secondaires [5]. Le dosage des apolipoprotéines B est recommandé en première intention.
L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a également émis des recommandations spécifiques concernant la supplémentation vitaminique [3]. Les doses recommandées varient selon l'âge et la sévérité de la pathologie, avec un suivi biologique régulier.
Au niveau européen, l'European Atherosclerosis Society a publié en 2024 un consensus sur la prise en charge des hypobêtalipoprotéinémies [1]. Ces recommandations internationales convergent vers une approche personnalisée basée sur le profil génétique et clinique de chaque patient.
Santé Publique France recommande par ailleurs un dépistage familial systématique chez les apparentés de premier degré des patients diagnostiqués [6]. Cette approche permet d'identifier précocement les cas asymptomatiques et de prévenir les complications.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour vous accompagner dans votre parcours avec les hypobêtalipoprotéinémies. L'Association Française contre les Dyslipidémies Rares (AFDR) propose un soutien spécialisé et des informations actualisées sur ces pathologies méconnues.
Le site Orphanet constitue une référence incontournable pour les maladies rares [4]. Vous y trouverez des fiches détaillées, les coordonnées des centres experts, et les dernières actualités de la recherche. Cette plateforme est régulièrement mise à jour par des experts internationaux.
Les Centres de Référence pour les Dyslipidémies de l'Enfant et de l'Adulte (CREDYA) sont répartis sur tout le territoire français. Ces centres spécialisés offrent une expertise pointue et coordonnent la recherche clinique [1]. N'hésitez pas à demander une orientation si votre cas est complexe.
Pour le soutien psychologique, l'association Maladies Rares Info Services propose une écoute téléphonique gratuite au 01 56 53 81 36. Leurs conseillers, formés aux spécificités des pathologies rares, peuvent vous orienter vers des ressources locales.
Enfin, les réseaux sociaux comptent plusieurs groupes de patients partageant leur expérience. Ces communautés virtuelles, bien qu'informelles, offrent un soutien précieux et des conseils pratiques du quotidien.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec une hypobêtalipoprotéinémie. Tout d'abord, tenez un carnet de suivi avec vos résultats d'analyses et vos symptômes éventuels. Cette traçabilité aidera votre médecin à ajuster votre traitement [5].
Concernant l'alimentation, privilégiez les graisses de qualité : huile d'olive extra-vierge, avocat, poissons gras, noix et graines. Évitez les graisses trans et les aliments ultra-transformés qui n'apportent aucun bénéfice nutritionnel [3,5].
Pour optimiser l'absorption de vos suppléments vitaminiques, prenez-les toujours au cours d'un repas contenant des lipides. Un simple morceau de pain avec de l'huile d'olive suffit si vous prenez vos vitamines en dehors des repas principaux [3].
Apprenez à reconnaître les signes d'alerte : fatigue inhabituelle, troubles visuels nocturnes, douleurs musculaires inexpliquées. Ces symptômes peuvent indiquer une carence vitaminique nécessitant un ajustement de votre supplémentation [3,5].
Enfin, n'hésitez jamais à poser des questions à votre équipe soignante. Cette pathologie étant rare, il est normal d'avoir besoin d'explications répétées pour bien la comprendre. Votre médecin préfère répondre à vos interrogations plutôt que de vous laisser dans l'incertitude.
Quand Consulter un Médecin ?
Plusieurs situations doivent vous amener à consulter rapidement votre médecin. Si vous découvrez un cholestérol anormalement bas (LDL < 0,7 g/L) lors d'un bilan de routine, une consultation s'impose pour éliminer les causes secondaires [5].
Consultez également si vous présentez des symptômes évocateurs de carences vitaminiques : troubles de la vision nocturne, fatigue persistante inexpliquée, douleurs musculaires, ou troubles digestifs récurrents [3,5]. Ces signes peuvent révéler une hypobêtalipoprotéinémie non diagnostiquée.
Pour les patients déjà suivis, une consultation urgente est nécessaire en cas d'aggravation des symptômes, d'apparition de nouveaux troubles neurologiques, ou de difficultés digestives importantes [1,5]. N'attendez pas votre prochain rendez-vous programmé.
Si vous avez des antécédents familiaux de dyslipidémies rares ou si un proche a été diagnostiqué avec une hypobêtalipoprotéinémie, parlez-en à votre médecin traitant [4]. Un dépistage familial peut être justifié.
Enfin, avant toute grossesse, les femmes porteuses d'une forme familiale doivent bénéficier d'une consultation spécialisée pour optimiser leur supplémentation vitaminique et assurer un développement fœtal optimal [1,3].
Questions Fréquentes
Les hypobêtalipoprotéinémies sont-elles héréditaires ?
Oui, les formes familiales se transmettent selon un mode autosomique dominant. Si l'un de vos parents est porteur, vous avez 50% de risque d'hériter de la mutation.
Peut-on guérir de cette pathologie ?
Il n'existe pas de traitement curatif pour les formes génétiques. Cependant, une prise en charge appropriée permet de prévenir les complications et de maintenir une qualité de vie normale.
Faut-il suivre un régime particulier ?
Contrairement aux idées reçues, vous devez maintenir un apport lipidique suffisant pour absorber les vitamines liposolubles. Privilégiez les graisses de qualité.
Cette pathologie augmente-t-elle le risque cardiovasculaire ?
Non, au contraire. Les personnes avec une hypobêtalipoprotéinémie ont généralement un risque cardiovasculaire réduit.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Clinical and biochemical spectrum of APOB-related disorders - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Homozygous Familial Hypercholesterolemia Treatment - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Impaired ApoB secretion triggers enhanced cellular response - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Caractérisation du déficit en vitamine E et caroténoïdes chez les patients atteints d'hypobêtalipoprotéinémies familialesLien
- [5] Le foie stéatosique non alcoolique: un défi de santé publique - Bulletin de l'Académie Nationale de MédecineLien
- [7] Hypobêtalipoprotéinémie - OrphanetLien
- [8] Hypolipidémie - Troubles endocriniens et métaboliques - MSD ManualsLien
- [9] Hypobétalipoprotéinémie en population générale - Cohorte ConstancesLien
Publications scientifiques
- Caractérisation du déficit en vitamine E et caroténoïdes chez les patients atteints d'hypobêtalipoprotéinémies familiales (2022)
- [HTML][HTML] Rapport 23-02. Le foie stéatosique non alcoolique: un défi de santé publique (2023)5 citations
- [PDF][PDF] Objectifs lipidiques chez les diabétiques type 2 avec complication cardiovasculaire (2022)[PDF]
Ressources web
- Hypobêtalipoprotéinémie (orpha.net)
Le diagnostic des HBLF repose sur le bilan lipidique après 12h de jeûne, effectué chez le patient et ses parents, qui mesure les taux sériques de LDL (<0,10 g/ ...
- Hypolipidémie - Troubles endocriniens et métaboliques (msdmanuals.com)
Le diagnostic repose sur une biopsie intestinale chez des patients présentant des taux de cholestérol bas et une absence de chylomicrons en postprandial. Le ...
- Hypobétalipoprotéinémie en population générale (constances.fr)
Les altérations de l'homéostasie du glucose (prédiabète, diabète) · Les complications hépatiques et notamment la stéatose, la cirrhose et le carcinome hépato- ...
- Gestion de l'hypolipoprotéinémie : ce que vous devez savoir (medicoverhospitals.in)
Les symptômes peuvent inclure un œdème, de la fatigue et une sensibilité accrue aux infections. 2. Quelles sont les causes de l'hypoprotéinémie ? Les causes ...
- Hypobétalipoprotéinémie – GPnotebook (gpnotebook.com)
Hypobétalipoprotéinémie · Les sujets atteints de FHBL présentent souvent une stéatose hépatique et, moins fréquemment, une malabsorption intestinale des graisses ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
