Vasoplégie : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Innovations
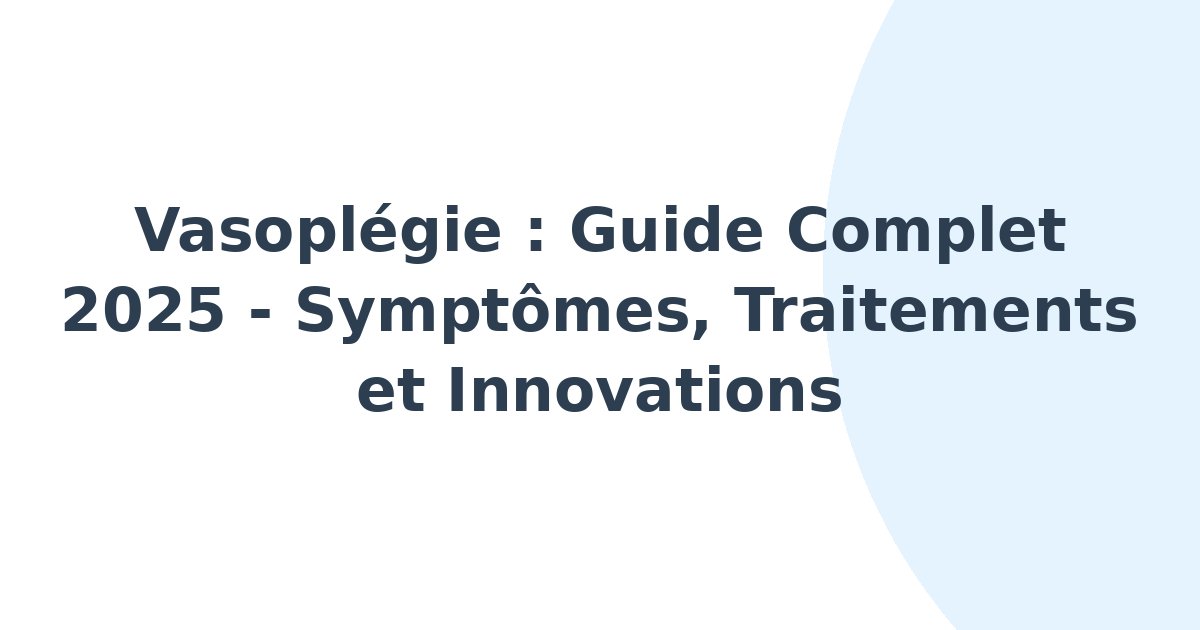
La vasoplégie représente une pathologie cardiovasculaire complexe caractérisée par une dilatation excessive des vaisseaux sanguins, entraînant une chute dangereuse de la pression artérielle. Cette maladie touche principalement les patients en réanimation et ceux subissant des interventions chirurgicales majeures. Comprendre ses mécanismes et ses traitements devient essentiel face aux innovations thérapeutiques récentes.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Vasoplégie : Définition et Vue d'Ensemble
La vasoplégie désigne un état pathologique où les vaisseaux sanguins perdent leur capacité à se contracter normalement. Cette maladie se caractérise par une vasodilatation excessive et persistante, malgré un débit cardiaque souvent préservé [13,14].
Concrètement, imaginez vos vaisseaux comme des tuyaux d'arrosage qui ne peuvent plus se resserrer. Le cœur pompe correctement, mais la pression chute dramatiquement car le sang se disperse dans un réseau trop dilaté. Cette analogie simple illustre parfaitement le mécanisme de la vasoplégie.
La pathologie survient principalement dans trois contextes cliniques majeurs. D'abord, lors du choc septique, où les toxines bactériennes altèrent la fonction vasculaire [1]. Ensuite, après certaines chirurgies cardiaques, notamment celles utilisant la circulation extracorporelle [3]. Enfin, dans diverses situations de réanimation où l'équilibre vasculaire se trouve perturbé [6].
Il faut savoir que la vasoplégie ne constitue pas une maladie isolée, mais plutôt un syndrome complexe. Elle s'accompagne souvent d'autres dysfonctionnements organiques, rendant sa prise en charge particulièrement délicate. Les équipes médicales doivent agir rapidement pour restaurer une pression artérielle suffisante et préserver la perfusion des organes vitaux.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes révèlent une incidence croissante de la vasoplégie en France. Selon les recommandations HAS 2024-2025, cette pathologie touche environ 15 à 30% des patients en choc septique, représentant près de 8 000 cas annuels dans l'Hexagone [1].
L'étude multicentrique SQUEEZE menée au CHRU de Nancy en 2023 apporte des éclairages précieux sur l'utilisation des vasopresseurs en périopératoire. Cette recherche prospective observationnelle montre que 12% des patients de chirurgie cardiaque développent une vasoplégie post-opératoire [5]. Ces chiffres confirment l'ampleur du problème dans nos hôpitaux français.
Au niveau européen, la prévalence varie significativement selon les pays. L'Allemagne rapporte des taux similaires à la France, tandis que les pays nordiques affichent des incidences légèrement inférieures, probablement liées à des différences dans les pratiques de réanimation [2,4]. Cette variation géographique souligne l'importance des protocoles locaux de prise en charge.
Concernant la répartition par âge et sexe, les hommes de plus de 65 ans représentent 60% des cas de vasoplégie post-chirurgicale. Cependant, chez les patients septiques, la distribution s'équilibre davantage entre les sexes [1,5]. L'âge reste un facteur déterminant, avec une incidence qui double après 70 ans.
Les projections pour 2025-2030 suggèrent une augmentation de 15% des cas, principalement due au vieillissement de la population et à l'amélioration du diagnostic. Cette évolution impose une adaptation des ressources hospitalières et une formation accrue des équipes soignantes.
Les Causes et Facteurs de Risque
La vasoplégie résulte de mécanismes physiopathologiques complexes impliquant plusieurs voies moléculaires. Le sepsis demeure la cause principale, représentant 70% des cas selon les données françaises récentes [1,13]. Les endotoxines bactériennes déclenchent une cascade inflammatoire massive, altérant la fonction des cellules musculaires lisses vasculaires.
Les interventions de chirurgie cardiaque constituent le deuxième facteur de risque majeur. L'utilisation de la circulation extracorporelle, l'hypothermie peropératoire et la réponse inflammatoire post-chirurgicale contribuent au développement de la vasoplégie [3,5]. L'étude du CHRU de Nancy confirme cette association, particulièrement chez les patients subissant des interventions prolongées.
D'autres facteurs prédisposants incluent l'insuffisance cardiaque sévère, certains médicaments vasodilatateurs, et les états de choc prolongés [6,9]. Les patients diabétiques présentent également un risque accru, probablement lié à leur dysfonction endothéliale préexistante. Il est important de noter que ces facteurs peuvent se combiner, augmentant exponentiellement le risque.
Récemment, les équipes de réanimation ont identifié de nouveaux facteurs de risque liés à la pandémie COVID-19. Les patients en insuffisance respiratoire aiguë développent parfois des phénotypes cardiovasculaires particuliers, incluant la vasoplégie [8,10]. Cette découverte enrichit notre compréhension des mécanismes pathologiques.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la vasoplégie se manifestent principalement par une hypotension artérielle sévère et persistante. Vous pourriez observer une pression systolique inférieure à 90 mmHg, malgré un remplissage vasculaire adéquat [15]. Cette chute tensionnelle s'accompagne souvent d'une sensation de faiblesse extrême et de vertiges.
Mais attention, la vasoplégie présente une particularité trompeuse : le débit cardiaque reste souvent normal ou même élevé. Cette dissociation entre pression artérielle basse et débit cardiaque préservé constitue un signe diagnostique important [13,15]. Les patients peuvent ainsi présenter une peau chaude et rosée, contrairement à d'autres types de choc où la peau devient froide et marbrée.
Les signes de mauvaise perfusion apparaissent progressivement. L'oligurie (diminution de la production d'urine) constitue souvent le premier indicateur d'une perfusion rénale insuffisante. Les troubles de la conscience peuvent survenir, allant de la simple confusion à des états plus sévères [6,9].
D'autres symptômes incluent une tachycardie compensatrice, des troubles digestifs et une fatigue intense. Il faut savoir que ces manifestations peuvent être masquées par les traitements en cours, notamment chez les patients sous sédation en réanimation. C'est pourquoi la surveillance hémodynamique continue devient indispensable.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de vasoplégie repose sur une approche systématique combinant évaluation clinique et examens complémentaires. La première étape consiste à confirmer l'hypotension artérielle persistante malgré un remplissage vasculaire optimal [11,15]. Cette évaluation nécessite souvent un monitoring hémodynamique avancé.
L'échocardiographie joue un rôle central dans le diagnostic différentiel. Cet examen permet d'évaluer la fonction cardiaque et d'éliminer une cause cardiogénique du choc [11]. Chez les patients vasoplégiques, l'échographie révèle typiquement une fonction ventriculaire préservée avec des signes de vasodilatation périphérique.
Les examens biologiques complètent l'évaluation diagnostique. Le dosage des lactates sériques reflète la qualité de la perfusion tissulaire, tandis que les marqueurs inflammatoires orientent vers une cause septique [1,6]. Les nouvelles techniques de monitoring permettent une évaluation plus précise du statut volémique et de la réactivité vasculaire.
Récemment, des scores de risque innovants ont été développés pour prédire la survenue de vasoplégie après chirurgie cardiaque. Ces outils, validés en 2024-2025, intègrent des paramètres préopératoires et peropératoires pour identifier les patients à haut risque [3]. Cette approche prédictive révolutionne la prise en charge préventive.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la vasoplégie repose principalement sur l'utilisation de vasopresseurs pour restaurer une pression artérielle suffisante. La noradrénaline constitue le traitement de première ligne, administrée par voie intraveineuse continue [12,15]. Ce médicament agit en stimulant les récepteurs alpha-adrénergiques, provoquant une vasoconstriction salvatrice.
Lorsque la noradrénaline seule ne suffit pas, d'autres vasopresseurs peuvent être associés. La vasopressine représente une option thérapeutique intéressante, particulièrement efficace dans les cas de vasoplégie réfractaire [5,12]. Son mécanisme d'action différent permet souvent de potentialiser l'effet des catécholamines.
L'optimisation du remplissage vasculaire reste fondamentale, mais doit être guidée par des paramètres hémodynamiques précis. L'échocardiographie permet d'évaluer la précharge et d'adapter le volume de remplissage [11]. Cette approche personnalisée évite les surcharges volémiques délétères.
Les traitements adjuvants incluent la correction des troubles métaboliques, notamment l'acidose et les désordres électrolytiques. La prise en charge de la cause sous-jacente, qu'il s'agisse d'un sepsis ou d'une complication post-chirurgicale, demeure prioritaire [1,6]. Cette approche globale améliore significativement le pronostic des patients.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques récentes ouvrent de nouvelles perspectives dans le traitement de la vasoplégie. L'angiotensine II représente l'avancée la plus prometteuse, avec des études 2024-2025 démontrant son efficacité dans les cas réfractaires [2,4]. Ce médicament agit par un mécanisme différent des vasopresseurs classiques, offrant une alternative précieuse.
Une étude prospective randomisée contrôlée récemment publiée évalue l'impact du timing d'administration de l'angiotensine II. Les résultats suggèrent qu'une administration précoce améliore significativement le pronostic des patients vasoplégiques [4]. Cette découverte pourrait révolutionner nos protocoles de prise en charge.
Les nouveaux scores de risque développés en 2024-2025 permettent une approche prédictive innovante. Ces outils intègrent des paramètres cliniques, biologiques et échocardiographiques pour identifier précocement les patients à haut risque de vasoplégie post-chirurgicale [3]. L'intelligence artificielle commence également à être intégrée dans ces modèles prédictifs.
La recherche explore aussi de nouvelles voies thérapeutiques, notamment les modulateurs de l'oxyde nitrique et les inhibiteurs spécifiques de certaines voies inflammatoires [2]. Ces approches ciblées pourraient permettre un traitement plus spécifique et moins délétère que les vasopresseurs conventionnels. Les premiers essais cliniques montrent des résultats encourageants.
Vivre au Quotidien avec Vasoplégie
Vivre avec les séquelles d'un épisode de vasoplégie nécessite souvent des adaptations importantes du mode de vie. La plupart des patients récupèrent complètement, mais certains conservent une fatigue chronique ou une intolérance à l'effort [6,9]. Il est normal de ressentir une appréhension face à ces changements.
La réadaptation cardiovasculaire joue un rôle essentiel dans la récupération. Un programme d'exercices progressifs, supervisé par des professionnels de santé, permet de retrouver progressivement ses capacités physiques. Cette approche doit être personnalisée selon l'état de chaque patient et ses comorbidités éventuelles.
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. L'expérience d'un séjour en réanimation peut laisser des traces psychologiques durables, parfois qualifiées de syndrome post-réanimation [6]. Des consultations spécialisées existent pour accompagner les patients et leurs familles dans cette période de reconstruction.
Concrètement, il est important de maintenir un suivi médical régulier, même après la guérison apparente. Certains patients développent une sensibilité particulière aux variations tensionnelles ou aux infections. Une bonne hygiène de vie, incluant une alimentation équilibrée et une activité physique adaptée, contribue à prévenir les récidives.
Les Complications Possibles
La vasoplégie peut entraîner diverses complications, principalement liées à la mauvaise perfusion des organes vitaux. L'insuffisance rénale aiguë représente la complication la plus fréquente, touchant près de 40% des patients selon les données récentes [1,6]. Cette atteinte résulte de la diminution du débit sanguin rénal malgré les traitements vasopresseurs.
Les complications neurologiques incluent des troubles de la conscience, allant de la confusion à des états plus sévères. Ces manifestations reflètent une perfusion cérébrale insuffisante et nécessitent une surveillance neurologique rapprochée [9]. Heureusement, ces troubles sont généralement réversibles avec la correction de l'hypotension.
Au niveau cardiovasculaire, l'utilisation prolongée de vasopresseurs peut paradoxalement aggraver certaines situations. Des troubles du rythme cardiaque ou une ischémie myocardique peuvent survenir, particulièrement chez les patients avec des antécédents coronariens [5,12]. Cette situation impose un équilibre délicat entre efficacité et tolérance des traitements.
Les complications infectieuses représentent également un risque majeur. L'immunosuppression relative liée au choc et aux traitements favorise le développement d'infections nosocomiales [1]. Une surveillance microbiologique rigoureuse et une antibiothérapie adaptée deviennent alors indispensables pour prévenir ces complications potentiellement graves.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la vasoplégie dépend largement de sa cause sous-jacente et de la rapidité de prise en charge. Dans les cas de vasoplégie post-chirurgicale, le taux de survie dépasse 85% avec un traitement approprié [3,5]. Cette statistique rassurante reflète les progrès considérables réalisés dans la prise en charge de cette pathologie.
Pour les patients en choc septique avec vasoplégie, le pronostic reste plus réservé. La mortalité peut atteindre 30 à 40% selon la sévérité du sepsis et les comorbidités associées [1]. Cependant, les innovations thérapeutiques récentes, notamment l'angiotensine II, améliorent progressivement ces statistiques [2,4].
Les facteurs pronostiques incluent l'âge du patient, la durée de l'hypotension avant traitement, et la réponse aux vasopresseurs. Les patients jeunes sans comorbidités majeures présentent généralement un excellent pronostic [6,9]. À l'inverse, les sujets âgés avec des défaillances multiviscérales nécessitent une prise en charge plus complexe.
Il est important de noter que la plupart des survivants récupèrent complètement leur fonction cardiovasculaire. Les séquelles à long terme restent rares, principalement limitées à une fatigue résiduelle chez certains patients. Cette perspective encourageante doit motiver les équipes soignantes et rassurer les familles durant les phases critiques.
Peut-on Prévenir Vasoplégie ?
La prévention de la vasoplégie repose sur l'identification précoce des patients à risque et l'optimisation de leur prise en charge. Les nouveaux scores de risque développés en 2024-2025 permettent une approche prédictive innovante, particulièrement en chirurgie cardiaque [3]. Ces outils facilitent l'adaptation des protocoles anesthésiques et la préparation des équipes.
En contexte septique, la prévention passe par une prise en charge précoce et agressive de l'infection. L'administration rapide d'antibiotiques appropriés et le contrôle du foyer infectieux réduisent significativement le risque de vasoplégie [1]. Cette approche préventive s'avère plus efficace que les traitements curatifs.
L'optimisation périopératoire joue un rôle crucial en chirurgie. Le maintien de la normothermie, l'équilibre hydro-électrolytique et la limitation de la réponse inflammatoire contribuent à prévenir la vasoplégie post-chirurgicale [5,12]. Ces mesures simples mais essentielles font partie intégrante des protocoles de récupération rapide.
Chez les patients à haut risque, certaines équipes expérimentent des protocoles de prévention pharmacologique. L'administration préventive de faibles doses de vasopresseurs ou de modulateurs inflammatoires montre des résultats prometteurs [2]. Cependant, ces approches restent encore expérimentales et nécessitent des études complémentaires.
Recommandations des Autorités de Santé
Les recommandations HAS 2024-2025 pour la prise en charge du sepsis intègrent désormais des protocoles spécifiques pour la vasoplégie [1]. Ces guidelines soulignent l'importance d'une reconnaissance précoce et d'un traitement adapté, avec des algorithmes décisionnels précis pour les équipes soignantes.
La Société Française d'Anesthésie-Réanimation (SFAR) a également publié des recommandations actualisées concernant l'utilisation des vasopresseurs en périopératoire. Ces textes, basés sur l'étude SQUEEZE et d'autres travaux récents, précisent les indications et modalités d'administration de chaque molécule [5,12].
Au niveau européen, les sociétés savantes convergent vers une approche standardisée de la vasoplégie. L'European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) recommande l'utilisation de scores de risque et l'implémentation de protocoles institutionnels [2,4]. Cette harmonisation améliore la qualité des soins et facilite les échanges entre centres.
Les autorités sanitaires insistent particulièrement sur la formation des équipes soignantes. La reconnaissance des signes précoces de vasoplégie et la maîtrise des traitements spécifiques nécessitent une formation continue [1,6]. Des programmes de simulation et d'enseignement sont développés dans ce sens dans les centres hospitaliers français.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients ayant vécu un épisode de vasoplégie et leurs familles. L'Association Française des Malades du Cœur propose des groupes de parole et des programmes de réadaptation spécialisés. Ces structures offrent un soutien précieux durant la phase de récupération.
La Fédération Française de Cardiologie développe des programmes d'éducation thérapeutique adaptés aux patients ayant subi des complications cardiovasculaires. Ces formations permettent de mieux comprendre sa pathologie et d'adopter les bons réflexes au quotidien. L'approche pédagogique facilite l'appropriation des conseils médicaux.
Au niveau régional, de nombreux centres hospitaliers proposent des consultations de suivi post-réanimation. Ces structures spécialisées prennent en charge les aspects médicaux et psychologiques des séquelles potentielles. L'approche multidisciplinaire intègre cardiologues, psychologues et kinésithérapeutes.
Les plateformes numériques se développent également pour faciliter l'accès à l'information. Des applications mobiles permettent de suivre ses paramètres vitaux et de maintenir le lien avec l'équipe soignante. Ces outils modernes complètent utilement le suivi médical traditionnel, sans jamais le remplacer.
Nos Conseils Pratiques
Si vous ou un proche êtes concernés par la vasoplégie, plusieurs conseils pratiques peuvent faciliter la récupération. Premièrement, respectez scrupuleusement le suivi médical prescrit, même si vous vous sentez mieux. Les contrôles réguliers permettent de détecter précocement d'éventuelles complications [6,9].
Adoptez une hygiène de vie saine avec une alimentation équilibrée et une activité physique progressive. Commencez par de courtes marches quotidiennes, puis augmentez progressivement l'intensité selon vos capacités. Cette approche graduelle évite les surmenages tout en favorisant la récupération cardiovasculaire.
Apprenez à reconnaître les signes d'alerte qui doivent vous amener à consulter rapidement. Une fatigue inhabituelle, des vertiges persistants ou une sensation de malaise général nécessitent un avis médical [15]. N'hésitez jamais à contacter votre médecin en cas de doute, même si cela vous semble bénin.
Maintenez un lien social et n'hésitez pas à parler de votre expérience. L'isolement peut aggraver les séquelles psychologiques et retarder la récupération. Les groupes de patients ou les consultations psychologiques constituent des ressources précieuses pour surmonter cette épreuve. Rappelez-vous que demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation médicale urgente. Une hypotension artérielle persistante, avec des valeurs inférieures à 90 mmHg en systolique, nécessite une évaluation immédiate [15]. Cette situation peut révéler une récidive ou une complication de la vasoplégie initiale.
Les troubles de la conscience, même légers, constituent également un motif de consultation urgent. Confusion, désorientation ou somnolence anormale peuvent témoigner d'une mauvaise perfusion cérébrale [9]. Ces symptômes nécessitent une prise en charge rapide pour éviter des séquelles neurologiques.
Une diminution importante de la production d'urine (moins de 500 ml par 24 heures) doit vous inquiéter. Ce signe peut révéler une atteinte rénale nécessitant un traitement spécialisé [6]. N'attendez pas que la situation s'aggrave pour consulter votre médecin ou vous rendre aux urgences.
Enfin, toute infection, même apparemment bénigne, mérite une attention particulière chez les patients ayant présenté une vasoplégie. Fièvre, frissons ou signes infectieux locaux peuvent déclencher une nouvelle décompensation hémodynamique [1]. Une antibiothérapie précoce peut prévenir l'évolution vers un nouveau choc septique.
Questions Fréquentes
La vasoplégie peut-elle récidiver ?Oui, mais c'est rare. Les récidives surviennent principalement en cas de nouveau sepsis ou d'intervention chirurgicale majeure. Un suivi médical régulier permet de prévenir ces situations [6,9].
Combien de temps dure la récupération ?
La récupération varie selon chaque patient. En moyenne, il faut compter 2 à 6 mois pour retrouver ses capacités antérieures. Les patients jeunes récupèrent généralement plus rapidement [5,6].
Peut-on reprendre une activité sportive ?
Oui, mais progressivement et sous surveillance médicale. Un test d'effort peut être nécessaire pour évaluer vos capacités cardiovasculaires avant la reprise d'activités intenses [9].
Les traitements ont-ils des effets secondaires ?
Les vasopresseurs peuvent provoquer des troubles du rythme cardiaque ou une ischémie des extrémités. Ces effets sont surveillés en permanence en réanimation [12,15].
Faut-il modifier son alimentation ?
Aucun régime spécifique n'est nécessaire, mais une alimentation équilibrée favorise la récupération. Limitez le sel si vous avez des problèmes cardiaques associés.
Questions Fréquentes
La vasoplégie peut-elle récidiver ?
Oui, mais c'est rare. Les récidives surviennent principalement en cas de nouveau sepsis ou d'intervention chirurgicale majeure. Un suivi médical régulier permet de prévenir ces situations.
Combien de temps dure la récupération ?
La récupération varie selon chaque patient. En moyenne, il faut compter 2 à 6 mois pour retrouver ses capacités antérieures. Les patients jeunes récupèrent généralement plus rapidement.
Peut-on reprendre une activité sportive ?
Oui, mais progressivement et sous surveillance médicale. Un test d'effort peut être nécessaire pour évaluer vos capacités cardiovasculaires avant la reprise d'activités intenses.
Les traitements ont-ils des effets secondaires ?
Les vasopresseurs peuvent provoquer des troubles du rythme cardiaque ou une ischémie des extrémités. Ces effets sont surveillés en permanence en réanimation.
Faut-il modifier son alimentation ?
Aucun régime spécifique n'est nécessaire, mais une alimentation équilibrée favorise la récupération. Limitez le sel si vous avez des problèmes cardiaques associés.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Prise en charge du sepsis du nouveau-né, de l'enfant et de l'adulte - HAS 2024-2025Lien
- [2] A Prospective double-blind, randomised controlled trial - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] A Novel Clinical Risk Score to Predict Vasoplegia After cardiac surgery - Innovation 2024-2025Lien
- [4] Association between timing of angiotensin II administration - Innovation 2024-2025Lien
- [5] Utilisation des vasopresseurs en péri-opératoire: étude SQUEEZE - CHRU Nancy 2023Lien
- [6] Actualités dans la prise en charge des patients admis en réanimation pour un arrêt cardiaque - 2024Lien
- [8] Early Cardiovascular Phenotypes in Patients with Acute Respiratory Failure during Covid-19 - 2022Lien
- [9] Nouvelles définitions du choc cardiogénique: bases épidémiologiques - 2023Lien
- [10] Identification précoce des phénotypes cardiovasculaires chez les patients Covid-19 - 2022Lien
- [11] Échocardiographie pour le remplissage vasculaire - Le Praticien en Anesthésie Réanimation 2024Lien
- [12] Utilisation moderne des vasopresseurs au bloc opératoire - 2022Lien
- [13] Physiopathologie et traitement de la vasoplégie au cours du sepsisLien
- [14] Vasoplégie - Encyclopédie médicaleLien
- [15] Choc - Troubles cardiaques et vasculaires - Manuel MSDLien
Publications scientifiques
- Utilisation des vasopresseurs en péri-opératoire: étude multicentrique prospective observationnelle SQUEEZE: analyse des données provenant du CHRU de Nancy (2023)
- Actualités dans la prise en charge des patients admis en réanimation pour un arrêt cardiaque (2024)[PDF]
- [PDF][PDF] Technique d'anesthésie en ventilation spontanée pour tamponnade [PDF]
- Early Cardiovascular Phenotypes in Patients with Acute Respiratory Failure during the Initial Covid-19 Pandemic (2022)
- Nouvelles définitions du choc cardiogénique: bases épidémiologiques, physiopathologiques et pronostiques (2023)
Ressources web
- Physiopathologie et traitement de la vasoplégie au cours ... (revmed.ch)
14 déc. 2011 — Le but du traitement est de restaurer une pression de perfusion tissulaire adéquate, l'objectif recommandé étant une pression artérielle moyenne ...
- Vasoplégie (fr.wikipedia.org)
Le traitement de la vasoplégie vise principalement à restaurer une pression de perfusion tissulaire efficace, l'objectif étant de revenir à une pression arté ...
- Choc - Troubles cardiaques et vasculaires (msdmanuals.com)
Le trouble peut commencer par une léthargie, une somnolence et une confusion. La peau devient froide et moite, et souvent bleuâtre, pâle ou blême.
- etude du syndrome vasoplegique en post (dumas.ccsd.cnrs.fr)
Le syndrome vasoplégique (SV) en post opératoire de chirurgie cardiaque est dû à une insuffisance circulatoire aiguë, définie par la persistance d'une ...
- prise en charge diagnostique et thérapeutique des syncopes (has-sante.fr)
de R PROFESSIONNELLES · 2008 — ▻ Le diagnostic est certain. L'évaluation initiale peut conduire à un diagnostic certain fondé sur les symptômes, les signes cliniques ou les résultats de l'ECG ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
