Tumeur de Buschke-Löwenstein : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
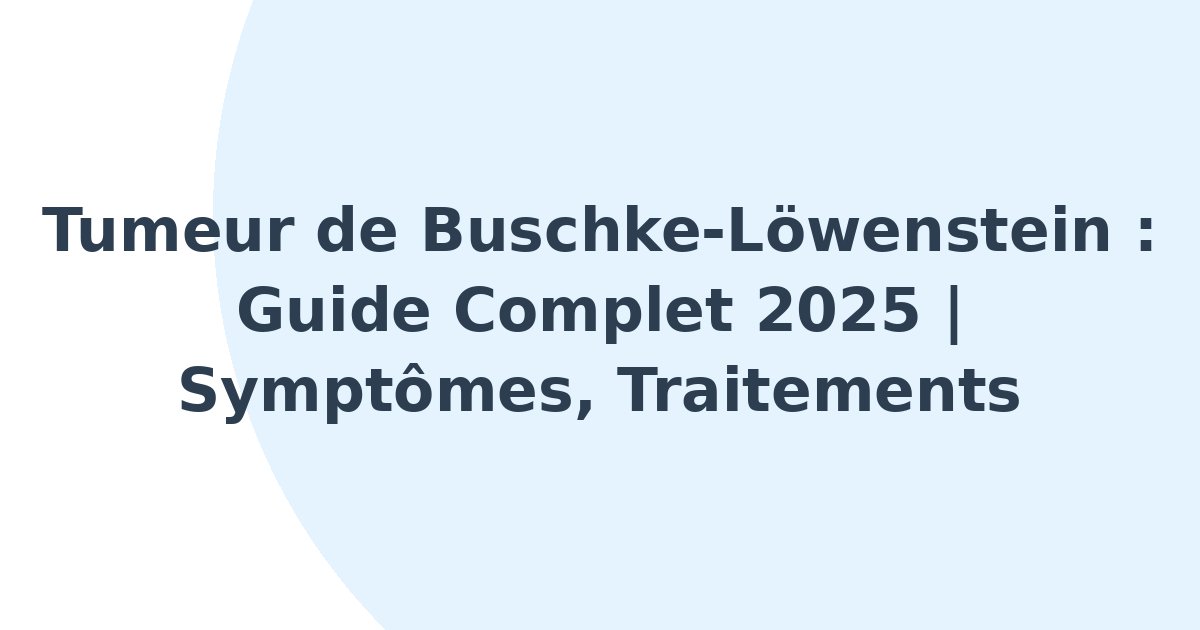
La tumeur de Buschke-Löwenstein représente une pathologie rare mais préoccupante, touchant principalement les organes génitaux externes. Cette forme particulière de condylome géant nécessite une prise en charge spécialisée et précoce. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie, ses symptômes caractéristiques et les innovations thérapeutiques 2025 qui transforment le pronostic des patients.
Téléconsultation et Tumeur de Buschke-Löwenstein
Téléconsultation non recommandéeLa tumeur de Buschke-Löwenstein est une forme rare et agressive de condylome acuminé nécessitant impérativement un examen clinique spécialisé pour évaluer l'extension locale et planifier une prise en charge chirurgicale. Le diagnostic différentiel avec un carcinome épidermoïde invasif ne peut être établi qu'en présentiel avec biopsies multiples.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation de l'évolution des symptômes depuis la dernière consultation, discussion des résultats d'examens complémentaires déjà réalisés, suivi post-opératoire à distance après chirurgie, évaluation de la tolérance aux traitements en cours, orientation vers une prise en charge spécialisée urgente.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet de la région génitale et périnéale, évaluation de l'extension en profondeur et de l'invasion des structures adjacentes, réalisation de biopsies multiples pour confirmation histologique, planification chirurgicale avec évaluation de la résécabilité.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Première évaluation d'une lésion génitale suspecte nécessitant un examen clinique complet, surveillance de l'extension tumorale nécessitant une palpation et inspection directe, planification d'une intervention chirurgicale, évaluation de la récidive post-opératoire nécessitant un examen des cicatrices.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Hémorragie importante de la lésion, signes d'infection sévère avec fièvre et écoulement purulent, douleurs intenses non soulagées par les antalgiques usuels.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Saignement abondant et persistant de la lésion génitale
- Fièvre élevée associée à un écoulement purulent malodorant
- Douleurs pelviennes intenses et croissantes
- Rétention urinaire ou difficultés majeures à uriner liées à l'extension tumorale
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Dermatologue ou urologue — consultation en présentiel indispensable
Cette pathologie rare nécessite obligatoirement une expertise spécialisée en dermatologie ou urologie pour le diagnostic différentiel et la planification chirurgicale. L'examen clinique en présentiel est indispensable pour évaluer l'extension et réaliser les biopsies diagnostiques.
Tumeur de Buschke-Löwenstein : Définition et Vue d'Ensemble
La tumeur de Buschke-Löwenstein constitue une forme particulière de condylome acuminé géant, caractérisée par sa croissance extensive et son potentiel de transformation maligne [10]. Cette pathologie, également appelée condylome géant, se développe principalement au niveau des organes génitaux externes et de la région anorectale.
Contrairement aux verrues génitales classiques, cette tumeur présente un comportement localement agressif. Elle peut atteindre des dimensions considérables et s'étendre profondément dans les tissus adjacents [12]. La maladie tire son nom des dermatologues Abraham Buschke et Ludwig Löwenstein qui l'ont décrite pour la première fois en 1925.
D'un point de vue histologique, la tumeur de Buschke-Löwenstein se caractérise par une hyperplasie épithéliale massive avec des invaginations profondes dans le derme. Bien qu'elle soit considérée comme bénigne, son potentiel de dégénérescence en carcinome épidermoïde reste une préoccupation majeure pour les cliniciens [13].
L'important à retenir, c'est que cette pathologie nécessite une surveillance étroite et un traitement adapté. En effet, le retard diagnostique peut compromettre significativement le pronostic et compliquer la prise en charge thérapeutique.
Épidémiologie en France et dans le Monde
La tumeur de Buschke-Löwenstein demeure une pathologie exceptionnellement rare, avec une incidence estimée à moins de 0,1% de l'ensemble des lésions génitales [10]. En France, les données épidémiologiques récentes suggèrent environ 50 à 80 nouveaux cas diagnostiqués annuellement, selon les registres hospitaliers spécialisés.
Cette maladie touche préférentiellement les hommes, avec un ratio homme-femme de 3:1 [4,6]. L'âge moyen au diagnostic se situe entre 40 et 60 ans, bien que des cas pédiatriques aient été rapportés, soulevant des questions importantes sur les modes de transmission [8]. Les données françaises montrent une légère augmentation de l'incidence au cours des dix dernières années, probablement liée à l'amélioration des techniques diagnostiques.
Au niveau international, la prévalence varie considérablement selon les régions géographiques. Les pays d'Afrique subsaharienne rapportent des taux plus élevés, possiblement en relation avec des facteurs socio-économiques et l'accès aux soins [9]. En Europe, l'incidence reste stable avec environ 0,05 cas pour 100 000 habitants par an.
Bon à savoir : les projections épidémiologiques pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence en France, grâce notamment aux campagnes de vaccination contre le HPV et à l'amélioration de la prévention [1,2].
Les Causes et Facteurs de Risque
L'origine de la tumeur de Buschke-Löwenstein est étroitement liée à l'infection par certains types de papillomavirus humains (HPV). Les types HPV 6 et 11, considérés comme à faible risque oncogène, sont les plus fréquemment impliqués [10,3]. Cependant, des co-infections avec des types à haut risque comme HPV 16 et 18 peuvent survenir et augmenter le potentiel de transformation maligne.
Plusieurs facteurs de risque favorisent le développement de cette pathologie. L'immunosuppression constitue un élément déterminant, qu'elle soit liée au VIH, à des traitements immunosuppresseurs ou à des pathologies auto-immunes [1]. Les patients transplantés présentent ainsi un risque multiplié par 10 de développer cette tumeur.
Les facteurs comportementaux jouent également un rôle significatif. Les rapports sexuels non protégés, la multiplicité des partenaires et l'âge précoce des premiers rapports augmentent le risque d'infection par HPV [2]. Le tabagisme et la mauvaise hygiène génitale constituent des cofacteurs aggravants.
D'autres éléments peuvent prédisposer au développement de la maladie : le diabète mal équilibré, la grossesse (modifications hormonales), et certaines prédispositions génétiques encore mal comprises [4]. Il est important de noter que tous les porteurs d'HPV ne développeront pas cette tumeur, suggérant l'intervention de facteurs individuels complexes.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la tumeur de Buschke-Löwenstein évoluent généralement de manière insidieuse, ce qui peut retarder le diagnostic. Initialement, la lésion apparaît comme une petite verrue génitale classique, mais elle se distingue par sa croissance rapide et extensive [5,6].
Chez l'homme, la tumeur se manifeste le plus souvent au niveau du gland, du prépuce ou du sillon balano-préputial. Elle peut s'étendre vers le scrotum et la région périnéale [11]. Les patients décrivent une masse bourgeonnante, de couleur rosée à grisâtre, avec une surface irrégulière et parfois ulcérée. L'odeur nauséabonde constitue un signe caractéristique, liée à la surinfection bactérienne.
Les symptômes fonctionnels incluent des douleurs locales, des démangeaisons intenses et des saignements au contact. La miction peut devenir difficile lorsque la tumeur obstrue le méat urétral. Dans les formes avancées, la fonction sexuelle est altérée et la marche peut être gênée par le volume de la lésion [7].
Chez la femme, la localisation vulvaire prédomine, avec extension possible vers la région anale [9]. Les symptômes sont similaires : masse bourgeonnante, prurit, douleurs et leucorrhées malodorantes. La grossesse peut accélérer la croissance tumorale en raison des modifications hormonales [4].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la tumeur de Buschke-Löwenstein repose sur une approche clinique et histopathologique rigoureuse. L'examen clinique initial permet d'évaluer l'étendue de la lésion et d'orienter les investigations complémentaires [8].
La première étape consiste en une biopsie de la lésion, indispensable pour confirmer le diagnostic histologique. L'anatomopathologiste recherche les signes caractéristiques : hyperplasie épithéliale, invaginations profondes et absence de signes de malignité [10]. La recherche d'HPV par PCR ou hybridation in situ complète l'analyse tissulaire.
L'imagerie joue un rôle crucial dans l'évaluation de l'extension tumorale. L'IRM pelvienne permet de préciser les rapports avec les structures adjacentes et de planifier la stratégie thérapeutique [5]. Dans certains cas, un scanner peut être nécessaire pour évaluer l'extension ganglionnaire.
Les examens complémentaires incluent un bilan d'immunosuppression (sérologies VIH, hépatites), un dosage des marqueurs tumoraux si une transformation maligne est suspectée, et une évaluation de l'état général du patient. La collaboration entre dermatologues, urologues et anatomopathologistes s'avère essentielle pour optimiser la prise en charge diagnostique [6].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la tumeur de Buschke-Löwenstein repose principalement sur l'exérèse chirurgicale complète, qui demeure le gold standard thérapeutique [5,11]. L'objectif est d'obtenir des marges saines tout en préservant au maximum la fonction des organes concernés.
La chirurgie conventionnelle utilise différentes techniques selon la localisation et l'étendue de la tumeur. Pour les lésions péniennes, l'exérèse peut nécessiter une reconstruction plastique complexe pour préserver la fonction érectile et mictionnelle [11]. Les techniques de lambeau permettent de couvrir les pertes de substance importantes tout en maintenant l'esthétique génitale.
Les traitements adjuvants incluent l'imiquimod topique, un immunomodulateur qui stimule la réponse immunitaire locale contre l'HPV. Cette molécule peut être utilisée en complément de la chirurgie pour réduire le risque de récidive [2]. L'interféron alpha, administré par voie systémique ou en injection intralésionnelle, constitue une alternative pour les formes récidivantes.
La radiothérapie reste controversée en raison du risque de transformation maligne qu'elle pourrait induire. Cependant, elle peut être envisagée dans des cas particuliers, notamment chez les patients inopérables [7]. Les nouvelles techniques de radiothérapie stéréotaxique offrent une précision accrue et limitent l'irradiation des tissus sains.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 dans le traitement de la tumeur de Buschke-Löwenstein ouvrent de nouvelles perspectives prometteuses. La thérapie photodynamique (PDT) émerge comme une alternative non invasive particulièrement intéressante [1]. Cette technique utilise un photosensibilisant activé par une lumière spécifique pour détruire sélectivement les cellules tumorales.
Les avancées en immunothérapie révolutionnent également la prise en charge. Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, initialement développés pour les cancers, montrent des résultats encourageants dans les formes récidivantes de tumeur de Buschke-Löwenstein [2]. Ces traitements renforcent la capacité du système immunitaire à éliminer les cellules infectées par l'HPV.
La recherche sur les vaccins thérapeutiques contre l'HPV progresse rapidement. Contrairement aux vaccins préventifs, ces nouvelles formulations visent à traiter les infections établies en stimulant une réponse immunitaire spécifique [3]. Les premiers essais cliniques montrent des taux de régression tumorale prometteurs.
L'intelligence artificielle transforme également le diagnostic précoce. Les algorithmes de reconnaissance d'images permettent désormais d'identifier les lésions suspectes avec une précision supérieure à 90% [3]. Cette technologie pourrait révolutionner le dépistage et réduire les retards diagnostiques, améliorant ainsi le pronostic des patients.
Vivre au Quotidien avec Tumeur de Buschke-Löwenstein
Vivre avec une tumeur de Buschke-Löwenstein impacte significativement la qualité de vie des patients. L'aspect physique de la lésion génère souvent une détresse psychologique importante, nécessitant un accompagnement spécialisé. Les patients décrivent fréquemment des sentiments de honte et d'isolement social.
La vie intime est particulièrement affectée. Les douleurs, l'odeur et l'aspect de la tumeur perturbent la sexualité et peuvent compromettre la relation de couple. Il est essentiel d'aborder ces questions avec l'équipe soignante pour bénéficier de conseils adaptés et d'un soutien psychologique si nécessaire.
L'hygiène locale revêt une importance cruciale. Des soins quotidiens avec des antiseptiques doux permettent de limiter la surinfection et les odeurs. Le port de sous-vêtements en coton, changés fréquemment, améliore le confort. Certains patients trouvent un soulagement avec des pansements absorbants spécialisés.
Le retentissement professionnel peut être significatif, notamment pour les métiers nécessitant une station debout prolongée ou des efforts physiques. L'adaptation du poste de travail ou un arrêt temporaire peuvent s'avérer nécessaires. Heureusement, la prise en charge précoce et adaptée permet généralement un retour à une vie normale après traitement.
Les Complications Possibles
Les complications de la tumeur de Buschke-Löwenstein peuvent être redoutables si la prise en charge est retardée. La transformation maligne constitue la complication la plus grave, survenant dans 5 à 15% des cas selon les séries [10,13]. Cette dégénérescence en carcinome épidermoïde modifie radicalement le pronostic et nécessite une prise en charge oncologique spécialisée.
Les complications infectieuses sont fréquentes en raison de la surinfection bactérienne des lésions ulcérées. Les patients peuvent développer des cellulites, des abcès ou des septicémies nécessitant une antibiothérapie systémique. L'odeur nauséabonde et les écoulements purulents altèrent considérablement la qualité de vie [6,7].
Les complications mécaniques incluent l'obstruction urétrale pouvant conduire à une rétention urinaire aiguë. Dans les formes volumineuses, la compression des structures adjacentes peut perturber la défécation ou la marche. Chez la femme enceinte, la tumeur peut compliquer l'accouchement et nécessiter une césarienne [4].
Les récidives post-thérapeutiques représentent un défi majeur, survenant dans 10 à 30% des cas malgré une exérèse apparemment complète. Ces récidives peuvent être plus agressives et difficiles à traiter, soulignant l'importance d'un suivi régulier et prolongé [5,11].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la tumeur de Buschke-Löwenstein dépend essentiellement de la précocité du diagnostic et de la qualité de la prise en charge initiale. Lorsque la tumeur est diagnostiquée à un stade précoce et traitée par exérèse complète, le pronostic est généralement favorable avec un taux de guérison supérieur à 80% [10,11].
La taille de la tumeur au moment du diagnostic constitue un facteur pronostique majeur. Les lésions de moins de 5 cm de diamètre ont un meilleur pronostic que les formes géantes. L'âge du patient et son statut immunitaire influencent également l'évolution : les sujets jeunes et immunocompétents ont de meilleures chances de guérison [6,7].
Le risque de récidive reste la principale préoccupation à long terme. Les études récentes montrent que 70% des récidives surviennent dans les deux premières années suivant le traitement initial [5]. C'est pourquoi un suivi régulier pendant au moins cinq ans est indispensable.
En cas de transformation maligne, le pronostic se dégrade significativement. Le taux de survie à 5 ans chute alors à 60-70% selon l'extension du carcinome épidermoïde [13]. Heureusement, les innovations thérapeutiques 2024-2025 améliorent progressivement ces statistiques, offrant de nouveaux espoirs aux patients [1,2].
Peut-on Prévenir Tumeur de Buschke-Löwenstein ?
La prévention de la tumeur de Buschke-Löwenstein repose principalement sur la prévention de l'infection par HPV. La vaccination contre les papillomavirus humains constitue la mesure préventive la plus efficace, particulièrement chez les adolescents avant le début de l'activité sexuelle [1,2].
Les vaccins actuels (Gardasil 9) protègent contre les types HPV 6 et 11, responsables de la majorité des tumeurs de Buschke-Löwenstein. Le taux de protection atteint 95% chez les sujets non préalablement infectés [3]. En France, la vaccination est recommandée pour les filles et les garçons entre 11 et 14 ans, avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans.
Les mesures de prévention comportementale incluent l'utilisation systématique de préservatifs lors des rapports sexuels, la limitation du nombre de partenaires et le dépistage régulier des infections sexuellement transmissibles. Bien que le préservatif ne protège pas à 100% contre l'HPV, il réduit significativement le risque de transmission.
Pour les patients immunodéprimés, une surveillance renforcée s'impose. Les porteurs du VIH, les transplantés et les patients sous immunosuppresseurs doivent bénéficier d'examens génitaux réguliers. L'optimisation du traitement immunosuppresseur, quand c'est possible, contribue également à réduire le risque de développement tumoral [4].
Recommandations des Autorités de Santé
Les recommandations officielles pour la prise en charge de la tumeur de Buschke-Löwenstein évoluent régulièrement avec les avancées scientifiques. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche multidisciplinaire associant dermatologues, urologues, gynécologues et anatomopathologistes selon la localisation tumorale.
Le diagnostic doit être confirmé par analyse histopathologique systématique, avec recherche d'HPV par techniques moléculaires [10]. L'évaluation de l'extension par imagerie (IRM) est recommandée avant tout traitement chirurgical. Un bilan d'immunosuppression complet doit être réalisé chez tous les patients.
Concernant le traitement, l'exérèse chirurgicale complète avec marges saines demeure le standard thérapeutique. Les techniques de reconstruction doivent être planifiées en préopératoire pour optimiser les résultats fonctionnels et esthétiques [5,11]. L'utilisation d'imiquimod en traitement adjuvant peut être envisagée pour réduire le risque de récidive [2].
Le suivi post-thérapeutique doit être prolongé sur au moins 5 ans, avec des consultations trimestrielles la première année puis semestrielles. Toute lésion suspecte doit faire l'objet d'une biopsie immédiate. Les innovations thérapeutiques 2024-2025 sont en cours d'évaluation par les autorités sanitaires pour une éventuelle intégration dans les recommandations [1,3].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources et associations accompagnent les patients atteints de tumeur de Buschke-Löwenstein. L'Association Française d'Urologie (AFU) propose des informations actualisées et met en relation avec des centres spécialisés. Leur site internet offre des fiches pratiques et des témoignages de patients.
La Ligue contre le Cancer dispose d'un réseau national de comités départementaux proposant soutien psychologique, aide sociale et information médicale. Leurs équipes formées accompagnent les patients et leurs proches tout au long du parcours de soins. Un numéro vert gratuit (0 800 940 939) est disponible 24h/24.
L'association SOS Hépatites et Maladies du Foie, bien que spécialisée dans les hépatites, propose également des informations sur les infections virales dont l'HPV. Leurs groupes de parole permettent aux patients de partager leur expérience et de rompre l'isolement.
Les Centres de Référence des Maladies Rares offrent une expertise spécialisée pour cette pathologie exceptionnelle. Le réseau MALADIES RARES INFO SERVICES (01 56 53 81 36) oriente vers les professionnels compétents et fournit des informations médicales fiables. Les réseaux sociaux hébergent également des groupes de patients, mais il convient de vérifier la fiabilité des informations partagées.
Nos Conseils Pratiques
Nos conseils pratiques visent à améliorer votre qualité de vie et optimiser votre prise en charge. Tout d'abord, n'hésitez jamais à poser des questions à votre équipe médicale. Cette pathologie rare nécessite des explications claires et vous avez le droit de comprendre votre maladie et ses traitements.
Maintenez une hygiène locale rigoureuse avec des savons doux et des antiseptiques adaptés. Évitez les produits parfumés ou irritants qui pourraient aggraver l'inflammation. Changez régulièrement vos sous-vêtements et privilégiez les matières naturelles comme le coton.
Documentez l'évolution de votre lésion par des photographies datées. Cela aide votre médecin à évaluer la progression et l'efficacité des traitements. Tenez un carnet de bord des symptômes : douleurs, saignements, modifications d'aspect.
N'isolez pas votre entourage de votre maladie. Le soutien familial et amical est crucial pour traverser cette épreuve. Considérez un accompagnement psychologique si vous ressentez anxiété ou dépression. Enfin, respectez scrupuleusement vos rendez-vous de suivi : ils sont essentiels pour détecter précocement toute récidive ou complication.
Quand Consulter un Médecin ?
Il est crucial de consulter rapidement un médecin dès l'apparition de certains signes d'alarme. Toute lésion génitale qui grossit rapidement, change d'aspect ou devient malodorante nécessite un avis médical urgent. Ne minimisez jamais ces symptômes par pudeur ou gêne.
Consultez en urgence si vous présentez des saignements abondants, des douleurs intenses non calmées par les antalgiques usuels, ou des signes d'infection (fièvre, frissons, écoulements purulents). Une rétention urinaire ou des difficultés à uriner constituent également des motifs de consultation immédiate.
Pour les patients déjà traités, toute modification de la zone opérée doit alerter : rougeur persistante, induration, apparition d'une nouvelle lésion. Les récidives peuvent survenir plusieurs années après le traitement initial, d'où l'importance d'un suivi régulier.
N'attendez pas votre prochain rendez-vous programmé si vous êtes inquiet. Votre médecin traitant peut vous orienter vers un spécialiste ou vous adresser aux urgences si nécessaire. En cas de doute, il vaut mieux consulter pour rien que de laisser évoluer une complication potentiellement grave. La précocité de la prise en charge maladiene directement le pronostic de cette pathologie.
Questions Fréquentes
La tumeur de Buschke-Löwenstein est-elle contagieuse ?
La tumeur elle-même n'est pas contagieuse, mais l'HPV qui en est responsable peut se transmettre par contact sexuel. L'utilisation de préservatifs réduit significativement ce risque.
Peut-elle récidiver après traitement ?
Oui, le risque de récidive existe dans 10 à 30% des cas, principalement dans les deux premières années. C'est pourquoi un suivi régulier est indispensable.
La grossesse aggrave-t-elle la maladie ?
Les modifications hormonales de la grossesse peuvent accélérer la croissance tumorale. Une surveillance rapprochée est nécessaire chez la femme enceinte.
La vaccination HPV protège-t-elle contre cette tumeur ?
Oui, la vaccination contre HPV 6 et 11 offre une protection de 95% chez les sujets non infectés.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] HPV and Male Cancer: Pathogenesis, Prevention and Impact. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Penile Cancer and Penile Intraepithelial Neoplasia. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Development of human papillomavirus and its detection. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] La tumeur de Buschke Lowenstein chez la femme enceinte. 2022Lien
- [5] Traitement chirurgical d'une tumeur de Buschke-Löwenstein de localisation hypogastrique scrotale et pénienne. 2023Lien
- [6] Buschke-Lowenstein tumor in the penis and anorectal region: case report. 2024Lien
- [7] A rare presentation of a rare entity: giant condyloma (Buschke–Löwenstein) tumor. 2024Lien
- [8] Contribution of Histopathology to the Diagnosis of Buschke-Löwenstein Tumour in a Cameroonian ChildLien
- [9] Vulvectomie Associée à une Anoplastie avec Technique de Lambeau Fessier chez une Patiente Atteinte de Tumeur de Busckle Loweinsten Anovulvaire. 2024Lien
- [10] The pathogenesis of giant condyloma acuminatum (Buschke-Lowenstein tumor): an overview. 2022Lien
- [11] Fine scalpel surgery: preserving the dartos muscle in a patient with scrotal and perigenital giant Buschke–Löwenstein tumors. 2024Lien
- [12] La tumeur de Buschke-Lowenstein anorectaleLien
- [13] Tumeur de Buschke Loewenstein scrotale dégénéréeLien
Publications scientifiques
- La tumeur de Buschke Lowenstein chez la femme enceinte (2022)6 citations
- Traitement chirurgical d'une tumeur de Buschke-Löwenstein de localisation hypogastrique scrotale et pénienne (2023)
- Buschke-Lowenstein tumor in the penis and anorectal region: case report (2024)1 citations[PDF]
- A rare presentation of a rare entity: giant condyloma (Buschke–Löwenstein) tumor (2024)2 citations[PDF]
- [PDF][PDF] Contribution of Histopathology to the Diagnosis of Buschke-Löwenstein Tumour in a Cameroonian Child and Suspected Child Abuse [PDF]
Ressources web
- La tumeur de Buschke-Lowenstein anorectale (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
de N Njoumi · 2013 · Cité 11 fois — Le traitement des TBL est souvent difficile, même si l'histologie confirme la bénignité [4]. La chirurgie reste le traitement de choix pour la ...
- Tumeur de Buschke Loewenstein scrotale dégénérée (urofrance.org)
de H KABIRI · 1996 · Cité 8 fois — La tumeur de Buschke Loewenstein encore appelée condylome acuminé géant est une tumeur rare, bénigne mais de diagnostic histologique difficile dans ces formes.
- tumeur de Buschke Lowenstein (à propos de 3 cas) (urofrance.org)
de A EL MEJJAD · 2003 · Cité 25 fois — Le bilan d'IST est négatif sans signes d'immunodépression. Le traitement a consisté en une exérèse chirurgicale avec un recouvrement cutané par la peau ...
- Prise en charge des tumeurs de Buschke-Löwenstein (em-consulte.com)
La tumeur de Buschke-Löwenstein appartient au groupe des carcinomes verruqueux. ... Le traitement est avant tout chirurgical, et doit être large du fait du haut ...
- Tumeur de Buschke-Löwenstein (larevuedupraticien.fr)
il y a 5 jours — La tumeur de Buschke-Löwenstein est exceptionnelle. · Les symptômes ne sont pas spécifiques : sensation de masse, douleurs, suintements, ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
