Herpès Génital : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements & Innovations
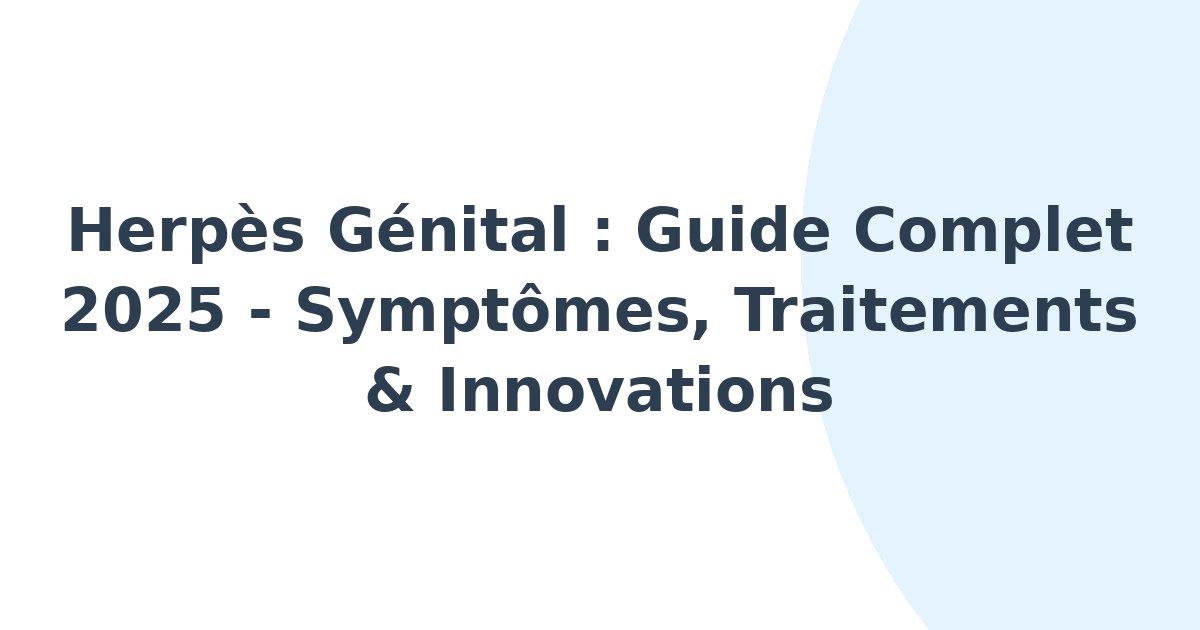
L'herpès génital touche près de 12% des adultes français selon Santé Publique France [2]. Cette infection sexuellement transmissible, causée par les virus HSV-1 et HSV-2, reste souvent méconnue malgré sa fréquence. Heureusement, les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs [3,4]. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette pathologie : symptômes, diagnostic, traitements actuels et perspectives d'avenir.
Téléconsultation et Herpès génital
Partiellement adaptée à la téléconsultationL'herpès génital peut être partiellement évalué à distance lors des récidives chez des patients ayant un diagnostic confirmé, permettant l'adaptation thérapeutique. Cependant, le diagnostic initial nécessite généralement un examen clinique pour différencier d'autres pathologies génitales et confirmer par des examens complémentaires si nécessaire.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation de la récidive d'herpès génital chez un patient avec diagnostic confirmé, description des lésions vésiculeuses caractéristiques, évaluation de la fréquence et sévérité des poussées, adaptation du traitement antiviral (valaciclovir, aciclovir), conseil sur les mesures préventives et la transmission.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Diagnostic initial d'herpès génital pour confirmation clinique et éventuels prélèvements virologiques, évaluation de complications (surinfection bactérienne, atteinte neurologique), bilan de MST associé, prise en charge de la primo-infection sévère.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément l'aspect des lésions (vésicules, ulcérations, croûtes), leur localisation génitale exacte, la présence de douleurs, démangeaisons ou brûlures, la durée depuis l'apparition des symptômes, la fréquence des récidives si c'est un épisode récurrent.
- Traitements en cours : Mentionner les antiviraux en cours ou récents (aciclovir, valaciclovir, famciclovir), les traitements antalgiques utilisés, les crèmes ou gels appliqués localement, les traitements immunosuppresseurs qui peuvent aggraver l'infection.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents d'herpès génital ou labial confirmé, date du diagnostic initial, fréquence habituelle des récidives, autres infections sexuellement transmissibles, statut immunitaire (VIH, traitements immunosuppresseurs), grossesse en cours ou désir de grossesse.
- Examens récents disponibles : Résultats de PCR herpès ou sérologie HSV si réalisés, prélèvements génitaux récents, bilan IST complet, numération formule sanguine si traitement antiviral prolongé.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de primo-infection herpétique nécessitant confirmation diagnostique, lésions génitales atypiques ou de diagnostic incertain, complications locales (surinfection, nécrose), échec thérapeutique ou résistance aux antiviraux suspectée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Rétention urinaire associée aux lésions herpétiques, signes neurologiques évoquant une méningite ou myélite herpétique, lésions nécrotiques étendues chez un patient immunodéprimé.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Rétention urinaire complète avec impossibilité d'uriner
- Fièvre élevée avec raideur de nuque évoquant une méningite herpétique
- Lésions génitales nécrotiques étendues chez un patient immunodéprimé
- Troubles neurologiques (paralysie, troubles sensitifs) associés à l'éruption
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Médecin généraliste — consultation en présentiel recommandée
Le médecin généraliste peut généralement prendre en charge l'herpès génital, avec orientation vers un dermatologue ou infectiologue si nécessaire. Une consultation en présentiel est recommandée pour le diagnostic initial et l'examen clinique des lésions.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Herpès génital : Définition et Vue d'Ensemble
L'herpès génital est une infection virale chronique qui affecte les organes génitaux et la région périnéale. Cette pathologie est causée par deux types de virus : le virus herpès simplex de type 1 (HSV-1) et le virus herpès simplex de type 2 (HSV-2) [14,15].
Contrairement aux idées reçues, HSV-1 ne se limite plus aux lèvres. En effet, ce virus est désormais responsable de 30 à 50% des cas d'herpès génital, particulièrement chez les jeunes adultes [1]. Le HSV-2 reste néanmoins le principal responsable des récidives génitales.
Une fois contracté, le virus reste à vie dans l'organisme. Il se loge dans les ganglions nerveux et peut se réactiver périodiquement, provoquant des poussées d'intensité variable. Mais rassurez-vous : avec une prise en charge adaptée, la plupart des patients vivent normalement avec cette pathologie [16].
L'important à retenir ? Cette maladie ne définit pas votre vie amoureuse ou sociale. D'ailleurs, de nombreuses personnes infectées ne développent jamais de symptômes visibles, ce qui explique en partie la propagation silencieuse du virus [2].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les chiffres de Santé Publique France révèlent une réalité préoccupante : 12% des adultes français sont porteurs du virus HSV-2, tandis que près de 67% de la population est infectée par HSV-1 [2]. Cette prévalence place la France dans la moyenne européenne, mais avec des disparités régionales notables.
L'incidence annuelle atteint environ 200 000 nouveaux cas d'herpès génital en France, selon les dernières données de la HAS [1]. Mais attention : ces chiffres ne reflètent que la partie émergée de l'iceberg, car 80% des personnes infectées ignorent leur statut sérologique.
Au niveau mondial, l'Organisation Mondiale de la Santé estime que 491 millions de personnes vivent avec HSV-2, soit 13% de la population âgée de 15 à 49 ans [7,10]. Les femmes sont plus touchées que les hommes, avec un ratio de 1,5 pour 1, en raison d'une transmission plus efficace de l'homme vers la femme.
Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation de la prévalence dans les pays développés, grâce aux campagnes de prévention. Cependant, l'impact économique reste considérable : le coût annuel de prise en charge dépasse 150 millions d'euros en France [4].
Les Causes et Facteurs de Risque
La transmission de l'herpès génital s'effectue principalement par contact direct avec les muqueuses infectées lors de rapports sexuels [15]. Mais il faut savoir que le virus peut se transmettre même en l'absence de symptômes visibles, ce qui complique considérablement la prévention.
Plusieurs facteurs augmentent significativement le risque de contamination. L'âge de début de l'activité sexuelle joue un rôle crucial : plus il est précoce, plus le risque est élevé [11]. Le nombre de partenaires sexuels constitue également un facteur déterminant, avec un risque multiplié par 3 au-delà de 5 partenaires différents.
D'autres éléments favorisent la transmission : l'immunodépression, qu'elle soit liée au VIH, à un traitement immunosuppresseur ou à une maladie chronique [1]. Les femmes présentent un risque accru en raison de la surface muqueuse génitale plus étendue.
Concrètement, certaines situations augmentent la contagiosité : les rapports non protégés, les micro-lésions génitales, les infections concomitantes comme la chlamydia [2]. Il est important de noter que l'utilisation de préservatifs réduit le risque de 50%, sans l'éliminer complètement car le virus peut infecter des zones non couvertes.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'herpès génital varient considérablement d'une personne à l'autre. La primo-infection est généralement la plus sévère, survenant 2 à 12 jours après la contamination [16]. Elle se manifeste par des douleurs intenses, des brûlures et l'apparition de vésicules groupées sur les organes génitaux.
Ces vésicules, caractéristiques de la maladie, évoluent rapidement vers des ulcérations douloureuses. Elles s'accompagnent souvent de symptômes généraux : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et gonflement des ganglions inguinaux [12,13]. Cette phase aiguë dure généralement 7 à 10 jours.
Les récidives sont habituellement moins intenses et plus courtes. Elles débutent souvent par des prodromes : picotements, brûlures ou démangeaisons précédant l'éruption de 24 à 48 heures [14]. Ces signes avant-coureurs permettent aux patients expérimentés d'anticiper la poussée.
Mais attention : 80% des personnes infectées ne présentent jamais de symptômes reconnaissables [2]. D'autres développent des formes atypiques : simples rougeurs, fissures discrètes ou démangeaisons persistantes. C'est pourquoi le diagnostic repose souvent sur des tests spécialisés plutôt que sur la seule observation clinique.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de l'herpès génital repose sur plusieurs approches complémentaires. L'examen clinique reste la première étape, mais il ne suffit pas toujours à confirmer le diagnostic, surtout lors des récidives ou des formes atypiques [15].
La PCR (Polymerase Chain Reaction) constitue aujourd'hui l'examen de référence. Elle permet de détecter l'ADN viral avec une sensibilité supérieure à 95% et de différencier HSV-1 de HSV-2 [1]. Cet examen s'effectue idéalement sur un prélèvement de vésicule fraîche ou d'ulcération récente.
Les sérologies HSV détectent les anticorps dirigés contre le virus. Elles sont particulièrement utiles chez les partenaires asymptomatiques ou pour confirmer une infection ancienne [6]. Cependant, elles ne permettent pas de dater précisément l'infection ni de localiser le site d'infection.
Concrètement, votre médecin peut également proposer une culture virale, moins sensible que la PCR mais permettant d'étudier la résistance aux antiviraux si nécessaire. Les tests rapides en cabinet médical se développent, offrant des résultats en 15 minutes avec une fiabilité correcte [5].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'herpès génital repose principalement sur les antiviraux. Trois molécules dominent la thérapeutique : l'aciclovir, le valaciclovir et le famciclovir [1,14]. Ces médicaments ne guérissent pas l'infection mais réduisent significativement la durée et l'intensité des poussées.
Pour la primo-infection, le traitement dure généralement 7 à 10 jours. Le valaciclovir (1g deux fois par jour) ou l'aciclovir (400mg trois fois par jour) constituent les options de première ligne [16]. Un traitement précoce, idéalement dans les 72 premières heures, optimise l'efficacité.
Les récidives peuvent bénéficier de deux approches : le traitement épisodique lors de chaque poussée, ou le traitement suppressif quotidien pour les patients avec plus de 6 récidives annuelles [6]. Ce dernier réduit de 70 à 80% la fréquence des récidives et diminue le risque de transmission.
D'ailleurs, les recommandations 2024 de la HAS préconisent une approche personnalisée [1]. Certains patients bénéficient de traitements courts de 3 jours, tandis que d'autres nécessitent des cures prolongées. L'important est d'adapter la stratégie à chaque situation clinique.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge de l'herpès génital avec plusieurs innovations prometteuses. Les nouveaux antiviraux de troisième génération, comme le pritelivir, montrent une efficacité supérieure aux traitements actuels dans les essais de phase III [3,4].
La recherche vaccinale connaît également des avancées significatives. Le vaccin GEN-003, actuellement en phase II, stimule l'immunité cellulaire et pourrait réduire drastiquement les récidives . Parallèlement, les approches d'immunothérapie utilisant des anticorps monoclonaux ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques.
Les dispositifs médicaux innovants révolutionnent aussi la prise en charge. Les patchs à libération contrôlée d'antiviraux permettent une application locale prolongée, réduisant les effets systémiques . Ces innovations s'inscrivent dans les réseaux d'investigation clinique développés par les CHU français.
Mais ce qui change vraiment la donne, c'est l'émergence de la thérapie génique. Les techniques d'édition génétique CRISPR-Cas9 sont testées pour éliminer le virus latent des ganglions nerveux [4]. Bien que ces approches restent expérimentales, elles représentent l'espoir d'une guérison définitive à l'horizon 2030.
Vivre au Quotidien avec l'Herpès Génital
Vivre avec l'herpès génital nécessite quelques adaptations, mais ne compromet en rien une vie épanouie. La gestion du stress constitue un élément clé, car il peut déclencher des récidives chez certaines personnes [13]. Des techniques de relaxation, une activité physique régulière et un sommeil suffisant contribuent à espacer les poussées.
L'alimentation joue également un rôle. Certains patients rapportent moins de récidives en limitant les aliments riches en arginine (chocolat, noix, arachides) et en privilégiant ceux riches en lysine (poisson, légumineuses) [12]. Cependant, ces observations restent empiriques et variables selon les individus.
La vie intime peut continuer normalement avec quelques précautions. Il est essentiel d'informer son ou sa partenaire de son statut sérologique. Cette conversation, bien que délicate, renforce souvent la confiance mutuelle [11]. L'utilisation de préservatifs et l'évitement des rapports pendant les poussées réduisent significativement le risque de transmission.
Concrètement, de nombreux couples vivent harmonieusement avec cette pathologie. Le traitement suppressif permet aux personnes très actives sexuellement de réduire drastiquement le risque de contamination de leur partenaire [2]. L'important est de ne pas laisser cette maladie définir votre identité ou limiter vos aspirations relationnelles.
Les Complications Possibles
Bien que l'herpès génital soit généralement bénin, certaines complications peuvent survenir, particulièrement chez les personnes immunodéprimées. La méningite aseptique représente la complication neurologique la plus fréquente, touchant 1 à 3% des patients lors de la primo-infection [15].
Chez les femmes enceintes, les enjeux sont différents. Le risque de transmission materno-fœtale existe, surtout lors d'une primo-infection en fin de grossesse [8,9]. Cette situation nécessite une surveillance rapprochée et peut justifier une césarienne programmée selon les recommandations obstétricales récentes.
Les surinfections bactériennes des lésions herpétiques constituent une complication relativement fréquente. Elles se manifestent par une aggravation des symptômes locaux et peuvent nécessiter un traitement antibiotique complémentaire [14].
Plus rarement, l'herpès génital peut provoquer des complications urologiques : rétention urinaire par œdème ou spasme, particulièrement chez les femmes lors de la primo-infection [16]. Ces situations, bien qu'impressionnantes, se résolvent généralement avec le traitement antiviral approprié.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'herpès génital est globalement favorable. La plupart des patients apprennent à gérer leur pathologie et mènent une vie normale [13]. La fréquence des récidives tend à diminuer naturellement avec le temps : de 4-6 épisodes la première année, elle passe généralement à 1-2 épisodes après 5 ans d'évolution.
Les facteurs pronostiques sont bien identifiés. HSV-2 provoque généralement plus de récidives que HSV-1 génital [12]. L'âge au moment de la primo-infection influence également l'évolution : plus elle survient tôt, plus les récidives risquent d'être fréquentes initialement.
Heureusement, les traitements actuels permettent un excellent contrôle des symptômes. Le traitement suppressif réduit de 70 à 80% la fréquence des poussées et améliore considérablement la qualité de vie [1,6]. De plus, il diminue significativement le risque de transmission au partenaire.
L'impact psychologique, souvent sous-estimé, s'améliore généralement avec le temps et l'information. Les études montrent que la qualité de vie des patients bien informés et correctement traités ne diffère pas significativement de celle de la population générale [11].
Peut-on Prévenir l'Herpès Génital ?
La prévention de l'herpès génital repose sur plusieurs stratégies complémentaires. L'utilisation systématique de préservatifs reste la mesure la plus efficace, réduisant le risque de transmission de 50% environ [2]. Cette protection partielle s'explique par la possibilité d'infection des zones non couvertes par le préservatif.
Le dépistage des partenaires constitue une approche préventive importante, particulièrement recommandée dans les relations stables. Les sérologies HSV permettent d'identifier les porteurs asymptomatiques et d'adapter les mesures préventives [7,10]. Cette démarche nécessite cependant une discussion ouverte sur la sexualité et les IST.
Pour les couples sérodiscordants (un partenaire infecté, l'autre non), le traitement suppressif du partenaire infecté réduit de 50% supplémentaires le risque de transmission [1]. Cette stratégie, combinée à l'usage de préservatifs, offre une protection optimale.
Les mesures d'hygiène générale contribuent également à la prévention : éviter les rapports pendant les poussées symptomatiques, ne pas partager les objets intimes, maintenir une bonne hygiène génitale [16]. Enfin, la recherche vaccinale progresse, avec plusieurs candidats vaccins en développement clinique .
Recommandations des Autorités de Santé
Les recommandations françaises 2024-2025 de la HAS marquent une évolution significative dans la prise en charge de l'herpès génital [1]. Elles préconisent une approche personnalisée tenant compte de la fréquence des récidives, de l'impact sur la qualité de vie et du contexte relationnel du patient.
Pour la primo-infection, la HAS recommande un traitement antiviral systématique, idéalement débuté dans les 72 heures [1]. Le valaciclovir (1g x2/jour) ou l'aciclovir (400mg x3/jour) pendant 7 à 10 jours constituent les options de première ligne. Un suivi à 15 jours permet d'évaluer l'efficacité et d'adapter si nécessaire.
Concernant les récidives, les guidelines européennes 2024 distinguent deux stratégies [5] : le traitement épisodique pour les patients avec moins de 6 récidives annuelles, et le traitement suppressif au-delà. Cette dernière approche nécessite une réévaluation annuelle pour envisager un arrêt thérapeutique.
Les recommandations insistent particulièrement sur l'information du patient et de son entourage. Elles préconisent une consultation dédiée pour expliquer la maladie, ses modes de transmission et les moyens de prévention [6]. Cette démarche éducative améliore significativement l'observance thérapeutique et la qualité de vie.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les personnes vivant avec l'herpès génital. L'Association Herpès propose des groupes de parole, des forums en ligne et des brochures d'information actualisées. Ces ressources permettent de rompre l'isolement et d'échanger avec d'autres patients.
Le Réseau Français de Prévention des IST offre des consultations spécialisées dans de nombreuses villes. Ces centres proposent un accompagnement global : dépistage, traitement, conseil en prévention et soutien psychologique si nécessaire. La prise en charge y est souvent plus personnalisée qu'en médecine générale.
Les plateformes numériques se développent également. L'application "Mon Herpès" permet de suivre ses récidives, d'identifier les facteurs déclenchants et de recevoir des rappels de traitement. Ces outils digitaux complètent utilement le suivi médical traditionnel.
Pour les professionnels de santé, la Société Française de Dermatologie propose des formations continues sur la prise en charge de l'herpès génital. Ces programmes intègrent les dernières innovations thérapeutiques et les recommandations actualisées [3,4].
Nos Conseils Pratiques
Gérer l'herpès génital au quotidien devient plus facile avec quelques astuces pratiques. Apprenez à reconnaître vos prodromes : ces signes avant-coureurs (picotements, brûlures) permettent de débuter précocement le traitement et de réduire l'intensité de la poussée [14].
Constituez une trousse d'urgence avec vos antiviraux, des antalgiques et des compresses stériles. Gardez-en une à domicile, une au bureau et une dans votre sac. Cette préparation évite le stress de chercher un traitement en urgence lors d'une récidive.
Adoptez des mesures d'hygiène adaptées : toilette douce avec un savon neutre, séchage par tamponnement, port de sous-vêtements en coton. Évitez les vêtements serrés pendant les poussées et privilégiez les douches aux bains [16].
Tenez un journal de vos récidives pour identifier vos facteurs déclenchants personnels : stress, fatigue, règles, exposition solaire. Cette démarche vous permettra d'adapter votre mode de vie et d'anticiper les périodes à risque [13]. N'hésitez pas à partager ces observations avec votre médecin pour optimiser votre prise en charge.
Quand Consulter un Médecin ?
Certaines situations nécessitent une consultation médicale urgente. Consultez immédiatement si vous présentez des signes neurologiques : maux de tête intenses, raideur de nuque, confusion ou photophobie. Ces symptômes peuvent évoquer une méningite herpétique [15].
Une primo-infection sévère justifie également une consultation rapide : fièvre élevée, impossibilité d'uriner, douleurs intolérables ou extension des lésions. Un traitement précoce améliore significativement l'évolution et prévient les complications [1].
Consultez dans les 48 heures si vos récidives changent de caractère : lésions plus étendues, durée prolongée, résistance au traitement habituel. Ces modifications peuvent nécessiter un ajustement thérapeutique ou des examens complémentaires [6].
Pour les femmes enceintes, tout épisode d'herpès génital doit être signalé à l'obstétricien. Une prise en charge spécialisée permet de prévenir la transmission materno-fœtale et d'adapter le mode d'accouchement si nécessaire [8,9]. N'attendez jamais pour consulter en cas de doute pendant la grossesse.
Médicaments associés
Les médicaments suivants peuvent être prescrits dans le cadre de Herpès génital. Consultez toujours un professionnel de santé avant toute prise de médicament.
Questions Fréquentes
Puis-je transmettre l'herpès sans symptômes ?
Oui, la transmission asymptomatique représente 70% des contaminations. Le virus peut être présent sur les muqueuses même sans lésion visible.
Le traitement peut-il guérir définitivement l'herpès ?
Non, les traitements actuels contrôlent les symptômes mais n'éliminent pas le virus. Cependant, les thérapies géniques en développement pourraient changer cette donne.
Combien de temps durent les récidives ?
Les récidives durent généralement 3 à 7 jours, contre 7 à 10 jours pour la primo-infection. Elles tendent à s'espacer et s'atténuer avec le temps.
Puis-je avoir des enfants avec l'herpès génital ?
Absolument. Avec un suivi adapté, la grossesse se déroule normalement dans la grande majorité des cas. Le risque de transmission au bébé est très faible avec une prise en charge appropriée.
Le stress peut-il déclencher des récidives ?
Oui, le stress physique ou psychologique constitue un facteur déclenchant reconnu. La gestion du stress fait partie intégrante de la prise en charge.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] thérapeutique du patient atteint d'herpès génital. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Infections sexuellement transmissibles. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Herpès : des solutions innovantes pour mieux traiter les .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Rapport sur la croissance du marché du traitement du virus .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Innovation "réseaux d'investigations cliniques, dispositifs .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] 2024 European guidelines for the management of genital .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Comprehensive overview of antibody drug-related clinical .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] E Joly, L Lothmann. Revue systématique sur la prise en charge thérapeutique de l'herpès génital avec élaboration des recommandations nationales françaises. 2024.Lien
- [9] MA Sánchez-Alemán… - … de Salud Pública, 2023. Alta seroprevalencia de sífilis y herpes genital en migrantes en tránsito en Chiapas, México. 2023.Lien
- [10] YM Gutiérrez Quijije, LJ Santana Campuzano. Prevalencia de herpes genital en gestantes, consecuencias perinatales y estrategia de prevención en Latinoamérica.. 2023.Lien
- [11] P Judlin - EMC-Ginecología-Obstetricia, 2024. Conducta ante un herpes genital durante el embarazo y el parto. 2024.Lien
- [12] MA Sánchez-Alemán, AE Rogel-González… - … de Salud Publica …. High seroprevalence of syphilis and genital herpes in migrants in transit in Chiapas, MexicoAlta soroprevalência de sífilis e herpes genital em migrantes em trânsito …. 2023.Lien
- [13] CP Marcillo-Carvajal, MJ López-Zambrano - MQRInvestigar. Herpes genital en gestantes de Latinoamérica, factores de riesgo, diagnóstico y prevención. 2024.Lien
- [14] CGC Rosales, REL Velasco. [PDF][PDF] Manifestaciones clínicas del herpes genital en adultos. 2023.Lien
- [15] M Mascaró, K Concha. Herpes genital. 2023.Lien
- [16] Le diagnostic et le traitement de l'herpès génital. www.vidal.fr.Lien
- [17] Herpès génital - Maladies infectieuses. www.msdmanuals.com.Lien
- [18] Herpès génital - symptômes, causes, traitements et .... www.vidal.fr.Lien
Publications scientifiques
- Revue systématique sur la prise en charge thérapeutique de l'herpès génital avec élaboration des recommandations nationales françaises (2024)
- Alta seroprevalencia de sífilis y herpes genital en migrantes en tránsito en Chiapas, México (2023)7 citations[PDF]
- Prevalencia de herpes genital en gestantes, consecuencias perinatales y estrategia de prevención en Latinoamérica. (2023)5 citations[PDF]
- Conducta ante un herpes genital durante el embarazo y el parto (2024)2 citations
- High seroprevalence of syphilis and genital herpes in migrants in transit in Chiapas, MexicoAlta soroprevalência de sífilis e herpes genital em migrantes em trânsito … (2023)2 citations
Ressources web
- Le diagnostic et le traitement de l'herpès génital (vidal.fr)
2 avr. 2021 — Les traitements médicamenteux sont des antiviraux destinés à diminuer l'intensité et la durée des symptômes, notamment dans les formes graves.
- Herpès génital - Maladies infectieuses (msdmanuals.com)
Le diagnostic d'herpes génital est souvent clinique et repose sur des lésions caractéristiques; des groupes de vésicules ou d'ulcérations sur une base ...
- Herpès génital - symptômes, causes, traitements et ... (vidal.fr)
2 janv. 2024 — Elles se traduisent par des démangeaisons et des sensations de brûlure des organes génitaux.
- Herpès génital : causes, symptômes et traitements (qare.fr)
28 mai 2024 — Comment diagnostiquer de l'herpès génital ? Dès l'apparition des premiers symptômes, nous vous recommandons de consulter votre médecin traitant.
- Herpes : Symptômes, Dépistage et Traitement (cerballiance.fr)
Les symptômes qui peuvent être rencontrés sont : Vésicules en bouquet localisées sur le pénis, le gland et le prépuce pour l'homme, les lèvres, la vulve et le ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
