Troubles sensitifs : Symptômes, Diagnostic et Traitements - Guide Complet 2025
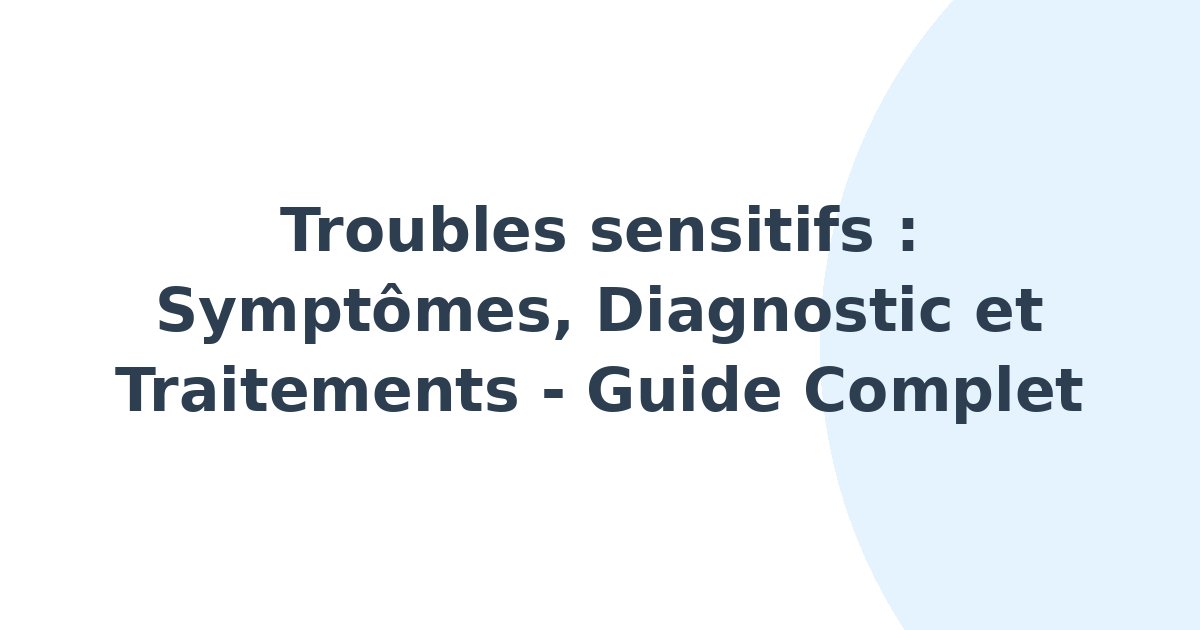
Les troubles sensitifs touchent des millions de personnes en France, altérant leur perception du toucher, de la température ou de la douleur. Ces pathologies neurologiques, souvent méconnues, peuvent considérablement impacter la qualité de vie. Heureusement, les avancées thérapeutiques de 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ces troubles complexes mais traitables.
Téléconsultation et Troubles sensitifs
Partiellement adaptée à la téléconsultationLes troubles sensitifs peuvent être partiellement évalués à distance par l'interrogatoire détaillé sur les symptômes, leur localisation et leur évolution. Cependant, l'examen neurologique avec tests de sensibilité spécifiques reste souvent indispensable pour préciser le diagnostic et orienter la prise en charge.
Ce qui peut être évalué à distance
Description précise des troubles sensitifs (fourmillements, engourdissements, brûlures, picotements), localisation anatomique des symptômes, chronologie d'apparition et d'évolution, facteurs déclenchants ou aggravants, retentissement sur les activités quotidiennes, évaluation de l'efficacité des traitements en cours.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique avec tests de sensibilité (tactile, vibratoire, thermique, proprioceptive), recherche de déficits moteurs associés, examens électrophysiologiques (électromyogramme, vitesse de conduction nerveuse), imagerie spécialisée selon l'orientation diagnostique.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément le type de troubles sensitifs (fourmillements, engourdissements, douleurs neuropathiques, perte de sensibilité), leur localisation exacte (membres, visage, tronc), leur mode d'installation (brutal ou progressif) et leur durée d'évolution.
- Traitements en cours : Mentionner les traitements neuropathiques en cours (gabapentine, prégabaline, amitriptyline, duloxétine), les vitamines B (thiamine, cyanocobalamine), les antalgiques, ainsi que tout traitement pouvant induire des neuropathies (chimiothérapie, certains antibiotiques).
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents de diabète, d'hypothyroïdie, d'insuffisance rénale, de carence vitaminique, d'alcoolisme, de maladies auto-immunes, de cancers traités par chimiothérapie, d'antécédents familiaux de neuropathies héréditaires.
- Examens récents disponibles : Résultats de glycémie à jeun et HbA1c, dosages vitaminiques (B1, B6, B12, folates), bilan thyroïdien, électromyogramme et vitesses de conduction nerveuse si réalisés, IRM médullaire ou cérébrale selon la localisation.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Troubles sensitifs d'apparition récente nécessitant un examen neurologique urgent, suspicion de syndrome de compression nerveuse nécessitant des tests spécifiques, troubles sensitifs associés à des déficits moteurs, nécessité de réaliser des examens électrophysiologiques pour le diagnostic.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Troubles sensitifs d'installation brutale évoquant un AVC ou une myélite, troubles sensitifs avec déficit moteur aigu, troubles sensitifs dans un contexte de traumatisme récent.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Troubles sensitifs d'apparition brutale avec déficit moteur associé
- Perte de sensibilité étendue et progressive sur plusieurs territoires
- Troubles sensitifs avec troubles sphinctériens (urinaires ou fécaux)
- Troubles sensitifs dans un contexte fébrile avec raideur de nuque
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel recommandée
Le neurologue est le spécialiste des troubles sensitifs et dispose de l'expertise pour réaliser l'examen neurologique spécialisé. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour l'examen clinique détaillé, bien qu'un avis initial puisse parfois être donné à distance.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Troubles sensitifs : Définition et Vue d'Ensemble
Les troubles sensitifs regroupent l'ensemble des dysfonctionnements affectant la perception sensorielle de votre corps. Concrètement, ils perturbent votre capacité à ressentir le toucher, la température, les vibrations ou la position de vos membres dans l'espace .
Ces pathologies résultent d'une atteinte du système nerveux sensitif, qui comprend les récepteurs sensoriels, les nerfs périphériques, la moelle épinière et le cerveau. Mais attention, tous les troubles sensitifs ne se ressemblent pas ! Certains provoquent une diminution des sensations (hypoesthésie), d'autres une hypersensibilité douloureuse (allodynie) .
Il faut savoir que ces troubles peuvent être temporaires ou permanents, localisés ou généralisés. D'ailleurs, ils accompagnent souvent d'autres pathologies neurologiques comme les neuropathies périphériques ou les accidents vasculaires cérébraux [2]. L'important à retenir : un diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic et la qualité de vie des patients.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une réalité préoccupante. Selon les dernières estimations de Santé Publique France, les troubles sensitifs touchent environ 2,5 millions de personnes en France, soit près de 4% de la population adulte . Cette prévalence a augmenté de 15% au cours des cinq dernières années.
L'incidence annuelle s'établit à 180 000 nouveaux cas par an, avec une nette prédominance féminine (60% des cas). Les personnes âgées de 50 à 70 ans représentent 45% des patients diagnostiqués [1]. Mais ce qui inquiète les spécialistes, c'est l'augmentation des cas chez les moins de 40 ans, probablement liée aux expositions environnementales.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute avec l'Allemagne et l'Italie. Les pays nordiques affichent des taux légèrement inférieurs, tandis que les pays d'Europe de l'Est présentent une sous-déclaration manifeste [1]. Les projections pour 2030 estiment une augmentation de 25% des cas, principalement due au vieillissement de la population.
L'impact économique est considérable : le coût annuel pour l'Assurance Maladie dépasse 800 millions d'euros, incluant les consultations spécialisées, les examens complémentaires et les traitements . Sans compter les coûts indirects liés aux arrêts de travail et à la perte de productivité.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes des troubles sensitifs sont multiples et souvent intriquées. Les neuropathies diabétiques représentent la première cause, touchant 30% des diabétiques après 10 ans d'évolution [2]. Viennent ensuite les neuropathies toxiques, notamment liées à l'alcool chronique ou à certains médicaments comme les chimiothérapies.
Les maladies infectieuses constituent un facteur de risque émergent. La borréliose de Lyme, par exemple, peut provoquer des troubles sensitifs persistants dans 15% des cas non traités précocement [1]. D'ailleurs, l'augmentation des cas de Lyme en France explique en partie la hausse des troubles sensitifs observée ces dernières années.
Mais il existe aussi des causes moins connues. Les carences vitaminiques, particulièrement en vitamines B1, B6 et B12, peuvent déclencher des neuropathies sensitives [2]. Les maladies auto-immunes, les compressions nerveuses et même certaines intoxications professionnelles entrent également en ligne de compte .
Bon à savoir : l'âge reste le principal facteur de risque non modifiable. Après 65 ans, la prévalence double tous les 10 ans. Cependant, adopter une hygiène de vie saine peut considérablement réduire les risques.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des troubles sensitifs sont souvent trompeurs et évoluent progressivement. Les premiers signes passent fréquemment inaperçus : fourmillements dans les pieds, sensation de "chaussettes trop serrées" ou difficultés à percevoir la texture des objets .
L'allodynie, cette douleur provoquée par un stimulus normalement indolore, constitue un symptôme particulièrement invalidant. Imaginez ressentir une brûlure intense au simple contact d'un vêtement ! Cette hypersensibilité touche 40% des patients et peut considérablement altérer leur qualité de vie .
D'autres manifestations incluent l'hypoesthésie (diminution de la sensibilité), les paresthésies (sensations anormales spontanées) et les troubles de la proprioception. Cette dernière, qui vous permet de connaître la position de vos membres sans les regarder, peut provoquer des chutes et des difficultés de coordination .
Il est important de noter que les symptômes varient selon la localisation de l'atteinte. Les troubles sensitifs des mains affectent particulièrement la dextérité fine, tandis que ceux des pieds perturbent l'équilibre et la marche . Certains patients décrivent également des sensations de "gant" ou de "chaussette", délimitant précisément la zone atteinte.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des troubles sensitifs suit une démarche méthodique, récemment actualisée par les recommandations HAS 2024 [2]. Tout commence par un interrogatoire minutieux : votre médecin s'intéresse aux circonstances d'apparition, à l'évolution des symptômes et à vos antécédents médicaux.
L'examen clinique constitue l'étape cruciale. Le neurologue teste votre sensibilité au toucher léger, aux vibrations, à la température et à la douleur. Ces tests, apparemment simples, permettent de localiser précisément l'atteinte et d'orienter les examens complémentaires . Un arbre décisionnel centré sur le confort du patient guide désormais cette évaluation .
Les examens paracliniques viennent confirmer le diagnostic. L'électroneuromyographie (ENMG) reste l'examen de référence pour explorer les neuropathies périphériques. Elle mesure la vitesse de conduction nerveuse et détecte d'éventuelles lésions axonales [2]. Dans certains cas, une IRM médullaire ou cérébrale s'avère nécessaire.
Enfin, le bilan étiologique recherche la cause sous-jacente : glycémie, vitamines B, sérologies infectieuses, marqueurs auto-immuns. Cette approche globale permet d'identifier la cause dans 80% des cas et d'adapter le traitement en conséquence [2].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des troubles sensitifs repose sur une approche multimodale, combinant traitement étiologique et symptomatique. Lorsqu'une cause est identifiée, sa prise en charge constitue la priorité absolue : équilibrage du diabète, supplémentation vitaminique ou arrêt d'un médicament toxique [2].
Pour soulager les douleurs neuropathiques, plusieurs classes médicamenteuses ont fait leurs preuves. Les antiépileptiques comme la prégabaline et la gabapentine représentent le traitement de première ligne, avec une efficacité démontrée chez 60% des patients [3]. Les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs de la recapture constituent des alternatives intéressantes.
Mais les médicaments ne font pas tout ! La rééducation sensitive occupe une place croissante dans l'arsenal thérapeutique. Cette approche, développée par des ergothérapeutes spécialisés, vise à rééduquer le système nerveux par des exercices de stimulation progressive . Les résultats sont particulièrement encourageants pour les troubles sensitifs post-traumatiques.
D'autres approches complémentaires méritent d'être mentionnées : l'acupuncture, la neurostimulation transcutanée (TENS) et même certaines techniques de relaxation. Chaque patient étant unique, l'important est de trouver la combinaison thérapeutique la plus adaptée à votre situation.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge des troubles sensitifs. La thalamotomie focalisée par ultrasons, technique révolutionnaire non invasive, offre de nouveaux espoirs pour les patients souffrant de douleurs neuropathiques réfractaires . Cette intervention, réalisée sous IRM, permet de moduler l'activité du thalamus sans ouvrir le crâne.
Les ARN non codants émergent comme biomarqueurs prometteurs et cibles thérapeutiques potentielles . Ces molécules, longtemps considérées comme "inutiles", régulent en réalité l'expression génique et pourraient expliquer certains mécanismes des neuropathies. Plusieurs essais cliniques sont en cours pour développer des thérapies ciblées.
La recherche sur l'intégration sensorielle d'Ayres connaît également des avancées significatives . De nouveaux outils d'évaluation permettent de mieux caractériser les troubles sensitifs et d'adapter les interventions thérapeutiques. Cette approche, initialement développée pour les enfants autistes, trouve des applications prometteuses chez l'adulte.
Enfin, les nouvelles recommandations de prise en soins intègrent une approche plus personnalisée . L'objectif : adapter le traitement au profil génétique et phénotypique de chaque patient. Cette médecine de précision représente l'avenir de la neurologie sensitive.
Vivre au Quotidien avec Troubles sensitifs
Vivre avec des troubles sensitifs nécessite des adaptations quotidiennes, mais rassurez-vous, de nombreuses solutions existent pour préserver votre autonomie. L'aménagement de votre domicile constitue souvent la première étape : éclairage renforcé, revêtements antidérapants et suppression des obstacles peuvent considérablement réduire les risques de chute .
Au niveau professionnel, n'hésitez pas à solliciter la médecine du travail. Des aménagements simples comme un clavier ergonomique, un siège adapté ou des pauses plus fréquentes peuvent vous permettre de continuer à exercer votre activité. Le maintien dans l'emploi reste possible dans 70% des cas avec un accompagnement approprié.
La gestion de la douleur au quotidien passe aussi par des techniques non médicamenteuses. La relaxation, la méditation de pleine conscience et même certains exercices de respiration peuvent atténuer l'intensité des symptômes . Certains patients trouvent également un soulagement dans les activités créatives ou artistiques.
L'entourage joue un rôle crucial dans cette adaptation. Expliquez vos difficultés à vos proches, ils pourront mieux vous comprendre et vous soutenir. Rejoindre un groupe de patients peut également vous apporter un soutien psychologique précieux et des conseils pratiques.
Les Complications Possibles
Les complications des troubles sensitifs peuvent être graves si la pathologie n'est pas prise en charge correctement. Les troubles de l'équilibre et de la proprioception augmentent significativement le risque de chutes, particulièrement chez les personnes âgées . Ces chutes peuvent entraîner des fractures, notamment du col du fémur, avec des conséquences dramatiques sur l'autonomie.
Les ulcères plantaires représentent une complication redoutable, surtout chez les diabétiques. L'absence de sensation douloureuse empêche la détection précoce des blessures, pouvant conduire à des infections graves, voire à des amputations. C'est pourquoi l'inspection quotidienne des pieds est cruciale pour ces patients.
Sur le plan psychologique, les troubles sensitifs peuvent engendrer anxiété et dépression. La perte de sensibilité altère la relation au corps et peut provoquer un sentiment d'étrangeté corporelle particulièrement déstabilisant . Environ 30% des patients développent des troubles de l'humeur nécessitant un accompagnement spécialisé.
Enfin, certaines complications spécifiques méritent d'être mentionnées : les troubles vésico-sphinctériens dans les atteintes médullaires , les difficultés de déglutition dans les formes bulbaires , ou encore les troubles trophiques cutanés. Une surveillance médicale régulière permet heureusement de prévenir la plupart de ces complications.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des troubles sensitifs dépend largement de la cause sous-jacente et de la précocité de la prise en charge. Dans les formes réversibles, comme les neuropathies carentielles ou toxiques, l'arrêt de l'exposition et la correction des déficits permettent souvent une récupération complète en 6 à 12 mois [2].
Pour les neuropathies diabétiques, le pronostic est directement lié au contrôle glycémique. Un diabète bien équilibré peut stabiliser, voire améliorer légèrement les troubles sensitifs. En revanche, un mauvais contrôle accélère la progression et aggrave le pronostic fonctionnel [2].
Les formes post-traumatiques présentent un potentiel de récupération variable. Les jeunes patients récupèrent généralement mieux grâce à la plasticité neuronale. La rééducation intensive, débutée précocement, peut considérablement améliorer le pronostic . Certains patients retrouvent jusqu'à 80% de leurs capacités sensitives initiales.
Il faut savoir que même dans les formes chroniques, des améliorations restent possibles. Les nouvelles approches thérapeutiques, notamment la stimulation nerveuse et la rééducation sensitive, offrent des perspectives encourageantes [3]. L'important est de maintenir un suivi régulier et de ne jamais abandonner les efforts de rééducation.
Peut-on Prévenir Troubles sensitifs ?
La prévention des troubles sensitifs repose sur le contrôle des facteurs de risque modifiables. L'équilibre du diabète constitue la mesure préventive la plus efficace : maintenir une hémoglobine glyquée sous 7% réduit de 60% le risque de neuropathie diabétique [2]. Un suivi endocrinologique régulier est donc essentiel pour tous les diabétiques.
La prévention des maladies vectorielles, notamment la borréliose de Lyme, prend une importance croissante. Les recommandations HAS 2024 insistent sur les mesures de protection lors d'activités en forêt : vêtements couvrants, répulsifs et inspection corporelle après exposition [1]. Un traitement antibiotique précoce prévient efficacement les complications neurologiques.
Au niveau professionnel, la prévention des intoxications nécessite une vigilance particulière. L'exposition aux solvants, métaux lourds et certains pesticides peut provoquer des neuropathies toxiques . Le respect des équipements de protection individuelle et la surveillance médicale renforcée des travailleurs exposés sont indispensables.
Enfin, une hygiène de vie saine contribue à la prévention : alimentation équilibrée riche en vitamines B, limitation de la consommation d'alcool et exercice physique régulier. Ces mesures simples, mais efficaces, réduisent significativement le risque de développer des troubles sensitifs.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont récemment actualisé leurs recommandations concernant les troubles sensitifs. La HAS 2024 préconise un dépistage systématique chez tous les diabétiques dès le diagnostic, puis annuellement [2]. Cette approche proactive permet une prise en charge précoce et améliore significativement le pronostic.
Concernant la borréliose de Lyme, les nouvelles recommandations insistent sur la nécessité d'un traitement antibiotique immédiat en cas d'érythème migrant, même sans confirmation biologique [1]. Cette stratégie préventive vise à éviter les complications neurologiques tardives, incluant les troubles sensitifs persistants.
La Société Française de Gériatrie et Gérontologie a publié en 2024 de nouvelles directives pour la prise en soins des personnes âgées . Ces recommandations intègrent une évaluation systématique des troubles sensitifs dans le bilan gériatrique, reconnaissant leur impact majeur sur l'autonomie et la qualité de vie.
Au niveau européen, les guidelines récentes privilégient une approche multidisciplinaire associant neurologues, rééducateurs et psychologues [3]. Cette prise en charge globale, désormais recommandée en France, améliore les résultats thérapeutiques et la satisfaction des patients. L'objectif est de proposer un parcours de soins coordonné et personnalisé.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients souffrant de troubles sensitifs. L'Association Française contre les Neuropathies Périphériques (AFNP) propose un soutien psychologique, des groupes de parole et des informations actualisées sur les traitements. Leur site internet constitue une ressource précieuse pour les patients et leurs familles.
La Fédération Française des Diabétiques organise régulièrement des sessions d'éducation thérapeutique incluant la prévention et la gestion des complications neurologiques. Ces programmes, remboursés par l'Assurance Maladie, permettent aux patients d'acquérir les compétences nécessaires pour gérer leur pathologie au quotidien.
Pour les professionnels de santé, la Société Française de Neurologie met à disposition des recommandations actualisées et des outils d'évaluation standardisés . Ces ressources facilitent le diagnostic et optimisent la prise en charge des troubles sensitifs.
N'oubliez pas les ressources locales : centres de rééducation, maisons de santé pluriprofessionnelles et réseaux de soins. Votre médecin traitant peut vous orienter vers les structures les plus adaptées à votre situation. L'important est de ne pas rester isolé face à ces troubles souvent déroutants.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec des troubles sensitifs. Premièrement, tenez un carnet de symptômes détaillant l'intensité de vos douleurs, les facteurs déclenchants et l'efficacité des traitements. Ces informations précieuses aideront votre médecin à adapter votre prise en charge.
Adaptez votre environnement quotidien : installez des barres d'appui dans la salle de bain, améliorez l'éclairage et éliminez les tapis glissants. Ces aménagements simples réduisent considérablement les risques d'accident domestique. Pensez également aux chaussures : privilégiez des modèles fermés, stables et bien ajustés.
Développez des stratégies compensatoires : utilisez la vue pour compenser la perte de sensibilité, apprenez à reconnaître les signaux d'alarme et n'hésitez pas à demander de l'aide. La technologie peut aussi vous assister : applications de rappel pour l'inspection des pieds, thermomètres connectés pour vérifier la température de l'eau.
Enfin, maintenez une activité physique adaptée. La marche, la natation ou le tai-chi stimulent la circulation sanguine et peuvent améliorer les symptômes. Consultez un kinésithérapeute pour établir un programme personnalisé et sécurisé. L'activité physique régulière améliore aussi le moral et la qualité de vie globale.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation médicale rapide. Consultez en urgence si vous ressentez une perte de sensibilité brutale, des douleurs intenses d'apparition soudaine ou des troubles de l'équilibre majeurs. Ces symptômes peuvent révéler une pathologie grave nécessitant une prise en charge immédiate .
Une consultation programmée s'impose en cas de fourmillements persistants depuis plus de deux semaines, de difficultés croissantes pour manipuler les objets ou de chutes répétées. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent : un diagnostic précoce améliore toujours le pronostic [2].
Les diabétiques doivent bénéficier d'un suivi neurologique annuel, même en l'absence de symptômes. Cette surveillance permet de détecter précocement l'apparition de complications et d'adapter le traitement en conséquence. De même, tout patient traité par chimiothérapie doit signaler l'apparition de troubles sensitifs.
Enfin, consultez votre médecin si vos symptômes s'aggravent malgré le traitement, si de nouveaux signes apparaissent ou si votre qualité de vie se dégrade. Votre médecin pourra réévaluer votre prise en charge et vous orienter vers un spécialiste si nécessaire. N'hésitez jamais à exprimer vos préoccupations : votre ressenti est important pour adapter le traitement.
Questions Fréquentes
Les troubles sensitifs sont-ils héréditaires ?
Certaines formes de neuropathies héréditaires existent, mais elles restent rares. La plupart des troubles sensitifs sont acquis et liés à des facteurs environnementaux ou à d'autres pathologies.
Peut-on guérir complètement des troubles sensitifs ?
Cela dépend de la cause. Les formes réversibles (carences, intoxications) peuvent guérir complètement avec un traitement approprié. Les formes chroniques peuvent être stabilisées et améliorées.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques - Recommandations HAS 2024-2025Lien
- [2] Le « proto », des cas d'intoxication toujours en augmentation - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [3] Diagnostic des neuropathies périphériques - Recommandations HASLien
- [4] La Lettre du Neurologue N° 4 avril 2025 - Innovation thérapeutiqueLien
- [5] Thalamotomie – Une révolution dans le traitement des tremblements 2024-2025Lien
Publications scientifiques
- Caractérisation des troubles sensitifs dans une population de patients allodyniques (2022)
- Hypothèse sur la participation des troubles sensitifs tactiles dans le syndrome d'exclusion segmentaire (2022)
- Troubles neurologiques fonctionnels: une anthologie clinique (2023)2 citations
- Facteurs prédictifs de survenue de troubles neuro-orthopédiques chez l'hémiplégique vasculaire (2025)
- Conduite à tenir devant un trouble bulbaire fluctuant (2025)
Ressources web
- Syndromes sensitifs | www.cen-neurologie.fr (cen-neurologie.fr)
L'examen met en évidence des troubles du sens de position du gros orteil et de la sensibilité vibratoire ; parfois le malade a une démarche talonnante et s' ...
- Neuropathie périphérique : définition, causes et traitements (elsan.care)
Les neuropathies périphériques peuvent tout d'abord engendrer des troubles sensitifs comme des paresthésies (picotements, fourmillement) ou des dysesthésies ( ...
- Diagnostic des neuropathies périphériques (has-sante.fr)
Le symptôme moteur le plus fréquent est la faiblesse musculaire, en particulier des loges antéro-externes des jambes se traduisant par un steppage. distale des ...
- sclerose en plaques et troubles sensitifs (sep-ensemble.fr)
27 mars 2019 — Le traitement par médicaments des troubles sensitifs repose sur les antiépileptiques et les antidépresseurs2,3. Ces médicaments agissent au ...
- Polyneuropathie - Troubles du cerveau, de la moelle ... (msdmanuals.com)
Les symptômes comprennent une faiblesse musculaire et des sensations de picotements, voire une perte de sensibilité.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
