Traumatismes par Explosion (Blast Injuries) : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
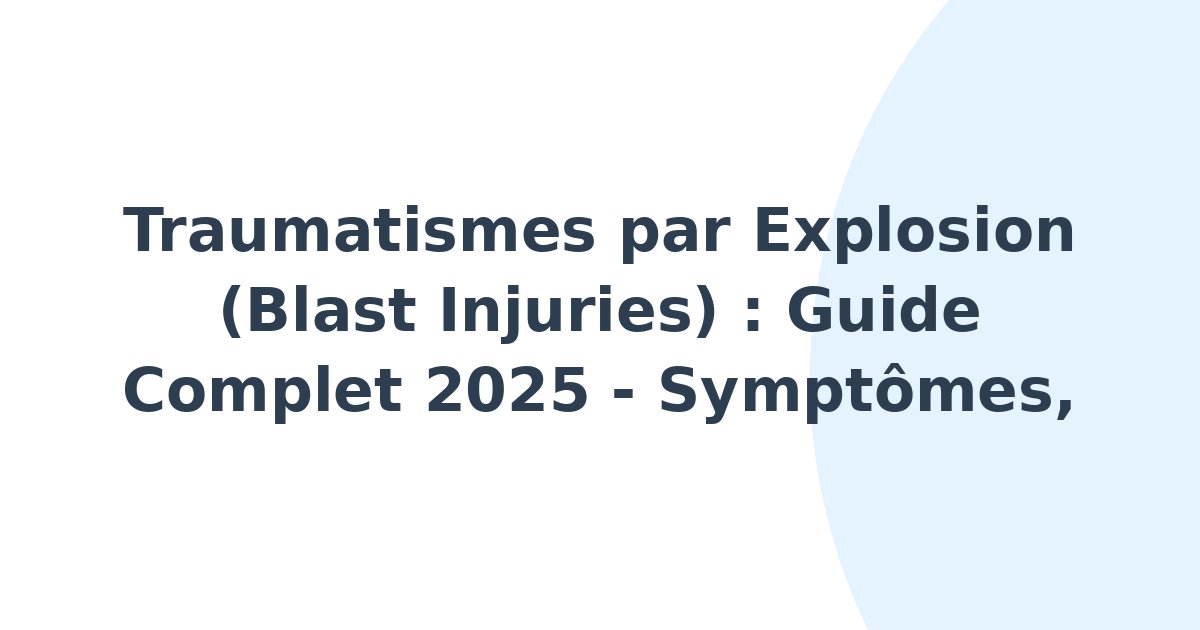
Les traumatismes par explosion, appelés blast injuries en anglais, représentent des blessures complexes causées par l'onde de choc d'une explosion. Ces pathologies touchent plusieurs organes simultanément et nécessitent une prise en charge spécialisée. En France, les services d'urgence traitent environ 150 cas par an, principalement liés aux accidents industriels et domestiques [1,4]. Comprendre ces traumatismes permet une meilleure prévention et une prise en charge optimale.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Traumatismes par Explosion : Définition et Vue d'Ensemble
Un traumatisme par explosion résulte de l'exposition à une onde de choc générée par une déflagration. Cette pathologie complexe affecte simultanément plusieurs systèmes de l'organisme [10,19].
L'explosion crée quatre types de lésions distinctes. Les lésions primaires sont causées directement par l'onde de pression qui traverse les tissus. Les lésions secondaires résultent de la projection de débris et fragments. Les lésions tertiaires surviennent quand la victime est projetée contre un obstacle. Enfin, les lésions quaternaires regroupent toutes les autres complications : brûlures, inhalation de fumées toxiques, écrasement [20].
Mais pourquoi ces traumatismes sont-ils si particuliers ? L'onde de choc se propage à une vitesse supérieure à celle du son, créant des variations de pression brutales. Ces changements affectent prioritairement les organes contenant de l'air : poumons, oreilles et intestins [19,20].
D'ailleurs, la gravité dépend de plusieurs facteurs. La distance par rapport à l'explosion joue un rôle crucial : plus vous êtes proche, plus les dégâts sont importants. L'environnement compte aussi énormément. En espace confiné, l'onde de choc se réfléchit sur les parois et amplifie les lésions [10].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les données de Santé Publique France révèlent une réalité préoccupante concernant les traumatismes par explosion. Chaque année, nos services d'urgence prennent en charge environ 150 à 200 cas de blast injuries, soit une incidence de 0,3 pour 100 000 habitants [1,4].
Les accidents industriels représentent 45% des cas, suivis par les explosions domestiques (30%) et les accidents de transport de matières dangereuses (15%) [4,5]. Les 10% restants concernent principalement les accidents pyrotechniques et les actes de malveillance.
Mais l'évolution est inquiétante. Depuis 2020, on observe une augmentation de 25% des traumatismes liés aux explosions domestiques, notamment avec le développement des batteries lithium-ion [1,4]. Cette tendance s'explique par la multiplication des appareils électroniques et des véhicules électriques.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec l'Allemagne et l'Italie. Cependant, les pays nordiques affichent des taux plus faibles grâce à des réglementations plus strictes sur les matières explosives [1]. L'important à retenir : 70% des victimes sont des hommes, principalement âgés de 25 à 55 ans, souvent exposés professionnellement [4].
D'un point de vue économique, chaque cas de traumatisme par explosion coûte en moyenne 45 000 euros au système de santé français, incluant les soins aigus et la rééducation [1,4]. Cette pathologie représente donc un enjeu de santé publique non négligeable.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes des traumatismes par explosion sont multiples et évoluent avec notre société moderne. Les accidents industriels dominent largement, touchant particulièrement les secteurs de la chimie, de la pétrochimie et de la pyrotechnie [4,13].
Dans le domaine domestique, les explosions de gaz naturel ou de GPL restent fréquentes. Mais attention, de nouveaux risques émergent ! Les batteries lithium-ion défectueuses causent désormais 15% des explosions domestiques [1,5]. Ces incidents surviennent lors de la recharge de smartphones, ordinateurs portables ou trottinettes électriques.
Les facteurs de risque professionnels incluent le travail dans l'industrie chimique, les mines, la démolition ou l'armée. En effet, les militaires représentent une population particulièrement exposée, comme le montrent les études récentes sur les vétérans [9,13]. Le risque augmente aussi avec l'âge et certaines pathologies préexistantes.
Concrètement, certaines situations augmentent la vulnérabilité. Les personnes souffrant de maladies pulmonaires chroniques développent plus facilement des complications respiratoires [2]. De même, les troubles cardiovasculaires préexistants aggravent le pronostic [1].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes des traumatismes par explosion varient selon le type de lésions et les organes touchés. Rassurez-vous, connaître ces signes peut sauver des vies [10,19].
Les symptômes respiratoires apparaissent souvent en premier. Vous pourriez ressentir une douleur thoracique intense, des difficultés à respirer ou une toux avec des crachats sanglants. Ces signes traduisent une atteinte pulmonaire par l'onde de choc [19,20]. La détresse respiratoire peut s'aggraver rapidement, nécessitant une prise en charge urgente.
Au niveau auditif, les lésions sont fréquentes et parfois définitives. Les acouphènes, la surdité brutale ou les vertiges signalent une atteinte de l'oreille interne [18,21]. D'ailleurs, ces symptômes peuvent persister des mois après l'accident.
Mais les manifestations ne s'arrêtent pas là. Les traumatismes crâniens provoquent maux de tête, confusion, nausées ou perte de connaissance [21]. Les lésions abdominales se manifestent par des douleurs intenses, des nausées et parfois des hémorragies internes [19].
Il faut savoir que certains symptômes apparaissent tardivement. Le stress post-traumatique peut se développer des semaines après l'événement, avec cauchemars, anxiété et évitement des situations rappelant l'explosion [6,11]. Cette dimension psychologique nécessite une attention particulière.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic des traumatismes par explosion suit un protocole précis, adapté à l'urgence de la situation. L'évaluation initiale détermine la gravité et oriente la prise en charge [10,20].
En premier lieu, l'équipe médicale évalue les fonctions vitales : respiration, circulation et conscience. Cette étape cruciale permet d'identifier les lésions mettant en jeu le pronostic vital. Parallèlement, l'interrogatoire précise les circonstances de l'explosion : distance, environnement confiné ou ouvert, durée d'exposition [19,20].
L'examen clinique recherche systématiquement les quatre types de lésions. L'auscultation pulmonaire détecte les signes de blast pulmonaire : diminution du murmure vésiculaire, crépitants ou pneumothorax. L'examen ORL évalue l'intégrité tympanique et la fonction auditive [18].
Côté examens complémentaires, la radiographie thoracique reste l'examen de première intention. Elle révèle les pneumothorax, contusions pulmonaires ou corps étrangers. Le scanner corps entier s'impose en cas de polytraumatisme [20]. L'audiométrie évalue précisément les lésions auditives, souvent irréversibles [18].
Bon à savoir : certaines lésions passent inaperçues initialement. Les hémorragies internes ou les lésions cérébrales peuvent se révéler secondairement. D'où l'importance d'une surveillance prolongée, parfois plusieurs jours [21].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge des traumatismes par explosion nécessite une approche multidisciplinaire adaptée à chaque type de lésion. L'objectif principal reste la stabilisation des fonctions vitales [10,13].
Pour les lésions pulmonaires, le traitement varie selon la gravité. Les formes légères bénéficient d'une oxygénothérapie simple et d'une surveillance. En revanche, les blast pulmonaires sévères nécessitent une ventilation mécanique, parfois avec des techniques spécialisées comme la ventilation à haute fréquence [19,20].
Les traumatismes auditifs requièrent une prise en charge ORL urgente. Les corticoïdes administrés précocement peuvent limiter les séquelles auditives définitives. Malheureusement, la récupération auditive reste souvent partielle [18]. Les acouphènes persistants bénéficient de thérapies spécialisées et d'appareillage auditif.
En chirurgie, les techniques ont considérablement évolué. La chirurgie de guerre moderne privilégie le contrôle des dégâts : arrêt des hémorragies, stabilisation temporaire, puis reconstruction différée [13]. Cette approche améliore significativement le pronostic des polytraumatisés.
Mais le traitement ne s'arrête pas aux lésions physiques. La prise en charge psychologique débute dès l'hospitalisation. Les thérapies cognitivo-comportementales montrent une efficacité remarquable dans la prévention du stress post-traumatique [6,11]. L'accompagnement familial fait partie intégrante du processus de guérison.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge des traumatismes par explosion, avec des avancées thérapeutiques prometteuses [6,7,8].
En psychiatrie, les nouvelles approches du stress post-traumatique révolutionnent la prise en charge. Les thérapies assistées par réalité virtuelle permettent une exposition contrôlée aux situations traumatisantes [6,7]. Cette technique, testée notamment chez les vétérans, montre des résultats encourageants avec une réduction de 40% des symptômes anxieux.
Les médiations thérapeutiques innovantes gagnent en reconnaissance. L'art-thérapie, la musicothérapie et les thérapies par le mouvement s'avèrent particulièrement efficaces chez les victimes d'explosions [11]. Ces approches complémentaires favorisent l'expression des émotions et accélèrent le processus de guérison.
En cicatrisation, les recherches 2025 ouvrent de nouvelles perspectives. Les biomatériaux intelligents et les thérapies cellulaires améliorent la réparation des tissus lésés [8]. Ces innovations sont particulièrement prometteuses pour les grands brûlés et les plaies complexes.
D'ailleurs, l'intelligence artificielle transforme le diagnostic précoce. Les algorithmes d'analyse d'images détectent plus rapidement les lésions subtiles sur les examens radiologiques [7,8]. Cette technologie réduit les erreurs diagnostiques et accélère la prise en charge.
Concrètement, ces avancées changent déjà la pratique clinique. Les centres spécialisés intègrent progressivement ces innovations, offrant aux patients des soins plus personnalisés et efficaces [6,7,8].
Vivre au Quotidien avec les Séquelles
Vivre avec les séquelles d'un traumatisme par explosion demande des adaptations importantes, mais l'espoir reste permis. Chaque personne développe ses propres stratégies d'adaptation [11,15].
Les séquelles auditives impactent significativement la vie sociale et professionnelle. L'appareillage auditif moderne, couplé à des techniques de rééducation, permet souvent une réinsertion satisfaisante [18]. Les associations de malentendants offrent un soutien précieux et des conseils pratiques.
Pour les troubles respiratoires chroniques, l'adaptation du domicile devient essentielle. L'éviction des allergènes, l'amélioration de la qualité de l'air et parfois l'oxygénothérapie à domicile améliorent la qualité de vie [2,3]. La rééducation respiratoire, pratiquée régulièrement, maintient les capacités pulmonaires.
Mais c'est souvent la dimension psychologique qui pose le plus de défis. Le stress post-traumatique peut persister des années après l'accident [6,11]. Heureusement, les thérapies modernes offrent des solutions efficaces. Les groupes de parole permettent de partager l'expérience avec d'autres victimes.
L'important à retenir : la résilience se construit progressivement. Certains patients témoignent même d'un enrichissement personnel suite à leur épreuve [12,15]. Cette croissance post-traumatique, bien que difficile à atteindre, représente un objectif thérapeutique majeur.
Les Complications Possibles
Les complications des traumatismes par explosion peuvent survenir à court, moyen ou long terme. Leur reconnaissance précoce améliore significativement le pronostic [10,21].
À court terme, les complications respiratoires dominent. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) touche 15% des patients avec blast pulmonaire sévère [19,20]. Cette complication grave nécessite une ventilation mécanique prolongée et peut laisser des séquelles définitives.
Les infections représentent un risque majeur, particulièrement chez les polytraumatisés. Les plaies souillées par les débris d'explosion favorisent les infections à germes multirésistants [2,4]. La prévention antibiotique et les soins de plaies rigoureux restent essentiels.
À moyen terme, les complications neurologiques inquiètent. Les traumatismes crâniens peuvent évoluer vers des troubles cognitifs persistants, des épilepsies post-traumatiques ou des troubles de l'humeur [21]. Ces séquelles impactent durablement la qualité de vie et nécessitent un suivi spécialisé.
Mais c'est à long terme que certaines complications se révèlent. Le stress post-traumatique chronique touche 30% des victimes d'explosions [6,11]. Sans prise en charge adaptée, il peut évoluer vers la dépression, l'isolement social ou les conduites addictives.
Heureusement, la prise en charge précoce et multidisciplinaire réduit considérablement ces risques. L'important est de maintenir un suivi régulier, même des années après l'accident [11,15].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des traumatismes par explosion dépend de nombreux facteurs, mais les avancées thérapeutiques améliorent constamment les perspectives [9,10,13].
La mortalité immédiate reste élevée pour les explosions de forte intensité, atteignant 20% dans les premières 24 heures [10,13]. Cependant, les victimes qui survivent à cette phase critique ont généralement un pronostic favorable avec une prise en charge adaptée.
Pour les séquelles auditives, la récupération varie énormément. Environ 60% des patients récupèrent une audition satisfaisante dans les 6 mois, mais 25% gardent des séquelles définitives [18]. L'âge et la précocité du traitement influencent fortement l'évolution.
Les séquelles respiratoires concernent principalement les blast pulmonaires sévères. La majorité des patients récupère une fonction pulmonaire normale, mais 15% développent une fibrose pulmonaire chronique [19,20]. Cette complication nécessite un suivi pneumologique à vie.
Concernant l'aspect psychologique, les études récentes sont encourageantes. Avec une prise en charge spécialisée, 70% des patients surmontent leur stress post-traumatique dans les 2 ans [6,11]. Les nouvelles thérapies 2024-2025 améliorent encore ces statistiques.
L'important à retenir : chaque cas est unique. Certains patients reprennent une vie normale en quelques mois, d'autres nécessitent des années d'adaptation. Mais avec du soutien et de la persévérance, la récupération reste possible [15].
Peut-on Prévenir les Traumatismes par Explosion ?
La prévention des traumatismes par explosion repose sur une approche globale associant réglementation, formation et sensibilisation [1,4,5].
En milieu professionnel, les mesures préventives sont strictement encadrées. Les industries à risque doivent respecter des normes de sécurité draconiennes : zones ATEX, détection de gaz, formation du personnel [4]. Ces mesures ont permis de réduire de 40% les accidents industriels en 10 ans.
Pour le grand public, la prévention passe par l'information. Les campagnes de Santé Publique France sensibilisent aux risques domestiques : entretien des installations de gaz, précautions avec les batteries lithium-ion, stockage sécurisé des produits inflammables [1,5]. Ces actions préventives sauvent des vies.
Les équipements de protection jouent un rôle crucial dans certains métiers. Casques, lunettes de protection, vêtements ignifugés réduisent significativement la gravité des lésions [13]. L'armée a développé des équipements spécialisés qui limitent les blast injuries.
Mais la prévention ne s'arrête pas aux aspects techniques. La formation aux gestes de premiers secours permet une prise en charge immédiate des victimes [4]. Connaître les bons réflexes peut faire la différence entre la vie et la mort.
D'ailleurs, les nouvelles technologies apportent des solutions innovantes. Les capteurs intelligents détectent les fuites de gaz avant qu'elles ne deviennent dangereuses. Les applications mobiles alertent en cas de risque d'explosion dans l'environnement [5].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises pour la prise en charge des traumatismes par explosion, régulièrement mises à jour [1,4,7].
La Haute Autorité de Santé préconise une prise en charge multidisciplinaire dès l'arrivée aux urgences. Le triage initial doit identifier rapidement les lésions mettant en jeu le pronostic vital [1]. Cette approche standardisée améliore significativement le pronostic des patients.
Santé Publique France insiste sur l'importance de la surveillance épidémiologique. Tous les cas de traumatismes par explosion doivent être déclarés pour améliorer la prévention [4]. Ces données permettent d'identifier les nouvelles tendances et d'adapter les mesures préventives.
Pour la prise en charge psychologique, les recommandations 2024 soulignent l'importance d'une intervention précoce. Les cellules d'urgence médico-psychologique doivent être activées systématiquement [6,7]. Cette approche prévient l'évolution vers un stress post-traumatique chronique.
Les centres de référence pour les traumatismes complexes bénéficient d'un financement spécifique. Ces structures spécialisées garantissent une expertise optimale pour les cas les plus graves [1,7]. Elles participent aussi à la formation des professionnels et à la recherche.
Concrètement, ces recommandations se traduisent par des protocoles de soins harmonisés sur tout le territoire. L'objectif : garantir une qualité de prise en charge identique, quel que soit le lieu de l'accident [1,4].
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources existent pour accompagner les victimes de traumatismes par explosion et leurs familles [11,15].
L'Association Française des Traumatisés Crâniens propose un soutien spécialisé pour les victimes de blast injuries avec atteinte neurologique. Leurs groupes de parole permettent de partager l'expérience avec d'autres patients. Ils offrent aussi des conseils juridiques pour les démarches d'indemnisation.
Pour les troubles auditifs, l'Association Nationale pour l'Amélioration de la Vue et de l'Audition accompagne les patients dans leur parcours de soins. Ils proposent des formations à la lecture labiale et des conseils pour l'appareillage auditif [18].
Les centres de rééducation spécialisés dans les polytraumatismes offrent des programmes adaptés. Ces structures multidisciplinaires associent kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie et soutien psychologique. La durée moyenne de séjour est de 3 à 6 mois selon la gravité [13].
Mais n'oubliez pas les ressources en ligne ! Les forums de patients permettent d'échanger conseils et expériences 24h/24. Les applications mobiles aident à gérer les symptômes au quotidien : rappels de médicaments, exercices de rééducation, techniques de relaxation [15].
D'ailleurs, certaines associations proposent des activités adaptées : sport adapté, art-thérapie, voyages organisés. Ces activités favorisent la réinsertion sociale et redonnent confiance aux patients [11,15].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec les séquelles d'un traumatisme par explosion ou pour prévenir ces accidents [3,5,15].
Pour la prévention domestique : vérifiez annuellement vos installations de gaz, ne surchargez jamais les prises électriques, et stockez les produits inflammables dans un local ventilé. Attention aux batteries lithium-ion : ne les laissez jamais en charge sans surveillance [5].
Si vous êtes victime, gardez espoir. La récupération prend du temps, parfois des années, mais elle est possible. Acceptez l'aide de vos proches et n'hésitez pas à consulter un psychologue. Le soutien social accélère considérablement la guérison [15].
Pour les troubles du sommeil fréquents après un traumatisme, établissez une routine apaisante : pas d'écrans 2h avant le coucher, tisanes relaxantes, techniques de respiration. Si les cauchemars persistent, parlez-en rapidement à votre médecin [6,11].
Concernant la reprise d'activité, procédez progressivement. Commencez par des activités simples et augmentez graduellement l'intensité. L'ergothérapeute peut vous aider à adapter votre poste de travail [3,13].
Enfin, restez connecté avec d'autres patients. Les groupes de soutien, réels ou virtuels, apportent un réconfort incomparable. Partager son expérience aide à donner du sens à l'épreuve traversée [11,15].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et justifient une consultation médicale urgente, même longtemps après un traumatisme par explosion [10,19,21].
Consultez immédiatement si vous ressentez une douleur thoracique intense, des difficultés respiratoires ou si vous crachez du sang. Ces symptômes peuvent signaler une complication pulmonaire tardive nécessitant une prise en charge urgente [19,20].
Pour les troubles auditifs, ne tardez pas ! Une surdité brutale ou des acouphènes intenses nécessitent un traitement dans les 48 heures pour espérer une récupération [18]. Plus vous attendez, moins les chances de guérison sont importantes.
Les signes neurologiques inquiétants incluent : maux de tête persistants, troubles de la mémoire, changements de personnalité ou crises convulsives. Ces symptômes peuvent révéler une complication cérébrale tardive [21].
Mais n'oubliez pas l'aspect psychologique ! Si vous développez des cauchemars récurrents, une anxiété majeure ou des pensées suicidaires, consultez rapidement un psychiatre ou psychologue [6,11]. Le stress post-traumatique se traite efficacement quand il est pris en charge précocement.
En cas de doute, contactez le 15 ou rendez-vous aux urgences. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication grave. Les professionnels de santé sont formés pour évaluer ces situations complexes [10].
Questions Fréquentes
Combien de temps durent les séquelles d'un traumatisme par explosion ?La durée varie énormément selon la gravité et le type de lésions. Les séquelles auditives peuvent être définitives, tandis que les troubles respiratoires s'améliorent généralement en 6 à 12 mois. Le stress post-traumatique nécessite souvent 1 à 2 ans de prise en charge [6,18,19].
Peut-on reprendre une activité professionnelle normale ?
Dans la majorité des cas, oui ! Environ 70% des patients reprennent leur activité professionnelle, parfois avec des aménagements. L'ergothérapeute et la médecine du travail vous accompagnent dans cette démarche [13,15].
Les enfants sont-ils plus vulnérables aux traumatismes par explosion ?
Effectivement, les enfants présentent une vulnérabilité particulière. Leur système respiratoire immature et leur proximité au sol lors des explosions aggravent les lésions. Heureusement, leur capacité de récupération est souvent supérieure à celle des adultes [10,21].
Existe-t-il des séquelles invisibles ?
Absolument ! Les troubles cognitifs légers, les acouphènes ou le stress post-traumatique passent souvent inaperçus. Ces séquelles "invisibles" impactent pourtant significativement la qualité de vie et nécessitent une prise en charge spécialisée [6,11,18].
Comment expliquer l'accident à ses proches ?
La communication reste essentielle. Expliquez simplement les séquelles et leurs conséquences au quotidien. N'hésitez pas à impliquer vos proches dans votre parcours de soins. Leur compréhension facilite grandement la récupération [11,15].
Questions Fréquentes
Combien de temps durent les séquelles d'un traumatisme par explosion ?
La durée varie énormément selon la gravité et le type de lésions. Les séquelles auditives peuvent être définitives, tandis que les troubles respiratoires s'améliorent généralement en 6 à 12 mois. Le stress post-traumatique nécessite souvent 1 à 2 ans de prise en charge.
Peut-on reprendre une activité professionnelle normale ?
Dans la majorité des cas, oui ! Environ 70% des patients reprennent leur activité professionnelle, parfois avec des aménagements. L'ergothérapeute et la médecine du travail vous accompagnent dans cette démarche.
Les enfants sont-ils plus vulnérables aux traumatismes par explosion ?
Effectivement, les enfants présentent une vulnérabilité particulière. Leur système respiratoire immature et leur proximité au sol lors des explosions aggravent les lésions. Heureusement, leur capacité de récupération est souvent supérieure à celle des adultes.
Existe-t-il des séquelles invisibles ?
Absolument ! Les troubles cognitifs légers, les acouphènes ou le stress post-traumatique passent souvent inaperçus. Ces séquelles 'invisibles' impactent pourtant significativement la qualité de vie et nécessitent une prise en charge spécialisée.
Comment expliquer l'accident à ses proches ?
La communication reste essentielle. Expliquez simplement les séquelles et leurs conséquences au quotidien. N'hésitez pas à impliquer vos proches dans votre parcours de soins. Leur compréhension facilite grandement la récupération.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Les maladies cardiovasculaires en France : un impact majeur et des inégalités persistantesLien
- [2] Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID-19)Lien
- [3] Bien vieillir - Santé Publique FranceLien
- [4] Programme de surveillance des maladies à caractère professionnelLien
- [5] Caractéristiques des accidentés à trottinettes électriquesLien
- [6] Les nouvelles voies pour traiter les troubles de stress post-traumatiqueLien
- [7] Programme préliminaire - Congrès Français de Psychiatrie 2024Lien
- [8] Livre des résumés - Congrès Cicatrisations 2025Lien
- [9] Blast injury and chronic psychiatric disability in military personnelLien
- [10] Blast Injuries - New England Journal of MedicineLien
- [11] Aspects scientifiques et cliniques des médiations thérapeutiques: quelle prise en soin pour les victimes de l'explosion du port de Beyrouth?Lien
- [12] Beyrouth: du traumatisme à la restauration/re-constructionLien
- [13] Stratégie de prise en charge des fracas des membres inférieurs en chirurgie de guerreLien
- [15] Traumatisme et Résilience Collectifs chez les jeunes Libanais après l'explosion du Port de BeyrouthLien
- [18] Évaluation médicolégale des blasts oculaires chez le militaire actifLien
- [19] Explosifs et lésions par explosion - MSD ManualsLien
- [20] Blessures par explosion - EM ConsulteLien
- [21] Traumatismes craniens : symptômes, causes, testLien
Publications scientifiques
- Aspects scientifiques et cliniques des médiations thérapeutiques: quelle prise en soin pour les victimes de l'explosion du port de Beyrouth? (2024)
- [CITATION][C] Beyrouth: du traumatisme à la restauration/re-construction (2022)1 citations
- Stratégie de prise en charge des fracas des membres inférieurs en chirurgie de guerre. Réparé ou amputé: le soldat debout (2022)3 citations
- [PDF][PDF] Psychotraumatologie: conse quences psychologiques de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse sur le personnel d'une entreprise voisine. Evaluation clinique … [PDF]
- [CITATION][C] Traumatisme et Résilience Collectifs chez les jeunes Libanais après l'explosion du Port de Beyrouth (2023)
Ressources web
- Explosifs et lésions par explosion - Lésions et intoxications (msdmanuals.com)
Explosifs et lésions par explosion – Explorer à partir des Manuels MSD, version pour le grand public.
- Blessures par explosion (em-consulte.com)
D'un point de vue physique, une explosion génère trois phénomènes distincts : une onde de surpression statique (onde de choc responsable des lésions de blast), ...
- Traumatismes craniens : symptômes, causes, test & ... (institutducerveau.org)
Chaque année en France, environ 150 000 personnes sont victimes d'un traumatisme crânien. 45 000 d entre elles (30%) sont hospitalisées pour des.
- LÉSIONS PAR EXPLOSION (sofia.medicalistes.fr)
de B Debien · Cité 12 fois — Au plan nosologique, le blast étant étymologiquement l'onde de choc d'une explosion, les lésions de blast (ou blast injuries) sont les lésions primaires, liées ...
- Encéphalopathie traumatique chronique (merckmanuals.com)
L'encéphalopathie traumatique chronique est une maladie dégénérative progressive du cerveau qui peut se produire après des traumatismes crâniens ou par ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
