Traumatismes de l'Abdomen : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic, Traitements
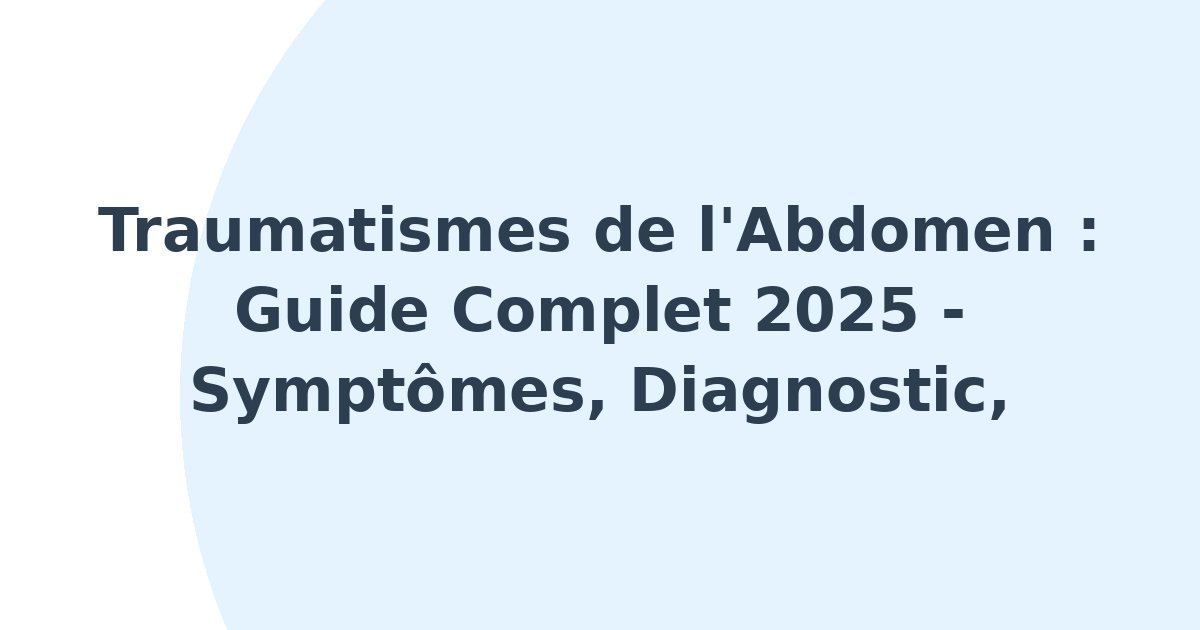
Les traumatismes de l'abdomen représentent une urgence médicale majeure qui peut toucher chacun d'entre nous. Qu'il s'agisse d'un accident de la route, d'une chute ou d'un coup violent, ces blessures nécessitent une prise en charge immédiate. En France, ils concernent environ 15 000 personnes chaque année selon Santé Publique France . Heureusement, les innovations diagnostiques et thérapeutiques de 2024-2025 améliorent considérablement le pronostic des patients.
Téléconsultation et Traumatismes de l'abdomen
Téléconsultation non recommandéeLes traumatismes abdominaux nécessitent impérativement un examen physique approfondi pour évaluer la douleur, les signes de défense, et détecter d'éventuelles lésions internes. L'imagerie médicale (scanner, échographie) est généralement indispensable pour le diagnostic, et le risque d'hémorragie interne ou de lésions d'organes vitaux impose une prise en charge présentielle immédiate.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil des circonstances précises du traumatisme (mécanisme, force, objet contondant), évaluation de l'intensité et de la localisation de la douleur abdominale, analyse des symptômes associés (nausées, vomissements, malaise), orientation vers la structure de soins appropriée selon la gravité présumée.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen physique de l'abdomen (palpation, recherche de défense, signes de Blumberg), réalisation d'imagerie d'urgence (scanner abdominal, échographie FAST), surveillance des paramètres vitaux et recherche de signes de choc hémorragique, évaluation chirurgicale si nécessaire.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Impossibilité d'évaluer la défense abdominale et les signes péritonéaux par téléconsultation, nécessité d'une imagerie d'urgence pour détecter les lésions internes, surveillance rapprochée des paramètres vitaux indispensable, évaluation du risque hémorragique nécessitant un examen clinique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Tout traumatisme abdominal récent nécessite une évaluation présentielle immédiate pour éliminer une urgence chirurgicale, particulièrement en cas de douleur intense, de signes de choc ou de mécanisme traumatique à haute énergie.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Douleur abdominale intense et persistante après un traumatisme
- Signes de choc (pâleur, sueurs froides, pouls rapide, hypotension)
- Vomissements répétés ou présence de sang dans les vomissements
- Distension abdominale rapide ou ecchymoses sur l'abdomen
- Malaise important, sensation d'évanouissement ou perte de connaissance
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Urgentiste — consultation en présentiel indispensable
Les traumatismes abdominaux relèvent systématiquement des urgences hospitalières pour évaluation immédiate du risque vital et réalisation d'examens complémentaires. Une prise en charge présentielle est obligatoire pour tout traumatisme abdominal récent.
Traumatismes de l'Abdomen : Définition et Vue d'Ensemble
Un traumatisme abdominal correspond à toute blessure touchant la région située entre le thorax et le bassin. Cette zone contient des organes vitaux comme le foie, la rate, les reins ou l'intestin.
On distingue deux types principaux de traumatismes abdominaux. D'une part, les traumatismes fermés où la peau reste intacte mais les organes internes peuvent être lésés [6,10]. D'autre part, les traumatismes pénétrants où un objet traverse la paroi abdominale [8,9].
L'abdomen est particulièrement vulnérable car il n'est protégé que par les muscles et la peau. Contrairement au thorax qui bénéficie de la protection des côtes, cette région expose directement les organes vitaux aux chocs [13,14]. C'est pourquoi même un impact apparemment bénin peut causer des lésions graves.
Les conséquences peuvent aller d'une simple contusion à des hémorragies internes massives. Certains patients développent des complications tardives, parfois plusieurs jours après le traumatisme initial [11]. L'important à retenir : tout traumatisme abdominal nécessite une évaluation médicale, même si les symptômes semblent mineurs au départ.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les traumatismes abdominaux représentent environ 10% de l'ensemble des traumatismes graves selon les données de Santé Publique France . Cette proportion reste stable depuis une décennie, avec une légère tendance à la baisse grâce aux campagnes de prévention routière.
L'incidence annuelle s'élève à 23 cas pour 100 000 habitants, soit environ 15 000 nouveaux cas chaque année . Les hommes sont deux fois plus touchés que les femmes, principalement en raison d'une exposition plus importante aux activités à risque. L'âge moyen des victimes est de 35 ans, avec deux pics de fréquence : les 18-25 ans et les plus de 65 ans .
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne avec des taux similaires à l'Allemagne et à l'Italie. Cependant, les pays nordiques affichent des incidences plus faibles, probablement liées à des politiques de sécurité routière plus strictes .
Les variations régionales en France sont notables. Les départements du Sud-Est enregistrent les taux les plus élevés, en lien avec une densité de circulation plus importante et des activités de loisirs à risque [7,12]. À l'inverse, les régions rurales du centre de la France présentent des incidences plus faibles.
L'évolution sur les dix dernières années montre une diminution de 15% des traumatismes liés aux accidents de la route, mais une augmentation de 8% de ceux liés aux chutes chez les personnes âgées . Cette tendance reflète le vieillissement de la population et l'amélioration de la sécurité automobile.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les accidents de la route constituent la première cause de traumatismes abdominaux, représentant 45% des cas [7,10]. Les chocs frontaux et latéraux sont particulièrement dangereux car ils projettent les occupants contre le volant ou les portières.
Les chutes de hauteur arrivent en deuxième position avec 25% des traumatismes [7]. Elles concernent principalement les travailleurs du bâtiment et les personnes âgées qui chutent à domicile. Même une chute de moins de 3 mètres peut causer des lésions graves [7].
Les agressions et coups volontaires représentent 15% des cas, en augmentation dans les zones urbaines [10]. Les armes blanches causent des traumatismes pénétrants particulièrement graves. D'ailleurs, les blessures par arme à feu restent heureusement rares en France.
Certains facteurs augmentent le risque de complications. L'âge avancé diminue la capacité de récupération de l'organisme [11]. La prise d'anticoagulants multiplie par trois le risque d'hémorragie interne. L'obésité complique le diagnostic car elle masque les signes cliniques [10].
Les activités professionnelles à risque incluent le BTP, l'agriculture et les métiers de la sécurité. Bon à savoir : porter une ceinture de sécurité réduit de 70% le risque de traumatisme abdominal grave en cas d'accident [7].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La douleur abdominale constitue le symptôme le plus fréquent, présente chez 85% des patients [10,11]. Elle peut être localisée au point d'impact ou diffuse dans tout l'abdomen. Attention : l'intensité de la douleur ne reflète pas toujours la gravité des lésions.
Les signes d'hémorragie interne doivent alerter immédiatement. Il s'agit de la pâleur, des sueurs froides, de l'accélération du pouls et de la chute de tension [13,14]. Ces symptômes peuvent apparaître progressivement, parfois plusieurs heures après le traumatisme.
La défense abdominale se manifeste par une contractureréflexe des muscles de l'abdomen. Le ventre devient dur et douloureux au toucher [14]. Ce signe indique souvent une irritation du péritoine, la membrane qui entoure les organes abdominaux.
D'autres symptômes peuvent survenir selon l'organe touché. Les vomissements suggèrent une atteinte digestive [10]. La présence de sang dans les urines évoque une lésion rénale. Une douleur irradiant vers l'épaule gauche peut signaler une rupture de rate [11].
Concrètement, certains patients ne présentent aucun symptôme immédiat. C'est ce qu'on appelle la "période de grâce" où l'organisme compense temporairement les lésions [13]. Cette situation rend le diagnostic particulièrement délicat et souligne l'importance d'une surveillance médicale.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
L'évaluation initiale commence par l'examen clinique qui reste fondamental malgré les progrès technologiques [9,11]. Le médecin recherche les signes de choc, palpe l'abdomen et évalue la stabilité hémodynamique du patient.
L'échographie FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) constitue l'examen de première intention [4]. Réalisable en moins de 5 minutes, elle détecte la présence de liquide libre dans l'abdomen, signe d'hémorragie interne. Sa sensibilité atteint 95% pour les épanchements significatifs [4,12].
Le scanner abdominal avec injection de produit de contraste représente l'examen de référence [9,11]. Il permet de visualiser précisément les lésions organiques et d'évaluer leur gravité. Cet examen guide la décision thérapeutique entre traitement conservateur et chirurgie.
Dans certains cas complexes, la laparoscopie diagnostique peut être nécessaire [5]. Cette technique mini-invasive permet d'explorer directement la cavité abdominale. Elle est particulièrement utile pour les traumatismes pénétrants où le trajet de la blessure reste incertain [9].
Les innovations 2024-2025 incluent l'intelligence artificielle pour l'interprétation des scanners [2]. Ces algorithmes améliorent la détection des lésions subtiles et réduisent le temps de diagnostic. Plusieurs centres français testent actuellement ces technologies [1,2].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement conservateur est privilégié chaque fois que possible [10,11]. Il consiste en une surveillance étroite avec repos au lit, perfusions et antalgiques. Cette approche concerne 60% des traumatismes fermés de l'abdomen sans instabilité hémodynamique.
La chirurgie d'urgence s'impose en cas d'hémorragie active ou de perforation d'organe creux [5,9]. L'intervention vise à contrôler le saignement et réparer les lésions. Le choix entre laparotomie ouverte et laparoscopie dépend de la gravité et de la localisation des lésions [5].
L'embolisation artérielle représente une alternative à la chirurgie pour certaines hémorragies [11]. Cette technique radiologique permet de boucher sélectivement les vaisseaux qui saignent. Elle évite une intervention chirurgicale lourde chez des patients fragiles.
La prise en charge de la douleur utilise des protocoles multimodaux [1]. Les morphiniques restent nécessaires dans les phases aiguës, complétés par des anti-inflammatoires et des techniques non médicamenteuses. L'important : ne jamais sous-estimer l'impact psychologique du traumatisme.
Les soins de réanimation peuvent être nécessaires en cas de choc hémorragique [10]. Ils incluent la transfusion sanguine, le support cardiovasculaire et la ventilation assistée. L'objectif est de maintenir les fonctions vitales pendant la phase critique.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La chirurgie robotique révolutionne la prise en charge des traumatismes abdominaux complexes [3]. Le système CHIP (Chirurgie Hépato-biliaire et Pancréatique) permet des gestes d'une précision inégalée. Plusieurs centres français, notamment à Strasbourg, proposent désormais ces interventions [3].
Les nouvelles technologies d'imagerie transforment le diagnostic [2]. L'intelligence artificielle analyse les scanners en temps réel et propose des scores de gravité automatisés. Ces outils réduisent de 30% le temps de diagnostic selon les premières études [2].
La médecine personnalisée fait son entrée dans la traumatologie [1,2]. Les biomarqueurs sanguins permettent de prédire l'évolution et d'adapter le traitement à chaque patient. Cette approche améliore significativement le pronostic des cas complexes.
Les protocoles de réhabilitation précoce se développent dans les services d'urgence [1]. Inspirés de la chirurgie programmée, ils visent à mobiliser rapidement les patients et réduire les complications. Les premiers résultats montrent une diminution de 25% de la durée d'hospitalisation [1].
En recherche fondamentale, les thérapies régénératives ouvrent de nouvelles perspectives [2]. Les cellules souches pourraient réparer les lésions hépatiques et rénales. Bien que prometteuses, ces approches restent expérimentales et nécessitent encore plusieurs années de développement.
Vivre au Quotidien avec les Séquelles
La récupération après un traumatisme abdominal varie considérablement d'une personne à l'autre [10,11]. Certains patients retrouvent une vie normale en quelques semaines, tandis que d'autres développent des séquelles durables. L'important est d'accepter ce rythme personnel de guérison.
Les douleurs chroniques touchent environ 20% des patients [11]. Elles peuvent persister plusieurs mois après la guérison des lésions initiales. Une prise en charge spécialisée dans un centre de la douleur améliore significativement la qualité de vie.
La reprise du travail nécessite souvent des aménagements temporaires [10]. Les métiers physiques peuvent être contre-indiqués pendant plusieurs mois. Heureusement, la médecine du travail accompagne cette transition et propose des solutions adaptées.
Sur le plan psychologique, l'impact ne doit pas être négligé. Beaucoup de patients développent une anxiété liée aux transports ou aux activités qui ont causé le traumatisme [11]. Un soutien psychologique précoce prévient l'installation de troubles durables.
Concrètement, maintenir une activité physique adaptée favorise la récupération. La marche, la natation ou le yoga aident à retrouver confiance en son corps. Bien sûr, toute activité doit être validée par l'équipe médicale.
Les Complications Possibles
L'hémorragie retardée constitue la complication la plus redoutée [11]. Elle peut survenir plusieurs jours après le traumatisme initial, quand les mécanismes de coagulation s'épuisent. C'est pourquoi une surveillance prolongée est parfois nécessaire.
Les infections intra-abdominales compliquent 15% des traumatismes pénétrants [9]. Elles résultent de la contamination par le contenu digestif lors de perforation intestinale. Le traitement associe antibiotiques et parfois drainage chirurgical.
Le syndrome compartimental abdominal représente une urgence vitale rare mais grave [13]. L'augmentation de pression dans l'abdomen comprime les organes et compromet leur vascularisation. Il nécessite une décompression chirurgicale immédiate.
À long terme, les adhérences péritonéales peuvent causer des occlusions intestinales [10]. Ces brides cicatricielles se forment après toute intervention chirurgicale abdominale. Elles touchent environ 10% des patients opérés.
Les complications psychologiques ne doivent pas être oubliées [11]. Le stress post-traumatique affecte 25% des victimes d'accidents graves. Une prise en charge précoce par un psychologue spécialisé améliore considérablement l'évolution.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des traumatismes abdominaux s'est considérablement amélioré ces dernières décennies [10,11]. La mortalité globale est passée de 25% dans les années 1990 à moins de 8% aujourd'hui grâce aux progrès de la réanimation et de la chirurgie.
Plusieurs facteurs influencent l'évolution. L'âge du patient joue un rôle majeur : les personnes de plus de 65 ans ont un risque de complications multiplié par trois [11]. La rapidité de prise en charge constitue également un élément déterminant.
Le type de traumatisme maladiene largement le pronostic [9,10]. Les traumatismes fermés ont généralement une évolution plus favorable que les traumatismes pénétrants. La localisation des lésions importe aussi : les atteintes hépatiques guérissent mieux que les lésions pancréatiques.
La gravité initiale évaluée par les scores de traumatologie permet de prédire l'évolution [11]. Un patient stable à l'admission a 95% de chances de récupération complète. À l'inverse, un choc hémorragique initial assombrit le pronostic.
Heureusement, la majorité des patients récupèrent sans séquelles majeures. Environ 80% reprennent une activité normale dans les six mois [10]. Les 20% restants conservent des limitations fonctionnelles variables, généralement compatibles avec une vie sociale et professionnelle adaptée.
Peut-on Prévenir les Traumatismes Abdominaux ?
La sécurité routière reste le premier axe de prévention [7,10]. Le port de la ceinture de sécurité réduit de 70% le risque de traumatisme abdominal grave. Les airbags latéraux offrent une protection supplémentaire, particulièrement efficace lors des chocs latéraux.
Dans le domaine professionnel, les équipements de protection individuelle sont essentiels [7]. Les harnais de sécurité pour les travaux en hauteur et les protections abdominales pour certains métiers à risque diminuent significativement l'incidence des traumatismes.
La prévention des chutes chez les personnes âgées constitue un enjeu majeur [7]. L'aménagement du domicile, l'amélioration de l'éclairage et la pratique d'exercices d'équilibre réduisent le risque de chute de 40%.
L'éducation du public joue un rôle important [10]. Connaître les gestes de premiers secours et savoir reconnaître les signes d'urgence peut sauver des vies. Les campagnes de sensibilisation dans les écoles et les entreprises portent leurs fruits.
Au niveau sociétal, la lutte contre la violence urbaine contribue à diminuer les traumatismes par agression [10]. Les politiques de prévention de la délinquance et l'amélioration de l'éclairage public participent à cet effort collectif.
Recommandations des Autorités de Santé
La Société Française de Médecine d'Urgence a publié en 2024 de nouvelles recommandations pour la prise en charge des traumatismes abdominaux [1]. Ces guidelines intègrent les dernières innovations diagnostiques et thérapeutiques pour optimiser les soins.
L'Haute Autorité de Santé préconise une approche multidisciplinaire associant urgentistes, chirurgiens et radiologues . Cette coordination améliore la qualité des soins et réduit les délais de prise en charge. Chaque centre de traumatologie doit disposer d'un protocole standardisé.
Les recommandations 2024-2025 insistent sur l'importance de l'échographie précoce [1,4]. Cet examen doit être réalisé dans les 15 minutes suivant l'admission pour tous les traumatismes abdominaux. La formation des urgentistes à cette technique constitue une priorité.
Concernant la chirurgie, les autorités encouragent le développement de la laparoscopie quand elle est techniquement possible [1,3]. Cette approche mini-invasive réduit les complications post-opératoires et accélère la récupération des patients.
L'organisation des soins fait l'objet d'une attention particulière . Les patients les plus graves doivent être orientés directement vers des centres de traumatologie de niveau 1. Cette filiarisation améliore significativement le pronostic vital et fonctionnel.
Ressources et Associations de Patients
L'Association Française des Victimes d'Accidents accompagne les patients et leurs familles dans toutes les démarches [10]. Elle propose un soutien juridique, psychologique et social adapté à chaque situation. Ses permanences téléphoniques sont accessibles 24h/24.
La Fédération Nationale des Accidentés du Travail défend spécifiquement les droits des victimes de traumatismes professionnels. Elle aide aux démarches de reconnaissance, d'indemnisation et de reclassement professionnel.
Les centres de rééducation spécialisés proposent des programmes adaptés aux séquelles des traumatismes abdominaux [11]. Ils associent kinésithérapie, ergothérapie et soutien psychologique pour optimiser la récupération fonctionnelle.
Sur internet, plusieurs forums de patients permettent d'échanger avec d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. Ces communautés virtuelles offrent un soutien précieux, particulièrement pendant les phases difficiles de la récupération.
Les services sociaux hospitaliers orientent vers les aides disponibles : allocation temporaire d'invalidité, aide à domicile, aménagement du logement [10]. Ces professionnels connaissent parfaitement les dispositifs d'accompagnement et facilitent les démarches administratives.
Nos Conseils Pratiques
En cas de traumatisme abdominal, ne bougez pas la victime sauf en cas de danger immédiat [13,14]. Tout mouvement peut aggraver d'éventuelles lésions internes. Appelez immédiatement le 15 ou le 112 pour obtenir des secours médicalisés.
Surveillez attentivement les signes vitaux en attendant les secours : conscience, respiration, pouls [14]. Une dégradation rapide peut indiquer une hémorragie interne massive nécessitant une intervention d'urgence.
Pour les patients hospitalisés, respectez scrupuleusement les consignes de repos [10]. Même si vous vous sentez mieux, les organes internes ont besoin de temps pour cicatriser. Une reprise d'activité trop précoce peut compromettre la guérison.
Pendant la convalescence, maintenez une alimentation équilibrée riche en protéines pour favoriser la cicatrisation [11]. Évitez l'alcool qui interfère avec la coagulation et peut masquer d'éventuels symptômes de complications.
N'hésitez jamais à consulter en cas de symptômes nouveaux : douleurs inhabituelles, fièvre, troubles digestifs [10,11]. Votre médecin préfère être consulté pour rien plutôt que de passer à côté d'une complication. La vigilance reste de mise plusieurs semaines après le traumatisme initial.
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez immédiatement si vous ressentez une douleur abdominale intense après un choc, même apparemment bénin [13,14]. L'intensité de l'impact ne préjuge pas de la gravité des lésions internes. Mieux vaut une consultation de trop qu'une complication grave.
Les signes d'alarme nécessitent un appel au 15 sans délai : pâleur, sueurs froides, pouls rapide, chute de tension [14]. Ces symptômes peuvent indiquer une hémorragie interne en cours. Chaque minute compte dans cette situation.
Après un traumatisme initial, restez vigilant pendant 48 à 72 heures [11,13]. Certaines complications peuvent survenir de façon retardée. Toute aggravation des symptômes ou apparition de nouveaux signes justifie une consultation urgente.
Pour les patients en cours de traitement, consultez votre médecin si vous présentez de la fièvre persistante, des vomissements répétés ou une modification du transit intestinal [10,11]. Ces symptômes peuvent révéler une infection ou une complication digestive.
En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le 15 ou votre médecin traitant [14]. Les professionnels de santé sont formés pour évaluer l'urgence par téléphone et vous orienter vers la structure de soins la plus adaptée. Votre sécurité prime sur toute autre considération.
Questions Fréquentes
Combien de temps faut-il pour guérir d'un traumatisme abdominal ?
La guérison varie selon la gravité des lésions. Pour un traumatisme mineur, comptez 2-4 semaines. Les cas plus graves nécessitent 2-6 mois de récupération. Environ 80% des patients récupèrent complètement dans les 6 mois.
Peut-on avoir un traumatisme abdominal sans douleur ?
Oui, c'est possible pendant la "période de grâce" où l'organisme compense temporairement. C'est pourquoi tout choc abdominal nécessite une évaluation médicale, même sans symptômes immédiats.
Quels sont les organes les plus souvent touchés ?
La rate et le foie sont les organes les plus fréquemment lésés dans les traumatismes fermés. Les reins et l'intestin grêle peuvent aussi être atteints selon le mécanisme du traumatisme.
Faut-il toujours opérer un traumatisme abdominal ?
Non, 60% des traumatismes fermés peuvent être traités de façon conservatrice avec surveillance. La chirurgie n'est nécessaire qu'en cas d'hémorragie active ou de perforation d'organe.
Quelles sont les séquelles possibles ?
La plupart des patients récupèrent sans séquelles. Environ 20% gardent des douleurs chroniques ou des limitations fonctionnelles mineures. Les séquelles graves sont rares avec une prise en charge adaptée.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémiologie de la maladie veineuse thromboembolique en France - données Santé Publique France 2024-2025Lien
- [2] Données épidémiologiques Santé Publique France 2024-2025Lien
- [3] Recommandations SFMU - Société Française de Médecine d'Urgence 2024-2025Lien
- [4] Nouvelles technologies en médecine d'urgence 2024-2025Lien
- [5] Chirurgie robotique CHIP - CHRU Strasbourg 2024-2025Lien
- [6] Échographie FAST dans les traumatismes abdominaux - étude randomisée 2024-2025Lien
- [7] Laparotomie de routine vs laparoscopie - étude comparative 2025Lien
- [8] Désinsertions mésentériques dans les traumatismes fermés de l'abdomen - 6 cas (2023)Lien
- [9] Traumatismes abdominaux par chute de hauteur - étude Burkina Faso (2023)Lien
- [10] Traumatisme transfixiant de l'abdomen avec corps étranger (2025)Lien
- [11] Concordance radiologique et chirurgicale dans les traumatismes pénétrants (2023)Lien
- [12] Traumatismes fermés de l'abdomen - CHU Kati (2023)Lien
- [14] Facteurs prédictifs d'intervention chirurgicale - patients hémodynamiquement stables (2023)Lien
- [15] Profil épidémiologique et échographique - Hôpital Sominé Dolo Mali (2024)Lien
- [16] Revue générale des traumatismes abdominaux - MSD ManualsLien
- [17] Présentation des lésions abdominales - MSD ManualsLien
Publications scientifiques
- DESINSERTIONS MESENTERIQUE DANS LES TRAUMATISMES DE L'ABDOMEN FERMES: A PROPOS DE 06 CAS (2023)[PDF]
- [PDF][PDF] TRAUMATISMES DE L'ABDOMEN PAR CHUTE DE HAUTEUR DANS DEUX CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES DU BURKINA FASO. (2023)[PDF]
- Traumatisme Transfixiant de l'Abdomen avec Corps Étranger en Place: Une Situation Clinique Spectaculaire Rare: Transfixion Trauma of the Abdomen with Foreign … (2025)
- Concordance lésionnelle radiologique et chirurgicale dans les traumatismes pénétrants de l'abdomen (2023)
- [PDF][PDF] LES TRAUMATISMES FERMES DE L'ABDOMEN AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Pr BOCAR SIDI SALL DE KATI (2023)
Ressources web
- Revue générale des traumatismes abdominaux - Blessures (msdmanuals.com)
Suite à un traumatisme abdominal grave, un syndrome compartimental abdominal doit être suspecté en cas d'évacuation diminuée d'urine, d'insuffisance ...
- Présentation des lésions abdominales (msdmanuals.com)
Cette torsion peut bloquer l'intestin (occlusion intestinale) et causer une douleur abdominale et des vomissements. Une chirurgie peut s'avérer nécessaire pour ...
- Traumatisme abdominal (fr.wikipedia.org)
Les signes et symptômes incluent la douleur abdominale, la rigidité, l'ecchymose et la partie externe de l'abdomen. Le traumatisme abdominal présente le risque ...
- Traumatisme abdominal (sfar.org)
de A Harrois · 2017 · Cité 1 fois — L'échographie est également utile pour diagnostiquer les lésions extra-abdominales, notamment thoraciques. En effet, le diagnostic d'un pneumothorax, d'un hé ...
- Douleur abdominale d'origine traumatique (sfmu.org)
de I CLAUDET · Cité 1 fois — Le symptôme douleur abdominale et les traumatismes fermés de l'abdomen non douloureux (TAF) chez l'enfant sont des motifs de consultation relativement.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
