Thrombose Veineuse Profonde du Membre Supérieur : Guide Complet 2025
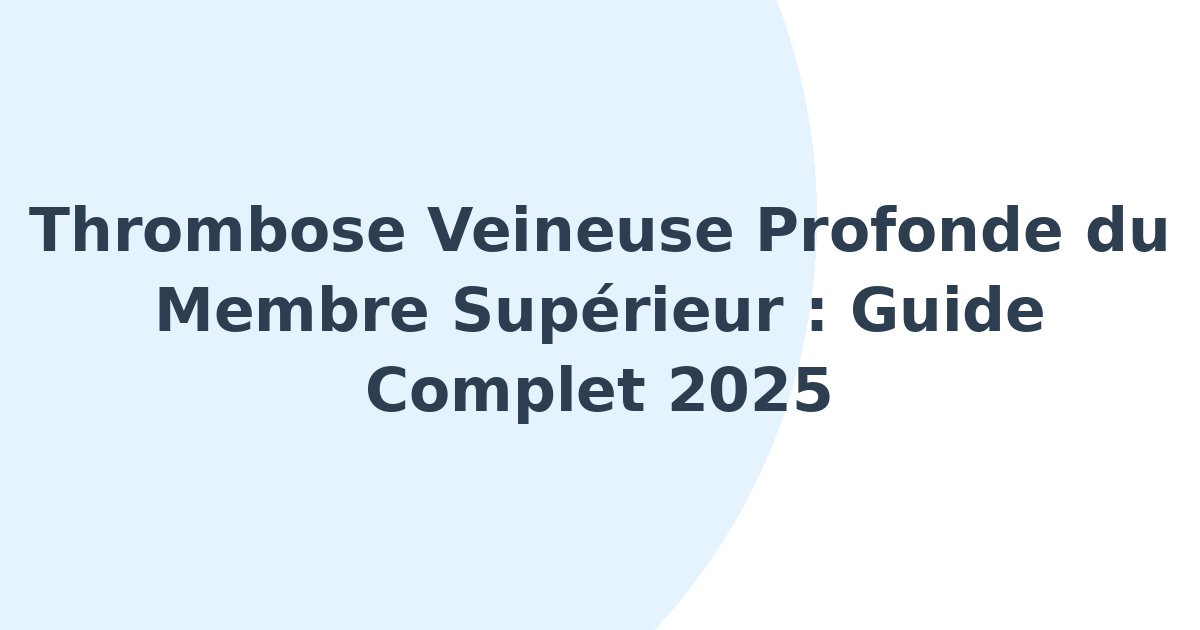
La thrombose veineuse profonde du membre supérieur représente une pathologie vasculaire moins connue que sa cousine des jambes, mais tout aussi préoccupante. Cette maladie touche environ 4 à 10% de toutes les thromboses veineuses profondes en France [1,2]. Contrairement aux idées reçues, elle peut survenir chez des personnes jeunes et actives. Comprendre ses mécanismes, reconnaître ses signes et connaître les traitements disponibles devient essentiel pour une prise en charge optimale.
Téléconsultation et Thrombose veineuse profonde du membre supérieur
Téléconsultation non recommandéeLa thrombose veineuse profonde du membre supérieur nécessite un diagnostic urgent par échographie-Doppler et une prise en charge thérapeutique immédiate par anticoagulation. L'examen clinique et les examens d'imagerie sont indispensables pour confirmer le diagnostic et évaluer l'extension du caillot. La téléconsultation ne permet pas de réaliser ces examens essentiels et pourrait retarder une prise en charge vitale.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique des symptômes et de leur évolution temporelle, évaluation des facteurs de risque thromboembolique (immobilisation, cancer, contraception), analyse des antécédents familiaux de thrombose, orientation vers une prise en charge urgente adaptée, suivi post-thérapeutique une fois le diagnostic confirmé.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique du membre atteint pour rechercher les signes de thrombose, réalisation d'une échographie-Doppler veineuse pour confirmer le diagnostic, prescription et surveillance d'un traitement anticoagulant, recherche de complications comme l'embolie pulmonaire.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion clinique de thrombose veineuse profonde nécessitant une échographie-Doppler urgente, nécessité d'initier un traitement anticoagulant avec surveillance biologique, évaluation de l'extension du caillot et du risque embolique, recherche de la cause sous-jacente de la thrombose.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Douleur thoracique ou essoufflement évoquant une embolie pulmonaire, gonflement massif du membre avec cyanose, fièvre associée évoquant une thrombophlébite septique.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Douleur thoracique brutale avec essoufflement (suspicion d'embolie pulmonaire)
- Gonflement massif et douloureux du bras avec cyanose ou pâleur
- Fièvre élevée associée aux signes de thrombose (risque septique)
- Engourdissement ou paralysie du membre atteint
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Angiologue ou médecine vasculaire — consultation en présentiel indispensable
L'angiologue ou le spécialiste en médecine vasculaire dispose de l'expertise spécifique pour le diagnostic et la prise en charge des thromboses veineuses. Une consultation en présentiel est indispensable pour réaliser l'échographie-Doppler diagnostique et initier le traitement anticoagulant approprié.
Thrombose veineuse profonde du membre supérieur : Définition et Vue d'Ensemble
La thrombose veineuse profonde du membre supérieur correspond à la formation d'un caillot sanguin dans les veines profondes du bras, de l'avant-bras ou de l'épaule. Cette pathologie affecte principalement les veines axillaire, sous-clavière, humérale ou brachiocéphalique [8,9].
Mais pourquoi parle-t-on de veines "profondes" ? En fait, notre système veineux comprend deux réseaux distincts : les veines superficielles, visibles sous la peau, et les veines profondes, situées plus en profondeur dans les muscles. Quand un caillot se forme dans ces dernières, les conséquences peuvent être graves [10].
D'ailleurs, cette maladie présente des particularités qui la distinguent de la thrombose veineuse des membres inférieurs. L'anatomie du membre supérieur, avec ses nombreux passages étroits entre les côtes et la clavicule, crée des zones de compression naturelle qui favorisent la stagnation sanguine [6,7].
Concrètement, le caillot peut partiellement ou complètement obstruer la circulation veineuse. Cette obstruction empêche le sang de remonter normalement vers le cœur, provoquant un engorgement en aval. L'important à retenir : plus le diagnostic est précoce, meilleur sera le pronostic.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes de Santé Publique France révèlent des chiffres préoccupants concernant la maladie veineuse thromboembolique dans son ensemble [1,2]. En France, on estime que 4 à 10% de toutes les thromboses veineuses profondes concernent les membres supérieurs, soit environ 8 000 à 12 000 nouveaux cas par an.
L'incidence de cette pathologie a considérablement augmenté ces dernières décennies. Cette hausse s'explique principalement par l'utilisation croissante de dispositifs médicaux invasifs : cathéters veineux centraux, stimulateurs cardiaques, défibrillateurs implantables [6]. En effet, près de 80% des thromboses du membre supérieur sont désormais liées à ces dispositifs médicaux.
Mais les données varient selon l'âge et le sexe. Les femmes présentent un risque légèrement supérieur, notamment entre 20 et 40 ans, période où les facteurs hormonaux (contraception, grossesse) jouent un rôle important [7]. Chez les hommes, le pic d'incidence se situe plutôt après 50 ans, souvent en lien avec des pathologies cardiovasculaires ou cancéreuses.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne haute avec une incidence de 0,4 à 1 cas pour 1000 habitants par an. Les pays nordiques affichent des taux légèrement supérieurs, probablement en raison d'un meilleur dépistage et d'une surveillance accrue des patients à risque [1,2].
L'évolution temporelle montre une tendance inquiétante : l'incidence a doublé en 15 ans, passant de 2 à 4 cas pour 100 000 habitants. Cette augmentation reflète non seulement l'amélioration du diagnostic, mais aussi l'évolution de nos modes de vie et de nos pratiques médicales .
Les Causes et Facteurs de Risque
Comprendre les causes de la thrombose veineuse profonde du membre supérieur nécessite de distinguer deux grandes catégories : les formes primaires et secondaires. Cette distinction est cruciale car elle influence directement la prise en charge [7].
Les formes secondaires représentent 80 à 90% des cas. Elles résultent principalement de la présence de cathéters veineux centraux, utilisés pour les chimiothérapies, la nutrition parentérale ou l'hémodialyse [6]. Ces dispositifs créent une irritation de la paroi veineuse et modifient les flux sanguins, favorisant la formation de caillots.
D'ailleurs, les stimulateurs cardiaques et défibrillateurs constituent une cause croissante. Une étude récente montre que 2 à 5% des patients développent une thrombose dans les mois suivant l'implantation . Le risque est particulièrement élevé chez les personnes âgées ou présentant des troubles de la coagulation.
Mais il existe aussi des causes moins évidentes. Le syndrome du défilé thoracique peut comprimer les vaisseaux entre la clavicule et la première côte. Certaines activités répétitives, comme le lancer au baseball ou la natation intensive, peuvent également déclencher cette pathologie chez des sportifs jeunes [7].
Les facteurs de risque généraux incluent l'âge avancé, les antécédents familiaux de thrombose, certains cancers (notamment hématologiques), les troubles de la coagulation héréditaires, et l'immobilisation prolongée . Bon à savoir : même une immobilisation du bras après une fracture peut suffire à déclencher une thrombose.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la thrombose veineuse profonde du membre supérieur peuvent être trompeurs et parfois discrets. Cette particularité explique pourquoi le diagnostic est souvent retardé, avec des conséquences potentiellement graves [10].
Le signe le plus caractéristique reste le gonflement du bras, généralement unilatéral et d'apparition progressive. Ce gonflement peut concerner tout le membre ou seulement une partie, selon la localisation du caillot. Vous pourriez remarquer que vos bagues deviennent trop serrées ou que votre montre laisse des marques [8,9].
La douleur constitue un autre symptôme fréquent, mais sa présentation varie énormément. Certains patients décrivent une sensation de lourdeur, d'autres une douleur sourde ou lancinante. Cette douleur s'aggrave typiquement lors des mouvements du bras ou de la pression [7].
D'autres signes peuvent vous alerter : une coloration bleutée ou violacée de la peau, l'apparition de veines superficielles dilatées et visibles (circulation collatérale), une sensation de chaleur locale. Parfois, des fourmillements ou une diminution de la force musculaire accompagnent ces symptômes .
Attention cependant : environ 30% des thromboses du membre supérieur restent asymptomatiques ou présentent des signes très discrets. C'est pourquoi une surveillance particulière s'impose chez les patients porteurs de dispositifs médicaux [6]. Il est normal de s'inquiéter face à ces symptômes, mais rassurez-vous : un diagnostic précoce permet une prise en charge efficace.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la thrombose veineuse profonde du membre supérieur repose sur une démarche méthodique combinant examen clinique et examens complémentaires. Cette approche structurée permet d'éviter les erreurs diagnostiques et les retards de prise en charge [8,9].
L'examen clinique constitue la première étape. Votre médecin recherchera les signes évocateurs : asymétrie des membres, coloration cutanée, circulation collatérale visible. Il évaluera également vos facteurs de risque et vos antécédents médicaux. Cette évaluation clinique permet d'établir une probabilité pré-test [10].
L'échographie-Doppler représente l'examen de référence. Cet examen non invasif permet de visualiser directement le caillot et d'évaluer les flux sanguins. Sa sensibilité dépasse 95% pour les veines proximales (axillaire, sous-clavière), mais elle diminue pour les veines plus distales [7]. L'avantage : cet examen peut être répété généralement bien toléré.
Parfois, des examens complémentaires s'avèrent nécessaires. La phlébographie, bien que plus invasive, reste l'examen de référence dans les cas douteux. Le scanner avec injection de produit de contraste peut également apporter des informations précieuses, notamment pour évaluer l'extension du caillot .
Les D-dimères sanguins, marqueurs de la coagulation, peuvent aider au diagnostic. Cependant, leur interprétation reste délicate car de nombreuses pathologies peuvent les élever. Un taux normal permet d'exclure une thrombose avec une bonne fiabilité, mais un taux élevé ne confirme pas le diagnostic [6].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la thrombose veineuse profonde du membre supérieur a considérablement évolué ces dernières années. L'objectif principal reste la dissolution du caillot et la prévention des complications, notamment l'embolie pulmonaire [9,10].
L'anticoagulation constitue le traitement de première ligne. Les héparines de bas poids moléculaire, administrées par injection sous-cutanée, permettent un traitement immédiat et efficace. Leur avantage : une action rapide et un contrôle biologique simplifié [4]. Le relais par anticoagulants oraux s'effectue généralement après 5 à 7 jours.
Les anticoagulants oraux directs (AOD) révolutionnent la prise en charge. Ces médicaments, comme le rivaroxaban ou l'apixaban, ne nécessitent pas de surveillance biologique régulière et présentent moins d'interactions médicamenteuses. Leur efficacité égale celle des traitements classiques avec un profil de sécurité amélioré [5].
Dans certains cas sévères, la thrombolyse peut être envisagée. Cette technique consiste à injecter directement des médicaments dissolvant les caillots au niveau de la thrombose. Elle s'adresse principalement aux patients jeunes présentant une thrombose étendue avec risque de séquelles importantes [3].
Bon à savoir : la durée du traitement anticoagulant varie selon le contexte. Pour une thrombose liée à un facteur déclenchant temporaire (cathéter, immobilisation), 3 mois suffisent généralement. En cas de facteur de risque persistant ou de récidive, le traitement peut se prolonger plusieurs années [7].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de la thrombose veineuse profonde du membre supérieur avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses [3,4].
Le traitement endovasculaire des syndromes post-thrombotiques représente une avancée majeure. Cette technique mini-invasive permet de traiter les séquelles à long terme des thromboses en restaurant la perméabilité veineuse. Les premiers résultats montrent une amélioration significative de la qualité de vie des patients [3].
L'innovation se situe également dans l'accompagnement pharmaceutique. Les entretiens pharmaceutiques sur les anticoagulants oraux se généralisent dans les pharmacies françaises. Ces consultations permettent d'optimiser l'observance thérapeutique et de réduire les complications liées aux traitements anticoagulants [4].
D'ailleurs, la recherche internationale apporte de nouveaux éclairages. L'American Society of Hematology a publié en 2024 de nouvelles recommandations intégrant les données les plus récentes sur la prise en charge des thromboses veineuses [5]. Ces guidelines mettent l'accent sur la personnalisation des traitements selon le profil de chaque patient.
Les techniques d'imagerie évoluent également. De nouveaux protocoles d'échographie permettent une détection plus précoce et plus précise des thromboses, notamment chez les patients porteurs de dispositifs médicaux . Cette amélioration diagnostique ouvre la voie à des traitements plus ciblés et plus efficaces.
Vivre au Quotidien avec une Thrombose Veineuse Profonde du Membre Supérieur
Vivre avec une thrombose veineuse profonde du membre supérieur nécessite des adaptations, mais ne doit pas compromettre votre qualité de vie. L'important est de comprendre les enjeux et d'adopter les bonnes stratégies [7,8].
La gestion du traitement anticoagulant constitue un défi quotidien. Vous devrez surveiller les signes de saignement, adapter votre alimentation si vous prenez des antivitamines K, et maintenir une observance rigoureuse. Les anticoagulants oraux directs simplifient considérablement cette gestion [4,5].
L'activité physique reste possible et même recommandée. Cependant, certaines précautions s'imposent : éviter les sports de contact, privilégier les activités douces comme la marche ou la natation, porter une compression si recommandée par votre médecin. L'objectif : maintenir une bonne circulation généralement bien tolérér de traumatisme [9].
Au niveau professionnel, des aménagements peuvent être nécessaires. Si votre travail implique des gestes répétitifs du bras ou le port de charges lourdes, discutez avec votre médecin du travail des adaptations possibles. La plupart des patients peuvent reprendre une activité normale après la phase aiguë [7].
Concrètement, surveillez l'apparition de nouveaux symptômes : augmentation du gonflement, douleur inhabituelle, essoufflement. Ces signes peuvent indiquer une complication et nécessitent une consultation rapide. Rassurez-vous : avec un suivi adapté, la plupart des patients retrouvent une vie normale.
Les Complications Possibles
Les complications de la thrombose veineuse profonde du membre supérieur peuvent être précoces ou tardives. Leur connaissance permet une surveillance adaptée et une prise en charge optimale [9,10].
L'embolie pulmonaire représente la complication la plus redoutable. Elle survient lorsqu'un fragment du caillot se détache et migre vers les poumons. Cette complication touche 10 à 15% des patients, d'où l'importance d'un traitement anticoagulant précoce [1,2]. Les signes d'alerte incluent un essoufflement soudain, des douleurs thoraciques, une toux.
Le syndrome post-thrombotique constitue la principale complication à long terme. Il se caractérise par un gonflement persistant, des douleurs chroniques, et parfois des troubles trophiques cutanés. Cette complication touche environ 20 à 30% des patients dans les années suivant l'épisode initial [3].
D'autres complications peuvent survenir : extension de la thrombose vers d'autres territoires veineux, récidive thrombotique (5 à 10% des cas), complications hémorragiques liées au traitement anticoagulant. Ces risques justifient un suivi médical régulier [7].
Heureusement, les innovations thérapeutiques récentes permettent de réduire significativement ces risques. Les nouveaux anticoagulants diminuent le risque hémorragique, tandis que les techniques endovasculaires offrent de nouvelles perspectives pour traiter les séquelles [3,5]. L'important : ne pas négliger le suivi médical même après la guérison apparente.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la thrombose veineuse profonde du membre supérieur dépend de nombreux facteurs, mais reste globalement favorable avec une prise en charge adaptée [8,9].
À court terme, le pronostic vital est excellent. Le risque de décès directement lié à la thrombose reste très faible, inférieur à 1%. Cependant, l'embolie pulmonaire peut compliquer l'évolution dans 10 à 15% des cas, d'où l'importance d'un traitement anticoagulant précoce [1,2].
La récupération fonctionnelle s'avère généralement satisfaisante. La plupart des patients retrouvent un usage normal de leur bras dans les 3 à 6 mois suivant le diagnostic. Néanmoins, environ 20% conservent des séquelles mineures : gonflement intermittent, sensation de lourdeur, intolérance à l'effort [7].
Le risque de récidive varie selon le contexte initial. Pour les thromboses liées à un facteur déclenchant temporaire (cathéter, immobilisation), le risque de récidive reste faible, inférieur à 5%. En revanche, en cas de thrombophilie héréditaire ou de cancer, ce risque peut atteindre 15 à 20% .
Bon à savoir : l'âge au moment du diagnostic influence le pronostic. Les patients jeunes présentent généralement une meilleure récupération fonctionnelle, mais aussi un risque de récidive plus élevé sur le long terme. À l'inverse, les patients âgés récupèrent moins bien mais récidivent moins souvent .
Peut-on Prévenir la Thrombose Veineuse Profonde du Membre Supérieur ?
La prévention de la thrombose veineuse profonde du membre supérieur repose sur l'identification et la gestion des facteurs de risque. Cette approche préventive s'avère particulièrement efficace chez les patients à haut risque [6,7].
Chez les porteurs de cathéters veineux centraux, plusieurs mesures préventives ont prouvé leur efficacité. L'utilisation de cathéters de petit calibre, leur positionnement optimal, et leur retrait dès que possible réduisent significativement le risque thrombotique. Certains centres proposent même une anticoagulation préventive chez les patients à très haut risque [6].
Pour les patients devant recevoir un stimulateur cardiaque, la prévention passe par une technique chirurgicale optimisée et parfois une anticoagulation temporaire. Les nouvelles techniques d'implantation réduisent le traumatisme vasculaire et donc le risque de thrombose .
Au niveau individuel, certaines mesures simples peuvent aider : maintenir une activité physique régulière, éviter l'immobilisation prolongée du bras, traiter les facteurs de risque cardiovasculaire. Chez les femmes, la discussion sur la contraception hormonale peut être pertinente en cas d'antécédents familiaux [7].
D'ailleurs, la sensibilisation des professionnels de santé joue un rôle crucial. Une meilleure reconnaissance des signes précoces permet un diagnostic plus rapide et donc une prévention des complications. Les programmes de formation continue intègrent désormais cette problématique [4].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises et internationales ont émis des recommandations précises concernant la prise en charge de la thrombose veineuse profonde du membre supérieur [1,2,5].
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche diagnostique standardisée. L'échographie-Doppler doit être réalisée dans les 24 heures suivant la suspicion clinique. En cas de forte suspicion et d'échographie non contributive, un scanner ou une phlébographie peuvent être nécessaires [8,9].
Concernant le traitement, les recommandations privilégient les anticoagulants oraux directs en première intention, sauf contre-indication. La durée minimale de traitement est fixée à 3 mois, avec possibilité de prolongation selon le contexte clinique. L'évaluation du rapport bénéfice-risque doit être régulière [4,5].
Santé Publique France insiste sur l'importance de la surveillance épidémiologique. Les données de 2024-2025 montrent une augmentation préoccupante de l'incidence, justifiant un renforcement des mesures préventives, notamment en milieu hospitalier [1,2].
Au niveau international, l'American Society of Hematology a publié en 2024 des guidelines actualisées. Ces recommandations mettent l'accent sur la personnalisation des traitements et l'intégration des nouvelles thérapies endovasculaires [5]. L'harmonisation des pratiques entre pays devient un enjeu majeur pour optimiser la prise en charge.
Ressources et Associations de Patients
Faire face à une thrombose veineuse profonde du membre supérieur ne doit pas se faire dans l'isolement. De nombreuses ressources existent pour vous accompagner dans cette épreuve.
L'Association Française pour la Prévention des Thromboses et des Embolies (AFPTE) propose des informations fiables et un soutien aux patients. Leurs brochures explicatives et leurs forums d'échange permettent de mieux comprendre la maladie et de partager son expérience avec d'autres patients.
Les centres de référence des maladies vasculaires rares offrent une expertise spécialisée. Ces centres, répartis sur le territoire français, proposent des consultations multidisciplinaires et participent aux protocoles de recherche les plus innovants [3].
D'ailleurs, les pharmaciens jouent un rôle croissant dans l'accompagnement. Les entretiens pharmaceutiques sur les anticoagulants, désormais remboursés, permettent d'optimiser votre traitement et de répondre à vos questions pratiques [4].
Les ressources numériques se développent également. Applications mobiles de suivi du traitement, sites web d'information médicale validée, téléconsultations spécialisées : ces outils modernes facilitent la gestion quotidienne de votre pathologie. L'important : toujours vérifier la fiabilité des sources d'information.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une thrombose veineuse profonde du membre supérieur nécessite quelques adaptations pratiques. Ces conseils, issus de l'expérience clinique et des témoignages de patients, peuvent vous faciliter le quotidien.
Pour la gestion du traitement anticoagulant, organisez-vous : pilulier hebdomadaire, rappels sur votre téléphone, carnet de suivi. Si vous voyagez, emportez toujours une ordonnance récente et une réserve de médicaments. En cas d'oubli, contactez rapidement votre médecin ou pharmacien [4].
Adaptez votre environnement de travail si nécessaire. Un support pour l'avant-bras, des pauses régulières, l'alternance des tâches peuvent prévenir la fatigue et les douleurs. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin du travail [7].
Côté alimentation, maintenez une alimentation équilibrée. Si vous prenez des antivitamines K, surveillez votre consommation de légumes verts riches en vitamine K, sans les supprimer complètement. L'objectif : maintenir des apports réguliers plutôt que de les faire varier [9].
Enfin, restez à l'écoute de votre corps. Notez vos symptômes, leur évolution, les facteurs déclenchants. Ces informations seront précieuses lors de vos consultations médicales. Et surtout, n'hésitez jamais à consulter en cas de doute : mieux vaut une consultation "pour rien" qu'une complication grave.
Quand Consulter un Médecin ?
Reconnaître les situations nécessitant une consultation médicale urgente peut sauver des vies. Avec une thrombose veineuse profonde du membre supérieur, certains signes ne trompent pas [9,10].
Consultez immédiatement si vous présentez des signes d'embolie pulmonaire : essoufflement soudain, douleur thoracique, toux avec crachats sanglants, malaise. Ces symptômes nécessitent un appel au 15 (SAMU) sans délai. N'attendez pas, n'hésitez pas : l'embolie pulmonaire peut être mortelle [1,2].
D'autres signes justifient une consultation rapide dans les 24 heures : aggravation brutale du gonflement du bras, apparition de douleurs intenses, coloration bleutée ou violacée de la peau, fièvre associée aux symptômes locaux. Ces signes peuvent indiquer une extension de la thrombose [7,8].
Si vous êtes sous traitement anticoagulant, surveillez les signes de saignement : saignements de nez répétés, hématomes spontanés, selles noires, urines rouges. Un saignement important nécessite un arrêt temporaire du traitement et une consultation urgente [4,5].
Pour le suivi de routine, planifiez des consultations régulières avec votre médecin traitant ou votre spécialiste. La fréquence dépend de votre situation : mensuelle au début, puis trimestrielle une fois la situation stabilisée. Ces consultations permettent d'adapter le traitement et de dépister précocement les complications [9].
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Thrombose veineuse profonde du membre supérieur :
Questions Fréquentes
Puis-je faire du sport avec une thrombose du membre supérieur ?
Oui, mais avec des précautions. Évitez les sports de contact et les efforts intenses du bras affecté pendant la phase aiguë. La natation douce, la marche, le vélo sont généralement autorisés.
Le traitement anticoagulant est-il à vie ?
Pas nécessairement. La durée dépend de la cause de votre thrombose. Pour une cause temporaire, 3 à 6 mois suffisent souvent. En cas de facteur de risque persistant, le traitement peut être prolongé.
Puis-je voyager en avion ?
Oui, mais prenez des précautions : levez-vous régulièrement, hydratez-vous, portez des vêtements amples. Emportez vos médicaments en cabine avec l'ordonnance.
La thrombose peut-elle récidiver ?
Le risque existe mais reste modéré (5 à 15% selon les cas). Le respect du traitement et le suivi médical réduisent considérablement ce risque.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémiologie de la maladie veineuse thromboembolique - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [2] Épidémiologie de la maladie veineuse thromboembolique en France - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [3] Traitement endovasculaire des syndromes post-thrombotiques - Innovation 2024-2025Lien
- [5] Entretien pharmaceutique sur les anticoagulants oraux - Innovation 2024-2025Lien
- [6] American Society of Hematology Guidelines - Innovation 2024-2025Lien
- [8] Thrombose veineuse profonde du membre supérieur associée à un cathéter veineux central chez les patients cancéreuxLien
- [11] Thromboses veineuses profondes du membre supérieur: analyse de 28 casLien
- [16] Thrombose veineuse profonde du membre supérieur - Revue Médicale SuisseLien
- [17] Thrombose veineuse profonde - MSD ManualsLien
- [18] Les symptômes et complications de la thrombose - VidalLien
Publications scientifiques
- Traduction et republication de:«Thrombose veineuse profonde du membre supérieur associée à un cathéter veineux central chez les patients cancéreux: diagnostic et … (2024)
- Médiastinite fibrosante idiopathique dans le cadre d'une fibrose multifocale révélée par une thrombose veineuse du membre supérieur: à propos d'une observation … (2023)
- Thrombose veineuse profonde symptomatique du membre supérieur après implantation d'un pacemaker: à propos d'un cas et revue de la littérature (2022)[PDF]
- Thromboses veineuses profondes du membre supérieur: analyse de 28 cas (2024)
- Thrombose veineuse extensive du membre supérieur après la vaccination anti-COVID-19 (2022)[PDF]
Ressources web
- Thrombose veineuse profonde du membre supérieur (revmed.ch)
4 févr. 2015 — A l'examen clinique, le syndrome obstructif veineux se manifeste par un œdème touchant le bras puis l'avant-bras et la main, associé à une ...
- Thrombose veineuse profonde - Troubles cardiovasculaires (msdmanuals.com)
6 juil. 2018 — Le diagnostic repose sur l'anamnèse et l'examen clinique et est confirmé par un examen objectif, typiquement une échographie doppler.
- Les symptômes et les complications de la thrombose ... (vidal.fr)
1 juil. 2022 — Des crampes, un engourdissement ou une sensation de chaleur dans le membre touché peuvent être ressentis. Mais dans la moitié des cas, la ...
- PRISE EN CHARGE DES THROMBOSES VEINEUSES ... (portailvasculaire.fr)
Une compression élastique du membre supérieur était prescrite pour 30% des patients. La TVP était associée à un Port-a-Cath ou un autre type de voie centrale ...
- Thrombose veineuse profonde (TVP) (msdmanuals.com)
Chez d'autres patients, si une veine profonde de la jambe est touchée, le mollet gonfle et peut devenir chaud, douloureux, et sensible au toucher. La cheville, ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
