Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
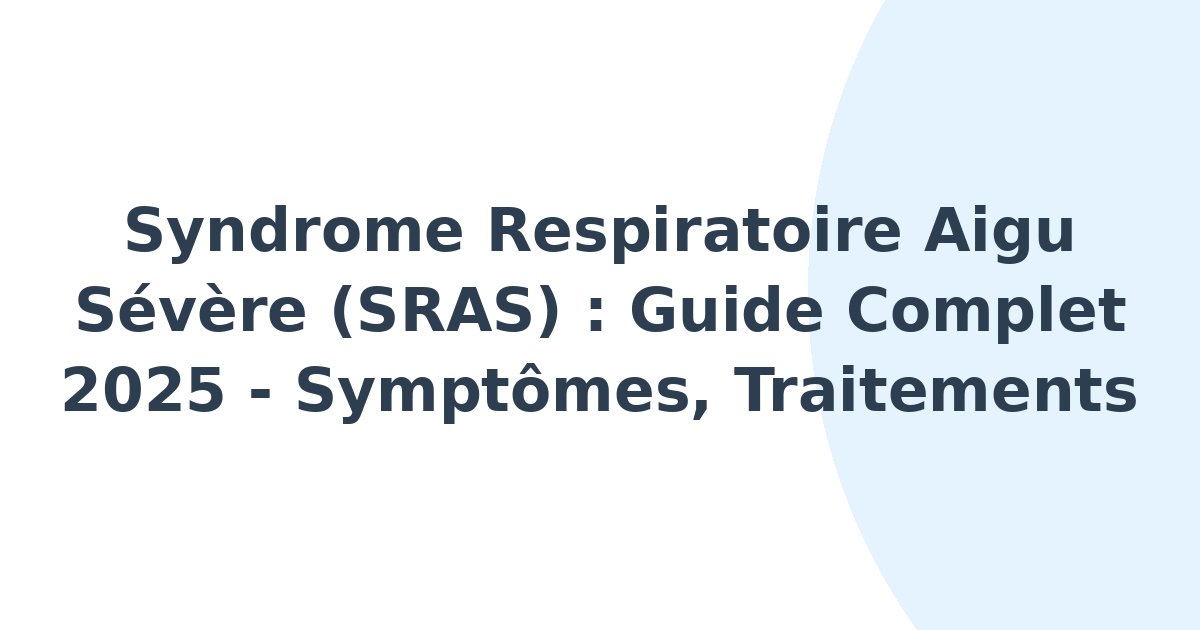
Le syndrome respiratoire aigu sévère, plus connu sous l'acronyme SRAS, est une pathologie respiratoire grave causée par un coronavirus. Cette maladie infectieuse, qui a marqué l'histoire médicale moderne, continue d'évoluer avec de nouvelles souches comme le SARS-CoV-2. Comprendre ses mécanismes, ses symptômes et les traitements disponibles est essentiel pour mieux l'appréhender.
Téléconsultation et Syndrome respiratoire aigu sévère
Téléconsultation non recommandéeLe syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est une pathologie infectieuse potentiellement mortelle nécessitant une prise en charge hospitalière immédiate avec isolement. L'évaluation clinique, les examens complémentaires urgents et la surveillance rapprochée sont indispensables pour évaluer la gravité et adapter le traitement.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique des symptômes respiratoires et leur évolution temporelle, évaluation des facteurs de risque d'exposition (voyage, contact), analyse des antécédents médicaux pertinents, orientation vers une prise en charge hospitalière urgente, coordination avec les équipes spécialisées.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique respiratoire complet avec auscultation pulmonaire, mesure de la saturation en oxygène et des paramètres vitaux, réalisation d'examens complémentaires urgents (radiographie thoracique, gazométrie, bilan biologique), mise en place de mesures d'isolement et de traitement de support.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion clinique de SRAS nécessitant confirmation diagnostique par tests spécialisés, détresse respiratoire même modérée nécessitant une évaluation clinique immédiate, fièvre élevée persistante avec altération de l'état général, nécessité de mise en place de mesures d'isolement et de surveillance hospitalière.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Détresse respiratoire aiguë avec dyspnée de repos, fièvre supérieure à 38°C avec signes de gravité systémique, suspicion forte de SRAS nécessitant isolement et prise en charge spécialisée immédiate.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Détresse respiratoire avec dyspnée de repos, tirage ou cyanose
- Fièvre élevée (>38,5°C) persistante avec altération marquée de l'état général
- Douleurs thoraciques intenses avec sensation d'oppression
- Confusion, agitation ou troubles de conscience associés aux symptômes respiratoires
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Pneumologue — consultation en présentiel indispensable
Le SRAS nécessite une prise en charge spécialisée en pneumologie ou médecine interne avec hospitalisation pour surveillance, examens complémentaires spécialisés et traitement de support. La consultation en présentiel est obligatoire pour l'évaluation clinique et la mise en place des mesures d'isolement.
Syndrome Respiratoire Aigu Sévère : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome respiratoire aigu sévère est une maladie infectieuse causée par des coronavirus spécifiques. Cette pathologie se caractérise par une atteinte respiratoire grave pouvant évoluer vers une détresse respiratoire majeure.
Mais qu'est-ce qui rend cette maladie si particulière ? Le SRAS se distingue par sa capacité à provoquer une inflammation pulmonaire intense. Les alvéoles pulmonaires se remplissent de liquide, compromettant gravement les échanges gazeux [13,14].
D'ailleurs, il faut distinguer le SRAS classique (SARS-CoV-1) apparu en 2003 du COVID-19 (SARS-CoV-2) identifié en 2019. Bien que ces deux pathologies partagent des similitudes, elles présentent des différences importantes dans leur transmission et leur gravité [5,12].
L'important à retenir : cette maladie peut toucher n'importe qui, mais certaines populations sont plus vulnérables. Les personnes âgées et celles présentant des comorbidités développent plus souvent des formes sévères nécessitant une hospitalisation [2,7].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques du SRAS révèlent une évolution complexe depuis son émergence. En France, Santé Publique France rapporte que l'expérience acquise avec le SARS-CoV-2 a considérablement enrichi notre compréhension de ces pathologies respiratoires [2].
Concrètement, l'épidémie de SRAS classique de 2003 avait touché 8 096 personnes dans le monde, avec un taux de mortalité de 9,6%. Heureusement, la France n'avait enregistré que quelques cas suspects sans transmission locale [13].
Mais la situation a radicalement changé avec le SARS-CoV-2. Les données de Santé Publique France montrent que cette nouvelle souche présente une contagiosité bien supérieure, mais paradoxalement une mortalité généralement plus faible que le SRAS original [2,5].
Il est intéressant de noter que les études récentes révèlent des variations importantes selon les régions. Les zones urbaines denses ont connu des taux d'incidence plus élevés, particulièrement dans les établissements de soins [1,8].
D'un point de vue démographique, les hommes semblent légèrement plus susceptibles de développer des formes graves. L'âge reste le facteur de risque principal, avec une augmentation exponentielle de la gravité après 65 ans [2,9].
Les Causes et Facteurs de Risque
Le syndrome respiratoire aigu sévère résulte de l'infection par des coronavirus spécifiques. Ces virus à ARN présentent une structure particulière avec des protéines de surface caractéristiques, notamment la fameuse protéine spike [12].
Les recherches récentes ont identifié des sites de clivage protéolytiques cruciaux dans la transmission virale. Ces mécanismes moléculaires déterminent en grande partie la capacité du virus à infecter les cellules humaines [12,5].
Mais quels sont les facteurs qui augmentent votre risque ? L'âge avancé constitue le principal facteur de risque. Les personnes de plus de 65 ans développent plus fréquemment des complications graves [2,14].
D'autres facteurs de risque incluent les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité et les pathologies respiratoires chroniques. Ces comorbidités fragilisent l'organisme face à l'infection [7,9].
Il faut également mentionner les facteurs environnementaux. L'exposition professionnelle, notamment pour les soignants, augmente significativement le risque de contamination [8,10].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du SRAS évoluent généralement en plusieurs phases. La période d'incubation varie de 2 à 10 jours, pendant laquelle vous pourriez ne ressentir aucun signe particulier [13,14].
Les premiers symptômes ressemblent souvent à ceux d'une grippe classique. Vous pourriez développer de la fièvre, des frissons, des courbatures et une fatigue intense. Ces signes apparaissent brutalement et s'intensifient rapidement [5,13].
Mais c'est l'atteinte respiratoire qui caractérise vraiment cette pathologie. Une toux sèche persistante s'installe, accompagnée d'une sensation d'oppression thoracique. La dyspnée (difficulté à respirer) peut survenir dès les premiers jours [7,14].
Certains patients rapportent également des troubles digestifs : nausées, vomissements ou diarrhées. Ces symptômes, moins spécifiques, peuvent précéder l'atteinte respiratoire [8,13].
L'important à retenir : si vous développez une fièvre élevée associée à des difficultés respiratoires, consultez rapidement. La précocité de la prise en charge influence considérablement le pronostic [2,7].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du SRAS repose sur une approche multidisciplinaire combinant clinique, biologie et imagerie. Votre médecin commencera par un interrogatoire détaillé sur vos symptômes et vos contacts récents [5,13].
L'examen clinique recherche les signes d'atteinte respiratoire. L'auscultation pulmonaire peut révéler des râles crépitants ou une diminution du murmure vésiculaire. La mesure de la saturation en oxygène constitue un élément clé [7,14].
Les examens biologiques incluent une RT-PCR pour détecter l'ARN viral. Cette technique, devenue standard, permet un diagnostic rapide et fiable. Des prélèvements nasopharyngés sont généralement réalisés [5,12].
D'ailleurs, l'imagerie thoracique joue un rôle crucial. Le scanner thoracique révèle souvent des opacités en verre dépoli caractéristiques, même avant l'apparition de symptômes sévères [7,9].
Bon à savoir : les tests sérologiques peuvent compléter le diagnostic en détectant les anticorps spécifiques. Ils s'avèrent particulièrement utiles pour confirmer une infection passée [2,5].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du SRAS a considérablement évolué grâce à l'expérience acquise. Le traitement reste essentiellement symptomatique et de support, car il n'existe pas d'antiviral spécifique universellement efficace [7,14].
L'oxygénothérapie constitue le pilier du traitement. Selon la gravité, elle peut aller de l'oxygène nasal simple à la ventilation mécanique invasive. Les techniques de ventilation ultra-protectrice ont montré leur intérêt dans les formes sévères [11,7].
Pour les cas les plus graves, l'ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle) peut être envisagée. Cette technique de suppléance cardio-respiratoire a sauvé de nombreuses vies, bien que son indication reste très spécialisée [10,11].
Les corticostéroïdes ont trouvé leur place dans le traitement des formes sévères. La dexaméthasone, en particulier, a démontré son efficacité pour réduire la mortalité chez les patients hospitalisés [2,9].
Certains traitements adjuvants peuvent être proposés : anticoagulants pour prévenir les thromboses, antibiotiques en cas de surinfection bactérienne, et support nutritionnel adapté [8,7].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque une période d'innovations majeures dans la lutte contre les syndromes respiratoires aigus sévères. La FDA américaine a récemment approuvé de nouveaux vaccins, notamment celui de Novavax, ouvrant de nouvelles perspectives préventives [3].
Les essais cliniques en cours explorent des approches révolutionnaires. L'immunothérapie cellulaire et génique basée sur le ciblage thérapeutique spécifique du coronavirus montre des résultats prometteurs en phase préclinique [6].
D'ailleurs, les techniques d'émulation d'essais cibles permettent désormais d'évaluer plus rapidement l'efficacité des traitements. Ces méthodologies innovantes accélèrent considérablement le développement thérapeutique [4].
Les décisions de la FDA attendues pour avril 2025 concernent plusieurs molécules prometteuses. Ces approbations pourraient révolutionner la prise en charge des formes sévères .
Il est passionnant de constater que la recherche se concentre également sur la prévention des séquelles pulmonaires. Les stratégies de ventilation ultra-protectrice multimodale réduisent significativement le biotraumatisme chez les patients sous ECMO [11].
Vivre au Quotidien avec le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
Vivre avec les séquelles d'un SRAS nécessite souvent des adaptations importantes. Beaucoup de patients rapportent une fatigue persistante qui peut durer plusieurs mois après la phase aiguë [8,9].
La rééducation respiratoire joue un rôle central dans la récupération. Des exercices spécifiques aident à retrouver progressivement une capacité pulmonaire optimale. Cette approche nécessite patience et persévérance [7,9].
Certains patients développent une fibrose pulmonaire séquellaire. Cette complication, heureusement rare, peut nécessiter un suivi spécialisé à long terme et parfois des traitements spécifiques [9].
L'aspect psychologique ne doit pas être négligé. L'expérience d'une maladie grave peut laisser des traces : anxiété, troubles du sommeil, voire syndrome de stress post-traumatique. Un accompagnement psychologique s'avère souvent bénéfique [8].
Bon à savoir : la reprise d'une activité physique adaptée favorise la récupération. Commencez doucement et augmentez progressivement l'intensité selon vos capacités et les conseils de votre équipe médicale.
Les Complications Possibles
Le SRAS peut entraîner diverses complications, certaines immédiates, d'autres à long terme. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) représente la complication la plus redoutable de la phase aiguë [7,10].
Cette complication survient lorsque l'inflammation pulmonaire devient incontrôlable. Les alvéoles se remplissent de liquide, compromettant gravement les échanges gazeux. Le pronostic dépend largement de la précocité et de la qualité de la prise en charge [10,11].
Les complications cardiovasculaires ne sont pas rares. Myocardites, troubles du rythme et événements thromboemboliques peuvent survenir, même chez des patients sans antécédents cardiaques [2,9].
À plus long terme, certains patients développent une fibrose pulmonaire. Cette cicatrisation anormale du tissu pulmonaire peut altérer durablement la fonction respiratoire [9].
D'autres complications incluent les surinfections bactériennes, particulièrement fréquentes chez les patients ventilés, et les complications liées à l'immobilisation prolongée [7,8].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du SRAS varie considérablement selon plusieurs facteurs. L'âge reste le déterminant principal : les patients jeunes et sans comorbidités ont généralement un excellent pronostic [2,13].
Les données récentes montrent que plus de 95% des patients de moins de 50 ans sans facteurs de risque guérissent complètement. Cependant, ce pourcentage diminue avec l'âge et la présence de comorbidités [2,14].
La précocité de la prise en charge influence significativement l'évolution. Les patients traités dès les premiers signes de détresse respiratoire ont un meilleur pronostic que ceux pris en charge tardivement [7,10].
Concernant les séquelles, les études de suivi montrent que la majorité des patients récupèrent une fonction pulmonaire normale dans les 6 à 12 mois. Néanmoins, environ 10 à 15% gardent des séquelles respiratoires [9].
Il est rassurant de constater que les innovations thérapeutiques récentes améliorent constamment le pronostic. Les techniques de ventilation protectrice et l'utilisation précoce des corticostéroïdes ont considérablement réduit la mortalité [11,7].
Peut-on Prévenir le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère ?
La prévention du SRAS repose principalement sur la limitation de la transmission virale. Les mesures barrières restent fondamentales : port du masque, distanciation physique et hygiène des mains [5,13].
La vaccination constitue désormais un outil préventif majeur. Les nouveaux vaccins approuvés en 2024-2025, notamment celui de Novavax, offrent une protection efficace contre les formes graves [3].
Pour les professionnels de santé, des protocoles spécifiques de protection sont essentiels. L'utilisation d'équipements de protection individuelle adaptés réduit considérablement le risque de contamination [8].
Il est important de maintenir une bonne maladie physique générale. L'exercice régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant renforcent les défenses immunitaires [14].
Certaines populations à risque bénéficient de mesures préventives renforcées : vaccination prioritaire, suivi médical rapproché et éviction des situations à risque [2,13].
Recommandations des Autorités de Santé
Santé Publique France a émis des recommandations précises basées sur l'expérience acquise avec les différentes souches de coronavirus responsables de SRAS [2]. Ces guidelines évoluent régulièrement selon les nouvelles données scientifiques.
Les recommandations actuelles insistent sur l'importance du diagnostic précoce. Tout patient présentant des symptômes respiratoires fébriles doit bénéficier d'une évaluation rapide, particulièrement s'il présente des facteurs de risque [5,7].
Concernant la prise en charge hospitalière, les autorités recommandent une approche graduée. L'oxygénothérapie doit être initiée dès que la saturation descend sous 94%, et les corticostéroïdes sont recommandés dans les formes sévères [7,2].
Les protocoles de sortie d'hospitalisation ont également été précisés. Un suivi à 1 mois, 3 mois et 6 mois est recommandé pour dépister d'éventuelles séquelles et adapter la rééducation [8,9].
D'ailleurs, les recommandations soulignent l'importance de la coordination entre les différents professionnels : médecins, kinésithérapeutes, psychologues et assistants sociaux [8].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints de SRAS et leurs familles. Ces structures offrent un soutien précieux tant sur le plan informatif que psychologique.
L'association "Après J20" regroupe des patients ayant développé des formes prolongées. Elle propose des groupes de parole, des conseils pratiques et milite pour une meilleure reconnaissance des séquelles [8].
La Fondation du Souffle, spécialisée dans les maladies respiratoires, a développé des programmes spécifiques pour les patients post-SRAS. Leurs ressources incluent des guides de rééducation et des conseils nutritionnels [9].
Les centres de rééducation post-réanimation proposent des programmes adaptés. Ces structures multidisciplinaires accompagnent la récupération physique et psychologique des patients [7,8].
Bon à savoir : de nombreuses ressources en ligne sont disponibles. Les sites des autorités sanitaires proposent des fiches pratiques régulièrement mises à jour [2,13].
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec ou après un SRAS nécessite quelques adaptations pratiques. Écoutez votre corps et respectez vos limites - la récupération prend du temps et chaque personne évolue à son rythme.
Maintenez une activité physique adaptée. Commencez par de courtes marches et augmentez progressivement selon votre tolérance. La rééducation respiratoire, si elle vous est prescrite, doit être suivie assidûment [7,9].
Surveillez votre alimentation. Une nutrition équilibrée, riche en protéines et vitamines, favorise la récupération. N'hésitez pas à consulter un nutritionniste si nécessaire [8].
Organisez votre environnement pour limiter les efforts inutiles. Placez les objets usuels à portée de main, aménagez votre espace de vie pour éviter les escaliers fréquents.
Restez connecté socialement. L'isolement peut aggraver les difficultés psychologiques. Maintenez le contact avec vos proches, participez aux groupes de soutien si cela vous aide [8].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation rapide. Une fièvre élevée (>38,5°C) associée à des difficultés respiratoires nécessite une évaluation médicale urgente [13,14].
Si vous ressentez une oppression thoracique, une sensation d'étouffement ou si votre toux devient très productive, ne tardez pas à consulter. Ces symptômes peuvent signaler une aggravation [7,5].
Pour les patients en cours de récupération, surveillez l'apparition de nouveaux symptômes. Une fatigue qui s'aggrave, des douleurs thoraciques persistantes ou une diminution de vos capacités d'effort doivent être signalées [8,9].
Les signes de détresse psychologique ne doivent pas être négligés. Anxiété majeure, troubles du sommeil persistants ou idées noires justifient un accompagnement spécialisé [8].
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre médecin traitant. Il vaut mieux consulter pour rien que passer à côté d'une complication [2,14].
Questions Fréquentes
Le SRAS est-il la même chose que la COVID-19 ?
Non, bien que les deux soient causés par des coronavirus. Le SRAS classique (SARS-CoV-1) est apparu en 2003, tandis que la COVID-19 est causée par le SARS-CoV-2 identifié en 2019. Le SARS-CoV-2 est plus contagieux mais généralement moins mortel que le SRAS original.
Combien de temps dure la récupération après un SRAS ?
La récupération varie selon la gravité de l'infection. Les formes légères guérissent en 2-3 semaines, tandis que les formes sévères peuvent nécessiter plusieurs mois de récupération. Environ 10-15% des patients gardent des séquelles respiratoires à long terme.
Peut-on attraper le SRAS plusieurs fois ?
Les réinfections sont possibles mais rares, surtout dans les mois suivant la première infection. L'immunité naturelle et vaccinale offrent une protection, mais celle-ci peut diminuer avec le temps et face aux variants.
Quels sont les signes d'urgence qui nécessitent une hospitalisation ?
Consultez immédiatement si vous présentez : difficultés respiratoires importantes, saturation en oxygène < 94%, fièvre élevée persistante, douleurs thoraciques intenses, ou confusion. Ces signes peuvent indiquer une forme sévère nécessitant une prise en charge hospitalière.
Les enfants peuvent-ils développer un SRAS sévère ?
Les enfants sont généralement moins touchés par les formes sévères de SRAS. Cependant, certains peuvent développer des complications, particulièrement ceux présentant des comorbidités. La surveillance médicale reste importante chez l'enfant symptomatique.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Bilan des épidémies de bronchiolite de septembre 2017 à juin 2021 - données épidémiologiques sur les infections respiratoiresLien
- [2] Expérience du SARS-CoV-2 et applications - Santé Publique FranceLien
- [3] U.S. FDA Approves BLA for Novavax's COVID-19 Vaccine - Innovation 2024-2025Lien
- [4] FDA Decisions Expected: April 2025 - Nouvelles approbations thérapeutiquesLien
- [5] Target Trial Emulation of Severe Acute Respiratory Syndrome - Méthodologies innovantesLien
- [6] CORONAVIRUS ÉMERGENT SARS-CoV-2 ET SYNDROME RESPIRATOIRE AIGÜE SEVERE: STRATÉGIES DE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE ET PRÉVENTIONLien
- [7] Approche d'immunothérapie cellulaire et génique basée sur le ciblage thérapeutique du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévèreLien
- [8] Actualités dans la prise en charge ventilatoire de l'insuffisance respiratoire aiguë sévèreLien
- [9] Evaluation de la satisfaction des patients atteints du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère sur leur prise en chargeLien
- [10] Quelle part de la fibrose pulmonaire chez les patients ayant présenté un syndrome de détresse respiratoire aigu sévère lié à la COVID-19Lien
- [11] Facteurs prédictifs de survie sous ECMO en syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère associé à la COVID-19Lien
- [12] Impact d'une stratégie de ventilation ultra-protectrice multimodale sur le bio traumatisme chez des patients présentant un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère nécessitant une ECMOLien
- [13] Rôle des sites de clivages protéolytiques de la protéine de spicule du Coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2)Lien
- [14] SRAS : symptômes, traitement, prévention - Institut PasteurLien
- [15] Coronavirus et syndromes respiratoires aigus (MERS et SRAS) - Manuel MSDLien
Publications scientifiques
- CORONAVIRUS ÉMERGENT SARS-CoV-2 ET SYNDROME RESPIRATOIRE AIGÜE SEVERE: STRATÉGIES DE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE ET PRÉVENTION (2022)[PDF]
- … 'une approche d'immunothérapie cellulaire et génique basée sur le ciblage thérapeutique du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère par des lymphocytes … (2022)[PDF]
- Actualités dans la prise en charge ventilatoire de l'insuffisance respiratoire aiguë sévère (2022)2 citations
- [HTML][HTML] Evaluation de la satisfaction des patients atteints du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère sur leur prise en charge au Centre Hospitalier … (2023)
- Quelle part de la fibrose pulmonaire chez les patients ayant présenté un syndrome de détresse respiratoire aigu sévère lié à la COVID-19 après leur séjour en … (2024)
Ressources web
- SRAS : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
Le SRAS, au départ nommé pneumopathie atypique, est caractérisé par une fièvre élevée (>38°C), associée à un ou plusieurs symptômes respiratoires : toux sèche, ...
- Coronavirus et syndromes respiratoires aigus (MERS et ... (msdmanuals.com)
Coronavirus et syndromes respiratoires aigus (MERS et SRAS) – En savoir plus sur les causes, les symptômes, les diagnostics et les traitements à partir des ...
- Syndrome respiratoire aigu sévère (fr.wikipedia.org)
Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est une maladie infectieuse des poumons (pneumonie aiguë) due à un coronavirus, le SARS-CoV, apparu pour la premiè ...
- Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) (canada.ca)
21 janv. 2020 — Les personnes atteintes du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ont de la fièvre, suivie par des symptômes respiratoires comme de la toux, ...
- SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SEVERE (sante.gouv.fr)
7 mai 2003 — associée à un ou plusieurs signes d'atteinte respiratoire basse (toux, dyspnée, gêne respiratoire, ... scanner pulmonaire, en l'absence d'un autre ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
