Syndrome Opsomyoclonique : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic, Traitements
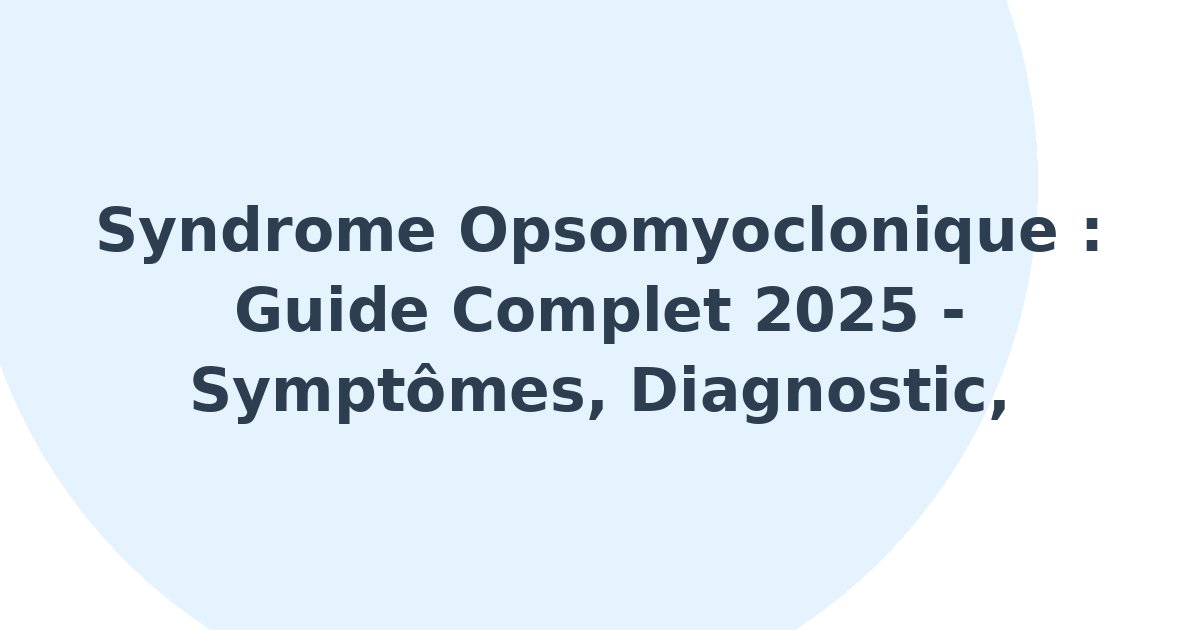
Le syndrome opsomyoclonique est une pathologie neurologique rare qui associe des mouvements oculaires anormaux (opsoclonus) et des secousses musculaires involontaires (myoclonus). Cette maladie touche principalement les enfants, mais peut également survenir chez l'adulte. Bien que rare, elle nécessite une prise en charge spécialisée rapide pour limiter les complications neurologiques à long terme.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Syndrome Opsomyoclonique : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome opsomyoclonique représente une pathologie neurologique complexe caractérisée par l'association de plusieurs symptômes distincts [13]. Cette maladie rare combine des mouvements oculaires chaotiques appelés opsoclonus, des secousses musculaires involontaires ou myoclonus, et souvent une ataxie (troubles de l'équilibre).
Concrètement, l'opsoclonus se manifeste par des mouvements oculaires rapides, multidirectionnels et conjugués, donnant l'impression que les yeux "dansent" de manière incontrôlable [3]. Ces mouvements persistent même les yeux fermés, ce qui distingue cette pathologie d'autres troubles oculomoteurs.
Le myoclonus, quant à lui, correspond à des contractions musculaires brèves et involontaires qui peuvent toucher différentes parties du corps [14]. L'association de ces symptômes crée un tableau clinique particulièrement invalidant pour les patients.
Il faut savoir que cette pathologie peut survenir à tout âge, mais elle présente deux pics de fréquence distincts. Chez l'enfant, elle est souvent associée à un neuroblastome, tandis que chez l'adulte, elle peut être d'origine paranéoplasique ou infectieuse [6].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Le syndrome opsomyoclonique demeure une pathologie exceptionnellement rare avec une incidence estimée à moins de 1 cas pour 10 millions d'habitants par an en France [13]. Cette rareté explique pourquoi de nombreux médecins n'en rencontrent jamais au cours de leur carrière.
Chez l'enfant, la pathologie représente environ 2 à 3% de tous les cas de neuroblastome, ce qui correspond à une dizaine de nouveaux cas pédiatriques par an en France [4]. L'âge médian de survenue chez l'enfant se situe autour de 18 mois, avec une légère prédominance féminine.
Pour les formes adultes, les données épidémiologiques restent fragmentaires. Cependant, les études récentes suggèrent une augmentation des cas rapportés, probablement liée à une meilleure reconnaissance de la pathologie par les neurologues [2]. Les formes paranéoplasiques représentent environ 50% des cas adultes.
D'ailleurs, les données européennes montrent des variations géographiques intéressantes, avec une incidence légèrement plus élevée dans les pays nordiques [2]. Cette différence pourrait s'expliquer par des facteurs génétiques ou environnementaux encore mal compris.
L'impact économique sur le système de santé français reste difficile à évaluer précisément, mais les coûts de prise en charge sont considérables en raison de la complexité diagnostique et thérapeutique [8].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes du syndrome opsomyoclonique varient considérablement selon l'âge de survenue. Chez l'enfant, le neuroblastome représente la cause principale, retrouvé dans 50 à 60% des cas [4]. Cette tumeur maligne du système nerveux sympathique déclenche une réaction auto-immune dirigée contre les neurones du tronc cérébral.
Mais d'autres causes pédiatriques existent. Les infections virales, notamment par les entérovirus, peuvent déclencher cette pathologie [7]. Plus récemment, des cas associés à l'infection par le virus West Nile ont été rapportés, élargissant le spectre des agents infectieux impliqués.
Chez l'adulte, les causes paranéoplasiques dominent le tableau clinique. Les cancers du poumon, du sein, de l'ovaire ou de la prostate peuvent déclencher cette réaction auto-immune [5,6]. Le mécanisme implique la production d'anticorps dirigés contre des antigènes neuronaux partagés entre la tumeur et le système nerveux.
Récemment, l'infection par le SARS-CoV-2 a été identifiée comme une nouvelle cause possible, particulièrement chez les patients présentant des formes sévères de COVID-19 [5]. Cette découverte souligne l'importance des mécanismes inflammatoires dans la genèse de cette pathologie.
Il est important de noter que dans environ 20% des cas, aucune cause n'est identifiée malgré des investigations approfondies. Ces formes idiopathiques posent des défis diagnostiques et thérapeutiques particuliers [14].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du syndrome opsomyoclonique forment une triade caractéristique facilement reconnaissable par un œil averti. L'opsoclonus constitue le signe le plus spécifique : ces mouvements oculaires rapides, chaotiques et multidirectionnels donnent l'impression que les yeux "dansent" de manière incontrôlable [3].
Ces mouvements oculaires anormaux persistent même les yeux fermés, ce qui les distingue des autres troubles oculomoteurs. Ils s'accompagnent souvent d'une photophobie et d'une gêne visuelle importante. Les patients décrivent fréquemment une sensation de "monde qui bouge" ou de vertige permanent.
Le myoclonus se manifeste par des secousses musculaires brèves et involontaires touchant principalement le tronc et les membres [14]. Ces mouvements peuvent être déclenchés par le toucher, les bruits ou les émotions. Ils interfèrent significativement avec les activités quotidiennes.
L'ataxie complète ce tableau clinique avec des troubles de l'équilibre et de la coordination. Les patients présentent une démarche instable, des difficultés pour les gestes fins et une dysarthrie (troubles de l'articulation). Chez l'enfant, on observe souvent une régression des acquisitions motrices.
D'autres symptômes peuvent s'associer : irritabilité extrême, troubles du sommeil, difficultés alimentaires chez l'enfant. Ces manifestations comportementales sont parfois au premier plan et peuvent retarder le diagnostic [4].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du syndrome opsomyoclonique repose avant tout sur la reconnaissance clinique de la triade symptomatique. Cependant, la rareté de cette pathologie fait que le délai diagnostique peut atteindre plusieurs mois, particulièrement chez l'adulte [2].
L'examen neurologique constitue la première étape cruciale. Le neurologue recherche spécifiquement les mouvements oculaires anormaux en faisant fixer un point au patient, puis en lui demandant de fermer les yeux. La persistance des mouvements oculaires les yeux fermés signe l'opsoclonus [3].
Les examens complémentaires visent à identifier une cause sous-jacente. Chez l'enfant, la recherche d'un neuroblastome est prioritaire : scanner thoraco-abdomino-pelvien, dosage des catécholamines urinaires et scintigraphie à la MIBG [4]. Ces examens permettent de détecter la tumeur primitive et ses métastases éventuelles.
Chez l'adulte, le bilan paranéoplasique comprend un scanner thoraco-abdomino-pelvien, une mammographie chez la femme, et le dosage d'anticorps anti-neuronaux spécifiques [6]. Ces anticorps, bien que non systématiquement retrouvés, peuvent orienter vers certains types de cancer.
L'IRM cérébrale reste généralement normale, mais elle permet d'éliminer d'autres causes de troubles neurologiques. La ponction lombaire peut montrer une pléocytose lymphocytaire modérée et une synthèse intrathécale d'immunoglobulines [14].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement du syndrome opsomyoclonique repose sur une approche multimodale combinant traitement étiologique et symptomatique. Lorsqu'une cause sous-jacente est identifiée, son traitement constitue la priorité absolue [6].
Chez l'enfant avec neuroblastome, la chimiothérapie antitumorale peut améliorer les symptômes neurologiques, mais paradoxalement, elle peut aussi les aggraver transitoirement. Cette "tempête opsomyoclonique" nécessite une surveillance rapprochée et un traitement immunosuppresseur intensif [4].
Les corticostéroïdes représentent le traitement de première ligne pour contrôler l'inflammation neurologique. La prednisolone à forte dose (2 mg/kg/jour chez l'enfant) permet souvent une amélioration rapide des symptômes [14]. Cependant, les rechutes à l'arrêt sont fréquentes, nécessitant des cures prolongées.
Les immunoglobulines intraveineuses constituent une alternative ou un complément aux corticostéroïdes. Administrées à la dose de 2 g/kg sur 2 à 5 jours, elles peuvent être particulièrement efficaces dans les formes sévères [8]. Leur mécanisme d'action implique une modulation de la réponse immune.
Pour les formes résistantes, d'autres immunosuppresseurs peuvent être utilisés : rituximab, cyclophosphamide, ou azathioprine. Ces traitements nécessitent une surveillance biologique étroite en raison de leurs effets secondaires potentiels [2].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées thérapeutiques récentes ouvrent de nouvelles perspectives pour les patients atteints de syndrome opsomyoclonique. Les recherches actuelles se concentrent sur une meilleure compréhension des mécanismes auto-immuns impliqués [1].
L'utilisation du rituximab en première ligne fait l'objet d'études prometteuses. Ce traitement ciblant les lymphocytes B pourrait permettre une rémission plus durable avec moins d'effets secondaires que les corticostéroïdes au long cours [2]. Les premiers résultats montrent une efficacité comparable avec un meilleur profil de tolérance.
Les thérapies par échanges plasmatiques représentent une innovation majeure pour les formes fulminantes. Cette technique permet d'éliminer rapidement les anticorps pathogènes circulants, offrant un contrôle symptomatique rapide en attendant l'efficacité des immunosuppresseurs [3].
La recherche fondamentale progresse également avec l'identification de nouveaux anticorps anti-neuronaux. Ces découvertes permettent un diagnostic plus précis et ouvrent la voie à des thérapies plus ciblées [1]. L'objectif est de développer des traitements personnalisés selon le profil immunologique de chaque patient.
Enfin, les approches de neuromodulation font l'objet d'investigations préliminaires. La stimulation magnétique transcrânienne pourrait représenter une option thérapeutique complémentaire pour contrôler certains symptômes résistants aux traitements conventionnels [2].
Vivre au Quotidien avec le Syndrome Opsomyoclonique
Vivre avec un syndrome opsomyoclonique nécessite des adaptations importantes dans la vie quotidienne. Les troubles visuels liés à l'opsoclonus rendent difficiles la lecture, la conduite et de nombreuses activités nécessitant une fixation visuelle stable [14].
L'aménagement du domicile devient souvent nécessaire pour prévenir les chutes liées à l'ataxie. Il faut savoir que les barres d'appui, l'éclairage adapté et l'élimination des obstacles constituent des mesures simples mais efficaces. Les patients bénéficient souvent d'une évaluation ergothérapique pour optimiser leur environnement.
Sur le plan professionnel, des aménagements de poste peuvent être nécessaires. Beaucoup de patients doivent réduire leur temps de travail ou changer d'activité professionnelle. Heureusement, la reconnaissance en affection de longue durée permet une prise en charge à 100% des soins liés à cette pathologie.
Le soutien psychologique s'avère crucial, tant pour le patient que pour sa famille. Cette maladie rare et imprévisible génère souvent anxiété et dépression. Les groupes de parole et les associations de patients offrent un soutien précieux pour rompre l'isolement.
L'activité physique adaptée, sous supervision kinésithérapique, aide à maintenir l'équilibre et la coordination. La natation, par exemple, permet un exercice sécurisé tout en travaillant la proprioception [13].
Les Complications Possibles
Le syndrome opsomyoclonique peut entraîner diverses complications, particulièrement en l'absence de traitement précoce et adapté. Les séquelles neurologiques représentent la complication la plus redoutée, notamment chez l'enfant [4].
Chez l'enfant, les troubles cognitifs et comportementaux peuvent persister malgré la résolution des symptômes moteurs. Ces séquelles incluent des difficultés d'apprentissage, des troubles de l'attention et des problèmes de comportement social. Environ 70% des enfants conservent des séquelles à long terme [4].
Les complications liées aux traitements immunosuppresseurs ne sont pas négligeables. L'utilisation prolongée de corticostéroïdes peut entraîner un retard de croissance chez l'enfant, une ostéoporose, un diabète cortico-induit et une susceptibilité accrue aux infections [8].
Sur le plan ophtalmologique, l'opsoclonus chronique peut conduire à une amblyopie fonctionnelle, particulièrement problématique chez l'enfant en période de développement visuel. Un suivi ophtalmologique régulier est donc indispensable [14].
Les chutes répétées liées à l'ataxie peuvent occasionner des traumatismes, parfois graves. La prévention par l'aménagement de l'environnement et l'utilisation d'aides techniques devient alors cruciale pour limiter ces risques [13].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du syndrome opsomyoclonique varie considérablement selon l'âge de survenue, la cause sous-jacente et la précocité de la prise en charge. Globalement, les formes pédiatriques ont un pronostic plus réservé que les formes adultes [4].
Chez l'enfant avec neuroblastome, le pronostic oncologique est généralement favorable, avec des taux de survie supérieurs à 90%. Cependant, les séquelles neurologiques persistent dans la majorité des cas malgré la guérison du cancer [4]. Ces séquelles incluent troubles cognitifs, difficultés scolaires et problèmes comportementaux.
Pour les formes adultes paranéoplasiques, le pronostic dépend largement du type et du stade du cancer sous-jacent. Lorsque la tumeur est traitée précocement, l'amélioration neurologique peut être spectaculaire [6]. Néanmoins, une récupération complète reste rare.
Les formes idiopathiques, sans cause identifiée, présentent un pronostic intermédiaire. Environ 50% des patients récupèrent complètement ou presque, tandis que les autres conservent des symptômes résiduels nécessitant un traitement au long cours [14].
Il est important de souligner que les innovations thérapeutiques récentes permettent d'espérer une amélioration du pronostic. Les nouveaux protocoles immunosuppresseurs et la meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques ouvrent des perspectives encourageantes [2].
Peut-on Prévenir le Syndrome Opsomyoclonique ?
La prévention primaire du syndrome opsomyoclonique reste limitée en raison de la nature souvent imprévisible de ses causes. Cependant, certaines mesures peuvent réduire le risque de développer cette pathologie ou en limiter la gravité [13].
Pour les formes paranéoplasiques, le dépistage précoce des cancers constitue la meilleure prévention. Les programmes de dépistage organisé (mammographie, frottis cervical, coloscopie) permettent de détecter certains cancers avant qu'ils ne déclenchent des syndromes paranéoplasiques [6].
Concernant les formes infectieuses, la vaccination contre certains virus peut théoriquement réduire le risque. Bien que les preuves soient limitées, la vaccination contre la grippe et d'autres infections virales courantes semble raisonnable [7].
La prévention secondaire, visant à limiter les complications, revêt une importance capitale. Elle repose sur la reconnaissance précoce des symptômes et la consultation rapide d'un neurologue. Plus le diagnostic est posé tôt, meilleur est le pronostic [2].
Pour les patients à risque (antécédents de cancer, immunodépression), une surveillance neurologique régulière peut permettre un diagnostic précoce. Cette vigilance est particulièrement importante chez les patients traités pour un cancer, population à risque de développer des syndromes paranéoplasiques [6].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises ont établi des recommandations spécifiques pour la prise en charge du syndrome opsomyoclonique, bien que cette pathologie rare ne fasse pas l'objet de guidelines dédiées [6]. La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une approche multidisciplinaire impliquant neurologues, oncologues et pédiatres selon les cas.
Le diagnostic doit être évoqué devant toute association d'opsoclonus et de myoclonus, particulièrement chez l'enfant. La HAS insiste sur la nécessité d'un bilan étiologique complet et rapide, incluant la recherche systématique d'un neuroblastome chez l'enfant de moins de 4 ans [4].
Concernant le traitement, les recommandations privilégient les corticostéroïdes en première intention, avec un relais par immunoglobulines intraveineuses en cas de résistance ou de contre-indication. L'utilisation d'immunosuppresseurs de seconde ligne doit être discutée en centre spécialisé [8].
La Société Française de Neurologie recommande un suivi neurologique prolongé, particulièrement chez l'enfant où les séquelles cognitives peuvent apparaître tardivement. Un bilan neuropsychologique annuel est conseillé pendant au moins 5 ans [14].
L'INSERM souligne l'importance de la recherche clinique dans cette pathologie rare et encourage la participation des patients aux protocoles de recherche. Cette démarche permet d'améliorer les connaissances et potentiellement l'accès à des traitements innovants [1].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les patients et leurs familles face au syndrome opsomyoclonique. L'association Orphanet constitue la référence principale pour les maladies rares en France, proposant des fiches d'information détaillées et régulièrement mises à jour [13].
Le Centre de Référence des Maladies Rares du Cervelet (MIRCEM) offre une expertise spécialisée pour cette pathologie. Basé à la Pitié-Salpêtrière, ce centre coordonne la prise en charge et la recherche sur les ataxies rares, incluant le syndrome opsomyoclonique [14].
Pour les familles d'enfants atteints, l'association "Grandir avec un neuroblastome" propose un soutien spécifique. Cette association organise des rencontres, diffuse de l'information médicale vulgarisée et facilite les échanges entre familles confrontées à cette épreuve.
Les réseaux sociaux ont également vu naître des groupes de soutien informels. Ces communautés virtuelles permettent de rompre l'isolement et d'échanger conseils pratiques et soutien moral. Cependant, il convient de vérifier la fiabilité des informations partagées.
Enfin, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) peuvent accompagner les démarches administratives et l'accès aux aides techniques. La reconnaissance du handicap permet l'accès à diverses prestations et aménagements [13].
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec un syndrome opsomyoclonique nécessite des adaptations concrètes au quotidien. Voici nos conseils pratiques basés sur l'expérience des patients et des professionnels de santé [14].
Pour gérer les troubles visuels, privilégiez un éclairage indirect et évitez les contrastes trop marqués. L'utilisation de lunettes teintées peut réduire la photophobie. Lors de la lecture, préférez les gros caractères et faites des pauses régulières pour reposer vos yeux.
Concernant la sécurité au domicile, installez des barres d'appui dans les escaliers et la salle de bain. Éliminez les tapis et obstacles qui pourraient provoquer des chutes. Un éclairage automatique nocturne sécurise les déplacements.
Pour l'alimentation, utilisez des couverts adaptés avec des manches épais si les tremblements gênent. Les verres avec couvercle et paille évitent les renversements. Privilégiez les aliments faciles à saisir et évitez les textures trop liquides.
Au niveau professionnel, n'hésitez pas à solliciter la médecine du travail pour des aménagements de poste. Le télétravail peut être une solution intéressante pour éviter les transports difficiles. La reconnaissance de travailleur handicapé ouvre droit à des aides spécifiques.
Enfin, maintenez une activité physique adaptée sous supervision médicale. La kinésithérapie et l'ergothérapie sont des alliés précieux pour préserver l'autonomie [13].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent alerter et conduire à une consultation médicale urgente. La survenue brutale de mouvements oculaires anormaux, surtout s'ils s'accompagnent de secousses musculaires, nécessite un avis neurologique rapide [3].
Chez l'enfant, toute régression des acquisitions motrices associée à des troubles du comportement doit faire évoquer cette pathologie. L'irritabilité extrême, les troubles du sommeil et les difficultés alimentaires constituent des signaux d'alarme [4].
Pour les patients déjà diagnostiqués, plusieurs situations nécessitent une consultation en urgence : aggravation brutale des symptômes, apparition de nouveaux signes neurologiques, ou signes d'infection dans un contexte d'immunosuppression [14].
Les patients traités par corticostéroïdes doivent surveiller l'apparition de signes de complications : prise de poids rapide, hypertension artérielle, troubles de l'humeur sévères, ou signes d'infection. Ces effets secondaires nécessitent parfois un ajustement thérapeutique [8].
En cas de doute, il ne faut jamais hésiter à contacter l'équipe médicale. Cette pathologie rare nécessite une surveillance rapprochée et une adaptation thérapeutique régulière. La communication avec l'équipe soignante constitue un élément clé de la prise en charge [2].
Questions Fréquentes
Le syndrome opsomyoclonique est-il héréditaire ?Non, cette pathologie n'est pas héréditaire. Elle résulte d'une réaction auto-immune déclenchée par diverses causes (tumeur, infection, etc.) [13].
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
La guérison complète est possible, particulièrement dans les formes idiopathiques. Cependant, des séquelles peuvent persister, notamment chez l'enfant [4].
Les traitements sont-ils remboursés ?
Oui, cette pathologie bénéficie d'une prise en charge à 100% au titre des affections de longue durée (ALD 30) [8].
Peut-on avoir des enfants avec cette maladie ?
La grossesse est possible, mais nécessite une surveillance spécialisée en raison des traitements immunosuppresseurs. Une consultation pré-conceptionnelle est recommandée [14].
L'activité physique est-elle contre-indiquée ?
Au contraire, une activité physique adaptée est bénéfique. Elle doit être encadrée par un kinésithérapeute pour éviter les chutes [13].
Combien de temps durent les traitements ?
La durée varie selon les cas, de quelques mois à plusieurs années. Certains patients nécessitent un traitement à vie [2].
Questions Fréquentes
Le syndrome opsomyoclonique est-il héréditaire ?
Non, cette pathologie n'est pas héréditaire. Elle résulte d'une réaction auto-immune déclenchée par diverses causes comme une tumeur ou une infection.
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
La guérison complète est possible, particulièrement dans les formes idiopathiques. Cependant, des séquelles peuvent persister, notamment chez l'enfant.
Les traitements sont-ils remboursés ?
Oui, cette pathologie bénéficie d'une prise en charge à 100% au titre des affections de longue durée (ALD 30).
Peut-on avoir des enfants avec cette maladie ?
La grossesse est possible, mais nécessite une surveillance spécialisée en raison des traitements immunosuppresseurs. Une consultation pré-conceptionnelle est recommandée.
L'activité physique est-elle contre-indiquée ?
Au contraire, une activité physique adaptée est bénéfique. Elle doit être encadrée par un kinésithérapeute pour éviter les chutes.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] NOS PROJETS DE RECHERCHE. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Adult-onset opsoclonus-myoclonus-ataxia syndrome. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Opsoclonus - StatPearls. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Presentation, Diagnosis, and Treatment of 194 Patients. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] A case of suspected paraneoplastic nerve syndrome associated with prostate cancer or opsoclonus‐myoclonus syndrome associated with COVID‐19 infectionLien
- [6] Diagnostic d'un syndrome neurologique paranéoplasiqueLien
- [7] Opsomyoclonus: A rare complication of West Nile virusLien
- [8] Du bon usage aux contraintes d'approvisionnement, 25 années d'utilisation des immunoglobulines polyvalentesLien
- [13] Syndrome d'opsoclonie-myoclonieLien
- [14] Syndrome d'opsoclonus-myoclonusLien
Publications scientifiques
- A case of suspected paraneoplastic nerve syndrome associated with prostate cancer or opsoclonus‐myoclonus syndrome associated with COVID‐19 infection, but … (2025)
- Diagnostic d'un syndrome neurologique paranéoplasique (2023)
- Opsomyoclonus: A rare complication of West Nile virus (2024)
- [HTML][HTML] Du bon usage aux contraintes d'approvisionnement, 25 années d'utilisation des immunoglobulines polyvalentes (2025)
- [PDF][PDF] Development of Neuroblastoma During Growth Hormone Therapy for Short Stature in a Girl With Mosaic Turner Syndrome (2025)[PDF]
Ressources web
- Syndrome d'opsoclonie-myoclonie (orpha.net)
Le diagnostic est clinique et repose sur la présence de 3 sur 4 critères suivants : 1) neuroblastome, 2) opsoclonie, 3) mouvements anormaux avec myoclonie et/ou ...
- Syndrome d'opsoclonus-myoclonus (mircem.fr)
– Opsoclonies : mouvements anormaux anarchiques des yeux ; – Ataxie : troubles de la marche et/ou troubles de l'équilibre ; – Troubles du comportement et/ou du ...
- Syndrome d'opsoclonie-myoclonie (fr.wikipedia.org)
Signes et symptômes · des opsoclonies (mouvements oculaires rapides, involontaires, multivectoriels (horizontaux et verticaux), imprévisibles, conjugués, sans ...
- Syndrome Opsoclonus-Myoclonus : Causes et Traitement (medicoverhospitals.in)
Les symptômes comprennent des mouvements oculaires erratiques, des contractions musculaires et une ataxie. 2. Quelles sont les causes du syndrome d'opsoclonie- ...
- Le syndrome opsomyoclonique (afsop.fr)
Introduction : Le syndrome opsomyoclonique, ou syndrome de Kinsbourne, est un syndrome paranéoplasique rare, associé à un neuroblastome dans 46% des cas, ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
