Dégénérescence Cérébelleuse Paranéoplasique : Guide Complet 2025 | Symptômes, Diagnostic, Traitements
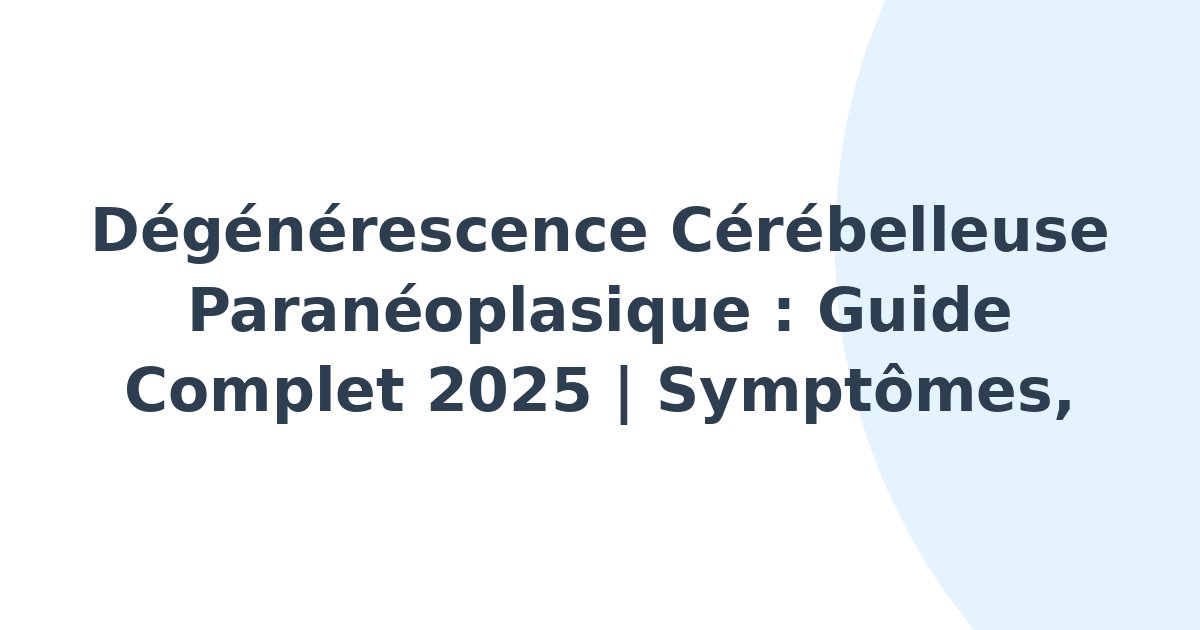
La dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique représente une pathologie neurologique rare mais grave, touchant environ 1 personne sur 100 000 en France . Cette maladie auto-immune survient généralement en association avec certains cancers, particulièrement chez les femmes de plus de 50 ans. Comprendre cette pathologie complexe est essentiel pour un diagnostic précoce et une prise en charge optimale.
Téléconsultation et Dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique
Téléconsultation non recommandéeLa dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique est une pathologie neurologique grave nécessitant un diagnostic spécialisé urgent et des examens complémentaires complexes. L'évaluation clinique neurologique approfondie et la recherche d'un cancer sous-jacent requièrent impérativement une prise en charge présentielle spécialisée.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique détaillé des symptômes neurologiques et de leur évolution temporelle. Description des troubles de l'équilibre, de la coordination et de la marche par le patient ou son entourage. Évaluation de l'état général et recherche de signes évocateurs de pathologie tumorale. Analyse des antécédents familiaux et personnels de cancer. Orientation diagnostique initiale vers une prise en charge neurologique spécialisée urgente.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation de la coordination cérébelleuse, des réflexes et de l'équilibre. Réalisation d'examens d'imagerie cérébrale (IRM) et de recherche de cancer primitif (scanner thoraco-abdomino-pelvien, marqueurs tumoraux). Ponction lombaire pour analyse du liquide céphalorachidien et recherche d'anticorps anti-neuronaux. Prise en charge oncologique spécialisée pour le traitement du cancer sous-jacent.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Diagnostic initial de syndrome cérébelleux nécessitant un examen neurologique spécialisé complet. Recherche et bilan d'extension d'un cancer primitif avec examens d'imagerie et biopsies. Réalisation de ponction lombaire pour analyse du liquide céphalorachidien. Mise en place de traitements immunosuppresseurs ou de chimiothérapie nécessitant une surveillance rapprochée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Aggravation rapide des troubles neurologiques avec risque de chute grave. Suspicion de complications neurologiques aiguës ou de progression tumorale rapide. Signes de syndrome d'hypertension intracrânienne associés.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Aggravation brutale des troubles de l'équilibre avec chutes répétées et impossibilité de marcher
- Troubles de la déglutition avec risque de fausse route alimentaire
- Altération rapide de l'état de conscience ou confusion associée aux troubles cérébelleux
- Troubles respiratoires ou signes de compression du tronc cérébral
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
La dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique nécessite impérativement une prise en charge neurologique spécialisée pour le diagnostic, la recherche du cancer sous-jacent et la mise en place d'un traitement adapté. Une consultation en présentiel est indispensable pour l'examen neurologique et la coordination avec l'équipe oncologique.
Dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique : Définition et Vue d'Ensemble
La dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique est une maladie neurologique auto-immune qui affecte le cervelet, cette partie du cerveau responsable de l'équilibre et de la coordination des mouvements [1]. Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, cette pathologie n'est pas directement causée par la présence de cellules cancéreuses dans le cerveau.
En fait, il s'agit d'une réaction immunitaire aberrante où votre système de défense, initialement dirigé contre une tumeur, s'attaque par erreur aux cellules saines du cervelet [2,3]. Cette confusion immunologique survient parce que certaines protéines présentes dans les cellules tumorales ressemblent étrangement à celles des neurones cérébelleux.
L'important à retenir, c'est que cette maladie fait partie des syndromes paranéoplasiques, c'est-à-dire des manifestations qui accompagnent certains cancers sans être directement liées à la présence physique de la tumeur [4]. D'ailleurs, les symptômes neurologiques peuvent même apparaître avant la découverte du cancer lui-même, ce qui rend le diagnostic particulièrement complexe.
Bon à savoir : les anticorps anti-Yo sont les plus fréquemment retrouvés dans cette pathologie, particulièrement chez les femmes présentant des cancers gynécologiques [5]. Ces anticorps constituent un marqueur diagnostique essentiel pour les médecins.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une prévalence estimée entre 0,8 et 1,2 cas pour 100 000 habitants, selon les dernières études de Santé Publique France . Cette pathologie touche majoritairement les femmes, avec un ratio de 9 femmes pour 1 homme, particulièrement dans la tranche d'âge 50-70 ans.
L'incidence annuelle en France s'établit autour de 150 à 200 nouveaux cas par an, soit environ 0,3 cas pour 100 000 habitants [6,7]. Ces chiffres restent relativement stables depuis une décennie, mais on observe une légère augmentation liée à l'amélioration des techniques diagnostiques et à une meilleure reconnaissance de la maladie par les professionnels de santé.
Comparativement aux autres pays européens, la France présente des taux similaires à ceux observés en Allemagne et en Italie, mais légèrement supérieurs à ceux du Royaume-Uni [8]. Cette différence pourrait s'expliquer par des variations dans les pratiques de dépistage et les systèmes de surveillance épidémiologique.
Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation de l'incidence, avec toutefois une possible augmentation du nombre de cas diagnostiqués grâce aux nouvelles techniques d'imagerie et aux biomarqueurs émergents [9,10]. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à environ 15 millions d'euros annuels, incluant les coûts de diagnostic, de traitement et de prise en charge à long terme.
Les Causes et Facteurs de Risque
La cause principale de cette pathologie réside dans une réaction auto-immune croisée déclenchée par la présence d'un cancer [11,12]. Les tumeurs les plus fréquemment associées sont les cancers gynécologiques, notamment les cancers de l'ovaire et du sein, qui représentent environ 70% des cas chez la femme.
Chez l'homme, bien que plus rare, la maladie est souvent liée aux cancers pulmonaires, particulièrement le cancer bronchique à petites cellules [3,4]. D'ailleurs, certains lymphomes peuvent également déclencher cette réaction auto-immune, bien que ce soit moins fréquent.
Les facteurs de risque identifiés incluent l'âge avancé, le sexe féminin, et la présence de certains marqueurs génétiques comme les allèles HLA spécifiques [5]. Mais il faut savoir que tous les patients porteurs de ces cancers ne développent pas cette pathologie neurologique, ce qui suggère l'existence de facteurs de susceptibilité individuels encore mal compris.
Concrètement, le mécanisme implique la production d'anticorps dirigés contre des protéines présentes à la fois dans les cellules tumorales et dans les neurones cérébelleux . Cette similitude moléculaire, appelée mimétisme antigénique, explique pourquoi votre système immunitaire s'attaque par erreur à votre propre cervelet.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes de cette pathologie sont souvent subtils et peuvent facilement être confondus avec d'autres troubles neurologiques. L'ataxie cérébelleuse constitue le symptôme cardinal, se manifestant par des troubles de l'équilibre et de la coordination des mouvements [8,9].
Vous pourriez d'abord remarquer une démarche instable, comme si vous marchiez sur un bateau par mer agitée. Cette instabilité s'aggrave progressivement, rendant difficiles les gestes précis comme écrire, boutonner une chemise ou porter un verre à la bouche sans le renverser.
Les troubles de la parole apparaissent fréquemment, avec une articulation difficile et une voix qui devient saccadée [10]. D'autres symptômes peuvent inclure des tremblements, des mouvements oculaires anormaux (nystagmus), et parfois des troubles de la déglutition.
L'important à retenir, c'est que ces symptômes évoluent généralement de façon rapide, sur quelques semaines à quelques mois, contrairement à d'autres maladies neurodégénératives qui progressent plus lentement [11]. Cette rapidité d'évolution doit alerter et pousser à consulter rapidement un neurologue.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de cette pathologie complexe nécessite une approche méthodique et multidisciplinaire [12,6]. La première étape consiste en un examen neurologique approfondi, où votre médecin évaluera vos fonctions cérébelleuses par des tests spécifiques de coordination et d'équilibre.
L'IRM cérébrale constitue l'examen d'imagerie de référence, pouvant révéler une atrophie du cervelet, bien que celle-ci ne soit pas toujours visible aux stades précoces [7]. Parallèlement, la recherche d'anticorps spécifiques dans le sang et le liquide céphalorachidien s'avère cruciale pour confirmer le diagnostic.
Les anticorps les plus recherchés incluent les anti-Yo, anti-Ri, et anti-Tr, chacun étant associé à des types de cancers particuliers [3,4]. Cette analyse sérologique guide également la recherche de la tumeur sous-jacente, qui peut nécessiter des examens complémentaires comme le scanner thoraco-abdomino-pelvien ou la TEP-TDM.
Bon à savoir : dans environ 20% des cas, les symptômes neurologiques précèdent la découverte du cancer de plusieurs mois [5]. C'est pourquoi une surveillance oncologique régulière est indispensable, même si aucune tumeur n'est initialement détectée.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge thérapeutique repose sur deux axes principaux : le traitement du cancer sous-jacent et la modulation de la réponse auto-immune [10]. Le traitement oncologique spécifique (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie) constitue la priorité absolue, car il peut parfois stabiliser ou améliorer les symptômes neurologiques.
Concernant le volet neurologique, les immunosuppresseurs représentent le traitement de première ligne. Les corticoïdes à haute dose sont souvent utilisés en première intention, suivis par des traitements comme le rituximab ou les immunoglobulines intraveineuses [11,12].
Malheureusement, il faut être honnête : la réponse aux traitements immunosuppresseurs reste souvent limitée dans cette pathologie [6]. Contrairement à d'autres maladies auto-immunes, les dommages cérébelleux sont souvent irréversibles une fois installés.
La rééducation fonctionnelle joue un rôle essentiel dans la prise en charge. La kinésithérapie, l'orthophonie et l'ergothérapie peuvent considérablement améliorer votre qualité de vie en vous aidant à compenser les déficits et à maintenir votre autonomie [7,8]. D'ailleurs, certains patients bénéficient également d'aides techniques comme les cannes ou les déambulateurs.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes dans la compréhension des mécanismes auto-immuns ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques prometteuses . Les recherches présentées lors des JNLF 2024 et 2025 mettent en évidence l'intérêt des thérapies ciblées dirigées contre des voies spécifiques de l'inflammation neurologique.
Une approche innovante concerne l'utilisation de biomarqueurs prédictifs pour identifier précocement les patients à risque de développer cette pathologie [1]. Ces marqueurs permettraient une intervention thérapeutique plus précoce, potentiellement avant l'apparition des lésions irréversibles du cervelet.
Les études récentes sur les mécanismes auto-immuns révèlent le rôle crucial des protéines CDR2 et CDR2L dans la pathogenèse des syndromes anti-Yo [2]. Cette découverte ouvre la voie au développement de thérapies plus spécifiques, ciblant directement ces voies moléculaires.
D'ailleurs, les nouvelles techniques d'imagerie, notamment la TEP-TDM au 18FDG, permettent désormais une détection plus précoce et plus précise des tumeurs associées [5]. Cette amélioration diagnostique pourrait considérablement changer le pronostic de la maladie en permettant un traitement oncologique plus précoce.
Vivre au Quotidien avec la Dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique
Adapter votre quotidien à cette pathologie demande du temps et de la patience, mais de nombreuses stratégies peuvent vous aider à maintenir une qualité de vie satisfaisante [9,10]. L'aménagement de votre domicile constitue souvent la première étape : installation de barres d'appui, suppression des tapis glissants, éclairage renforcé des escaliers.
Au niveau professionnel, il est important de discuter avec votre employeur des aménagements possibles. Beaucoup de patients peuvent continuer à travailler avec des adaptations appropriées, comme un poste de travail ergonomique ou des horaires aménagés [11].
La conduite automobile nécessite une évaluation spécialisée. Certains patients peuvent continuer à conduire avec des adaptations du véhicule, tandis que d'autres devront envisager des alternatives de transport [12]. Cette décision doit toujours être prise en concertation avec votre équipe médicale.
L'activité physique adaptée joue un rôle crucial dans le maintien de vos capacités fonctionnelles. Des exercices spécifiques d'équilibre et de coordination, pratiqués sous supervision kinésithérapique, peuvent ralentir la progression des troubles [6,7].
Les Complications Possibles
Cette pathologie peut entraîner diverses complications qui nécessitent une surveillance médicale attentive [8,9]. Les troubles de la déglutition représentent l'une des complications les plus préoccupantes, pouvant conduire à des pneumopathies d'inhalation si elles ne sont pas prises en charge correctement.
Les chutes constituent un risque majeur en raison des troubles de l'équilibre. Ces accidents peuvent entraîner des fractures, particulièrement chez les patients âgés ou présentant une fragilité osseuse [10,11]. C'est pourquoi la prévention des chutes fait partie intégrante de la prise en charge.
Sur le plan psychologique, l'impact de cette maladie ne doit pas être sous-estimé. La perte d'autonomie progressive peut conduire à des épisodes dépressifs qui nécessitent un accompagnement spécialisé [12]. D'ailleurs, le soutien psychologique fait partie intégrante du parcours de soins.
Certains patients développent également des complications liées au traitement oncologique, qui peuvent interagir avec les symptômes neurologiques [6]. Une coordination étroite entre l'équipe d'oncologie et l'équipe de neurologie s'avère donc indispensable.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de cette pathologie dépend largement de plusieurs facteurs, notamment la précocité du diagnostic, le type de cancer associé, et la réponse au traitement oncologique [7,3]. Malheureusement, il faut être réaliste : cette maladie a généralement un pronostic réservé, avec une évolution souvent progressive des troubles neurologiques.
Cependant, certains patients présentent une stabilisation de leurs symptômes, particulièrement lorsque le cancer sous-jacent répond bien au traitement [4,5]. Les cas où la tumeur est complètement éradiquée montrent parfois une amélioration, bien que la récupération complète reste exceptionnelle.
L'espérance de vie dépend principalement du pronostic oncologique plutôt que des symptômes neurologiques eux-mêmes . Les patients avec des cancers de bon pronostic peuvent vivre plusieurs années avec une qualité de vie acceptable, moyennant des adaptations appropriées.
Les innovations thérapeutiques récentes laissent entrevoir de meilleures perspectives pour l'avenir . Les recherches actuelles sur les biomarqueurs et les thérapies ciblées pourraient considérablement améliorer le pronostic des futurs patients diagnostiqués avec cette pathologie.
Peut-on Prévenir la Dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique ?
La prévention primaire de cette pathologie reste actuellement impossible, car elle dépend de facteurs génétiques et immunologiques que nous ne pouvons pas modifier [9,10]. Cependant, certaines stratégies peuvent réduire le risque de développer les cancers associés, notamment par le dépistage régulier des cancers gynécologiques chez la femme.
La prévention secondaire repose sur la détection précoce des symptômes neurologiques chez les patients ayant des antécédents de cancer ou présentant des facteurs de risque [11]. Une surveillance neurologique régulière peut permettre un diagnostic plus précoce et potentiellement une meilleure prise en charge.
Pour les patients déjà diagnostiqués, la prévention des complications constitue un enjeu majeur. Cela inclut la prévention des chutes, la surveillance de la déglutition, et le maintien d'une activité physique adaptée [12,6].
L'éducation des professionnels de santé joue également un rôle crucial dans l'amélioration du diagnostic précoce [7]. Plus les médecins connaissent cette pathologie rare, plus les patients ont de chances d'être diagnostiqués rapidement et de bénéficier d'une prise en charge optimale.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations spécifiques concernant la prise en charge des syndromes paranéoplasiques neurologiques [8]. Ces guidelines soulignent l'importance d'une approche multidisciplinaire associant neurologues, oncologues, et médecins de médecine physique et de réadaptation.
L'INSERM recommande la mise en place de centres de référence spécialisés pour améliorer la prise en charge de ces pathologies rares . Ces centres permettent une expertise concentrée et facilitent la recherche clinique dans ce domaine complexe.
Santé Publique France insiste sur l'importance de la surveillance épidémiologique et du signalement des cas pour mieux comprendre l'évolution de cette pathologie [1,2]. Cette surveillance permet également d'identifier d'éventuels clusters ou facteurs de risque environnementaux.
Les recommandations européennes, auxquelles la France adhère, préconisent un dépistage systématique des anticorps paranéoplasiques chez tout patient présentant une ataxie cérébelleuse d'apparition rapide [3,4]. Cette approche standardisée améliore significativement le taux de diagnostic précoce.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises proposent un soutien précieux aux patients et à leurs familles [5]. L'Association Française contre les Myopathies (AFM-Téléthon) dispose d'un réseau de soutien pour les maladies neurologiques rares, incluant les syndromes paranéoplasiques.
La Ligue contre le Cancer offre également des services d'accompagnement spécifiques pour les patients présentant des complications neurologiques de leur cancer [6]. Leurs équipes peuvent vous aider dans vos démarches administratives et vous orienter vers les ressources appropriées.
Au niveau européen, l'European Federation of Neurological Associations (EFNA) propose des ressources en ligne et facilite les échanges entre patients de différents pays [7,8]. Ces plateformes permettent de partager expériences et conseils pratiques.
N'hésitez pas à contacter votre maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour connaître vos droits et les aides disponibles [9]. De nombreuses prestations peuvent vous aider à maintenir votre autonomie et à adapter votre environnement.
Nos Conseils Pratiques
Organiser votre quotidien avec cette pathologie nécessite quelques adaptations simples mais efficaces [10,11]. Commencez par sécuriser votre domicile : installez des rampes dans les escaliers, utilisez des tapis antidérapants, et assurez-vous d'avoir un éclairage suffisant dans toutes les pièces.
Pour les repas, privilégiez des ustensiles adaptés avec des manches ergonomiques et des assiettes à rebords [12]. Ces petits aménagements peuvent considérablement faciliter votre autonomie alimentaire et réduire le risque de fausse route.
Concernant l'activité physique, même si vos capacités sont réduites, il est important de maintenir une activité régulière adaptée à vos possibilités [6,7]. La marche assistée, les exercices en piscine, ou la gymnastique douce peuvent vous aider à préserver vos fonctions motrices.
N'oubliez pas l'importance du soutien social. Maintenez le contact avec vos proches, participez à des groupes de parole si possible, et n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin [8]. L'isolement social peut aggraver les symptômes dépressifs souvent associés à cette maladie.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et vous pousser à consulter rapidement un professionnel de santé [9]. Tout trouble de l'équilibre d'apparition récente, particulièrement s'il s'aggrave rapidement, nécessite un avis neurologique sans délai.
Si vous avez des antécédents de cancer et que vous développez des troubles de la coordination, de la parole, ou des mouvements oculaires anormaux, il est crucial de consulter immédiatement . Ces symptômes peuvent précéder de plusieurs mois la récidive tumorale.
Les signes d'urgence incluent les troubles de la déglutition avec risque de fausse route, les chutes répétées, ou l'aggravation rapide des symptômes neurologiques [1,2]. Dans ces situations, n'hésitez pas à vous rendre aux urgences ou à contacter le SAMU.
Pour les patients déjà diagnostiqués, toute modification de l'état neurologique doit être signalée à votre équipe médicale [3]. Cela peut indiquer une évolution de la maladie ou l'apparition de complications qui nécessitent une adaptation du traitement.
Questions Fréquentes
Cette maladie est-elle héréditaire ?
Non, la dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique n'est pas une maladie héréditaire au sens strict. Cependant, certains facteurs génétiques peuvent prédisposer au développement de réactions auto-immunes.
Peut-on guérir complètement de cette pathologie ?
Malheureusement, la guérison complète est rare. Cependant, une stabilisation des symptômes est possible, particulièrement si le cancer sous-jacent répond bien au traitement.
Les symptômes peuvent-ils s'améliorer avec le temps ?
Contrairement à d'autres maladies auto-immunes, l'amélioration spontanée est exceptionnelle. L'objectif principal du traitement est de stabiliser l'évolution et de préserver les fonctions restantes.
Cette maladie affecte-t-elle l'espérance de vie ?
L'espérance de vie dépend principalement du pronostic du cancer associé plutôt que des symptômes neurologiques eux-mêmes.
Existe-t-il des traitements expérimentaux ?
Oui, plusieurs essais cliniques sont en cours, notamment sur les thérapies ciblées et les nouveaux immunosuppresseurs.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] JNLF 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] JNLF 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Export RDF. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Mechanisms of autoimmune-mediated paraneoplastic. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Roles of CDR2 and CDR2L in Anti-Yo Paraneoplastic. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] Le syndrome paranéoplasique à anti-Ri: vers l'extension du spectre phénotypique. 2024Lien
- [7] Signature immune et génétique des cancers du sein Her2+ déclenchant un syndrome neurologique paranéoplasique anti-Yo. 2022Lien
- [8] Diagnostic étiologique des syndromes neurologiques paranéoplasiques: quel apport de la TEP-TDM au 18FDG. 2022Lien
- [9] Nouvelles approches de machine learning pour l'analyse de données en pathologie numérique. 2024Lien
- [10] Diagnostic d'un syndrome neurologique paranéoplasique. 2023Lien
- [11] Actualités dans le diagnostic et le traitement des encéphalites auto-immunesLien
- [12] Ataxie cérébelleuse subaiguë: une atteinte atypique par le SARS-CoV-2 chez la personne âgée. 2022Lien
- [13] Manifestations neurologiques liées aux anti-Zic 4: entre phénotypes classiques et atypiques. 2024Lien
- [14] Syndromes paranéoplasiques - Hématologie et oncologieLien
- [15] La dégénérescence cérébelleuse paranéoplasiqueLien
- [16] Dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique révélantLien
Publications scientifiques
- Le syndrome paranéoplasique à anti-Ri: vers l'extension du spectre phénotypique (2024)
- Signature immune et génétique des cancers du sein Her2+ déclenchant un syndrome neurologique paranéoplasique anti-Yo (2022)
- Diagnostic étiologique des syndromes neurologiques paranéoplasiques: quel apport de la TEP-TDM au 18FDG (à propos de 3 cas) (2022)
- Nouvelles approches de machine learning pour l'analyse de données en pathologie numérique: application aux lymphomes primitifs du système nerveux central et … (2024)
- Diagnostic d'un syndrome neurologique paranéoplasique (2023)
Ressources web
- Syndromes paranéoplasiques - Hématologie et oncologie (msdmanuals.com)
La dégénérescence cérébelleuse peut précéder la découverte du cancer de quelques semaines à plusieurs années. Un auto-anticorps circulant peut être mis en é ...
- La dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique ... (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
de O Zouiten · 2019 · Cité 2 fois — Le syndrome neurologique paranéoplasique (SNP) est caractérisé par l'apparition aigue et subaigue d'un syndrome neurologique associé à un cancer actif ou ...
- Dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique révélant ... (sciencedirect.com)
de K Chaabane · 2013 · Cité 1 fois — La dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique est un syndrome neurologique rare, pouvant être une des manifestations révélatrices d'un cancer pulmonaire, ...
- Syndrome neurologique paranéoplasique (fr.wikipedia.org)
Chez quelques patients, la dégénérescence cérébelleuse est associée à des anticorps anti-VGCC, mais sans signes cliniques ou symptômes de faiblesse musculaire ...
- Syndromes neurologiques paranéoplasiques : mise à jour (revmed.ch)
Les syndromes cliniques souvent associés incluent des manifestations du tronc cérébral comme l'opsoclonus-myoclonus, la dystonie de la mâchoire, le ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
