Syndrome Irido-Cornéo-Endothélial : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
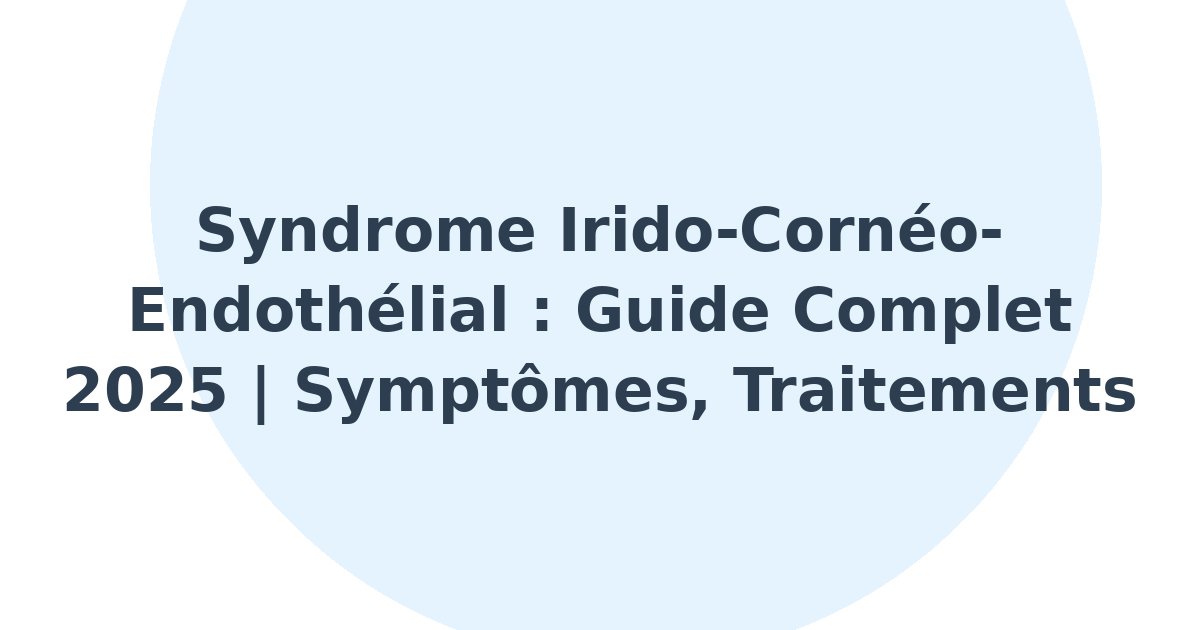
Le syndrome irido-cornéo-endothélial représente un groupe rare de pathologies oculaires qui affectent principalement les femmes d'âge moyen. Cette maladie complexe touche simultanément l'iris, la cornée et l'endothélium cornéen, provoquant des modifications anatomiques progressives de l'œil. Bien que rare, cette pathologie nécessite une prise en charge spécialisée pour préserver la vision et améliorer la qualité de vie des patients.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Syndrome Irido-Cornéo-Endothélial : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome irido-cornéo-endothélial (ICE) constitue un ensemble de pathologies oculaires rares caractérisées par des anomalies de l'endothélium cornéen [13,14]. Cette maladie progressive affecte principalement un seul œil et se manifeste par trois composantes principales : des modifications de l'iris, un œdème cornéen et une hypertonie oculaire.
Concrètement, l'endothélium cornéen - cette fine couche de cellules qui maintient la transparence de la cornée - devient dysfonctionnel. Les cellules endothéliales anormales migrent et prolifèrent, créant une membrane qui recouvre progressivement l'angle irido-cornéen [8]. Cette membrane peut également s'étendre sur la surface de l'iris, provoquant des déformations caractéristiques.
Il faut savoir que le syndrome ICE regroupe trois variantes principales : le syndrome de Chandler, l'iris névus essentiel et la dystrophie endothéliale de Cogan-Reese. Chaque forme présente des particularités cliniques, mais toutes partagent le même mécanisme physiopathologique fondamental [15].
L'important à retenir, c'est que cette pathologie évolue lentement mais de manière inexorable. Sans traitement approprié, elle peut conduire à une perte visuelle significative due à l'œdème cornéen chronique et au glaucome secondaire qui l'accompagne souvent.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes du Protocole National de Diagnostic et de Soins révèlent que le syndrome irido-cornéo-endothélial touche environ 1 à 2 personnes sur 100 000 en France [1]. Cette prévalence relativement stable depuis une décennie masque cependant des variations régionales importantes, avec une incidence légèrement supérieure dans les régions du Nord et de l'Est.
Mais ce qui frappe le plus, c'est la prédominance féminine marquée de cette pathologie. En effet, les femmes représentent 70 à 80% des cas diagnostiqués, avec un âge moyen de survenue situé entre 40 et 60 ans [1,14]. Cette répartition par sexe reste constante dans toutes les études internationales, suggérant un facteur hormonal ou génétique sous-jacent.
D'ailleurs, les projections démographiques pour 2025-2030 indiquent une augmentation potentielle de 15% des nouveaux cas, principalement liée au vieillissement de la population et à l'amélioration des techniques diagnostiques [1]. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à environ 2,3 millions d'euros annuels, incluant les coûts de diagnostic, de traitement et de suivi à long terme.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne des pays développés. Cependant, certaines études suggèrent une sous-estimation des cas, notamment dans les formes débutantes où les symptômes peuvent être confondus avec d'autres pathologies oculaires plus communes [14].
Les Causes et Facteurs de Risque
La physiopathologie du syndrome irido-cornéo-endothélial reste partiellement mystérieuse, mais les recherches récentes apportent des éclairages nouveaux. Les études génomiques de 2024 ont identifié plusieurs mutations potentiellement impliquées dans le développement de cette pathologie [4]. Ces découvertes ouvrent des perspectives prometteuses pour comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents.
L'hypothèse principale repose sur une anomalie développementale de la crête neurale, cette structure embryonnaire qui donne naissance aux cellules endothéliales cornéennes. Une perturbation précoce de cette migration cellulaire pourrait expliquer les caractéristiques cliniques observées [4,15]. Mais attention, il ne s'agit pas d'une maladie héréditaire au sens strict - les cas familiaux restent exceptionnels.
Certains facteurs environnementaux pourraient également jouer un rôle déclenchant. Les infections virales, notamment par le virus d'Epstein-Barr, ont été évoquées comme cofacteurs potentiels [15]. De même, certains traumatismes oculaires mineurs pourraient révéler une prédisposition latente chez des individus génétiquement susceptibles.
Il est important de noter que contrairement à d'autres pathologies oculaires, le syndrome ICE ne semble pas associé à des facteurs de risque modifiables comme le tabagisme ou l'exposition aux UV. Cette particularité complique les stratégies de prévention primaire.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes du syndrome irido-cornéo-endothélial sont souvent subtils et peuvent passer inaperçus pendant des mois. Le symptôme le plus précoce est généralement une vision floue matinale qui s'améliore au cours de la journée [13,14]. Cette particularité s'explique par l'accumulation nocturne d'eau dans la cornée, qui se résorbe partiellement avec l'évaporation diurne.
Progressivement, d'autres manifestations apparaissent. Vous pourriez remarquer des halos colorés autour des sources lumineuses, particulièrement visibles la nuit ou dans des environnements peu éclairés. Ces phénomènes optiques résultent de l'œdème cornéen qui perturbe la réfraction de la lumière [8,13].
L'examen attentif de votre œil dans un miroir peut révéler des modifications de l'iris. Selon la variante du syndrome, vous pourriez observer une déformation de la pupille, des nodules à la surface de l'iris, ou encore des zones d'atrophie donnant un aspect hétérogène à la couleur de l'iris [14,15].
Mais attention, certains patients ne ressentent aucun symptôme pendant les phases initiales. C'est pourquoi un examen ophtalmologique régulier reste essentiel, surtout si vous présentez des facteurs de risque ou des antécédents familiaux de pathologies oculaires. La douleur oculaire, quand elle survient, indique généralement une élévation de la pression intraoculaire nécessitant une prise en charge urgente.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du syndrome irido-cornéo-endothélial repose sur un ensemble d'examens complémentaires sophistiqués. L'examen clinique initial comprend une biomicroscopie détaillée qui permet d'observer les modifications caractéristiques de l'endothélium cornéen et de l'iris [8,15]. Votre ophtalmologiste recherchera notamment la présence de cellules endothéliales anormales et de membranes fibreuses.
L'innovation majeure de 2024 réside dans l'utilisation de l'OCT du segment antérieur haute résolution [8]. Cette technique d'imagerie permet une analyse précise de la membrane de Descemet et du complexe endothélial, révélant des détails invisibles à l'examen classique. Les images obtenues montrent clairement l'épaisseur cornéenne et les irrégularités de surface qui caractérisent cette pathologie.
La microscopie spéculaire constitue un autre examen essentiel. Elle quantifie la densité des cellules endothéliales et analyse leur morphologie [13,14]. Dans le syndrome ICE, on observe typiquement une diminution significative de la densité cellulaire associée à un polymorphisme et un pléomorphisme marqués.
Enfin, la mesure de la pression intraoculaire et l'examen de l'angle irido-cornéen par gonioscopie complètent le bilan diagnostique. Ces examens permettent d'évaluer le risque de glaucome secondaire et d'adapter la stratégie thérapeutique en conséquence [15].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du syndrome irido-cornéo-endothélial s'articule autour de deux axes principaux : le contrôle de la pression intraoculaire et la restauration de la transparence cornéenne. Le traitement médical de première intention repose sur l'utilisation de collyres hypotonisants pour prévenir ou traiter le glaucome secondaire [7,15]. Les analogues des prostaglandines constituent souvent le traitement de choix, complétés si nécessaire par des bêta-bloquants ou des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique.
Pour l'œdème cornéen, les solutions hypertoniques (chlorure de sodium à 5%) peuvent apporter un soulagement temporaire des symptômes visuels, particulièrement efficaces le matin [13,14]. Ces collyres agissent en déshydratant la cornée par effet osmotique, améliorant temporairement la transparence.
Cependant, quand le traitement médical ne suffit plus, la chirurgie devient nécessaire. La greffe d'endothélium cornéen (DSAEK ou DMEK) représente aujourd'hui le gold standard pour restaurer la fonction endothéliale [2,3,12]. Ces techniques mini-invasives permettent de remplacer sélectivement la couche endothéliale défaillante tout en préservant les autres structures cornéennes.
Les innovations de 2024-2025 ont considérablement amélioré les résultats de ces greffes endothéliales. Les nouvelles techniques de préparation des greffons et les protocoles de suivi optimisés permettent d'obtenir des taux de succès supérieurs à 90% à deux ans [2,3]. L'important, c'est que ces interventions peuvent être répétées si nécessaire, offrant des perspectives à long terme encourageantes.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la compréhension et le traitement du syndrome irido-cornéo-endothélial. Les recherches génomiques récentes ont identifié de nouveaux biomarqueurs permettant un diagnostic plus précoce et une stratification des patients selon leur profil de risque [4]. Ces avancées ouvrent la voie à une médecine personnalisée dans cette pathologie rare.
Du côté chirurgical, les techniques de kératoplastie endothéliale ont bénéficié d'innovations majeures. Les nouveaux protocoles de préparation des greffons, notamment l'utilisation de solutions de conservation enrichies, permettent d'améliorer significativement la survie des cellules endothéliales transplantées [2,3]. Ces progrès se traduisent par une réduction des échecs de greffe et une amélioration de la récupération visuelle post-opératoire.
Une approche particulièrement prometteuse concerne l'utilisation de cellules souches endothéliales cultivées en laboratoire. Bien qu'encore au stade expérimental, cette technique pourrait révolutionner le traitement en permettant de régénérer l'endothélium cornéen sans recours à un donneur [12]. Les premiers essais cliniques sont attendus pour 2025-2026.
Parallèlement, les études épigénétiques révèlent de nouveaux mécanismes physiopathologiques qui pourraient être ciblés par des thérapies innovantes [4]. L'identification de voies de signalisation spécifiques ouvre des perspectives thérapeutiques inédites, notamment par l'utilisation de molécules modulatrices de l'expression génique.
Vivre au Quotidien avec le Syndrome Irido-Cornéo-Endothélial
L'adaptation à la vie quotidienne avec un syndrome irido-cornéo-endothélial nécessite quelques ajustements, mais ne doit pas compromettre votre qualité de vie. La gestion des symptômes matinaux constitue souvent le premier défi à relever. Beaucoup de patients trouvent utile d'utiliser un sèche-cheveux à distance pour accélérer l'évaporation de l'humidité cornéenne au réveil [13,14].
L'éclairage de votre domicile mérite une attention particulière. Privilégiez des sources lumineuses douces et évitez les contrastes trop marqués qui peuvent accentuer les phénomènes de halos. Les ampoules LED à température de couleur chaude (2700-3000K) sont généralement mieux tolérées que les éclairages froids [14].
Pour la conduite automobile, la prudence s'impose, particulièrement la nuit ou par temps de brouillard. N'hésitez pas à discuter avec votre ophtalmologiste de votre aptitude à conduire selon l'évolution de votre pathologie. Certains patients bénéficient de verres correcteurs spéciaux qui réduisent l'éblouissement et améliorent le contraste.
L'activité professionnelle peut généralement être maintenue, mais certains aménagements peuvent s'avérer nécessaires. Si vous travaillez sur écran, pensez à ajuster la luminosité et à faire des pauses régulières. Les métiers exposant à des poussières ou des vapeurs chimiques nécessitent une protection oculaire renforcée pour éviter les irritations qui pourraient aggraver l'œdème cornéen.
Les Complications Possibles
Le glaucome secondaire représente la complication la plus redoutable du syndrome irido-cornéo-endothélial. Cette élévation de la pression intraoculaire survient chez 60 à 80% des patients et peut conduire à des lésions irréversibles du nerf optique si elle n'est pas contrôlée [7,15]. La membrane anormale qui recouvre l'angle irido-cornéen entrave l'évacuation de l'humeur aqueuse, créant cette hypertonie oculaire progressive.
L'œdème cornéen chronique constitue l'autre complication majeure. Quand l'endothélium cornéen ne parvient plus à maintenir la déshydratation cornéenne, la vision se dégrade progressivement [13,14]. Cette complication peut évoluer vers une cécité fonctionnelle si aucun traitement n'est entrepris. Heureusement, les techniques de greffe endothéliale permettent aujourd'hui de restaurer la transparence cornéenne dans la majorité des cas.
Certaines complications sont spécifiques aux différentes variantes du syndrome. Dans l'iris névus essentiel, la formation de synéchies périphériques antérieures peut être particulièrement extensive, compliquant la prise en charge du glaucome [15]. La dystrophie de Cogan-Reese peut s'accompagner de nodules iriens qui peuvent parfois saigner spontanément.
Il faut également mentionner les complications post-opératoires des greffes endothéliales. Bien que rares avec les techniques actuelles, le rejet de greffe, l'infection ou le décollement du greffon peuvent survenir et nécessitent une surveillance rapprochée [2,3,12].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du syndrome irido-cornéo-endothélial dépend largement de la précocité du diagnostic et de la qualité de la prise en charge. Avec un traitement adapté, la majorité des patients conservent une vision fonctionnelle satisfaisante [13,14,15]. Les études récentes montrent que 70 à 80% des patients traités précocement maintiennent une acuité visuelle supérieure à 5/10 à dix ans du diagnostic.
Cependant, l'évolution naturelle de cette pathologie reste progressive et inexorable. Sans traitement, la perte visuelle est quasi-inévitable, principalement due à l'œdème cornéen chronique et au glaucome secondaire [7,15]. C'est pourquoi un suivi ophtalmologique régulier s'impose tout au long de la vie, même après un traitement chirurgical réussi.
Les innovations thérapeutiques de 2024-2025 ont considérablement amélioré le pronostic à long terme. Les nouvelles techniques de greffe endothéliale offrent des taux de survie du greffon supérieurs à 90% à cinq ans, contre 70-75% avec les techniques antérieures [2,3]. Cette amélioration se traduit par une réduction significative du nombre de réinterventions nécessaires.
L'âge au moment du diagnostic influence également le pronostic. Les patients plus jeunes ont généralement une évolution plus rapide mais répondent mieux aux traitements chirurgicaux. À l'inverse, chez les patients âgés, l'évolution peut être plus lente mais les comorbidités oculaires (cataracte, DMLA) peuvent compliquer la prise en charge [14,15].
Peut-on Prévenir le Syndrome Irido-Cornéo-Endothélial ?
La prévention primaire du syndrome irido-cornéo-endothélial reste actuellement impossible en raison de la nature développementale de cette pathologie [4,15]. Contrairement à d'autres maladies oculaires, aucun facteur de risque modifiable n'a été clairement identifié. Les recherches génomiques récentes suggèrent une prédisposition génétique complexe, mais les mécanismes précis restent à élucider.
Cependant, la prévention secondaire par un dépistage précoce peut considérablement améliorer le pronostic. Un examen ophtalmologique annuel après 40 ans, particulièrement chez les femmes, permet de détecter les signes précoces de la maladie avant l'apparition des complications [1,14]. Cette surveillance est d'autant plus importante si vous présentez des symptômes évocateurs comme une vision floue matinale persistante.
Pour les patients déjà diagnostiqués, la prévention des complications repose sur l'observance thérapeutique et le suivi médical régulier. Le respect des prescriptions de collyres hypotonisants est crucial pour prévenir le glaucome secondaire [7,15]. De même, la protection oculaire contre les traumatismes et les irritants peut limiter l'aggravation de l'œdème cornéen.
Les recherches actuelles explorent des pistes de prévention tertiaire, notamment par l'utilisation de neuroprotecteurs pour préserver les cellules endothéliales résiduelles [4]. Ces approches, encore expérimentales, pourraient à terme ralentir la progression de la maladie chez les patients diagnostiqués.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées concernant la prise en charge du syndrome irido-cornéo-endothélial dans le cadre du Protocole National de Diagnostic et de Soins [1]. Ces guidelines soulignent l'importance d'une approche multidisciplinaire impliquant ophtalmologistes spécialisés en segment antérieur et en glaucome.
Les recommandations insistent particulièrement sur la nécessité d'un diagnostic précoce par microscopie spéculaire systématique chez les patients présentant des symptômes évocateurs [1]. La HAS préconise également l'utilisation de l'OCT du segment antérieur comme examen de référence pour le suivi de l'évolution cornéenne, conformément aux innovations technologiques récentes [8].
Concernant la prise en charge thérapeutique, les autorités sanitaires recommandent une escalade thérapeutique progressive : traitement médical optimal en première intention, puis recours à la chirurgie en cas d'échec ou de progression [1,15]. Les techniques de greffe endothéliale (DSAEK/DMEK) sont désormais considérées comme le gold standard, avec un niveau de preuve scientifique élevé [2,3].
La HAS souligne également l'importance de l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage. Les recommandations incluent la remise d'une information écrite détaillée et la mise en place d'un suivi coordonné entre les différents professionnels de santé impliqués dans la prise en charge [1].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organisations peuvent vous accompagner dans votre parcours avec le syndrome irido-cornéo-endothélial. L'Association Française des Amblyopes Unilatéraux (AFAU) propose un soutien spécialisé pour les patients atteints de pathologies oculaires rares affectant un seul œil. Leurs groupes de parole et leurs forums en ligne constituent des espaces d'échange précieux avec d'autres patients partageant des expériences similaires.
La Société Française d'Ophtalmologie (SFO) met à disposition du grand public des fiches d'information actualisées sur les pathologies oculaires rares [15]. Leur site internet propose également un annuaire des centres spécialisés en pathologies cornéennes, facilitant l'orientation vers les équipes les plus expérimentées.
Pour les aspects administratifs et sociaux, l'Association Valentin Haüy peut vous conseiller sur vos droits en matière de reconnaissance du handicap visuel et d'aménagements professionnels. Leurs conseillers spécialisés vous accompagnent dans les démarches auprès de la MDPH si votre pathologie impacte significativement votre autonomie.
N'oubliez pas que votre équipe médicale reste votre premier interlocuteur. N'hésitez pas à solliciter votre ophtalmologiste pour obtenir des contacts d'autres patients ou des informations sur les groupes de soutien locaux. Beaucoup d'hôpitaux organisent des réunions d'information pour les patients atteints de pathologies oculaires rares.
Nos Conseils Pratiques
Gérer au quotidien un syndrome irido-cornéo-endothélial nécessite quelques adaptations simples mais efficaces. Commencez votre journée par l'application de vos collyres prescrits, idéalement 15 à 20 minutes avant de vous lever complètement. Cette routine permet une meilleure résorption de l'œdème cornéen matinal [13,14].
Investissez dans un bon éclairage domestique. Les lampes à intensité variable vous permettront d'adapter la luminosité selon vos besoins visuels du moment. Évitez les éclairages directs et privilégiez les sources lumineuses indirectes qui réduisent l'éblouissement et les phénomènes de halos.
Pour vos déplacements, constituez-vous une trousse d'urgence contenant vos collyres habituels, des larmes artificielles et les coordonnées de votre ophtalmologiste. Cette précaution s'avère particulièrement utile lors de voyages ou de déplacements professionnels prolongés [14].
Maintenez un carnet de suivi où vous noterez l'évolution de vos symptômes, les effets des traitements et vos questions pour les consultations. Cette démarche facilite le dialogue avec votre équipe médicale et permet un suivi plus précis de l'évolution de votre pathologie. N'hésitez pas à photographier votre œil si vous observez des changements inhabituels - ces images peuvent être utiles lors des consultations.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et motiver une consultation ophtalmologique en urgence. Une douleur oculaire intense associée à une baisse brutale de la vision peut signaler une poussée hypertensive majeure nécessitant un traitement immédiat [7,15]. De même, l'apparition de nausées et de vomissements accompagnant une douleur oculaire évoque un glaucome aigu par fermeture de l'angle.
Une modification rapide de l'aspect de votre iris - changement de couleur, apparition de nodules, déformation pupillaire - justifie également une consultation rapide [14,15]. Ces signes peuvent indiquer une progression de la maladie nécessitant un ajustement thérapeutique.
Pour le suivi de routine, respectez scrupuleusement les rendez-vous programmés par votre ophtalmologiste. La fréquence habituelle varie de 3 à 6 mois selon le stade de votre pathologie et la stabilité de votre état [1,13]. Ces consultations permettent de surveiller l'évolution de la pression intraoculaire, de l'œdème cornéen et de l'état de l'iris.
N'attendez pas votre prochain rendez-vous si vous ressentez une gêne inhabituelle, même minime. Une consultation anticipée peut permettre de détecter précocement une complication et d'adapter le traitement avant qu'elle ne s'aggrave. Votre ophtalmologiste préfère toujours être consulté pour rien que de découvrir tardivement une complication évitable.
Questions Fréquentes
Le syndrome irido-cornéo-endothélial est-il héréditaire ?Non, cette pathologie n'est pas héréditaire au sens classique. Bien que des recherches récentes aient identifié des mutations génétiques potentiellement impliquées, les cas familiaux restent exceptionnels [4,15]. Il s'agit plutôt d'une anomalie développementale survenant de manière sporadique.
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
Il n'existe pas de guérison définitive, mais les traitements actuels permettent de contrôler efficacement l'évolution et de préserver la vision [13,14]. Les greffes endothéliales offrent d'excellents résultats à long terme, avec des taux de succès supérieurs à 90% [2,3].
La maladie peut-elle toucher les deux yeux ?
Dans plus de 95% des cas, le syndrome ICE reste unilatéral [14,15]. L'atteinte bilatérale est exceptionnelle et doit faire rechercher d'autres pathologies. Cette caractéristique unilatérale constitue d'ailleurs un élément diagnostique important.
Quels sont les risques de la greffe endothéliale ?
Les complications sont rares avec les techniques actuelles : rejet de greffe (5-10%), infection (< 1%), décollement du greffon (10-15%) [2,3,12]. La plupart de ces complications peuvent être traitées efficacement si elles sont détectées précocement.
Peut-on continuer à travailler avec cette pathologie ?
Oui, dans la majorité des cas. Certains aménagements du poste de travail peuvent être nécessaires, notamment pour les métiers nécessitant une vision précise ou exposant à des irritants oculaires [14]. Discutez-en avec votre médecin du travail et votre ophtalmologiste.
Questions Fréquentes
Le syndrome irido-cornéo-endothélial est-il héréditaire ?
Non, cette pathologie n'est pas héréditaire au sens classique. Bien que des recherches récentes aient identifié des mutations génétiques potentiellement impliquées, les cas familiaux restent exceptionnels. Il s'agit plutôt d'une anomalie développementale survenant de manière sporadique.
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
Il n'existe pas de guérison définitive, mais les traitements actuels permettent de contrôler efficacement l'évolution et de préserver la vision. Les greffes endothéliales offrent d'excellents résultats à long terme, avec des taux de succès supérieurs à 90%.
La maladie peut-elle toucher les deux yeux ?
Dans plus de 95% des cas, le syndrome ICE reste unilatéral. L'atteinte bilatérale est exceptionnelle et doit faire rechercher d'autres pathologies. Cette caractéristique unilatérale constitue d'ailleurs un élément diagnostique important.
Quels sont les risques de la greffe endothéliale ?
Les complications sont rares avec les techniques actuelles : rejet de greffe (5-10%), infection (< 1%), décollement du greffon (10-15%). La plupart de ces complications peuvent être traitées efficacement si elles sont détectées précocement.
Peut-on continuer à travailler avec cette pathologie ?
Oui, dans la majorité des cas. Certains aménagements du poste de travail peuvent être nécessaires, notamment pour les métiers nécessitant une vision précise ou exposant à des irritants oculaires. Discutez-en avec votre médecin du travail et votre ophtalmologiste.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) - Syndrome irido-cornéo-endothélial. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Clinical Outcomes of Endothelial Keratoplasty With a Novel Technique. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Clinical Outcomes of Endothelial Keratoplasty With Advanced Protocols. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] The genomic and epigenomic landscape of iridocorneal endothelial syndrome. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Glaucome chronique à angle fermé. CHACUN S, MÉTAYER C.Lien
- [8] Iridocorneal endothelial syndrome: Descemet's membrane-endothelium complex assessed by high-resolution anterior segment optical coherence tomography. Bergés M, Kirkegaard E. 2022.Lien
- [12] A Functional and Immunologic Point of View on Corneal Endothelial Transplantation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Spelta S, Micera A. 2024.Lien
- [13] Le syndrome irido-cornéo-endothélial ou la perte du contrôle endothélial.Lien
- [14] Syndrome irido-cornéo-endothélial. Orphanet.Lien
- [15] SFO Rapport - Syndrome irido-cornéo-endothélial.Lien
Publications scientifiques
- Iridoschisis: une condition rare (2024)
- Iridoschisis: une condition rare (2024)
- [PDF][PDF] Glaucome chronique à angle fermé [PDF]
- Iridocorneal endothelial syndrome: Descemet's membrane-endothelium complex assessed by high-resolution anterior segment optical coherence tomography (2022)1 citations
- [PDF][PDF] Uvéites: éviter les pièges [PDF]
Ressources web
- Le syndrome irido-cornéo-endothélial ou la perte du ... (sciencedirect.com)
de AM Robert · 2013 · Cité 6 fois — Les trois symptômes majeurs du syndrome irido-cornéo-endothélial sont les anomalies endothéliales, les altérations de l'iris et la fermeture de l'angle ...
- Syndrome irido-cornéo-endothélial (orpha.net)
Le syndrome ICE, survenant le plus souvent chez les jeunes femmes, est caractérisé par la présence d'une atrophie et de trous iriens, d'une distorsion ...
- SFO | SFO Rapport Site Generation (em-consulte.com)
- Un syndrome irido-cornéo-endothélial (imagedumois.com)
Une femme, âgée de 40 ans, myope, consulte pour un flou visuel à l'œil gauche. À l'examen, l'acuité visuelle de l'œil gauche est de 2/10.
- Le glaucome du syndrome irido-cornéo-endothélial (em-consulte.com)
Le glaucome associé au syndrome ICE est souvent difficile à traiter, nécessitant l'emploi du traitement médical et la chirurgie filtrante anti-glaucomateuse.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
