Syndrome Dysgénésique et Respiratoire Porcin : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
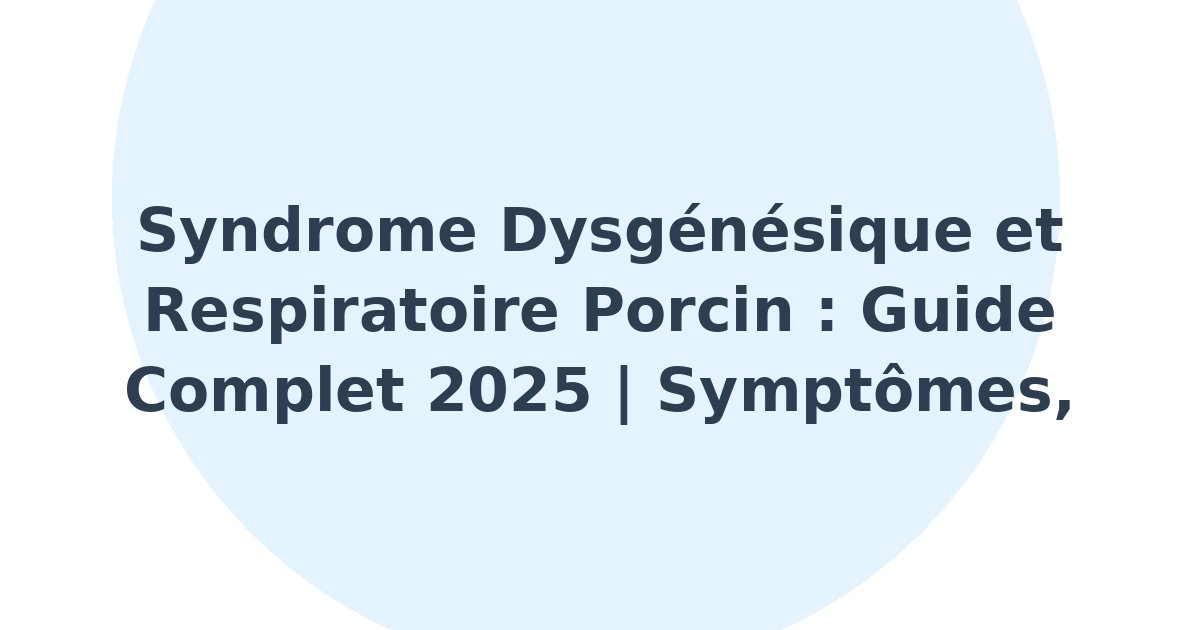
Le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP) représente l'une des pathologies virales les plus préoccupantes en élevage porcin. Cette maladie infectieuse, causée par un virus à ARN, affecte principalement les systèmes reproducteur et respiratoire des porcs. Bien que cette pathologie concerne avant tout la médecine vétérinaire, sa compréhension reste essentielle pour les professionnels de santé humaine dans le contexte des zoonoses émergentes.
Téléconsultation et Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin
Téléconsultation non recommandéeLe syndrome dysgénésique et respiratoire porcin est une maladie vétérinaire affectant exclusivement les porcs et ne concerne pas la médecine humaine. Cette pathologie nécessite une consultation vétérinaire spécialisée avec examen clinique direct des animaux et analyses de laboratoire spécifiques.
Ce qui peut être évalué à distance
Pour cette pathologie vétérinaire, seuls certains éléments peuvent être discutés à distance : description des symptômes observés chez les animaux, historique de l'élevage, mesures préventives déjà mises en place, analyse des facteurs de risque environnementaux, orientation vers les services vétérinaires appropriés.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
L'examen clinique direct des animaux par un vétérinaire, les prélèvements sanguins et respiratoires pour analyses virologiques, l'évaluation de l'état général du cheptel, la mise en place de mesures de biosécurité spécifiques nécessitent impérativement une intervention vétérinaire sur site.
Cette pathologie relevant de la médecine vétérinaire, contactez immédiatement un vétérinaire ou les services vétérinaires départementaux en cas de suspicion de maladie dans votre élevage.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Confirmation du diagnostic par prélèvements et analyses de laboratoire spécialisées, évaluation de l'état général du cheptel et de chaque animal, mise en place d'un protocole de biosécurité adapté, prescription et administration de traitements spécifiques nécessitent l'intervention directe d'un vétérinaire.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Mortalité importante et brutale dans l'élevage, détresse respiratoire sévère chez plusieurs animaux, suspicion de forme aiguë avec complications nécessitent une intervention vétérinaire d'urgence sur site.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Mortalité brutale et élevée dans l'élevage (>10% en quelques jours)
- Détresse respiratoire sévère avec dyspnée marquée chez de nombreux animaux
- Avortements massifs dans l'élevage (>20% des truies gestantes)
- Hyperthermie généralisée du cheptel avec prostration
Cette pathologie étant d'ordre vétérinaire, contactez immédiatement un vétérinaire ou les services vétérinaires d'urgence en cas de signes de gravité dans votre élevage.
Spécialité recommandée
Vétérinaire spécialisé en pathologie porcine — consultation en présentiel indispensable
Cette pathologie étant exclusivement vétérinaire, seul un vétérinaire spécialisé en pathologie porcine peut établir le diagnostic et mettre en place le traitement adapté. Une intervention sur site est indispensable pour l'examen du cheptel et les prélèvements diagnostiques.
Syndrome Dysgénésique et Respiratoire Porcin : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin constitue une pathologie virale majeure qui bouleverse l'industrie porcine mondiale depuis sa première identification en 1987. Cette maladie infectieuse, provoquée par un virus à ARN de la famille des Arteriviridae, se caractérise par des manifestations cliniques touchant deux systèmes principaux : reproducteur et respiratoire [9].
D'ailleurs, le virus responsable présente une particularité remarquable : il existe sous deux génotypes distincts. Le génotype européen (type 1) et le génotype nord-américain (type 2) diffèrent par leur virulence et leur distribution géographique. En fait, cette diversité génétique complique considérablement les stratégies de prévention et de traitement [10].
Concrètement, le SDRP se manifeste différemment selon l'âge des animaux affectés. Chez les truies reproductrices, on observe des avortements tardifs, des mortalités périnatales et une diminution significative de la fertilité. Les porcelets, quant à eux, développent principalement des troubles respiratoires sévères pouvant évoluer vers une pneumonie mortelle [4].
L'important à retenir : cette pathologie représente un défi sanitaire et économique considérable. Les pertes économiques mondiales attribuées au SDRP dépassent plusieurs milliards d'euros annuellement, ce qui en fait l'une des maladies animales les plus coûteuses au monde.
Épidémiologie en France et dans le Monde
La situation épidémiologique du SDRP en France révèle une prévalence préoccupante dans les élevages porcins. Selon les données de l'ANSES, environ 60 à 80% des élevages français présentent une séropositivité au virus, avec des variations régionales significatives [9]. Les régions de Bretagne et des Pays de la Loire, concentrant la majorité de la production porcine nationale, affichent les taux les plus élevés.
Mais l'évolution temporelle montre des tendances contrastées. Entre 2019 et 2024, on observe une stabilisation relative de la prévalence, mais avec des épisodes épizootiques ponctuels particulièrement virulents. D'ailleurs, les nouvelles souches émergentes présentent parfois une pathogénicité accrue, comme l'ont démontré les travaux récents sur la modulation de la réponse immunitaire [4].
À l'échelle européenne, la situation varie considérablement. L'Allemagne et les Pays-Bas rapportent des prévalences similaires à la France, tandis que les pays nordiques maintiennent des statuts sanitaires plus favorables. Cependant, les échanges commerciaux intensifs compliquent le contrôle de la diffusion virale [5].
Concrètement, l'impact économique en France se chiffre à plusieurs centaines de millions d'euros annuellement. Les pertes directes incluent la mortalité, les troubles reproducteurs et la baisse des performances zootechniques. Les coûts indirects, liés aux mesures de biosécurité et aux traitements, représentent une charge supplémentaire considérable pour les éleveurs.
Les Causes et Facteurs de Risque
Le virus du SDRP appartient à la famille des Arteriviridae et présente un tropisme particulier pour les macrophages alvéolaires pulmonaires. Cette spécificité cellulaire explique en grande partie la symptomatologie respiratoire caractéristique de la maladie. En effet, le virus détourne les mécanismes de défense immunitaire de l'hôte pour assurer sa réplication [4].
Plusieurs facteurs de risque favorisent l'introduction et la diffusion du virus dans les élevages. La densité d'élevage constitue un élément déterminant : plus les animaux sont concentrés, plus le risque de transmission augmente exponentiellement. D'ailleurs, les systèmes d'élevage intensif créent des maladies particulièrement favorables à la circulation virale [10].
Les mouvements d'animaux représentent le principal vecteur d'introduction du virus. Chaque introduction d'un animal séropositif dans un cheptel indemne constitue un risque majeur. Mais les vecteurs indirects ne sont pas négligeables : le personnel, les véhicules, les équipements peuvent tous véhiculer le virus sur de longues distances.
Bon à savoir : les maladies environnementales influencent également la survie virale. Le virus résiste mieux aux basses températures et à l'humidité élevée, expliquant les pics d'incidence observés en automne et en hiver. Cette saisonnalité doit être prise en compte dans les stratégies de prévention [5].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
La symptomatologie du SDRP varie considérablement selon l'âge des animaux, leur statut immunitaire et la souche virale impliquée. Chez les truies reproductrices, les premiers signes apparaissent généralement 2 à 4 semaines après l'infection. On observe alors des avortements tardifs (après 70 jours de gestation), des mises bas prématurées et une augmentation significative de la mortalité périnatale [10].
Les porcelets nouveau-nés présentent souvent un syndrome de détresse respiratoire caractéristique. Ils développent une dyspnée marquée, une cyanose des extrémités et une faiblesse générale. D'ailleurs, certains porcelets naissent avec des lésions cutanées particulières : des zones de nécrose ou de coloration bleu-rouge qui leur valent parfois l'appellation de "porcelets bleus" [11].
Chez les porcs en croissance, la symptomatologie respiratoire domine le tableau clinique. On note une toux persistante, une dyspnée d'effort et parfois de la fièvre. Ces animaux présentent également un retard de croissance marqué et une susceptibilité accrue aux infections bactériennes secondaires [7].
Il faut savoir que l'évolution clinique peut être très variable. Certains animaux développent des formes subcliniques avec peu de symptômes apparents, tandis que d'autres évoluent vers des complications sévères. Cette variabilité complique le diagnostic précoce et souligne l'importance des examens complémentaires.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du SDRP repose sur une approche multidisciplinaire combinant l'examen clinique, l'épidémiologie et les analyses de laboratoire. La première étape consiste en une évaluation clinique approfondie de l'élevage, incluant l'anamnèse, l'observation des animaux et l'analyse des performances zootechniques [11].
Les techniques de détection virale ont considérablement évolué ces dernières années. La RT-PCR en temps réel constitue aujourd'hui la méthode de référence pour la détection de l'ARN viral. Cette technique permet non seulement de confirmer la présence du virus, mais aussi de déterminer le génotype impliqué et d'évaluer la charge virale [5].
D'ailleurs, les innovations récentes incluent l'utilisation de collecteurs cycloniques de bio-aérosols pour la détection environnementale du virus. Cette approche non invasive permet de surveiller la circulation virale dans l'élevage sans manipulation directe des animaux, révolutionnant ainsi les stratégies de monitoring [5].
La sérologie complète le diagnostic en révélant l'historique immunitaire du cheptel. Les tests ELISA permettent de détecter les anticorps spécifiques et d'évaluer le statut immunitaire collectif. Cependant, l'interprétation des résultats sérologiques nécessite une expertise particulière, notamment pour distinguer les anticorps vaccinaux des anticorps d'infection naturelle.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Actuellement, il n'existe aucun traitement antiviral spécifique contre le SDRP. La prise en charge repose essentiellement sur des mesures de soutien et la prévention des complications bactériennes secondaires. Cette limitation thérapeutique souligne l'importance cruciale des stratégies préventives [10].
Le traitement symptomatique inclut l'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens pour réduire la fièvre et l'inflammation pulmonaire. Les antibiotiques sont réservés au traitement des surinfections bactériennes, particulièrement fréquentes chez les animaux immunodéprimés par l'infection virale [7].
Mais la vaccination représente l'outil thérapeutique principal actuellement disponible. Les vaccins vivants atténués constituent la référence, bien qu'ils présentent certaines limitations. Ces vaccins peuvent induire une virémie transitoire et présenter des risques de recombinaison avec les souches sauvages [6].
Les recherches récentes explorent des approches innovantes comme l'utilisation d'extraits d'algues aux propriétés immunomodulatrices et antivirales. Ces substances naturelles pourraient potentialiser l'efficacité vaccinale tout en réduisant les effets secondaires . D'ailleurs, l'évaluation de ces nouvelles approches thérapeutiques fait l'objet d'études approfondies dans plusieurs centres de recherche européens.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque une révolution dans la lutte contre le SDRP avec l'approbation par la FDA de porcs génétiquement modifiés résistants au virus. Cette innovation majeure, développée par Genus PIC, représente la première autorisation commerciale d'animaux d'élevage génétiquement édités pour la résistance à une maladie spécifique [1].
Ces porcs génétiquement édités présentent une modification ciblée du récepteur CD163, utilisé par le virus pour pénétrer dans les cellules. Cette approche révolutionnaire pourrait transformer radicalement l'industrie porcine en éliminant la susceptibilité génétique à l'infection. D'ailleurs, les premiers résultats commerciaux sont attendus avec impatience par l'ensemble de la filière [1].
Parallèlement, les recherches sur les nouveaux vaccins progressent rapidement. Les approches basées sur les nanoparticules et les vecteurs viraux recombinants montrent des résultats prometteurs en termes d'efficacité et de sécurité. Ces technologies de nouvelle génération pourraient surmonter les limitations des vaccins actuels [2].
En fait, l'intelligence artificielle révolutionne également le diagnostic et la surveillance épidémiologique. Les algorithmes d'apprentissage automatique permettent désormais d'analyser en temps réel les données de production et de détecter précocement les épisodes infectieux [3]. Cette approche prédictive ouvre de nouvelles perspectives pour la gestion sanitaire des élevages.
Vivre au Quotidien avec le Syndrome Dysgénésique et Respiratoire Porcin
Pour les éleveurs confrontés au SDRP, la gestion quotidienne de cette pathologie représente un défi constant. L'adaptation des pratiques d'élevage devient essentielle pour maintenir la viabilité économique tout en préservant le bien-être animal. Concrètement, cela implique une réorganisation complète des protocoles sanitaires [9].
La biosécurité renforcée constitue le pilier de la gestion quotidienne. Chaque entrée dans l'élevage doit faire l'objet de procédures strictes : douche obligatoire, changement de vêtements, désinfection du matériel. Ces mesures, bien qu'contraignantes, s'avèrent indispensables pour limiter la circulation virale [10].
D'ailleurs, l'organisation du travail doit être repensée selon le principe de la "marche en avant". Les soigneurs commencent toujours par les animaux les plus jeunes et les plus sensibles, puis progressent vers les animaux plus âgés. Cette logique permet de réduire significativement les risques de transmission .
L'important à retenir : le soutien psychologique des éleveurs ne doit pas être négligé. La gestion d'une pathologie chronique génère stress et anxiété. Les groupements de défense sanitaire jouent un rôle crucial en proposant accompagnement technique et soutien moral aux professionnels confrontés à cette maladie.
Les Complications Possibles
Le SDRP peut évoluer vers diverses complications qui aggravent considérablement le pronostic. Les surinfections bactériennes représentent la complication la plus fréquente, particulièrement chez les animaux jeunes dont le système immunitaire est affaibli par l'infection virale [7].
Les co-infections virales constituent également un défi majeur. L'association du SDRP avec d'autres virus respiratoires porcins, comme le virus de la grippe porcine ou le circovirus porcin, aggrave significativement la symptomatologie et augmente la mortalité. Ces interactions virales complexes font l'objet de recherches approfondies [7].
Chez les truies reproductrices, les complications incluent des troubles de la fertilité persistants même après la guérison clinique. On observe une diminution du taux de conception, une augmentation des retours en chaleur et parfois une infertilité définitive. Ces séquelles reproductives représentent un impact économique considérable [8].
D'ailleurs, certaines souches particulièrement virulentes peuvent provoquer des syndromes hémorragiques avec des lésions cutanées étendues. Ces formes sévères, heureusement rares, nécessitent une prise en charge d'urgence et présentent un taux de mortalité élevé.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du SDRP dépend de multiples facteurs incluant l'âge des animaux, leur statut immunitaire, la souche virale impliquée et la rapidité de mise en œuvre des mesures thérapeutiques. Chez les porcelets nouveau-nés, la mortalité peut atteindre 50 à 80% dans les formes aiguës non traitées [11].
Cependant, avec une prise en charge adaptée, le pronostic s'améliore considérablement. Les élevages qui mettent en place des protocoles de biosécurité stricts et des programmes vaccinaux appropriés parviennent généralement à stabiliser la situation sanitaire en 6 à 12 mois [10].
L'évolution vers la chronicité représente un défi particulier. Certains élevages développent une forme endémique de la maladie avec des épisodes récurrents de moindre intensité. Cette situation, bien que moins dramatique que les formes aiguës, génère des pertes économiques continues [9].
Bon à savoir : les innovations récentes, notamment les porcs génétiquement résistants, pourraient révolutionner le pronostic à long terme. Ces avancées technologiques laissent entrevoir la possibilité d'une éradication progressive de la maladie dans les décennies à venir [1]. En attendant, la vigilance et la prévention restent les meilleures armes contre cette pathologie.
Peut-on Prévenir le Syndrome Dysgénésique et Respiratoire Porcin ?
La prévention du SDRP repose sur une approche globale combinant biosécurité, vaccination et gestion sanitaire rigoureuse. La biosécurité constitue la première ligne de défense : elle vise à empêcher l'introduction du virus dans les élevages indemnes et à limiter sa diffusion dans les élevages infectés [9].
Les mesures de biosécurité externe incluent le contrôle des mouvements d'animaux, la quarantaine systématique des nouveaux arrivants et la désinfection des véhicules de transport. Ces protocoles, bien qu'exigeants, s'avèrent particulièrement efficaces pour prévenir l'introduction virale .
La vaccination préventive représente un outil complémentaire essentiel. Les programmes vaccinaux doivent être adaptés à la situation épidémiologique locale et régulièrement réévalués en fonction de l'évolution des souches circulantes. L'évaluation récente des vaccins vivants atténués montre leur efficacité mais souligne aussi leurs limitations [6].
D'ailleurs, l'approche "tout plein - tout vide" constitue une stratégie préventive particulièrement efficace. Cette méthode consiste à vider complètement les bâtiments entre chaque bande d'animaux, permettant un nettoyage et une désinfection approfondis. Cette rupture de la chaîne de transmission s'avère déterminante pour le contrôle de la maladie.
Recommandations des Autorités de Santé
L'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a publié des recommandations spécifiques pour la gestion du SDRP en France. Ces directives soulignent l'importance d'une surveillance épidémiologique renforcée et d'une coordination entre tous les acteurs de la filière porcine [9].
Les groupements de défense sanitaire jouent un rôle central dans l'application de ces recommandations. Ils assurent la coordination locale des mesures de prévention, l'information des éleveurs et le suivi épidémiologique des cheptels. Leur action s'avère déterminante pour maintenir un niveau sanitaire élevé [10].
Au niveau européen, l'EFSA (European Food Safety Authority) recommande une harmonisation des stratégies de lutte contre le SDRP. Cette coordination internationale devient essentielle face à l'intensification des échanges commerciaux et aux risques de diffusion transfrontalière des souches virulentes [2].
Concrètement, les autorités insistent sur la nécessité d'améliorer les systèmes de détection précoce. L'utilisation de nouvelles technologies, comme les collecteurs de bio-aérosols, fait partie des innovations recommandées pour optimiser la surveillance sanitaire [5]. Ces outils permettent une détection plus rapide et moins invasive de la circulation virale.
Ressources et Associations de Patients
Bien que le SDRP soit une pathologie vétérinaire, plusieurs organismes proposent un accompagnement aux professionnels confrontés à cette maladie. La Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire (FRGDS) constitue la ressource principale pour les éleveurs français [10].
Les chambres d'agriculture proposent également des services d'accompagnement technique et économique. Leurs conseillers spécialisés aident les éleveurs à adapter leurs pratiques et à optimiser leurs protocoles sanitaires. Cette expertise de terrain s'avère particulièrement précieuse lors des épisodes aigus.
D'ailleurs, les organisations professionnelles comme la Fédération Nationale Porcine (FNP) jouent un rôle important dans la diffusion d'informations et la coordination des actions collectives. Elles assurent également la représentation de la profession auprès des autorités sanitaires.
Les réseaux d'éleveurs constituent une ressource informelle mais essentielle. L'échange d'expériences entre professionnels confrontés aux mêmes difficultés permet de partager les bonnes pratiques et de maintenir le moral des troupes. Ces solidarités professionnelles s'avèrent souvent déterminantes dans la gestion des crises sanitaires.
Nos Conseils Pratiques
Face au SDRP, l'anticipation reste votre meilleure alliée. Établissez un plan de biosécurité rigoureux avant même l'arrivée de la maladie dans votre région. Cette préparation vous permettra de réagir rapidement et efficacement en cas de besoin [9].
Surveillez quotidiennement vos animaux et tenez un registre détaillé des observations. Notez tous les signes cliniques suspects : toux, difficultés respiratoires, troubles reproducteurs. Cette vigilance constante permet une détection précoce et améliore significativement le pronostic [11].
N'hésitez pas à faire appel à votre vétérinaire dès les premiers signes suspects. Un diagnostic précoce permet de mettre en place rapidement les mesures appropriées et de limiter la diffusion virale. Le coût d'une consultation préventive reste dérisoire comparé aux pertes potentielles [10].
Enfin, investissez dans la formation continue. Les connaissances sur le SDRP évoluent rapidement, notamment avec les innovations thérapeutiques récentes. Participez aux formations proposées par les organismes professionnels et restez informé des dernières avancées scientifiques. Cette veille technologique vous donnera un avantage concurrentiel décisif.
Quand Consulter un Médecin ?
Dans le contexte du SDRP, la consultation vétérinaire s'impose dans plusieurs situations spécifiques. Contactez immédiatement votre vétérinaire si vous observez des avortements groupés chez vos truies reproductrices, particulièrement en fin de gestation. Ce signe constitue souvent le premier indicateur d'une infection par le virus du SDRP [10].
Les troubles respiratoires chez les porcelets nécessitent également une intervention rapide. Une dyspnée marquée, une toux persistante ou une coloration bleutée des extrémités doivent vous alerter. Ces symptômes peuvent évoluer rapidement vers des complications graves [11].
D'ailleurs, toute chute brutale des performances zootechniques justifie une investigation approfondie. Une diminution du taux de conception, une augmentation de la mortalité ou un retard de croissance inexpliqué peuvent révéler une infection subclinique [9].
En cas de suspicion d'introduction du virus dans votre élevage, n'attendez pas l'apparition des symptômes. La mise en place précoce de mesures de confinement et de diagnostic peut limiter considérablement l'impact de la maladie. Rappelez-vous : dans la lutte contre le SDRP, chaque heure compte.
Questions Fréquentes
Le SDRP peut-il affecter l'homme ?
Non, le virus du SDRP est strictement spécifique aux porcins et ne présente aucun risque pour la santé humaine.
Combien de temps le virus survit-il dans l'environnement ?
La survie virale dépend des maladies environnementales. À température ambiante, le virus peut persister plusieurs jours sur les surfaces contaminées.
La vaccination est-elle obligatoire ?
La vaccination contre le SDRP n'est pas obligatoire en France, mais elle est fortement recommandée dans les zones à risque.
Peut-on consommer la viande d'animaux infectés ?
La consommation de viande provenant d'animaux infectés ne présente aucun risque pour la santé humaine.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] FDA Approves Genus PIC's Gene-Edited PRRS-Resistant Pigs in Landmark DecisionLien
- [2] Current Status of Porcine Reproductive and Respiratory SyndromeLien
- [3] Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Research 2025Lien
- [4] Modulation de la réponse immunitaire et impact de l'infection par le virus du SDRPLien
- [5] Collecteurs cycloniques de bio-aérosols pour la détection du virus du SDRPLien
- [6] Evaluation des vaccins vivants atténués contre le SDRPLien
- [7] Evaluation des risques de transferts de contaminants viraux en abattoirLien
- [8] Les co-infections virales affectant le système respiratoire porcinLien
- [9] Effets immunomodulateurs et antiviraux d'extraits d'alguesLien
- [10] Infections reproductives-néonatales du porcLien
- [12] Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin - ANSESLien
- [13] Le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP) - FRGDSLien
- [14] Signes cliniques et diagnostic du SDRPLien
Publications scientifiques
- … A porcin et les macrophages alvéolaires: modulation de la réponse immunitaire et impact de l'infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (2024)
- … collecteurs cycloniques de bio-aérosols à l'échelle de l'animal ou d'un groupe d'animaux pour la détection du virus du Syndrome Dysgénésique et Respiratoire Porcin (2024)
- Evaluation de la virémie et des capacités de transmission des vaccins vivants atténués contre le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin pour une meilleure … (2023)
- Evaluation des risques de transferts de contaminants viraux liés à l'utilisation d'eau recyclée en abattoir pour le lavage des camions de transport de porcs (2025)
- Les co-infections virales affectant le système respiratoire porcin: conséquences et limites des systèmes d'étude (2024)
Ressources web
- syndrome dysgénésique et respiratoire porcin - Anses (anses.fr)
Le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP) est une maladie virale spécifique des porcins qui se caractérise par des troubles de la reproduction ...
- Le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP) (frgdsaura.fr)
5 déc. 2023 — Elle se caractérise par des troubles de la reproduction chez les truies gestantes, ainsi que par des problèmes respiratoires et des retards de ...
- Signes cliniques et diagnostic du SDRP - Articles (3trois3.com)
5 févr. 2016 — Chez les jeunes porcs et ceux en croissance, les principales manifestations cliniques sont de la pneumonie et un retard de croissance.
- Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) (blv.admin.ch)
9 juil. 2021 — Les animaux ont la fièvre, éternuent, toussent et respirent avec difficulté, ces signes se traduisent par une baisse des performances d' ...
- Le SDRP porcin | Section porcin (gds-calvados.fr)
La maladie prend l'allure d'un syndrome grippal classique, avec des manifestations de type cyanose (bleuissement) des oreilles, du groin, de la vulve et des ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
