Syndrome de Rubinstein-Taybi : Guide Complet 2025 - Symptômes, Diagnostic, Traitements
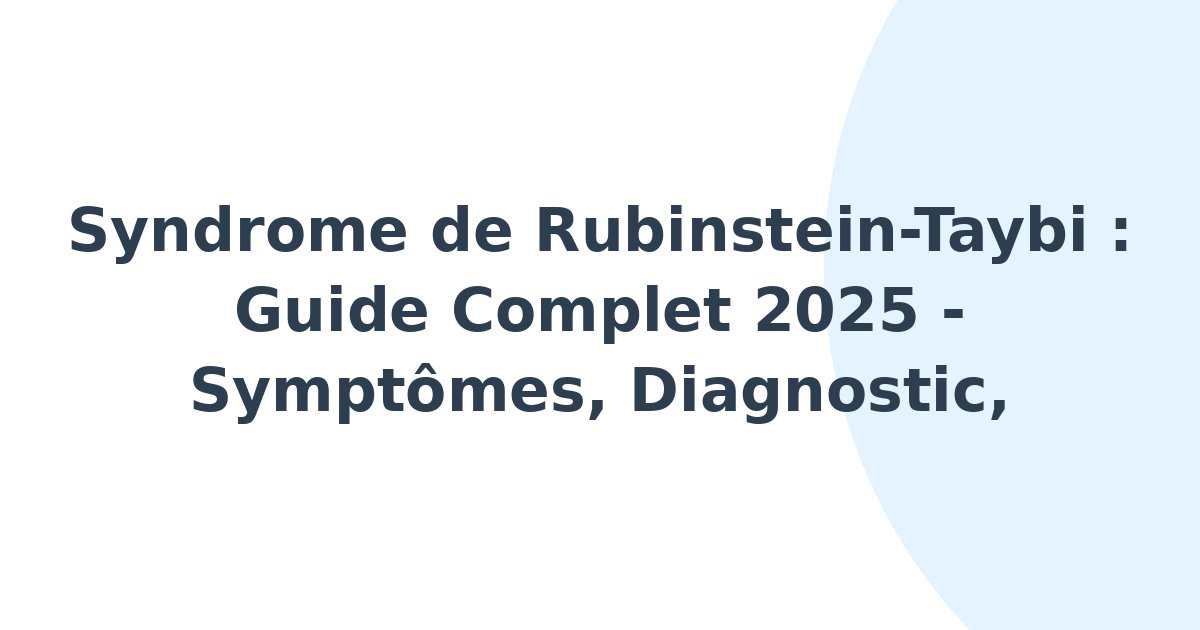
Le syndrome de Rubinstein-Taybi est une maladie génétique rare qui touche environ 1 personne sur 125 000 naissances en France. Cette pathologie complexe associe un retard de développement, des malformations caractéristiques et des troubles du comportement. Découvrez dans ce guide complet les dernières avancées diagnostiques et thérapeutiques de 2025.
Téléconsultation et Syndrome de Rubinstein-Taybi
Téléconsultation non recommandéeLe syndrome de Rubinstein-Taybi est une maladie génétique rare nécessitant un diagnostic clinique spécialisé basé sur l'examen physique des dysmorphies faciales caractéristiques, l'évaluation du retard de développement et la mesure précise des anomalies des pouces et orteils. La complexité des manifestations multisystémiques et la nécessité d'un suivi pluridisciplinaire coordonné rendent la téléconsultation insuffisante pour une prise en charge optimale.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation visuelle des traits faciaux caractéristiques (sourcils arqués, cils longs, nez crochu), observation des déformations des pouces et gros orteils si visibles, discussion sur l'évolution du développement psychomoteur, analyse de l'historique des complications médicales, coordination avec l'équipe pluridisciplinaire déjà en place.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen clinique complet pour confirmer les dysmorphies faciales subtiles, mesure précise des anomalies des pouces et orteils, évaluation neurologique du retard mental, examens complémentaires (caryotype, FISH, séquençage), coordination avec les spécialistes (généticien, cardiologue, orthopédiste).
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de nouvelles complications cardiaques nécessitant une évaluation cardiologique, aggravation du retard de développement nécessitant une réévaluation neurologique complète, infections respiratoires récurrentes nécessitant un examen pulmonaire, troubles de la déglutition nécessitant une évaluation ORL spécialisée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Détresse respiratoire liée aux malformations des voies aériennes, convulsions non contrôlées ou état de mal épileptique, signes d'insuffisance cardiaque aiguë chez les patients porteurs de cardiopathie congénitale.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Détresse respiratoire avec tirage ou cyanose (liée aux anomalies des voies aériennes supérieures)
- Convulsions prolongées ou répétées non contrôlées par le traitement habituel
- Signes d'insuffisance cardiaque aiguë : essoufflement au repos, œdèmes, fatigue extrême
- Troubles de la conscience ou altération brutale de l'état neurologique
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Généticien — consultation en présentiel indispensable
Le généticien est le spécialiste de référence pour le syndrome de Rubinstein-Taybi, capable d'évaluer les dysmorphies caractéristiques et de coordonner le suivi pluridisciplinaire. Une consultation en présentiel est indispensable car le diagnostic repose sur l'examen clinique détaillé des traits faciaux et des anomalies des extrémités.
Syndrome de Rubinstein-Taybi : Définition et Vue d'Ensemble
Le syndrome de Rubinstein-Taybi (SRT) est une maladie génétique rare décrite pour la première fois en 1963. Cette pathologie complexe résulte de mutations dans les gènes CREBBP ou EP300, essentiels au développement normal [1,5].
Concrètement, cette maladie se caractérise par une triade de symptômes principaux. D'abord, un retard de croissance et de développement intellectuel. Ensuite, des malformations faciales distinctives avec un nez crochu et des yeux inclinés vers le bas. Enfin, des anomalies des pouces et des gros orteils, élargis et déviés [13,14].
Mais le syndrome ne se limite pas à ces manifestations visibles. En effet, il peut affecter de nombreux organes et systèmes. Les patients présentent souvent des troubles cardiaques, rénaux ou encore des difficultés alimentaires [2,5]. L'important à retenir : chaque personne atteinte développe un tableau clinique unique, même si certains signes restent constants.
D'ailleurs, les progrès récents en génétique permettent aujourd'hui un diagnostic plus précoce et précis. Les nouvelles techniques de séquençage identifient des mutations jusqu'alors méconnues [3,7]. Cette évolution ouvre la voie à des prises en charge personnalisées et plus efficaces.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, le syndrome de Rubinstein-Taybi touche environ 1 naissance sur 125 000, soit près de 6 nouveaux cas par an selon les données de Santé Publique France [1,13]. Cette prévalence reste stable depuis une décennie, mais le diagnostic s'améliore considérablement.
Au niveau mondial, l'incidence varie peu entre les populations. Les études européennes rapportent des chiffres similaires : 1/100 000 à 1/125 000 naissances [5,9]. Cependant, certaines régions montrent des variations liées aux pratiques diagnostiques plutôt qu'à une réelle différence épidémiologique.
L'âge au diagnostic a considérablement évolué ces dernières années. Alors qu'il fallait attendre 3 à 5 ans en moyenne dans les années 2010, le diagnostic se pose désormais dès les premiers mois de vie [2,11]. Cette amélioration résulte des progrès en génétique moléculaire et de la sensibilisation des professionnels.
Concernant la répartition par sexe, aucune différence significative n'existe. Garçons et filles sont touchés de manière équivalente [6,9]. En revanche, l'expression clinique peut varier selon le sexe, notamment pour certains troubles comportementaux.
Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilité de l'incidence. Mais l'amélioration du diagnostic pourrait révéler des formes atypiques jusqu'alors méconnues [3,5]. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à 2-3 millions d'euros annuels, incluant les soins spécialisés et l'accompagnement familial.
Les Causes et Facteurs de Risque
Le syndrome de Rubinstein-Taybi résulte de mutations génétiques affectant principalement deux gènes. Dans 55% des cas, la mutation touche le gène CREBBP situé sur le chromosome 16. Dans 8% des cas, c'est le gène EP300 du chromosome 22 qui est impliqué [1,5,8].
Ces gènes codent pour des protéines essentielles à la régulation de l'expression génique. Concrètement, elles agissent comme des "interrupteurs" qui activent ou désactivent d'autres gènes pendant le développement [3,7]. Quand ces protéines dysfonctionnent, le développement normal est perturbé.
Dans la grande majorité des cas, ces mutations surviennent de novo. Cela signifie qu'elles apparaissent spontanément chez l'enfant, sans être héritées des parents [5,13]. Seuls 1 à 2% des cas sont familiaux, avec transmission d'un parent porteur de la mutation.
Aucun facteur de risque environnemental n'a été identifié à ce jour. L'âge parental, l'exposition à des toxiques ou les infections pendant la grossesse ne semblent pas influencer le risque [2,9]. Cette absence de facteur de risque modifiable rend la prévention primaire impossible actuellement.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes du syndrome de Rubinstein-Taybi apparaissent dès la naissance, mais leur reconnaissance peut prendre du temps. Les signes faciaux caractéristiques constituent souvent le premier indice diagnostique [1,6].
Le visage présente des traits distinctifs : nez crochu avec une cloison nasale proéminente, yeux inclinés vers le bas avec des cils longs, sourcils arqués et bouche petite [13,14]. Ces caractéristiques s'accentuent avec l'âge et deviennent plus évidentes vers 2-3 ans.
Les anomalies des extrémités représentent un autre signe majeur. Les pouces et gros orteils sont élargis, courts et déviés vers l'extérieur [5,8]. Cette malformation, appelée "pouce en spatule", est présente chez 90% des patients et constitue un critère diagnostique important.
Le retard de développement se manifeste précocement. La croissance staturo-pondérale est ralentie, avec une taille adulte généralement inférieure à la normale [2,9]. Le développement psychomoteur est également retardé : marche vers 2-3 ans, premiers mots vers 3-4 ans.
D'autres symptômes peuvent compléter le tableau. Les troubles du sommeil touchent 70% des patients [6]. Les difficultés alimentaires sont fréquentes dans la petite enfance, nécessitant parfois une nutrition entérale. Certains enfants développent aussi des troubles du comportement avec hyperactivité ou stéréotypies.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du syndrome de Rubinstein-Taybi repose aujourd'hui sur une approche multidisciplinaire combinant examen clinique et analyses génétiques [1,5]. Cette démarche s'est considérablement affinée ces dernières années.
La première étape consiste en un examen clinique approfondi par un généticien ou un pédiatre expérimenté. L'évaluation porte sur les signes faciaux, les anomalies des extrémités et le développement psychomoteur [2,13]. Des photographies standardisées sont souvent réalisées pour documenter les traits caractéristiques.
L'analyse génétique constitue l'étape confirmative. Le séquençage des gènes CREBBP et EP300 permet d'identifier la mutation causale dans environ 65% des cas [3,5]. Les techniques récentes de séquençage haut débit augmentent ce taux de détection et réduisent les délais d'analyse.
Quand l'analyse génétique standard reste négative, des examens complémentaires peuvent être proposés. La recherche de réarrangements chromosomiques par CGH-array ou l'analyse de l'épigénome apportent parfois des réponses [7,11]. Ces approches innovantes révèlent des mécanismes pathologiques jusqu'alors méconnus.
Le diagnostic prénatal devient possible quand une mutation familiale est identifiée. Cependant, cette situation reste exceptionnelle compte tenu du caractère sporadique de la maladie [8,11]. Les nouvelles techniques d'imagerie fœtale permettent parfois de suspecter le diagnostic avant la naissance.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Il n'existe pas de traitement curatif du syndrome de Rubinstein-Taybi, mais une prise en charge multidisciplinaire améliore considérablement la qualité de vie des patients [1,2]. Cette approche globale s'adapte aux besoins spécifiques de chaque personne.
La stimulation précoce constitue un pilier thérapeutique essentiel. La kinésithérapie, l'orthophonie et la psychomotricité débutent dès les premiers mois de vie [5,6]. Ces interventions favorisent le développement psychomoteur et limitent les retards d'acquisition.
Les troubles du comportement nécessitent souvent une approche pharmacologique. Les médicaments psychotropes, utilisés avec précaution, peuvent améliorer l'hyperactivité ou les troubles du sommeil [6,9]. L'accompagnement psychologique de l'enfant et de sa famille reste indispensable.
Certaines complications requièrent des traitements spécifiques. Les malformations cardiaques peuvent nécessiter une chirurgie corrective [2,13]. Les troubles de la déglutition imposent parfois une nutrition entérale temporaire. La surveillance ophtalmologique permet de dépister et corriger les troubles visuels fréquents.
L'approche éducative adaptée joue un rôle crucial. La scolarisation en milieu spécialisé ou avec accompagnement permet aux enfants de développer leurs capacités [9,14]. L'objectif vise l'autonomie maximale possible selon les capacités individuelles.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la recherche sur le syndrome de Rubinstein-Taybi avec plusieurs innovations thérapeutiques prometteuses [2,3,4]. Ces avancées ouvrent de nouvelles perspectives pour les patients et leurs familles.
Les thérapies épigénétiques représentent l'approche la plus innovante. Des molécules capables de moduler l'expression génique sont actuellement testées en laboratoire [3,7]. Ces traitements visent à compenser les dysfonctionnements des protéines CREBBP et EP300 en agissant sur leurs voies de signalisation.
Plusieurs startups spécialisées dans les maladies rares développent des médicaments spécifiques au syndrome de Rubinstein-Taybi [4]. Ces entreprises bénéficient de financements publics et privés pour accélérer le développement de leurs molécules candidates. Les premiers essais cliniques pourraient débuter dès 2025.
Le premier consensus international publié en 2024 standardise la prise en charge diagnostique et thérapeutique [5,12]. Ce document, élaboré par 50 experts mondiaux, harmonise les pratiques et améliore la qualité des soins. Il intègre les dernières découvertes scientifiques et les recommandations basées sur les preuves.
Les techniques de profilage transcriptomique révèlent de nouveaux mécanismes pathologiques [3]. Ces approches permettent d'identifier des cibles thérapeutiques inédites et de développer des biomarqueurs de suivi. L'objectif vise des traitements personnalisés selon le profil moléculaire de chaque patient.
Vivre au Quotidien avec le Syndrome de Rubinstein-Taybi
Vivre avec le syndrome de Rubinstein-Taybi nécessite des adaptations quotidiennes mais n'empêche pas une vie épanouie [6,9]. Chaque famille développe ses propres stratégies selon les besoins spécifiques de son enfant.
L'organisation du domicile joue un rôle important. Les aménagements simples facilitent l'autonomie : barres d'appui, éclairage adapté, rangements accessibles [9,14]. Ces modifications permettent aux personnes atteintes de gagner en indépendance et en confiance.
La scolarité adaptée constitue un enjeu majeur. Beaucoup d'enfants bénéficient d'un accompagnement personnalisé en milieu ordinaire ou spécialisé [6]. Les progrès scolaires, même modestes, apportent une grande satisfaction aux familles et renforcent l'estime de soi des enfants.
Les activités de loisirs doivent être encouragées et adaptées. La natation, la musique ou les activités artistiques permettent l'épanouissement personnel [9]. Ces moments de plaisir contribuent au bien-être psychologique et au développement social.
Le soutien familial reste essentiel. Les parents apprennent à gérer les défis quotidiens tout en préservant l'équilibre familial [6,9]. L'aide des associations de patients et des professionnels spécialisés s'avère précieuse dans cette démarche d'accompagnement.
Les Complications Possibles
Le syndrome de Rubinstein-Taybi peut s'accompagner de diverses complications médicales nécessitant une surveillance régulière [1,2]. La connaissance de ces risques permet une prise en charge préventive optimale.
Les malformations cardiaques touchent environ 30% des patients. Il s'agit le plus souvent de communications interventriculaires ou de sténoses valvulaires [2,13]. Un suivi cardiologique annuel permet de dépister ces anomalies et de planifier d'éventuelles interventions chirurgicales.
Les troubles respiratoires représentent une complication fréquente. L'hypotonie et les malformations des voies aériennes supérieures favorisent les apnées du sommeil [6,9]. Ces troubles peuvent affecter la qualité du sommeil et le développement cognitif s'ils ne sont pas traités.
Certains patients développent des tumeurs bénignes, notamment des méningiomes ou des pilomatrixomes [5,13]. Bien que rares, ces complications nécessitent une surveillance oncologique spécialisée. Le risque tumoral semble lié aux dysfonctionnements des gènes suppresseurs de tumeurs.
Les troubles ophtalmologiques sont quasi-constants : strabisme, erreurs de réfraction, glaucome [2,14]. Un suivi ophtalmologique précoce et régulier permet de préserver au mieux les capacités visuelles. Les corrections optiques ou chirurgicales améliorent significativement la qualité de vie.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du syndrome de Rubinstein-Taybi s'est considérablement amélioré grâce aux progrès de la prise en charge multidisciplinaire [5,9]. L'espérance de vie, bien qu'encore réduite, tend à se normaliser avec un suivi médical optimal.
La survie à l'âge adulte est désormais la règle dans les pays développés. Les études récentes montrent une espérance de vie de 50-60 ans en moyenne, contre 30-40 ans il y a deux décennies [9]. Cette amélioration résulte d'une meilleure prise en charge des complications cardiaques et respiratoires.
Le développement intellectuel varie considérablement d'un patient à l'autre. Si la déficience intellectuelle reste constante, son degré oscille entre léger et sévère [6]. Environ 20% des patients atteignent une autonomie partielle à l'âge adulte, notamment pour les gestes de la vie quotidienne.
L'intégration sociale dépend largement de l'accompagnement reçu pendant l'enfance. Les patients bénéficiant d'une stimulation précoce et d'une scolarité adaptée développent de meilleures compétences sociales [9,14]. Certains accèdent même à un emploi protégé ou à des activités semi-autonomes.
Les facteurs pronostiques incluent la précocité du diagnostic, la qualité de la prise en charge et l'absence de complications majeures [2,5]. L'environnement familial et social joue également un rôle déterminant dans l'évolution à long terme.
Peut-on Prévenir le Syndrome de Rubinstein-Taybi ?
La prévention primaire du syndrome de Rubinstein-Taybi reste actuellement impossible en raison de son caractère génétique sporadique [1,5]. Les mutations surviennent de manière aléatoire, sans facteur déclenchant identifiable.
Cependant, la prévention secondaire par diagnostic précoce prend tout son sens. Un diagnostic rapide permet d'initier précocement les prises en charge spécialisées [2,11]. Cette approche améliore significativement le pronostic développemental et limite les complications.
Le conseil génétique joue un rôle important pour les familles concernées. Bien que le risque de récurrence soit faible (1-2%), une consultation génétique permet d'évaluer précisément ce risque [5,8]. Les couples peuvent ainsi prendre des décisions éclairées concernant leurs projets parentaux.
Les techniques de diagnostic prénatal évoluent rapidement. L'échographie fœtale peut parfois détecter certaines malformations caractéristiques [11]. Le diagnostic génétique préimplantatoire reste théoriquement possible mais rarement justifié compte tenu de la rareté des formes familiales.
La sensibilisation des professionnels constitue un enjeu majeur de prévention secondaire. Une meilleure connaissance du syndrome par les pédiatres et généralistes permettrait de réduire l'errance diagnostique [1,13]. Les formations médicales continues intègrent progressivement ces connaissances.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 un protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) spécifique au syndrome de Rubinstein-Taybi [1]. Ce document de référence harmonise les pratiques sur l'ensemble du territoire français.
Le PNDS recommande un suivi multidisciplinaire coordonné dès le diagnostic confirmé. L'équipe de soins doit inclure : généticien, pédiatre, cardiologue, ophtalmologue, orthophoniste et kinésithérapeute [1,5]. Cette approche globale optimise la prise en charge et limite les ruptures de parcours.
Concernant la surveillance médicale, le protocole préconise des examens réguliers : échocardiographie annuelle, bilan ophtalmologique semestriel, évaluation du développement psychomoteur trimestrielle [1,2]. Cette surveillance permet de dépister précocement les complications et d'adapter les traitements.
L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a émis des recommandations spécifiques concernant l'usage des psychotropes chez ces patients [6]. La prescription doit être prudente, avec surveillance renforcée des effets indésirables et réévaluation régulière du rapport bénéfice-risque.
Au niveau européen, l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) encourage le développement de médicaments orphelins pour cette pathologie [4]. Des procédures accélérées d'évaluation sont prévues pour les traitements innovants répondant à un besoin médical non couvert.
Ressources et Associations de Patients
L'Association Rubinstein-Taybi France constitue la principale ressource pour les familles concernées par cette maladie rare. Créée en 2003, elle regroupe plus de 200 familles et propose un accompagnement personnalisé [14].
Cette association organise des rencontres familiales annuelles permettant l'échange d'expériences et le partage de conseils pratiques. Ces événements créent des liens durables entre les familles et rompent l'isolement souvent ressenti [9]. Des ateliers thématiques abordent les questions éducatives, médicales et sociales.
Au niveau international, l'International Rubinstein-Taybi Syndrome Association coordonne les efforts de recherche et d'information. Cette organisation facilite les collaborations scientifiques et harmonise les recommandations de prise en charge [5,12].
Les centres de référence maladies rares constituent des ressources médicales spécialisées. En France, plusieurs centres proposent des consultations dédiées : Hôpital Necker (Paris), CHU de Bordeaux, CHU de Lyon [1,13]. Ces structures assurent le diagnostic, le suivi et la coordination des soins.
Les plateformes d'information en ligne offrent des ressources actualisées : Orphanet, Maladies Rares Info Services, sites des associations [13,14]. Ces outils permettent aux familles d'accéder à une information fiable et de se tenir informées des dernières avancées.
Nos Conseils Pratiques
Faire face au diagnostic de syndrome de Rubinstein-Taybi nécessite du temps et de l'adaptation. Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre cette situation complexe.
Constituez votre équipe médicale progressivement. Ne cherchez pas à tout organiser immédiatement. Commencez par identifier un médecin référent qui coordonnera les soins [1,2]. Ajoutez ensuite les spécialistes selon les besoins spécifiques de votre enfant.
Documentez le parcours médical de votre enfant. Tenez un carnet de santé détaillé avec les comptes-rendus, examens et traitements [5]. Cette documentation facilitera les consultations et évitera la répétition d'examens inutiles.
Rejoignez une association de patients dès que possible. L'expérience des autres familles s'avère inestimable pour naviguer dans le système de soins [9,14]. Ces échanges apportent des conseils concrets et un soutien moral précieux.
Préservez l'équilibre familial en n'oubliant pas les autres membres de la famille. Les frères et sœurs ont aussi besoin d'attention et d'explications adaptées à leur âge [6]. Organisez des moments de détente et de plaisir pour toute la famille.
Restez informés des avancées sans vous laisser submerger par l'information. Choisissez des sources fiables et limitez vos recherches à des moments dédiés [13]. L'excès d'information peut générer de l'anxiété inutile.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alerte nécessitent une consultation médicale urgente chez les personnes atteintes du syndrome de Rubinstein-Taybi [1,2]. La connaissance de ces situations permet une prise en charge rapide et appropriée.
Les troubles respiratoires aigus constituent une urgence absolue. Difficultés respiratoires, cyanose ou pauses respiratoires prolongées imposent un appel immédiat au SAMU [2,6]. Ces symptômes peuvent révéler une décompensation cardiaque ou des apnées sévères.
Tout changement comportemental brutal doit alerter les familles. Agitation extrême, prostration inhabituelle ou troubles de la conscience peuvent signaler une complication neurologique [6,9]. Une consultation en urgence permet d'éliminer une cause organique.
Les troubles digestifs persistants nécessitent également une évaluation médicale. Vomissements répétés, refus alimentaire total ou douleurs abdominales intenses peuvent révéler une complication chirurgicale [2,13]. Le seuil de consultation doit être bas chez ces patients fragiles.
Pour le suivi de routine, respectez le calendrier établi avec votre équipe médicale. Les consultations régulières permettent de dépister précocement les complications et d'ajuster les traitements [1,5]. N'hésitez pas à contacter votre médecin référent en cas de doute ou d'inquiétude.
Questions Fréquentes
Le syndrome de Rubinstein-Taybi est-il héréditaire ?
Dans 98% des cas, la maladie résulte d'une mutation spontanée non héritée des parents. Seuls 1-2% des cas sont familiaux avec transmission d'un parent porteur.
Mon enfant pourra-t-il avoir une vie normale ?
Chaque enfant évolue différemment, mais beaucoup atteignent une certaine autonomie avec un accompagnement adapté. L'important est de stimuler ses capacités dès le plus jeune âge.
Existe-t-il un traitement curatif ?
Aucun traitement curatif n'existe actuellement, mais la recherche progresse rapidement. Les thérapies épigénétiques en développement offrent des perspectives encourageantes pour l'avenir.
Comment expliquer la maladie aux frères et sœurs ?
Utilisez des mots simples adaptés à leur âge : 'ton frère/ta sœur a besoin de plus d'aide pour grandir'. Rassurez-les sur le fait qu'ils ne peuvent pas 'attraper' la maladie.
Quelles aides financières sont disponibles ?
L'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) peuvent être accordées. Contactez votre MDPH pour constituer un dossier.
Mon enfant peut-il être scolarisé normalement ?
La scolarisation est possible avec des aménagements appropriés : ULIS, AVS, ou établissement spécialisé selon les besoins. L'équipe éducative s'adapte aux capacités de chaque enfant.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Protocole National de Diagnostic et de Soins - Syndrome de Rubinstein-TaybiLien
- [2] Diagnosis and management in Rubinstein-Taybi syndrome - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Transcriptome and acetylome profiling identify crucial steps - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Rubinstein Taybi syndrome medication: Startups in Rare Disease - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Diagnosis and management in Rubinstein-Taybi syndrome: first international consensus statement (2024)Lien
- [6] The behavioral phenotype of Rubinstein–Taybi syndrome: A scoping review of the literature (2022)Lien
- [7] Syndrome de Rubinstein-Taybi: Caractérisation des profils épigénétiques pour l'étude des mécanismes moléculaires de la pathologie (2023)Lien
- [8] Rubinstein-Taybi syndrome: case report of a rare syndrome caused by an abnormality of chromosome 16 (2024)Lien
- [9] The natural history of adults with Rubinstein-Taybi syndrome: a families-reported experience (2022)Lien
- [10] Síndrome de Rubinstein-Taybi: uma abordagem diagnóstica, evolução clínica e revisão (2023)Lien
- [11] Challenges in Prenatal Ultrasound Diagnosis of Rubinstein–Taybi Syndrome: A Case Report and Comprehensive Literature Review (2025)Lien
- [12] Diagnóstico y tratamiento del síndrome de Rubinstein-Taybi: primera declaración de consenso internacionalLien
- [13] Le syndrome de Rubinstein-Taybi - OrphanetLien
- [14] Syndrome de Rubinstein-Taybi - La maladie en bref - OrphanetLien
Publications scientifiques
- Diagnosis and management in Rubinstein-Taybi syndrome: first international consensus statement (2024)17 citations[PDF]
- The behavioral phenotype of Rubinstein–Taybi syndrome: A scoping review of the literature (2022)16 citations
- Syndrome de Rubinstein-Taybi: Caractérisation des profils épigénétiques pour l'étude des mécanismes moléculaires de la pathologie (2023)
- Rubinstein-Taybi syndrome: case report of a rare syndrome caused by an abnormality of chromosome 16 (2024)[PDF]
- The natural history of adults with Rubinstein-Taybi syndrome: a families-reported experience (2022)15 citations[PDF]
Ressources web
- Le syndrome de Rubinstein-Taybi (orpha.net)
Le syndrome de Rubinstein-Taybi (SRT) est une maladie génétique caractérisée par un retard de croissance et de développement, ainsi que par des signes ...
- Syndrome de Rubinstein-Taybi ❖ La maladie en bref (orpha.net)
24 mai 2018 — Définition : Le syndrome de Rubinstein-Taybi est un syndrome malformatif très rare caractérisé par un retard de croissance et de développement ...
- Texte du PNDS (has-sante.fr)
Le diagnostic de SRT peut être évoqué chez un patient devant l'association de différents signes : • une dysmorphie faciale caractéristique.
- Syndrome de Rubinstein et Taybi (medg.fr)
14 mars 2019 — Déf : le syndrome de Rubinstein et Taybi (SRT) est une maladie génétique associant des anomalies morphologiques, un déficit intellectuel ( ...
- Syndrome de Rubinstein-Taybi (fr.wikipedia.org)
Le syndrome de Rubinstein-Taybi est l'association d'un retard mental, d'un aspect caractéristique de la face, des gros orteils et des pouces.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
