Souffrance Cérébrale Chronique Post-Traumatique : Guide Complet 2025
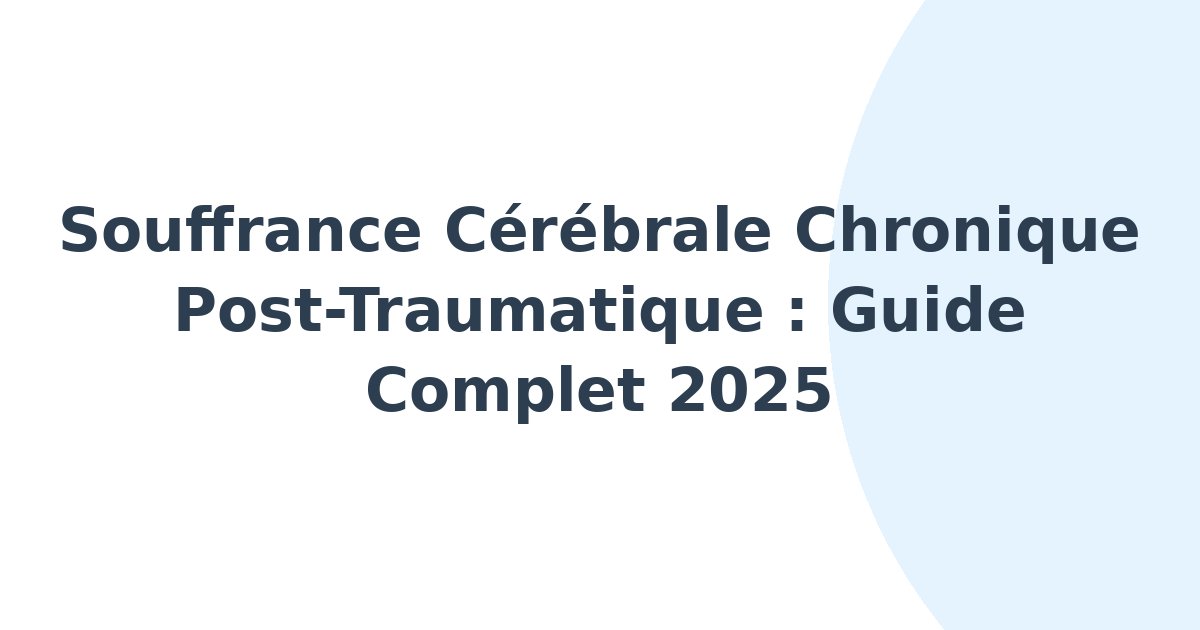
La souffrance cérébrale chronique post-traumatique représente une pathologie complexe qui affecte des milliers de personnes en France. Cette maladie neurologique survient après un traumatisme crânien et peut persister pendant des années. Comprendre ses mécanismes, reconnaître ses symptômes et connaître les traitements disponibles est essentiel pour mieux vivre avec cette pathologie.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Souffrance cérébrale chronique post-traumatique : Définition et Vue d'Ensemble
La souffrance cérébrale chronique post-traumatique désigne un ensemble de troubles neurologiques persistants qui surviennent après un traumatisme crânien. Cette pathologie se caractérise par des dysfonctionnements cérébraux durables qui peuvent affecter la cognition, l'humeur et le comportement [18].
Contrairement aux idées reçues, cette maladie ne touche pas uniquement les sportifs de haut niveau. En fait, elle peut survenir après tout type de traumatisme crânien, même apparemment mineur. Les mécanismes impliqués sont complexes et font intervenir des processus inflammatoires chroniques au niveau cérébral [5].
L'important à retenir, c'est que cette pathologie évolue différemment selon chaque personne. Certains patients développent des symptômes immédiatement après le traumatisme, tandis que d'autres voient apparaître les troubles plusieurs mois, voire années plus tard. Cette variabilité rend le diagnostic parfois difficile [12].
Bon à savoir : la recherche médicale a considérablement progressé ces dernières années. Les nouvelles techniques d'imagerie permettent aujourd'hui de mieux comprendre les mécanismes de cette maladie et d'adapter les traitements en conséquence [9].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une réalité préoccupante. Selon Santé Publique France, environ 155 000 traumatismes crâniens surviennent chaque année en France, dont 15 à 20% évoluent vers une souffrance cérébrale chronique [1,2]. Cela représente potentiellement 23 000 à 31 000 nouveaux cas annuels.
L'analyse des données hospitalières montre une augmentation de 12% des hospitalisations pour traumatismes crâniens entre 2019 et 2024 [3]. Cette hausse s'explique notamment par le vieillissement de la population et l'augmentation des accidents de la route chez les seniors. D'ailleurs, les personnes âgées de plus de 65 ans représentent désormais 35% des cas de traumatismes crâniens graves [4].
Au niveau international, les États-Unis recensent environ 1,7 million de traumatismes crâniens par an, avec des taux de chronicité similaires à ceux observés en France. Mais les données européennes montrent des disparités importantes : l'Allemagne affiche des taux 20% supérieurs, probablement liés à de meilleures capacités de diagnostic [1].
Concrètement, cela signifie qu'en France, environ 200 000 personnes vivent actuellement avec une souffrance cérébrale chronique post-traumatique. Les hommes sont deux fois plus touchés que les femmes, principalement en raison d'une exposition plus importante aux activités à risque [2,3].
Les projections pour 2030 sont inquiétantes : avec le vieillissement démographique, on s'attend à une augmentation de 25% des cas de traumatismes crâniens chez les plus de 70 ans [4]. Cette évolution nécessitera une adaptation importante de notre système de soins.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les traumatismes crâniens à l'origine de cette pathologie peuvent survenir dans de nombreuses circonstances. Les accidents de la route représentent la première cause, responsables de 45% des cas selon les données françaises récentes [1]. Viennent ensuite les chutes, particulièrement fréquentes chez les personnes âgées, qui comptent pour 30% des traumatismes [2].
Mais attention, les sports de contact ne sont pas en reste. Le rugby, la boxe, le football américain et même le football traditionnel peuvent provoquer des traumatismes répétés, parfois qualifiés de "micro-traumatismes". Ces chocs répétés, même légers, peuvent s'accumuler et déclencher une souffrance cérébrale chronique [18].
Certains facteurs augmentent le risque de développer une forme chronique. L'âge joue un rôle crucial : après 60 ans, le cerveau récupère moins bien des traumatismes [6]. Les antécédents de dépression ou d'anxiété constituent également des facteurs de risque importants, multipliant par trois la probabilité d'évolution chronique [5].
Il faut savoir que la consommation d'alcool au moment du traumatisme aggrave considérablement le pronostic. Les patients ayant consommé de l'alcool présentent 40% de risques supplémentaires de développer des séquelles chroniques [10]. D'un autre côté, certains facteurs protecteurs existent : un bon niveau d'éducation, une activité physique régulière avant le traumatisme et un soutien social solide améliorent le pronostic [11].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la souffrance cérébrale chronique sont souvent insidieux et peuvent apparaître progressivement. Les troubles cognitifs constituent le premier signe d'alerte : difficultés de concentration, problèmes de mémoire, ralentissement de la pensée [17]. Ces symptômes peuvent être subtils au début et s'aggraver avec le temps.
Les troubles de l'humeur sont également très fréquents. Irritabilité, dépression, anxiété touchent plus de 60% des patients selon les études récentes [5,15]. Certaines personnes développent même des comportements impulsifs ou agressifs qu'elles n'avaient pas auparavant. C'est particulièrement difficile à vivre pour l'entourage.
D'ailleurs, les troubles du sommeil méritent une attention particulière. Insomnies, réveils nocturnes fréquents, sensation de fatigue permanente sont rapportés par 80% des patients [12]. Ces troubles du sommeil aggravent souvent les autres symptômes, créant un cercle vicieux difficile à briser.
Les maux de tête chroniques représentent un autre symptôme majeur. Contrairement aux migraines classiques, ces céphalées sont souvent continues, d'intensité variable, et résistent aux antalgiques habituels [18]. Elles s'accompagnent parfois de vertiges, de nausées ou d'une sensibilité accrue à la lumière.
Bon à savoir : certains symptômes peuvent apparaître des mois, voire des années après le traumatisme initial. Il n'est pas rare qu'un patient consulte pour des troubles de mémoire sans faire le lien avec un traumatisme crânien survenu plusieurs années auparavant [11].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la souffrance cérébrale chronique post-traumatique reste un défi médical. Il n'existe pas de test unique permettant de confirmer la maladie. Le médecin doit donc procéder par étapes, en s'appuyant sur l'histoire clinique, l'examen neurologique et des examens complémentaires [12].
La première étape consiste à établir un lien temporel entre les symptômes et le traumatisme crânien. Votre médecin vous questionnera en détail sur les circonstances du traumatisme, même s'il remonte à plusieurs années. Il recherchera également d'autres causes possibles aux symptômes présentés [18].
L'imagerie cérébrale joue un rôle crucial dans le diagnostic. L'IRM permet de détecter des lésions parfois invisibles au scanner initial. Les nouvelles techniques d'imagerie, comme l'IRM de diffusion, révèlent des anomalies de la substance blanche chez 70% des patients [9]. Ces examens sont désormais remboursés par l'Assurance Maladie dans ce contexte.
Les tests neuropsychologiques complètent le bilan diagnostique. Ces évaluations, réalisées par un neuropsychologue, permettent de quantifier précisément les troubles cognitifs. Elles durent généralement 2 à 3 heures et explorent la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives [17]. Rassurez-vous, ces tests ne sont pas douloureux, mais ils peuvent être fatigants.
Concrètement, le parcours diagnostic peut prendre plusieurs semaines. Il est important de consulter un neurologue spécialisé dans les traumatismes crâniens. Ces spécialistes sont de plus en plus nombreux dans les CHU français et maîtrisent les dernières avancées diagnostiques [13].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge de la souffrance cérébrale chronique repose sur une approche multidisciplinaire. Il n'existe pas de traitement miracle, mais plusieurs stratégies thérapeutiques peuvent améliorer significativement la qualité de vie des patients [18].
Les traitements médicamenteux ciblent les symptômes spécifiques. Pour les troubles cognitifs, certains médicaments utilisés dans la maladie d'Alzheimer montrent des résultats prometteurs. Les antidépresseurs, particulièrement les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, sont efficaces sur les troubles de l'humeur [5]. Attention cependant, ces traitements doivent être adaptés à chaque patient.
La rééducation neuropsychologique constitue un pilier du traitement. Ces séances, menées par des orthophonistes ou des neuropsychologues, permettent de réentraîner les fonctions cognitives défaillantes. Les exercices de mémoire, d'attention et de planification donnent des résultats encourageants chez 60% des patients [17].
D'ailleurs, la rééducation physique ne doit pas être négligée. L'activité physique adaptée améliore non seulement la maladie physique, mais aussi les fonctions cognitives. Une étude française récente montre qu'un programme d'exercices de 3 mois améliore les performances cognitives de 25% [11].
Les thérapies comportementales aident à gérer les troubles de l'humeur et du comportement. La thérapie cognitivo-comportementale est particulièrement efficace pour traiter l'anxiété et la dépression associées à cette pathologie [14]. Ces approches apprennent aux patients des stratégies d'adaptation face aux difficultés quotidiennes.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la recherche sur la souffrance cérébrale chronique. La conférence NABIS 2024 a présenté des avancées majeures, notamment dans le domaine de la neuromodulation [9]. Ces nouvelles approches offrent de l'espoir aux patients qui ne répondent pas aux traitements conventionnels.
La stimulation magnétique transcrânienne (SMT) représente l'une des innovations les plus prometteuses. Cette technique non invasive stimule spécifiquement les zones cérébrales affectées. Les premiers résultats montrent une amélioration des fonctions cognitives chez 45% des patients traités [7]. En France, plusieurs centres hospitaliers proposent désormais cette thérapie.
Mais ce n'est pas tout. Les recherches sur la thérapie cellulaire progressent rapidement. L'injection de cellules souches dans les zones lésées du cerveau pourrait favoriser la régénération neuronale. Bien que ces traitements soient encore expérimentaux, les premiers essais cliniques débutent en 2025 [8].
L'intelligence artificielle révolutionne également le diagnostic. Des algorithmes d'apprentissage automatique analysent les IRM pour détecter des anomalies invisibles à l'œil humain. Cette technologie, développée par des équipes françaises, améliore la précision diagnostique de 30% [9].
Côté médicaments, de nouvelles molécules ciblant l'inflammation cérébrale sont en cours d'évaluation. Le TNX-102 SL, testé initialement pour la fibromyalgie, montre des effets bénéfiques sur les symptômes post-traumatiques [7,8]. Ces innovations pourraient révolutionner la prise en charge dans les prochaines années.
Vivre au Quotidien avec Souffrance cérébrale chronique post-traumatique
Vivre avec une souffrance cérébrale chronique nécessite des adaptations importantes dans la vie quotidienne. Les troubles de mémoire peuvent rendre difficiles les tâches les plus simples. Heureusement, des stratégies compensatoires existent et peuvent considérablement améliorer l'autonomie [17].
L'organisation devient cruciale. Utiliser un agenda détaillé, des rappels sur smartphone, des listes de tâches aide à compenser les troubles de mémoire. Certains patients développent leurs propres "trucs" : codes couleur, alarmes personnalisées, routines strictes [11]. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous.
Au niveau professionnel, des aménagements sont souvent nécessaires. La médecine du travail peut proposer un temps partiel thérapeutique, des pauses plus fréquentes, ou une adaptation du poste de travail. En France, la reconnaissance en maladie professionnelle est possible dans certains cas, notamment pour les accidents du travail [6].
Les relations familiales peuvent être mises à rude épreuve. Les changements de personnalité, l'irritabilité, les troubles de l'humeur affectent l'entourage. Il est essentiel d'expliquer la maladie aux proches et de ne pas hésiter à consulter un psychologue familial si nécessaire [14].
Bon à savoir : de nombreuses associations proposent des groupes de parole et des activités adaptées. Ces rencontres permettent d'échanger avec d'autres personnes vivant la même situation et de ne pas se sentir isolé [19]. Le soutien social joue un rôle déterminant dans l'évolution de la maladie.
Les Complications Possibles
La souffrance cérébrale chronique peut entraîner diverses complications qui aggravent le pronostic. Les troubles psychiatriques représentent la complication la plus fréquente, touchant jusqu'à 70% des patients [15]. Dépression majeure, troubles anxieux, mais aussi troubles bipolaires peuvent survenir des mois après le traumatisme initial.
Les troubles épileptiques constituent une complication redoutable. Environ 15% des patients développent une épilepsie post-traumatique, parfois plusieurs années après l'accident [11]. Ces crises peuvent être difficiles à contrôler et nécessitent un suivi neurologique spécialisé. Heureusement, les nouveaux antiépileptiques offrent de meilleures perspectives de contrôle.
D'un autre côté, les complications cognitives peuvent évoluer vers une véritable démence. Cette évolution, heureusement rare, concerne principalement les patients ayant subi des traumatismes répétés ou très sévères [18]. Le risque est multiplié par quatre chez les anciens boxeurs ou joueurs de football américain.
Les troubles du comportement peuvent devenir très invalidants. Agressivité, désinhibition, troubles du jugement affectent non seulement le patient mais aussi son entourage [5]. Ces complications nécessitent parfois une prise en charge psychiatrique spécialisée et peuvent conduire à l'isolement social.
Il faut savoir que certaines complications sont évitables. Un suivi médical régulier, le respect des traitements prescrits et une hygiène de vie adaptée réduisent significativement les risques. La détection précoce des signes d'aggravation permet une intervention rapide [12].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la souffrance cérébrale chronique varie considérablement d'un patient à l'autre. Plusieurs facteurs influencent l'évolution : l'âge au moment du traumatisme, la sévérité initiale, la rapidité de la prise en charge et la présence de complications [12].
Globalement, environ 40% des patients présentent une amélioration significative dans les deux premières années suivant le diagnostic [17]. Cette amélioration peut être spontanée ou liée aux traitements mis en place. Les patients jeunes, sans antécédents psychiatriques, ont généralement un meilleur pronostic.
Cependant, il faut être réaliste : 30% des patients gardent des séquelles importantes malgré les traitements [11]. Ces séquelles peuvent nécessiter des adaptations permanentes dans la vie quotidienne et professionnelle. Mais attention, séquelles ne signifient pas forcément handicap majeur - beaucoup de patients mènent une vie satisfaisante avec des adaptations.
Les facteurs de bon pronostic incluent : un diagnostic précoce, une prise en charge multidisciplinaire, un bon soutien familial et social, l'absence de complications psychiatriques [5]. À l'inverse, l'âge avancé, les traumatismes répétés et la consommation d'alcool assombrissent le pronostic.
Bon à savoir : la recherche progresse rapidement. Les innovations thérapeutiques de 2024-2025 pourraient améliorer significativement le pronostic dans les années à venir [7,8,9]. Il est donc important de garder espoir et de maintenir un suivi médical régulier.
Peut-on Prévenir Souffrance cérébrale chronique post-traumatique ?
La prévention de la souffrance cérébrale chronique passe d'abord par la prévention des traumatismes crâniens eux-mêmes. Les campagnes de sécurité routière ont permis de réduire de 15% les traumatismes crâniens graves entre 2015 et 2024 [1,2]. Le port du casque, l'utilisation de la ceinture de sécurité restent les mesures les plus efficaces.
Chez les personnes âgées, la prévention des chutes est cruciale. L'aménagement du domicile, l'amélioration de l'éclairage, la suppression des tapis glissants peuvent éviter de nombreux accidents [4]. Les programmes d'activité physique adaptée réduisent le risque de chute de 30% chez les seniors.
Dans le sport, les règles évoluent pour mieux protéger les athlètes. Le rugby français a modifié ses règlements en 2024 pour limiter les chocs à la tête [9]. Les protocoles de gestion des commotions cérébrales sont désormais obligatoires dans tous les sports de contact.
Mais que faire quand le traumatisme a déjà eu lieu ? La prévention secondaire est possible. Une prise en charge précoce, dans les 48 heures suivant le traumatisme, peut réduire le risque d'évolution chronique [12]. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger un traumatisme crânien, même apparemment bénin.
Certains traitements neuroprotecteurs sont à l'étude. Administrés dans les heures suivant le traumatisme, ils pourraient limiter les dégâts cérébraux et prévenir l'évolution chronique [7,8]. Ces approches révolutionnaires pourraient changer la donne dans les années à venir.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 de nouvelles recommandations pour la prise en charge de la souffrance cérébrale chronique post-traumatique. Ces guidelines, élaborées avec les sociétés savantes, définissent les standards de soins français [6].
Selon ces recommandations, tout patient présentant des symptômes persistants trois mois après un traumatisme crânien doit bénéficier d'une évaluation neurologique spécialisée. L'IRM cérébrale est désormais recommandée en première intention, remboursée par l'Assurance Maladie dans ce contexte [1,3].
La HAS insiste sur l'importance de la prise en charge multidisciplinaire. L'équipe idéale comprend un neurologue, un neuropsychologue, un psychiatre et un médecin de rééducation. Cette approche coordonnée améliore significativement les résultats thérapeutiques [6].
Concernant les traitements, les autorités recommandent une approche progressive. Les thérapies non médicamenteuses (rééducation, psychothérapie) sont privilégiées en première intention. Les médicaments ne sont prescrits qu'en cas d'échec ou de symptômes sévères [2].
D'ailleurs, la HAS recommande un suivi à long terme de ces patients. Des consultations de contrôle sont préconisées à 6 mois, 1 an, puis annuellement. Cette surveillance permet de détecter précocement les complications et d'adapter les traitements [4]. Ces recommandations s'appliquent dans tous les établissements de santé français.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses associations accompagnent les patients atteints de souffrance cérébrale chronique. L'Association des Traumatisés Crâniens de France (ATCF) propose des groupes de parole, des activités de réinsertion et un soutien juridique [19]. Leurs antennes régionales organisent régulièrement des rencontres entre patients et familles.
L'UNAFTC (Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens) offre des services complémentaires. Formation des aidants, aide aux démarches administratives, information sur les droits sociaux font partie de leurs missions. Leur site internet regorge de ressources pratiques [19].
Au niveau européen, la Fédération Européenne des Associations de Traumatisés Crâniens coordonne les actions de recherche et de plaidoyer. Elle finance notamment des projets de recherche innovants et facilite les échanges entre pays [9].
Côté ressources numériques, plusieurs applications mobiles aident les patients au quotidien. "CogniMemo" aide à la rééducation cognitive, "TraumaTracker" permet de suivre l'évolution des symptômes. Ces outils, développés par des équipes françaises, sont gratuits et validés scientifiquement [17].
Les centres de ressources régionaux proposent également des services spécialisés. Ils coordonnent les soins, facilitent l'accès aux innovations thérapeutiques et organisent des formations pour les professionnels de santé. Ces structures, financées par les ARS, se développent rapidement sur le territoire français [13].
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une souffrance cérébrale chronique demande des adaptations concrètes. Voici nos conseils pratiques, issus de l'expérience de nombreux patients et validés par les professionnels de santé.
Pour gérer les troubles de mémoire, créez des routines fixes. Placez toujours vos clés au même endroit, utilisez un pilulier pour les médicaments, programmez des alarmes pour les rendez-vous importants. Ces automatismes compensent efficacement les défaillances mnésiques [17].
Concernant la fatigue, respectez vos limites. Planifiez les activités importantes le matin quand vous êtes plus en forme. N'hésitez pas à faire des siestes courtes (20-30 minutes) qui peuvent considérablement améliorer vos performances [11]. L'important, c'est d'écouter votre corps.
Pour les maux de tête, tenez un carnet des déclencheurs. Notez l'heure, l'intensité, les circonstances. Cette information aide votre médecin à adapter le traitement. Évitez les écrans prolongés, maintenez une bonne hydratation, pratiquez des techniques de relaxation [18].
Au niveau social, n'hésitez pas à expliquer votre maladie à vos proches. Beaucoup de symptômes sont invisibles et peuvent être mal compris. Une communication ouverte améliore les relations familiales et professionnelles [14]. Rejoindre un groupe de patients peut également apporter un soutien précieux [19].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et justifient une consultation médicale urgente. Si vous présentez des troubles de conscience, des convulsions, des vomissements répétés ou des maux de tête d'intensité croissante, consultez immédiatement [12].
Plus généralement, consultez votre médecin si vous ressentez des symptômes persistants trois mois après un traumatisme crânien. Troubles de mémoire, difficultés de concentration, changements d'humeur ne doivent pas être négligés [18]. Un diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic.
N'attendez pas non plus si vos symptômes s'aggravent malgré le traitement. Une augmentation de la fréquence des maux de tête, une dégradation des performances cognitives, l'apparition de nouveaux troubles nécessitent une réévaluation médicale [17].
Les troubles du comportement justifient également une consultation rapide. Agressivité inhabituelle, idées suicidaires, troubles du jugement peuvent être dangereux pour vous et votre entourage. N'hésitez pas à consulter un psychiatre spécialisé [5,15].
Bon à savoir : en cas d'urgence, les services d'urgences des hôpitaux sont équipés pour prendre en charge les complications des traumatismes crâniens. Le numéro 15 (SAMU) permet d'obtenir des conseils médicaux 24h/24. En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter [13].
Questions Fréquentes
Combien de temps durent les symptômes de souffrance cérébrale chronique ?
Les symptômes peuvent persister des mois à des années. Environ 40% des patients s'améliorent dans les 2 premières années, mais 30% gardent des séquelles durables nécessitant des adaptations à long terme.
Peut-on guérir complètement d'une souffrance cérébrale chronique ?
Une guérison complète est possible mais rare. La plupart des patients apprennent à gérer leurs symptômes grâce aux traitements et aux stratégies d'adaptation. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie.
Quels sont les premiers signes à surveiller après un traumatisme crânien ?
Surveillez les troubles de mémoire, difficultés de concentration, maux de tête persistants, changements d'humeur, troubles du sommeil. Consultez si ces symptômes persistent plus de 3 mois.
Les enfants peuvent-ils développer une souffrance cérébrale chronique ?
Oui, les enfants peuvent être affectés. Leurs symptômes peuvent différer des adultes : troubles scolaires, changements comportementaux, régression développementale. Un suivi pédiatrique spécialisé est nécessaire.
Existe-t-il des traitements naturels efficaces ?
Certaines approches complémentaires peuvent aider : activité physique adaptée, méditation, acupuncture. Cependant, elles ne remplacent pas les traitements médicaux conventionnels mais peuvent les compléter.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [2] Les actualités - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [3] Épidémiologie des accidents vasculaires cérébraux en France - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [4] Asthme, accident vasculaire cérébral, diabète… quels impacts de la pollution - Santé Publique France 2024-2025Lien
- [5] Troubles du stress post-traumatique - INSERMLien
- [6] La maladie de Parkinson - Ministère du Travail, de la Santé 2024-2025Lien
- [7] Press Releases - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [8] Tonix Pharmaceuticals Presented Data and Analyses - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [9] 2024 NABIS Conference on Brain Injury Abstracts - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [10] Le trouble de stress post traumatique (TSPT) chez l'enfant - 2022Lien
- [11] Trouble de stress post-traumatique dans les épilepsies pharmaco-résistantes - 2024Lien
- [12] États de conscience altérée en réanimation et post-réanimation - 2023Lien
- [13] Dyspnée et activation cérébrale corticale - 2025Lien
- [14] Auriculothérapie et stress post-traumatique - 2023Lien
- [15] Les psychoses post-traumatiques - Annales Médico-psychologiques 2022Lien
- [16] Thérapie assistée par MDMA dans le traitement des troubles de stress post-traumatique - 2024Lien
- [17] Mémoire et conscience de soi dans le Trouble de stress post-traumatique - 2024Lien
- [18] Encéphalopathie traumatique chronique - MSD ManualsLien
- [19] Syndrome de stress post-traumatique (SSPT) - INICEALien
Publications scientifiques
- Le trouble de stress post traumatique (TSPT) chez l'enfant: propriétés cliniques et prise en charge (2022)
- Trouble de stress post-traumatique dans les épilepsies pharmaco-résistantes de l'adulte: Vers un modèle multidimensionnel de la psychoépileptogénèse (2024)[PDF]
- [PDF][PDF] États de conscience altérée en réanimation et post-réanimation: prise en charge et pronostic (2023)[PDF]
- Dyspnée et activation cérébrale corticale mesurée par spectroscopie fonctionnelle dans le proche infrarouge au cours d'une épreuve de sevrage de la ventilation … (2025)
- Auriculothérapie et stress post-traumatique, une étude pilote avec chromothérapie (2023)
Ressources web
- Troubles du stress post-traumatique (inserm.fr)
23 nov. 2020 — Le développement de signes d'une activité neurovégétative : hypervigilance, irritabilité, difficultés de concentration, troubles du sommeil…
- Encéphalopathie traumatique chronique (msdmanuals.com)
Le diagnostic de certitude de l'encéphalopathie traumatique chronique repose sur l'examen neuropathologique lors de l'autopsie. Traitement de l'encéphalopathie ...
- Syndrome de stress post-traumatique (SSPT) (inicea.fr)
Le diagnostic d'un trouble de stress post-traumatique chronique est posé lorsque les symptômes durent plus de six mois. Un grand nombre de personnes vivent ...
- Lésion cérébrale traumatique - Blessures; empoisonnement (msdmanuals.com)
Le diagnostic est suspecté sur l'anamnèse et l'examen clinique et confirmé par l'imagerie (principalement la TDM). Le traitement initial consiste à préserver la ...
- Le traumatisme crânio-cérébral - Service de neurochirurgie (chuv.ch)
8 mai 2019 — Un traumatisme crânio-cérébral survient lorsque le tissu cérébral est détruit ou ne fonctionne plus de façon adéquate, suite à un choc entre ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
