Hématome Subdural : Symptômes, Traitement et Guide Complet 2025
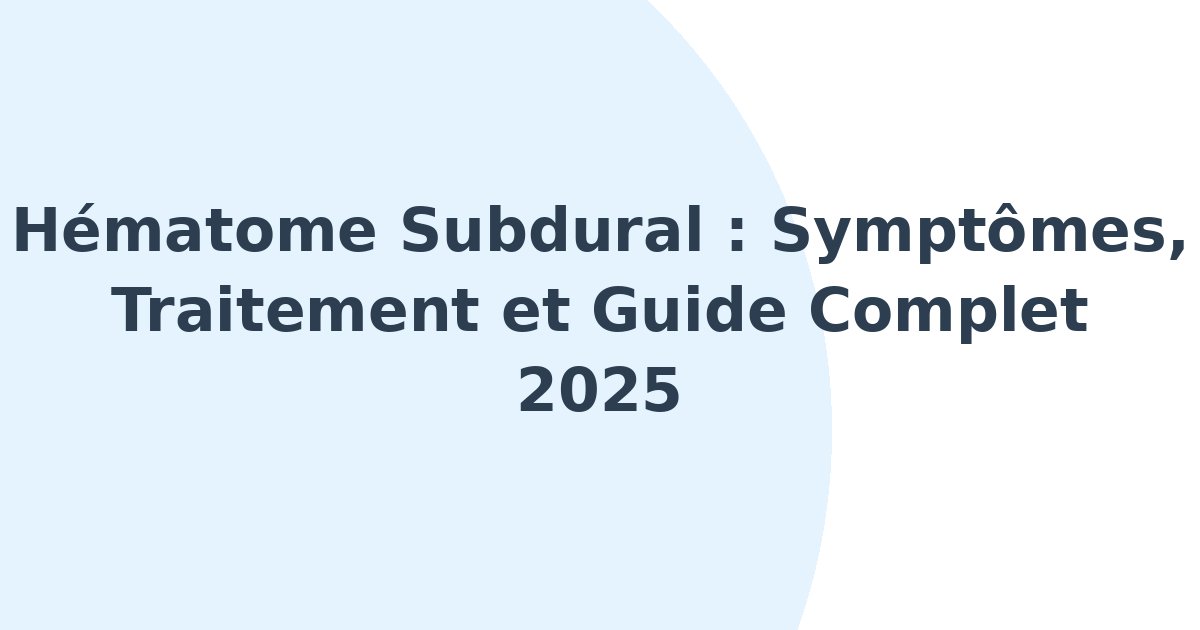
L'hématome subdural représente une accumulation de sang entre le cerveau et sa membrane protectrice. Cette pathologie neurochirurgicale touche environ 15 000 personnes par an en France [1,6]. Bien que souvent liée à un traumatisme crânien, elle peut survenir spontanément, particulièrement chez les personnes âgées. Comprendre ses mécanismes, reconnaître ses symptômes et connaître les traitements disponibles s'avère essentiel pour une prise en charge optimale.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Hématome subdural : Définition et Vue d'Ensemble
Un hématome subdural correspond à un épanchement sanguin situé entre la dure-mère (membrane externe du cerveau) et l'arachnoïde (membrane intermédiaire). Cette collection sanguine exerce une pression sur le tissu cérébral, pouvant entraîner des complications neurologiques graves [14,15].
On distingue principalement deux types d'hématomes subduraux. L'hématome subdural aigu survient dans les heures suivant un traumatisme et constitue une urgence neurochirurgicale absolue. L'hématome subdural chronique se développe progressivement sur plusieurs semaines ou mois, touchant préférentiellement les personnes âgées [6,9].
La physiopathologie implique généralement une rupture des veines ponts qui relient la surface cérébrale aux sinus veineux duraux [11]. Ces vaisseaux fragiles peuvent se rompre lors d'un mouvement brusque de la tête, même sans traumatisme direct apparent. D'ailleurs, chez les personnes âgées, l'atrophie cérébrale augmente l'espace subdural et fragilise ces connexions veineuses.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'incidence de l'hématome subdural chronique atteint 14 à 18 cas pour 100 000 habitants par an, avec une nette prédominance masculine (ratio 2:1) [6,9]. Cette pathologie touche principalement les personnes âgées de plus de 65 ans, représentant 85% des cas diagnostiqués selon les données hospitalières françaises de 2024.
L'évolution épidémiologique montre une augmentation constante de 3% par an depuis 2019, directement corrélée au vieillissement de la population [9,13]. Les projections démographiques suggèrent un doublement des cas d'ici 2035, posant des défis majeurs pour les services de neurochirurgie français.
Comparativement, les pays nordiques présentent des taux similaires (15-20/100 000), tandis que les pays asiatiques rapportent des incidences plus faibles (8-12/100 000). Cette différence s'explique partiellement par les variations génétiques et les habitudes de consommation d'alcool [13]. En effet, l'alcoolisme chronique multiplie par 4 le risque de développer un hématome subdural chronique.
L'impact économique sur le système de santé français représente environ 180 millions d'euros annuels, incluant les hospitalisations, interventions chirurgicales et rééducation. Chaque patient génère en moyenne des coûts de 12 000 à 15 000 euros selon la complexité du cas [10].
Les Causes et Facteurs de Risque
Les traumatismes crâniens constituent la cause principale des hématomes subduraux, représentant 70% des cas aigus [14,15]. Même un choc apparemment mineur peut suffire chez les personnes à risque. Les chutes domestiques, accidents de la voie publique et agressions représentent les circonstances les plus fréquentes.
Certains facteurs prédisposent particulièrement à cette pathologie. L'âge avancé fragilise les vaisseaux cérébraux et augmente l'espace subdural par atrophie cérébrale [9,11]. L'alcoolisme chronique altère la coagulation et favorise les chutes répétées, multipliant le risque par quatre selon une étude française récente [13].
Les anticoagulants et antiagrégants plaquettaires représentent des facteurs de risque majeurs. Une étude de 2022 rapporte que le rivaroxaban multiplie par 6 le risque d'hématome subdural spontané [12]. D'ailleurs, l'augmentation des prescriptions d'anticoagulants oraux directs explique partiellement la hausse d'incidence observée ces dernières années.
Mais d'autres causes moins fréquentes existent. Les malformations artérioveineuses cérébrales peuvent se révéler par un hématome subdural, particulièrement au niveau de la fosse postérieure [8]. Certaines procédures médicales, comme la rachianesthésie, peuvent exceptionnellement provoquer cette complication [7].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de l'hématome subdural varient considérablement selon sa forme et sa localisation. Dans la forme aiguë, les signes apparaissent rapidement après le traumatisme : céphalées intenses, vomissements, troubles de la conscience et déficits neurologiques focaux [14,16]. Ces symptômes constituent une urgence absolue nécessitant une prise en charge immédiate.
L'hématome subdural chronique présente une symptomatologie plus insidieuse. Les patients développent progressivement des troubles cognitifs, une confusion, des troubles de l'équilibre et des céphalées fluctuantes [6,9]. Ces signes, souvent attribués au vieillissement normal, retardent fréquemment le diagnostic.
Concrètement, vous pourriez observer chez un proche âgé une détérioration progressive de ses capacités intellectuelles, des chutes répétées ou des changements de personnalité. Ces manifestations, évoluant sur plusieurs semaines, doivent alerter et motiver une consultation neurologique [10,16].
Il faut savoir que certains symptômes sont particulièrement évocateurs. L'association de céphalées matinales, de troubles de la marche et de confusion chez une personne âgée sous anticoagulants doit faire suspecter un hématome subdural chronique. D'ailleurs, près de 30% des patients présentent des symptômes fluctuants, alternant périodes d'amélioration et d'aggravation [9].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'hématome subdural repose principalement sur l'imagerie cérébrale. Le scanner cérébral sans injection constitue l'examen de première intention, permettant de visualiser la collection sanguine et d'évaluer son retentissement sur les structures cérébrales [14,15]. Cette technique identifie 95% des hématomes subduraux aigus et 85% des formes chroniques.
L'IRM cérébrale apporte des informations complémentaires précieuses, particulièrement pour dater l'hématome et détecter les récidives [6,16]. Les séquences FLAIR et T2 révèlent les collections anciennes que le scanner peut méconnaître. En effet, les hématomes chroniques deviennent isodenses au parenchyme cérébral, rendant leur détection difficile au scanner.
L'examen clinique neurologique reste fondamental pour évaluer le retentissement fonctionnel. L'échelle de Glasgow permet de quantifier l'altération de la conscience, tandis que l'examen des fonctions supérieures détecte les troubles cognitifs subtils [10]. Ces évaluations guident les décisions thérapeutiques et le pronostic.
Mais attention, certains pièges diagnostiques existent. Les hématomes subduraux bilatéraux peuvent passer inaperçus car ils n'entraînent pas de déviation des structures médianes. D'ailleurs, chez les patients déments, l'aggravation cognitive peut être attribuée à tort à l'évolution naturelle de la maladie [9].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de l'hématome subdural dépend de sa forme, de son volume et de l'état clinique du patient. Pour les hématomes aigus volumineux avec effet de masse, l'évacuation chirurgicale en urgence s'impose par craniotomie ou craniectomie [1,14]. Cette intervention vise à décomprimer rapidement le cerveau et prévenir l'engagement cérébral.
L'hématome subdural chronique bénéficie généralement d'une approche moins invasive. La technique du trou de trépan avec drainage constitue le traitement de référence, offrant d'excellents résultats avec une morbidité réduite [4,6]. Cette procédure, réalisée sous anesthésie locale, permet l'évacuation progressive de la collection sanguine.
Certains cas sélectionnés peuvent bénéficier d'un traitement conservateur. Les hématomes de petit volume chez des patients asymptomatiques peuvent être surveillés par imagerie répétée [10]. Cette approche nécessite une surveillance clinique rapprochée et une réévaluation régulière de l'indication chirurgicale.
Le traitement médical adjuvant joue un rôle important. L'arrêt temporaire des anticoagulants, sous contrôle cardiologique, permet de limiter l'extension de l'hématome [12]. La prise en charge de l'hypertension intracrânienne par diurétiques osmotiques peut s'avérer nécessaire dans les formes sévères [14].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques récentes transforment la prise en charge des hématomes subduraux. Le programme de recherche 2024-2025 de la Société Française de Neurochirurgie explore de nouvelles techniques mini-invasives, notamment l'utilisation de cathéters de drainage sous-duraux à demeure [1]. Ces dispositifs permettent une évacuation progressive et contrôlée, réduisant les risques de récidive.
L'émergence des techniques endoscopiques révolutionne l'approche chirurgicale. Les innovations 2024 incluent l'utilisation d'endoscopes flexibles pour l'évacuation des hématomes chroniques multiloculaires [3]. Cette approche minimise les traumatismes chirurgicaux tout en optimisant l'évacuation des collections complexes.
La recherche pharmacologique explore de nouvelles pistes thérapeutiques. Les études récentes évaluent l'efficacité des agents hémostatiques locaux pour prévenir les récidives post-opératoires [4]. Ces innovations promettent de réduire significativement les taux de reprise chirurgicale, actuellement de 10 à 15%.
D'ailleurs, l'intelligence artificielle s'intègre progressivement dans le diagnostic et le suivi. Les algorithmes de deep learning développés en 2024 permettent une détection automatisée des hématomes subduraux sur les scanners cérébraux, avec une sensibilité de 98% [2]. Cette technologie optimise le dépistage précoce et la surveillance évolutive.
Vivre au Quotidien avec Hématome subdural
La récupération après un hématome subdural nécessite souvent des adaptations importantes du mode de vie. Les patients doivent généralement éviter les activités à risque de chute pendant plusieurs mois après l'intervention [6,10]. Cette précaution s'avère particulièrement importante chez les personnes âgées, plus susceptibles de développer des récidives.
La rééducation neurologique joue un rôle central dans la récupération fonctionnelle. Les troubles cognitifs et moteurs résiduels bénéficient d'une prise en charge multidisciplinaire associant kinésithérapie, orthophonie et ergothérapie [9]. Cette approche globale optimise les chances de récupération et l'autonomie des patients.
L'adaptation du domicile s'avère souvent nécessaire pour prévenir les chutes. L'installation de barres d'appui, l'amélioration de l'éclairage et la suppression des obstacles constituent des mesures préventives essentielles [13]. Ces aménagements, parfois pris en charge par l'assurance maladie, réduisent significativement le risque de récidive.
Il est important de maintenir un suivi médical régulier. Les consultations neurochirurgicales permettent de détecter précocement les récidives, survenant dans 10 à 15% des cas [10]. D'ailleurs, certains patients développent une anxiété post-traumatique nécessitant un accompagnement psychologique spécialisé.
Les Complications Possibles
Les complications de l'hématome subdural peuvent être immédiates ou tardives. L'engagement cérébral constitue la complication la plus redoutable des formes aiguës, pouvant entraîner le décès en l'absence de traitement urgent [14,15]. Cette situation d'urgence absolue nécessite une décompression chirurgicale immédiate.
Les récidives représentent la complication la plus fréquente des hématomes chroniques, survenant dans 10 à 15% des cas selon les séries françaises récentes [6,10]. Ces récidives peuvent apparaître plusieurs mois après l'intervention initiale, nécessitant parfois une nouvelle chirurgie. L'âge avancé et la poursuite des anticoagulants constituent les principaux facteurs de risque.
Les complications infectieuses post-opératoires, bien que rares (2-3% des cas), peuvent compromettre le pronostic fonctionnel [10]. L'empyème subdural nécessite un traitement antibiotique prolongé et parfois une reprise chirurgicale pour lavage et drainage.
Certains patients développent des séquelles neurologiques permanentes. Les troubles cognitifs résiduels touchent environ 20% des patients âgés, particulièrement ceux ayant présenté des symptômes prolongés avant le diagnostic [9]. Ces séquelles peuvent altérer significativement la qualité de vie et l'autonomie.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de l'hématome subdural dépend largement de sa forme et de la rapidité de prise en charge. Les hématomes aigus présentent une mortalité de 30 à 50% malgré un traitement optimal [14,15]. Cette mortalité élevée s'explique par la gravité des lésions cérébrales associées et les délais de prise en charge.
En revanche, les hématomes subduraux chroniques offrent un pronostic beaucoup plus favorable. Les études françaises récentes rapportent une mortalité inférieure à 5% et un taux de récupération complète de 70 à 80% [6,9]. Cette différence s'explique par l'adaptation progressive du cerveau à la compression et l'absence de lésions parenchymateuses associées.
L'âge constitue un facteur pronostique majeur. Les patients de moins de 65 ans récupèrent généralement sans séquelles, tandis que les personnes âgées conservent plus fréquemment des troubles cognitifs résiduels [10,13]. La présence de comorbidités, notamment cardiovasculaires, influence également le pronostic fonctionnel.
Il faut savoir que la précocité du diagnostic améliore considérablement le pronostic. Les patients diagnostiqués dans les premières semaines d'évolution présentent de meilleurs résultats fonctionnels que ceux pris en charge tardivement [9]. D'ailleurs, la qualité de la récupération dépend aussi de l'adhésion aux programmes de rééducation post-opératoire.
Peut-on Prévenir Hématome subdural ?
La prévention de l'hématome subdural repose principalement sur la réduction des facteurs de risque modifiables. La prévention des chutes chez les personnes âgées constitue l'axe prioritaire, impliquant l'aménagement du domicile, l'amélioration de l'éclairage et la suppression des obstacles [13,16]. Ces mesures simples réduisent significativement l'incidence des traumatismes crâniens.
La gestion optimale des traitements anticoagulants nécessite une surveillance renforcée. L'évaluation régulière du rapport bénéfice-risque, particulièrement chez les patients âgés à risque de chute, permet d'adapter les posologies ou de modifier les molécules [12]. Cette approche personnalisée réduit le risque hémorragique sans compromettre l'efficacité thérapeutique.
L'éducation des patients et de leur entourage joue un rôle crucial. La sensibilisation aux signes d'alerte neurologiques permet un diagnostic plus précoce et améliore le pronostic [9,16]. Cette démarche éducative doit cibler particulièrement les familles de patients à risque élevé.
Mais certaines mesures préventives spécifiques méritent d'être soulignées. Le port du casque lors d'activités à risque, même chez l'adulte, réduit l'incidence des traumatismes crâniens [15]. D'ailleurs, la prise en charge de l'alcoolisme chronique diminue significativement le risque de récidive chez les patients ayant déjà présenté un hématome subdural [13].
Recommandations des Autorités de Santé
Les recommandations françaises de prise en charge des hématomes subduraux ont été actualisées en 2024 par la Société Française de Neurochirurgie [1]. Ces guidelines préconisent une approche multidisciplinaire associant neurochirurgiens, radiologues et gériatres pour optimiser la prise en charge des patients âgés.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande un dépistage systématique chez les patients âgés sous anticoagulants présentant des troubles cognitifs d'apparition récente [2]. Cette recommandation vise à réduire les retards diagnostiques, particulièrement fréquents dans cette population à risque.
Les recommandations européennes de 2024 insistent sur l'importance de la surveillance post-opératoire prolongée [3]. Un suivi clinique et radiologique à 3, 6 et 12 mois permet de détecter précocement les récidives et d'adapter la prise en charge. Cette surveillance rapprochée améliore significativement le pronostic à long terme.
Concernant la prévention, les autorités sanitaires recommandent une évaluation gériatrique standardisée pour tous les patients de plus de 75 ans [2]. Cette évaluation multidimensionnelle identifie les facteurs de risque modifiables et guide les interventions préventives personnalisées. L'objectif est de réduire l'incidence de cette pathologie dans une population vieillissante.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients et familles confrontés aux hématomes subduraux. L'Association France Traumatisme Crânien propose un soutien psychologique et des groupes de parole pour les patients et leurs proches. Cette structure offre également des conseils pratiques pour l'adaptation du quotidien post-traumatique.
La Fédération Nationale des Associations d'Aide aux Handicapés Moteurs peut intervenir pour l'aménagement du domicile et l'obtention d'aides techniques. Ces services, partiellement pris en charge par l'assurance maladie, facilitent le maintien à domicile des patients présentant des séquelles.
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) évaluent les besoins d'accompagnement et attribuent les prestations adaptées. La reconnaissance du handicap permet l'accès à diverses aides financières et humaines, notamment l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) pour les personnes âgées.
D'ailleurs, de nombreuses ressources en ligne sont disponibles. Le site de la Société Française de Neurochirurgie propose des fiches d'information patient actualisées [1]. Ces documents, validés par des experts, offrent des explications claires sur la pathologie, les traitements et le suivi nécessaire.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations pratiques pour les patients et leurs proches. Après un traumatisme crânien, même apparemment bénin, surveillez l'apparition de céphalées persistantes, de troubles de l'équilibre ou de confusion [16]. Ces symptômes, particulièrement chez les personnes âgées ou sous anticoagulants, justifient une consultation médicale rapide.
Pour les patients diagnostiqués, respectez scrupuleusement les consignes post-opératoires. Évitez les efforts physiques intenses pendant au moins 6 semaines et reprenez progressivement vos activités habituelles [6,10]. Cette prudence temporaire prévient les complications et optimise la récupération.
Adaptez votre environnement pour prévenir les chutes. Installez des barres d'appui dans la salle de bain, améliorez l'éclairage des escaliers et supprimez les tapis glissants [13]. Ces aménagements simples réduisent considérablement le risque de récidive.
Maintenez un dialogue ouvert avec votre équipe médicale. N'hésitez pas à signaler tout symptôme inhabituel, même s'il vous paraît mineur [9]. La détection précoce des complications améliore significativement le pronostic. D'ailleurs, conservez précieusement vos comptes-rendus d'imagerie, ils seront utiles pour le suivi à long terme.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes imposent une consultation médicale urgente. Après un traumatisme crânien, consultez immédiatement en cas de perte de connaissance, de vomissements répétés, de troubles visuels ou de convulsions [14,15]. Ces symptômes peuvent révéler un hématome subdural aigu nécessitant une prise en charge neurochirurgicale urgente.
Chez les personnes âgées, soyez attentif aux changements comportementaux progressifs. Une confusion croissante, des troubles de la mémoire récente ou des chutes répétées doivent motiver une consultation neurologique [9,16]. Ces signes insidieux peuvent révéler un hématome subdural chronique.
Les patients sous anticoagulants méritent une vigilance particulière. Tout symptôme neurologique nouveau, même mineur, justifie un avis médical rapide [12]. Cette population à risque développe plus fréquemment des hématomes spontanés ou après traumatismes minimes.
En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le 15 ou à vous rendre aux urgences. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'un diagnostic urgent [14]. D'ailleurs, les services d'urgences sont habitués à ces situations et sauront évaluer rapidement la gravité de votre état.
Questions Fréquentes
Un hématome subdural peut-il guérir spontanément ?Les petits hématomes subduraux chroniques peuvent effectivement se résorber spontanément dans 20 à 30% des cas [6,10]. Cette évolution favorable concerne principalement les collections de faible volume chez des patients asymptomatiques. Cependant, une surveillance médicale reste indispensable.
Peut-on reprendre le sport après un hématome subdural ?
La reprise sportive est généralement possible après 3 à 6 mois, selon l'avis neurochirurgical [10]. Les sports de contact restent déconseillés pendant au moins un an. Cette prudence vise à prévenir les récidives, particulièrement fréquentes en cas de nouveau traumatisme.
Les anticoagulants doivent-ils être arrêtés définitivement ?
L'arrêt définitif n'est pas systématique mais nécessite une évaluation cardiologique [12]. Le rapport bénéfice-risque doit être réévalué individuellement, en tenant compte du risque thromboembolique et hémorragique. Des alternatives thérapeutiques peuvent parfois être proposées.
Quelle est la différence avec un AVC ?
L'hématome subdural se situe entre les méninges, tandis que l'AVC hémorragique touche directement le tissu cérébral [14,15]. Les symptômes peuvent être similaires, mais l'imagerie permet facilement de différencier ces deux pathologies. Le pronostic et les traitements diffèrent également significativement.
Actes médicaux associés
Les actes CCAM suivants peuvent être pratiqués dans le cadre de Hématome subdural :
Questions Fréquentes
Un hématome subdural peut-il guérir spontanément ?
Les petits hématomes subduraux chroniques peuvent effectivement se résorber spontanément dans 20 à 30% des cas. Cette évolution favorable concerne principalement les collections de faible volume chez des patients asymptomatiques. Cependant, une surveillance médicale reste indispensable.
Peut-on reprendre le sport après un hématome subdural ?
La reprise sportive est généralement possible après 3 à 6 mois, selon l'avis neurochirurgical. Les sports de contact restent déconseillés pendant au moins un an. Cette prudence vise à prévenir les récidives, particulièrement fréquentes en cas de nouveau traumatisme.
Les anticoagulants doivent-ils être arrêtés définitivement ?
L'arrêt définitif n'est pas systématique mais nécessite une évaluation cardiologique. Le rapport bénéfice-risque doit être réévalué individuellement, en tenant compte du risque thromboembolique et hémorragique. Des alternatives thérapeutiques peuvent parfois être proposées.
Quelle est la différence avec un AVC ?
L'hématome subdural se situe entre les méninges, tandis que l'AVC hémorragique touche directement le tissu cérébral. Les symptômes peuvent être similaires, mais l'imagerie permet facilement de différencier ces deux pathologies. Le pronostic et les traitements diffèrent également significativement.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Programme Déroulé. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Recommandations-diagnostic-alzheimer. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Programme Déroulé Complet. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Burr hole evacuation of chronic subdural hematoma. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [6] L'Hématome sous dural chronique de l'adulte: Protocole thérapeutique et revue de littératureLien
- [7] D'une rachianesthésie à un hématome sous-dural: à propos d'un casLien
- [8] Un hématome sous dural aigu de la fosse cérébrale postérieureLien
- [9] Hématome Subdural Chronique de l'Adulte à Brazzaville: Aspects Cliniques et RadiologiquesLien
- [10] Hématome sous–dural chronique: expérience du service de neurochirurgieLien
- [11] Étude des veines ponts chez les enfants ayant un hématome sous-duralLien
- [12] Hématome Sous-Dural Aigu sous Rivaroxaban: A Propos de Deux CasLien
- [13] Devenir de l'hématome sous-dural chronique associé à l'alcoolLien
- [14] Hématomes intracrâniens - Lésions et intoxicationsLien
- [15] Hématome sous-dural : types, symptômes, causesLien
- [16] Hématome sous dural: symptômes et causesLien
Publications scientifiques
- [PDF][PDF] L'Hématome sous dural chronique de l'adulte: Protocole thérapeutique et revue de littérature (2023)
- [PDF][PDF] D'une rachianesthésie à un hématome sous-dural: à propos d'un cas au Centre Hospitalier Universitaire d'Owendo From spinal anesthesia to subdural … [PDF]
- [PDF][PDF] Un hématome sous dural aigu de la fosse cérébrale postérieure: circonstance de découverte d'une malformation artérioveineuse cérébelleuse: à propos d'un … [PDF]
- Hématome Subdural Chronique de l'Adulte à Brazzaville: Aspects Cliniques et Radiologiques à Propos de 96 Cas (2023)
- [PDF][PDF] Hématome sous–dural chronique: expérience du service de neurochirurgie/HMRU Constantine (2024)
Ressources web
- Hématomes intracrâniens - Lésions et intoxications (msdmanuals.com)
Les symptômes d'hématomes sous-duraux peuvent inclure les suivants : mal de tête persistant, somnolence fluctuante, confusion, altération de la mémoire, ...
- Hématome sous-dural : types, symptômes, causes ... (apollohospitals.com)
19 févr. 2025 — Dans le cas d'un hématome sous-dural, le saignement se produit sous le crâne et à l'extérieur du cerveau. Cependant, lorsque le sang s'accumule, ...
- Hématome sous dural: symptômes et causes (xpermd.org)
Les hématomes intracrâniens sont accompagné d'une perte de connaissance, avec un passage rapide aux urgences. Comment les traités de manière peu invasive ?
- Hématome sous-dural chronique (deuxiemeavis.fr)
12 déc. 2023 — Comment diagnostiquer un hématome sous-dural chronique ? Le seul examen nécessaire et suffisant est le scanner cérébral sans injection de ...
- 1.1.7 CONDUITE A TENIR DEVANT UN HEMATOME ... (campus.neurochirurgie.fr)
Les signes d'hypertension intracrânienne (vomissement, céphalées) concernent environ 15% des patients, le plus souvent sans déficit neurologique. On identifie ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
