Rubéole : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitement et Prévention
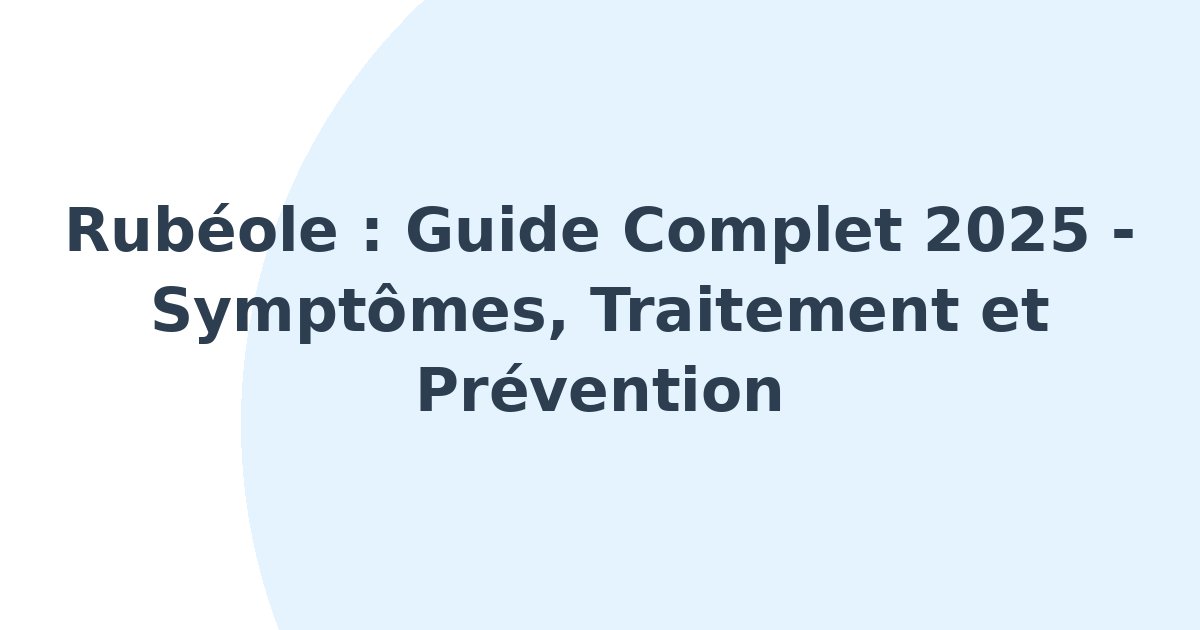
La rubéole est une maladie virale contagieuse qui touche principalement les enfants et les jeunes adultes. Bien que généralement bénigne, elle peut avoir des conséquences graves chez la femme enceinte. En France, grâce à la vaccination, les cas ont considérablement diminué depuis les années 1980. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette pathologie : symptômes, diagnostic, traitements et prévention.
Téléconsultation et Rubéole
Partiellement adaptée à la téléconsultationLa rubéole est généralement une infection bénigne dont les symptômes peuvent être évalués à distance, notamment l'éruption cutanée caractéristique et les signes généraux. Cependant, le diagnostic différentiel avec d'autres éruptions virales et l'évaluation du risque de contagion nécessitent souvent un examen clinique, particulièrement chez la femme enceinte ou en contact avec des femmes enceintes.
Ce qui peut être évalué à distance
Description précise de l'éruption cutanée (localisation, aspect, évolution), évaluation des symptômes associés (fièvre, adénopathies, arthralgies), analyse du contexte épidémiologique et des contacts récents, vérification du statut vaccinal et sérologique, orientation diagnostique initiale face à un syndrome éruptif fébrile.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen physique pour confirmer les caractéristiques de l'éruption et palper les adénopathies, diagnostic différentiel avec d'autres exanthèmes viraux, prélèvements biologiques pour confirmation sérologique si nécessaire, évaluation spécialisée en cas de grossesse ou de contact avec une femme enceinte.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter précisément l'apparition et l'évolution de l'éruption cutanée (localisation initiale, progression), la présence et l'intensité de la fièvre, les douleurs articulaires ou musculaires, les ganglions palpables, et depuis combien de jours ces symptômes sont présents.
- Traitements en cours : Mentionner tous les traitements symptomatiques pris (paracétamol, anti-inflammatoires), les éventuels antibiotiques prescrits par erreur, et tout traitement immunosuppresseur ou corticoïde qui pourrait modifier l'évolution de l'infection.
- Antécédents médicaux pertinents : Statut vaccinal ROR (rougeole-oreillons-rubéole), antécédents de rubéole confirmée, grossesse en cours ou projet de grossesse, contacts récents avec des cas suspects de rubéole, profession à risque (enseignement, petite enfance, milieu médical).
- Examens récents disponibles : Résultats de sérologies récentes (IgM/IgG rubéole), test de grossesse si applicable, numération formule sanguine si déjà réalisée, et tout prélèvement virologique en cours.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Doute diagnostique face à une éruption atypique nécessitant un examen dermatologique, femme enceinte ou en âge de procréer sans immunité confirmée, contact professionnel avec des femmes enceintes nécessitant une évaluation du risque, complications articulaires persistantes ou sévères.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Signes neurologiques associés évoquant une méningo-encéphalite, purpura ou signes hémorragiques, détresse respiratoire chez l'immunodéprimé, fièvre élevée persistante avec altération importante de l'état général.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Maux de tête violents avec raideur de nuque ou troubles de la conscience
- Apparition de taches hémorragiques (purpura) sur la peau
- Difficultés respiratoires ou essoufflement important
- Fièvre supérieure à 39°C persistante malgré le traitement symptomatique
- Douleurs articulaires invalidantes ou gonflements articulaires importants
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Généraliste — consultation en présentiel recommandée
Le médecin généraliste peut généralement prendre en charge la rubéole, mais une consultation en présentiel est souvent recommandée pour confirmer le diagnostic clinique et évaluer le risque de contagion, particulièrement important chez les femmes en âge de procréer.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Rubéole : Définition et Vue d'Ensemble
La rubéole est une infection virale causée par le virus de la rubéole, appartenant à la famille des Togaviridae [1]. Cette maladie se caractérise par une éruption cutanée typique et des symptômes généralement légers chez l'enfant et l'adulte.
Mais attention, la situation change complètement lorsqu'une femme enceinte contracte la rubéole. En effet, le virus peut traverser le placenta et provoquer de graves malformations chez le fœtus, constituant ce qu'on appelle le syndrome de rubéole congénitale [4]. Cette complication majeure explique pourquoi la vaccination contre la rubéole reste un enjeu de santé publique prioritaire.
D'ailleurs, il est important de distinguer la rubéole de la rougeole, deux maladies souvent confondues. La rubéole, surnommée "troisième maladie" ou "rougeole allemande", présente des symptômes plus discrets que sa cousine la rougeole . Concrètement, l'éruption de la rubéole est plus fine et moins étendue, et la fièvre généralement moins élevée.
Le virus de la rubéole ne survit que chez l'homme, ce qui en fait théoriquement une maladie éliminable par la vaccination. Cette caractéristique unique a d'ailleurs permis à plusieurs régions du monde d'atteindre l'élimination de la rubéole [6].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la situation épidémiologique de la rubéole a radicalement changé depuis l'introduction de la vaccination. Selon les données de Santé Publique France, l'incidence de la rubéole a chuté de plus de 99% depuis les années 1980 [1]. Cette diminution spectaculaire témoigne de l'efficacité des programmes de vaccination mis en place.
Actuellement, moins de 10 cas de rubéole sont déclarés chaque année en France métropolitaine [1]. Ces chiffres placent notre pays parmi les bons élèves européens en matière de contrôle de cette maladie. D'ailleurs, la France a officiellement atteint le statut d'élimination de la rubéole en 2018, confirmé par l'Organisation mondiale de la santé.
Mais la vigilance reste de mise. En effet, des cas sporadiques continuent d'être observés, principalement chez des adultes jeunes non vaccinés ou incomplètement vaccinés [3,5]. Ces situations rappellent l'importance du maintien d'une couverture vaccinale élevée pour éviter toute résurgence.
Au niveau mondial, la situation est plus contrastée. Selon les dernières estimations, environ 100 000 enfants naissent encore chaque année avec un syndrome de rubéole congénitale dans le monde [2]. Cette réalité souligne les inégalités d'accès à la vaccination entre les pays développés et en développement.
L'important à retenir : la rubéole reste un problème de santé publique dans de nombreuses régions d'Afrique et d'Asie, où la couverture vaccinale demeure insuffisante [6]. Ces disparités géographiques expliquent pourquoi l'élimination mondiale de la rubéole reste un objectif à atteindre.
Les Causes et Facteurs de Risque
Le virus de la rubéole est l'unique agent responsable de cette maladie. Ce virus à ARN se transmet exclusivement d'homme à homme par voie respiratoire, principalement par les gouttelettes émises lors de la toux, des éternuements ou de la parole [1].
La période de contagiosité s'étend généralement de 7 jours avant à 7 jours après l'apparition de l'éruption cutanée. Mais attention, une personne peut être contagieuse même en l'absence de symptômes visibles, ce qui complique le contrôle de la transmission [1].
Plusieurs facteurs augmentent le risque de contracter la rubéole. L'absence de vaccination constitue évidemment le principal facteur de risque. En France, les personnes nées avant 1980 peuvent présenter une immunité incomplète, car la vaccination systématique n'était pas encore généralisée [3,5].
D'ailleurs, certaines populations restent plus vulnérables. Les voyageurs se rendant dans des pays où la rubéole circule encore activement présentent un risque accru d'exposition. De même, les professionnels de santé non immunisés constituent un groupe à risque particulier, pouvant à la fois contracter et transmettre la maladie [1].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la rubéole varient considérablement selon l'âge du patient. Chez l'enfant, la maladie passe souvent inaperçue ou se manifeste par des signes très discrets. En revanche, chez l'adolescent et l'adulte, les symptômes sont généralement plus marqués [1].
L'éruption cutanée constitue le signe le plus caractéristique de la rubéole. Elle débute typiquement au visage avant de s'étendre vers le tronc et les membres. Ces petites taches rosées, appelées exanthème, sont plus fines et moins confluentes que celles de la rougeole [1].
Mais d'autres symptômes peuvent précéder ou accompagner l'éruption. Une fièvre modérée (généralement inférieure à 38,5°C), des maux de tête légers et une fatigue sont fréquemment observés. Chez l'adulte, on note souvent des douleurs articulaires, particulièrement au niveau des poignets et des chevilles [1].
Un signe particulièrement évocateur chez l'adulte est l'augmentation de volume des ganglions lymphatiques, notamment ceux situés derrière les oreilles et à la base du crâne. Cette adénopathie peut persister plusieurs semaines après la guérison [1].
Il faut savoir que près de 50% des infections par le virus de la rubéole passent totalement inaperçues. Cette forme asymptomatique explique en partie pourquoi la maladie peut circuler silencieusement dans une population [1].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la rubéole repose sur un faisceau d'arguments cliniques et biologiques. Devant une éruption évocatrice, votre médecin procédera d'abord à un interrogatoire détaillé pour rechercher les facteurs de risque et évaluer votre statut vaccinal [1].
L'examen clinique permet d'identifier les signes caractéristiques : éruption typique, adénopathies et éventuels signes articulaires. Mais attention, le diagnostic clinique seul n'est pas suffisant, car d'autres maladies virales peuvent présenter des symptômes similaires [1].
La confirmation biologique devient donc indispensable. Deux types d'examens sont disponibles : la sérologie et la PCR. La sérologie recherche les anticorps spécifiques (IgM et IgG) dans le sang, tandis que la PCR détecte directement le matériel génétique du virus [1].
Concrètement, la présence d'IgM anti-rubéole signe une infection récente, tandis que les IgG témoignent d'une immunité ancienne (infection passée ou vaccination). En cas de doute, un second prélèvement à 15 jours d'intervalle peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic [1].
Dans certaines situations particulières, notamment chez la femme enceinte, des examens complémentaires peuvent être requis. L'échographie fœtale et l'amniocentèse permettent alors d'évaluer un éventuel retentissement sur le fœtus [4].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Il n'existe actuellement aucun traitement antiviral spécifique contre la rubéole. La prise en charge repose donc sur un traitement symptomatique visant à soulager les manifestations de la maladie [1].
Chez l'enfant, le traitement est généralement minimal. Du paracétamol peut être administré en cas de fièvre ou de douleurs, en respectant les posologies adaptées à l'âge et au poids. Il est important d'éviter l'aspirine chez l'enfant en raison du risque de syndrome de Reye [1].
Chez l'adulte, la prise en charge peut être légèrement plus complexe en raison des douleurs articulaires fréquentes. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent alors être prescrits pour soulager ces symptômes, toujours sous surveillance médicale [1].
Le repos reste un élément fondamental du traitement. D'ailleurs, l'éviction scolaire ou professionnelle est recommandée pendant la période de contagiosité pour éviter la transmission à d'autres personnes [1].
Bon à savoir : la guérison survient spontanément en 7 à 10 jours dans la grande majorité des cas. Les complications sont rares chez l'enfant et l'adulte immunocompétent, ce qui explique le caractère généralement bénin de cette maladie [1].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes dans le domaine de la rubéole se concentrent principalement sur l'amélioration des stratégies vaccinales et le développement de nouveaux outils diagnostiques. Selon le rapport de la Haute Autorité de Santé, les innovations de 2024 portent sur l'optimisation des programmes de vaccination .
Une approche particulièrement prometteuse concerne le développement de vaccins combinés plus efficaces. Les recherches actuelles visent à améliorer la durée de protection et à réduire le nombre d'injections nécessaires . Ces innovations s'inscrivent dans la stratégie mondiale d'élimination de la rubéole d'ici 2030.
D'ailleurs, les nouvelles technologies de diagnostic rapide font l'objet d'intenses recherches. Des tests de détection rapide par PCR en temps réel sont en cours de développement, permettant un diagnostic en quelques heures plutôt qu'en plusieurs jours .
Mais l'innovation la plus significative de 2024-2025 concerne la lutte contre la désinformation vaccinale. Suite aux controverses passées sur les vaccins, de nouveaux programmes de communication basés sur des preuves scientifiques solides ont été mis en place . Ces initiatives visent à restaurer la confiance du public dans la vaccination.
Les projections épidémiologiques récentes suggèrent qu'avec les stratégies actuelles, l'élimination mondiale de la rubéole pourrait être atteinte d'ici 2030 [2]. Cette perspective encourageante motive les efforts de recherche actuels.
Vivre au Quotidien avec la Rubéole
Heureusement, la rubéole est une maladie de courte durée qui n'entraîne généralement pas de séquelles à long terme. Pendant la phase aiguë, quelques adaptations du mode de vie suffisent pour favoriser la guérison et limiter la transmission [1].
Le repos constitue la pierre angulaire de la prise en charge. Il est recommandé de rester à domicile pendant au moins 7 jours après l'apparition de l'éruption. Cette période d'isolement protège votre entourage tout en vous permettant de récupérer plus rapidement [1].
L'hydratation joue également un rôle important. Boire suffisamment d'eau aide l'organisme à éliminer les toxines et à maintenir une température corporelle stable. En cas de fièvre, cette recommandation devient encore plus cruciale [1].
Concernant l'alimentation, aucun régime particulier n'est nécessaire. Cependant, privilégier des aliments faciles à digérer peut être bénéfique, surtout si vous ressentez une fatigue importante. Les fruits riches en vitamine C peuvent également soutenir votre système immunitaire [1].
Pour les adultes souffrant de douleurs articulaires, l'application de compresses tièdes sur les articulations douloureuses peut apporter un soulagement. Ces douleurs disparaissent généralement en quelques semaines sans laisser de séquelles [1].
Les Complications Possibles
Bien que généralement bénigne, la rubéole peut parfois entraîner des complications, particulièrement chez certaines populations à risque. La complication la plus redoutable reste le syndrome de rubéole congénitale chez le fœtus [4].
Chez la femme enceinte, l'infection par le virus de la rubéole peut traverser la barrière placentaire et affecter le développement fœtal. Les risques sont maximaux au cours du premier trimestre de grossesse, pouvant atteindre 90% si l'infection survient avant la 11ème semaine [4].
Le syndrome de rubéole congénitale se manifeste par une triade classique : cataracte congénitale, cardiopathie et surdité [4,7]. D'autres atteintes peuvent s'y associer : retard de croissance, microcéphalie, retard mental et atteintes hépatiques [4].
Chez l'adulte, les complications restent rares mais peuvent inclure des arthrites prolongées, particulièrement chez la femme. Ces douleurs articulaires peuvent persister plusieurs mois après la guérison de l'infection initiale [1].
Dans de très rares cas, des complications neurologiques ont été rapportées, notamment des encéphalites ou des myélites transverses [8]. Ces situations exceptionnelles nécessitent une prise en charge spécialisée en milieu hospitalier.
Bon à savoir : chez l'enfant immunocompétent, les complications sont exceptionnelles, ce qui explique le caractère généralement rassurant de cette maladie dans cette population [1].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la rubéole est excellent dans l'immense majorité des cas. Chez l'enfant et l'adulte immunocompétent, la guérison survient spontanément en 7 à 10 jours sans laisser de séquelles [1].
L'infection confère une immunité à vie, ce qui signifie qu'une personne ayant contracté la rubéole ne peut plus la développer une seconde fois. Cette immunité naturelle est comparable à celle obtenue par la vaccination [1].
Chez l'adulte, les douleurs articulaires peuvent parfois persister quelques semaines à quelques mois après la guérison. Cependant, ces symptômes finissent toujours par disparaître complètement sans traitement spécifique [1].
La situation est différente pour le syndrome de rubéole congénitale. Les enfants atteints présentent des handicaps permanents nécessitant une prise en charge multidisciplinaire à vie. Heureusement, grâce à la vaccination, ces cas sont devenus exceptionnels dans les pays développés [4].
D'un point de vue épidémiologique, le pronostic est également encourageant. L'élimination de la rubéole dans de nombreux pays développés démontre qu'il est possible de contrôler efficacement cette maladie par la vaccination [6].
Peut-on Prévenir la Rubéole ?
La prévention de la rubéole repose essentiellement sur la vaccination. En France, le vaccin contre la rubéole fait partie du calendrier vaccinal obligatoire depuis 2018 pour tous les enfants nés après le 1er janvier 2018 [3].
Le vaccin utilisé est un vaccin vivant atténué, généralement administré sous forme de vaccin combiné ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole). La première dose est recommandée à 12 mois, suivie d'une seconde dose entre 16 et 18 mois [3].
L'efficacité vaccinale est remarquable : une seule dose confère une protection de 95%, et deux doses portent cette efficacité à plus de 99%. Cette performance explique le succès des programmes d'élimination dans les pays développés [3,5].
Pour les adultes nés avant l'ère vaccinale, un rattrapage peut être nécessaire. Il est particulièrement important pour les femmes en âge de procréer de vérifier leur statut immunitaire avant une grossesse. Une simple prise de sang permet de doser les anticorps anti-rubéole [1].
D'ailleurs, certaines professions à risque (personnel de santé, enseignants) bénéficient de recommandations vaccinales spécifiques. Ces mesures visent à protéger les populations vulnérables, notamment les femmes enceintes [1].
Bon à savoir : le vaccin contre la rubéole est contre-indiqué pendant la grossesse. Il est donc essentiel de vérifier son statut immunitaire avant de concevoir un enfant [1].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations précises concernant la prévention et la prise en charge de la rubéole. La Haute Autorité de Santé (HAS) actualise régulièrement ces guidelines en fonction des données épidémiologiques .
Concernant la vaccination, les recommandations sont claires : tous les enfants doivent recevoir deux doses de vaccin ROR selon le calendrier vaccinal en vigueur. Pour les adultes nés avant 1980, une vérification du statut immunitaire est recommandée, particulièrement chez les femmes en âge de procréer [3,5].
Santé Publique France insiste sur l'importance du maintien d'une couverture vaccinale élevée (>95%) pour préserver l'élimination de la rubéole acquise en 2018 . Cette vigilance est d'autant plus importante que des résurgences ont été observées dans d'autres pays européens.
En cas de suspicion de rubéole, les autorités recommandent une déclaration obligatoire auprès des services de santé publique. Cette surveillance permet de détecter rapidement d'éventuelles épidémies et d'adapter les mesures de contrôle [1].
Pour les professionnels de santé, des recommandations spécifiques existent concernant la prise en charge des femmes enceintes exposées à la rubéole. Un protocole précis définit les examens à réaliser et le suivi à mettre en place [1].
L'important à retenir : ces recommandations évoluent régulièrement en fonction des nouvelles données scientifiques et épidémiologiques. Il est donc essentiel de se référer aux sources officielles pour obtenir les informations les plus récentes .
Ressources et Associations de Patients
Bien que la rubéole soit devenue rare en France, plusieurs ressources restent disponibles pour les patients et leurs familles. Les centres de vaccination publics constituent la première ressource pour toute question relative à la prévention [1].
L'Assurance Maladie propose des informations détaillées sur son site internet, notamment concernant les modalités de prise en charge et les recommandations vaccinales. Ces ressources sont régulièrement mises à jour par des experts médicaux [1].
Pour les familles concernées par le syndrome de rubéole congénitale, des associations spécialisées dans le handicap peuvent apporter un soutien précieux. Bien que spécifiquement dédiées à la rubéole, ces structures offrent un accompagnement adapté aux besoins particuliers de ces enfants [4].
Les centres de référence en infectiologie pédiatrique constituent également une ressource importante pour les cas complexes. Ces structures spécialisées peuvent fournir une expertise pointue en cas de complications ou de situations particulières [1].
D'ailleurs, les services de santé publique départementaux restent disponibles pour toute question relative à la prévention ou à la surveillance épidémiologique. Ces services jouent un rôle clé dans le maintien de l'élimination de la rubéole .
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations pratiques pour prévenir la rubéole et gérer une éventuelle infection. Tout d'abord, vérifiez votre statut vaccinal et celui de vos enfants. Le carnet de santé ou de vaccination constitue la meilleure source d'information [1].
Si vous êtes une femme en âge de procréer, faites doser vos anticorps anti-rubéole avant de planifier une grossesse. Cette simple prise de sang peut vous éviter bien des inquiétudes et permettre une vaccination préventive si nécessaire [1].
En cas de voyage dans des pays où la rubéole circule encore, assurez-vous d'être correctement vacciné. Consultez votre médecin ou un centre de vaccination internationale au moins 4 semaines avant le départ [1].
Si vous développez une éruption cutanée accompagnée de fièvre, consultez rapidement votre médecin. Un diagnostic précoce permet une prise en charge adaptée et limite les risques de transmission [1].
Pendant la maladie, respectez scrupuleusement la période d'isolement recommandée. Cette mesure simple mais efficace protège votre entourage, particulièrement les femmes enceintes de votre environnement [1].
Enfin, n'hésitez pas à vous informer auprès de sources fiables. La désinformation concernant les vaccins peut avoir des conséquences graves sur la santé publique .
Quand Consulter un Médecin ?
Plusieurs situations nécessitent une consultation médicale rapide en cas de suspicion de rubéole. Tout d'abord, toute éruption cutanée accompagnée de fièvre chez un enfant ou un adulte non vacciné justifie un avis médical [1].
La consultation devient urgente si vous êtes enceinte et avez été exposée à une personne atteinte de rubéole. Dans ce cas, contactez immédiatement votre gynécologue ou votre médecin traitant pour évaluer les risques et organiser la surveillance nécessaire [1].
Chez l'adulte, des douleurs articulaires importantes accompagnant l'éruption peuvent nécessiter une prise en charge spécifique. N'hésitez pas à consulter si ces symptômes vous gênent dans vos activités quotidiennes [1].
En cas de fièvre élevée (>39°C) ou de signes neurologiques (maux de tête intenses, troubles de la conscience), une consultation en urgence s'impose. Ces symptômes peuvent témoigner de complications rares mais sérieuses [8].
Pour les professionnels de santé, toute suspicion de rubéole chez un patient nécessite une déclaration aux autorités sanitaires. Cette démarche fait partie de la surveillance épidémiologique nationale [1].
Enfin, si vous avez des doutes sur votre statut vaccinal ou celui de vos enfants, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Il pourra vous conseiller sur les mesures préventives adaptées à votre situation [1].
Questions Fréquentes
La rubéole est-elle vraiment différente de la rougeole ?
Oui, ce sont deux maladies distinctes causées par des virus différents. La rubéole présente généralement des symptômes plus légers que la rougeole, avec une éruption plus fine et une fièvre moins élevée.
Peut-on attraper la rubéole deux fois ?
Non, l'infection par le virus de la rubéole confère une immunité à vie. Une personne ayant eu la rubéole ne peut plus la contracter une seconde fois.
Le vaccin contre la rubéole est-il sûr ?
Oui, le vaccin ROR est utilisé depuis des décennies avec un excellent profil de sécurité. Les effets secondaires graves sont exceptionnels.
Que faire si je suis enceinte et exposée à la rubéole ?
Consultez immédiatement votre médecin pour évaluer votre statut immunitaire et organiser la surveillance nécessaire. Des examens spécifiques peuvent être réalisés.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Rougeole : fréquence et contagion. Assurance Maladie. 2024-2025.Lien
- [2] Rubéole : définition et modes de transmission. Assurance Maladie. 2024-2025.Lien
- [3] Rougeole en France. Bilan annuel 2024. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [4] 20 ans de confiance. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Update from Vaccine Innovation Prioritization Strategy. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] D'où vient l'idée (fausse) que le vaccin contre la rougeole. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] RAPPORT D'INFORMATION. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Estimated Current and Future Congenital Rubella. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] Histoire de la prophylaxie de la rubéole en France. 2024.Lien
- [10] Syndrome de rubéole congénitale, une série de cas. 2024.Lien
- [11] La lutte contre la rubéole en France: quelle (s) histoire (s)?. 2025.Lien
- [13] Quatrième réunion annuelle de la Commission régionale de suivi et de revérification de l'élimination de la rougeole et de la rubéole. 2025.Lien
- [14] Les Atteintes oculaires de la rubéole congénitale chez les enfants de 0 à 1 an Au CHU IOTA de Bamako. 2024.Lien
- [15] Myélite transverse aigue après vaccination Rubéole-Rougeole à Abidjan: A propos d'un cas.Lien
Publications scientifiques
- Histoire de la prophylaxie de la rubéole en France (2024)
- [HTML][HTML] Syndrome de rubéole congénitale, une série de cas (2024)
- La lutte contre la rubéole en France: quelle (s) histoire (s)? (2025)
- Granulomes cutanés induits par la rubéole vaccinale chez une patiente atteinte d'ataxie-télangiectasie (2023)
- Quatrième réunion annuelle de la Commission régionale de suivi et de revérification de l'élimination de la rougeole et de la rubéole. Du 4 au 6 novembre 2024 … (2025)[PDF]
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
