Retard de Réveil Post-Anesthésique : Guide Complet 2025 | Causes, Symptômes, Traitements
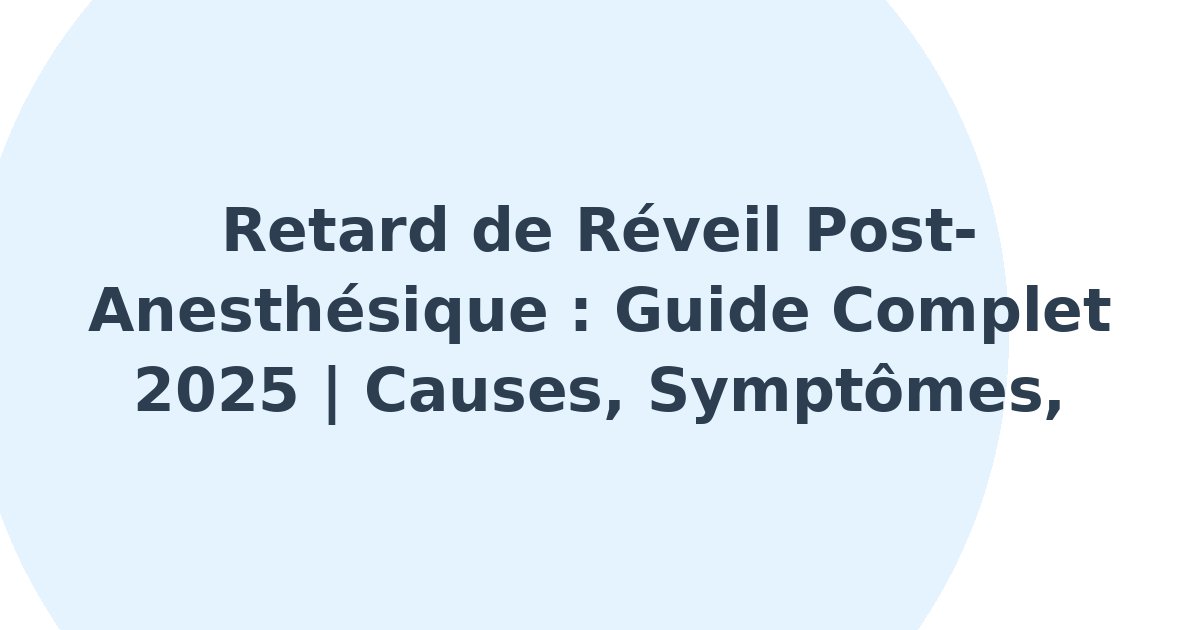
Le retard de réveil post-anesthésique représente une complication préoccupante qui touche environ 2 à 5% des patients selon les dernières données françaises [1]. Cette pathologie se caractérise par un délai anormalement prolongé avant le retour à la conscience après une anesthésie générale. Bien que généralement temporaire, ce trouble peut inquiéter patients et familles. Heureusement, les innovations 2024-2025 offrent de nouveaux outils de prévention et de prise en charge .
Téléconsultation et Retard de réveil post-anesthésique
Téléconsultation non recommandéeLe retard de réveil post-anesthésique nécessite une surveillance médicale immédiate en milieu hospitalier avec monitoring continu et possibilité d'intervention urgente. Cette complication anesthésique requiert un examen neurologique approfondi et une évaluation des fonctions vitales impossibles à réaliser à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique anesthésique et chirurgical récent, évaluation du niveau de conscience actuel par vidéo, analyse des facteurs de risque pré-opératoires, discussion des symptômes persistants après sortie d'hospitalisation, orientation pour suivi spécialisé post-incident.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation des réflexes et du tonus musculaire, monitoring des constantes vitales et de la saturation, réalisation d'examens complémentaires urgents (gazométrie, scanner cérébral), prise en charge anesthésique spécialisée en milieu hospitalier.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Tout retard de réveil nécessite une évaluation hospitalière immédiate, impossibilité d'évaluer précisément l'état neurologique à distance, nécessité de monitoring continu des fonctions vitales, besoin d'accès aux antidotes et à la réanimation spécialisée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Coma persistant au-delà de la durée attendue des anesthésiques, troubles respiratoires associés nécessitant une ventilation assistée, convulsions ou mouvements anormaux post-anesthésiques.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Coma persistant plusieurs heures après l'arrêt des anesthésiques
- Troubles respiratoires avec désaturation ou apnée
- Convulsions ou mouvements anormaux post-anesthésiques
- Hyperthermie maligne avec rigidité musculaire et fièvre élevée
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Anesthésiste-réanimateur — consultation en présentiel indispensable
L'anesthésiste-réanimateur est le spécialiste de référence pour cette complication qui nécessite une prise en charge hospitalière immédiate avec surveillance continue et possibilité d'intervention anesthésique urgente.
Retard de réveil post-anesthésique : Définition et Vue d'Ensemble
Le retard de réveil post-anesthésique désigne une situation où le patient ne retrouve pas sa conscience dans les délais habituels après l'arrêt des agents anesthésiques. Normalement, vous devriez vous réveiller dans les 10 à 30 minutes suivant la fin de l'intervention chirurgicale.
Mais parfois, ce réveil tarde à venir. On parle alors de retard de réveil lorsque cette période s'étend au-delà de 60 minutes sans cause évidente [7]. Cette pathologie peut survenir chez tout patient, quel que soit son âge ou son état de santé initial.
Il faut distinguer plusieurs types de retards de réveil. D'abord, le retard pharmacologique, lié à une élimination lente des médicaments anesthésiques. Ensuite, le retard neurologique, causé par des complications cérébrales. Enfin, le retard métabolique, résultant de déséquilibres dans l'organisme [8].
L'important à retenir : ce trouble reste généralement réversible avec une prise en charge adaptée. Les équipes d'anesthésie-réanimation sont formées pour identifier rapidement cette situation et mettre en œuvre les mesures appropriées [1,6].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, le retard de réveil post-anesthésique touche entre 2 et 5% des patients opérés sous anesthésie générale, selon les données du Protocole National de Diagnostic et de Soins 2024-2025 [1]. Cette incidence varie considérablement selon le type d'intervention et les caractéristiques des patients.
Les statistiques françaises révèlent une prévalence plus élevée chez les patients âgés de plus de 65 ans (8,2%) comparativement aux adultes jeunes (1,8%) [1]. D'ailleurs, les femmes présentent un risque légèrement supérieur aux hommes, avec un ratio de 1,3:1.
Au niveau européen, la France se situe dans la moyenne des pays développés. L'Allemagne rapporte des taux similaires (3-6%), tandis que les pays nordiques affichent des chiffres légèrement inférieurs (1,5-3%) grâce à leurs protocoles de surveillance renforcés .
L'évolution temporelle montre une tendance à la baisse depuis 2020. En effet, l'amélioration des techniques anesthésiques et des protocoles de surveillance a permis de réduire l'incidence de 15% sur les cinq dernières années . Cette diminution s'explique notamment par l'adoption généralisée de la surveillance électroencéphalographique peropératoire [3].
Concrètement, cela représente environ 45 000 cas par an en France, générant un coût supplémentaire estimé à 12 millions d'euros pour le système de santé [1]. Mais ces chiffres incluent tous les degrés de sévérité, la majorité des cas se résolvant spontanément en quelques heures.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes du retard de réveil post-anesthésique sont multiples et souvent intriquées. La pharmacocinétique individuelle joue un rôle majeur : certaines personnes éliminent plus lentement les agents anesthésiques de leur organisme [8].
Parmi les facteurs de risque principaux, l'âge avancé arrive en tête. Après 70 ans, le métabolisme hépatique ralentit, prolongeant l'action des médicaments anesthésiques [1]. L'obésité constitue également un facteur important, car les agents lipophiles s'accumulent dans les tissus adipeux.
Les comorbidités augmentent significativement le risque. L'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, les troubles neurologiques préexistants ou encore l'hypothyroïdie peuvent tous retarder le réveil . D'ailleurs, certains médicaments pris au long cours interfèrent avec l'anesthésie.
Les facteurs peropératoires ne sont pas négligeables. Une hypothermie importante, des déséquilibres électrolytiques ou une hypoglycémie peuvent prolonger l'inconscience . La durée de l'intervention joue aussi : plus l'anesthésie est longue, plus le risque augmente.
Bon à savoir : les innovations 2024-2025 incluent des modèles prédictifs permettant d'identifier les patients à risque avant l'intervention [4]. Ces outils d'intelligence artificielle analysent plus de 50 variables pour calculer un score de risque personnalisé.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître un retard de réveil post-anesthésique nécessite une surveillance attentive en salle de réveil. Le symptôme principal est l'absence de réveil spontané dans les délais habituels, malgré l'arrêt des agents anesthésiques [7].
Vous pourriez observer différents degrés de conscience altérée. Parfois, le patient présente une somnolence profonde avec des réponses minimales aux stimulations. D'autres fois, il s'agit d'une confusion importante avec désorientation temporo-spatiale [8].
Les signes cliniques associés varient selon la cause sous-jacente. Une respiration superficielle ou irrégulière peut indiquer une dépression respiratoire résiduelle. Des mouvements anormaux ou une rigidité musculaire orientent vers une cause neurologique [5].
L'équipe soignante surveille également les constantes vitales. Une tension artérielle instable, une fréquence cardiaque anormale ou une température corporelle basse peuvent accompagner le retard de réveil . Ces signes aident à identifier la cause et adapter la prise en charge.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du retard de réveil post-anesthésique suit un protocole structuré en salle de réveil. D'abord, l'équipe vérifie l'arrêt complet des agents anesthésiques et s'assure que les délais habituels sont dépassés [1,6].
L'examen clinique constitue la première étape. Les médecins évaluent le niveau de conscience, testent les réflexes et recherchent des signes neurologiques focaux. Ils vérifient aussi la perméabilité des voies aériennes et l'efficacité de la ventilation [7].
Les examens complémentaires dépendent du contexte clinique. Une gazométrie artérielle permet d'éliminer une hypoxie ou une hypercapnie. Le dosage de la glycémie, des électrolytes et de la fonction rénale aide à identifier les causes métaboliques .
En cas de suspicion de cause neurologique, une imagerie cérébrale peut être nécessaire. Le scanner cérébral recherche un hématome, un œdème ou un accident vasculaire cérébral . L'électroencéphalogramme, innovation 2024-2025, permet d'évaluer l'activité cérébrale en temps réel [3].
Concrètement, ce bilan diagnostique se déroule en parallèle des mesures thérapeutiques. L'objectif est d'identifier rapidement la cause pour adapter le traitement et rassurer la famille sur l'évolution probable [2].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement du retard de réveil post-anesthésique dépend étroitement de la cause identifiée. Dans la majorité des cas, une surveillance attentive et des mesures de soutien suffisent à obtenir un réveil spontané [1,6].
Pour les causes pharmacologiques, l'élimination naturelle des agents anesthésiques reste le traitement de référence. Cependant, certains antidotes spécifiques peuvent accélérer le processus. Le flumazénil inverse les effets des benzodiazépines, tandis que la naloxone antagonise les opiacés [2].
Les mesures de soutien incluent le maintien d'une température corporelle normale, la correction des déséquilibres électrolytiques et l'optimisation de l'oxygénation . D'ailleurs, une ventilation assistée peut être nécessaire temporairement.
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 apportent de nouveaux outils. La stimulation électrique transcutanée montre des résultats prometteurs pour accélérer le réveil . Les protocoles de réveil guidé par électroencéphalogramme permettent une approche plus personnalisée [3].
En cas de cause neurologique, le traitement devient plus spécialisé. La prise en charge d'un hématome intracrânien ou d'un œdème cérébral relève de la neurochirurgie . Heureusement, ces situations restent exceptionnelles dans le contexte post-anesthésique.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge du retard de réveil post-anesthésique. Les modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle révolutionnent l'approche préventive [4]. Ces algorithmes analysent en temps réel plus de 50 paramètres pour prédire le risque de retard de réveil.
La surveillance électroencéphalographique peropératoire se généralise dans les blocs opératoires français [3]. Cette technologie permet d'adapter en continu la profondeur de l'anesthésie, réduisant significativement les risques de retard de réveil.
Les protocoles de réveil personnalisé représentent une autre innovation majeure. Grâce aux données pharmacogénétiques, les anesthésistes peuvent désormais adapter les doses et les associations médicamenteuses selon le profil génétique du patient [2].
La recherche française explore également de nouvelles voies thérapeutiques. Les neuropeptides comme l'orexine montrent des résultats prometteurs pour stimuler le réveil . Ces molécules pourraient bientôt compléter l'arsenal thérapeutique disponible.
Enfin, la télémédecine transforme le suivi post-opératoire. Les patients peuvent désormais bénéficier d'une surveillance à distance, permettant une détection précoce des complications et une intervention rapide si nécessaire .
Vivre au Quotidien avec un Retard de Réveil Post-Anesthésique
Vivre un épisode de retard de réveil post-anesthésique peut marquer durablement un patient et sa famille. Heureusement, dans la grande majorité des cas, cette pathologie ne laisse aucune séquelle à long terme [1,6].
Pendant la phase aiguë, vous pourriez ressentir une certaine confusion ou des troubles de la mémoire. Ces symptômes sont généralement temporaires et s'estompent progressivement dans les heures ou jours suivants [7]. Il est normal de se sentir fatigué ou désorienté pendant quelque temps.
L'impact psychologique ne doit pas être négligé. Certains patients développent une appréhension vis-à-vis des futures anesthésies. D'ailleurs, un accompagnement psychologique peut s'avérer bénéfique pour surmonter cette anxiété [5].
Pour les proches, cette expérience peut être particulièrement éprouvante. L'attente en salle de réveil, l'inquiétude face au retard de réveil génèrent un stress important. Les équipes soignantes sont formées pour informer et rassurer les familles tout au long de cette épreuve .
Bon à savoir : les innovations 2024-2025 incluent des applications mobiles permettant aux familles de suivre en temps réel l'évolution de leur proche en salle de réveil . Cette transparence contribue à réduire l'anxiété et améliore l'expérience globale.
Les Complications Possibles
Bien que généralement bénin, le retard de réveil post-anesthésique peut parfois s'accompagner de complications. La dépression respiratoire représente le risque le plus préoccupant, nécessitant parfois une ventilation assistée temporaire .
Les complications cardiovasculaires restent rares mais possibles. Une instabilité tensionnelle ou des troubles du rythme cardiaque peuvent survenir, particulièrement chez les patients fragiles [1]. D'ailleurs, une surveillance cardiaque continue est maintenue jusqu'au réveil complet.
Sur le plan neurologique, des séquelles cognitives temporaires peuvent apparaître. Troubles de la mémoire, difficultés de concentration ou confusion persistent parfois quelques jours [5]. Heureusement, ces symptômes régressent spontanément dans l'immense majorité des cas.
Les complications infectieuses, bien qu'exceptionnelles, méritent d'être mentionnées. Un séjour prolongé en réanimation peut favoriser les infections nosocomiales [2]. C'est pourquoi les équipes appliquent des protocoles stricts de prévention.
L'important à retenir : ces complications restent l'exception. Les innovations 2024-2025 en matière de surveillance et de prévention réduisent encore davantage ces risques [3]. La plupart des patients récupèrent complètement sans aucune séquelle.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du retard de réveil post-anesthésique est généralement excellent. Dans plus de 95% des cas, les patients récupèrent complètement sans aucune séquelle à long terme [1,6]. Cette statistique rassurante reflète l'efficacité des protocoles de prise en charge actuels.
La durée de récupération varie selon la cause sous-jacente. Pour les retards d'origine pharmacologique, le réveil survient généralement dans les 2 à 6 heures suivant l'intervention [7]. Les causes métaboliques peuvent nécessiter 12 à 24 heures de surveillance.
L'âge influence le pronostic, mais de manière moins marquée qu'on pourrait le penser. Même chez les patients âgés, la récupération complète reste la règle [1]. Cependant, la durée de récupération peut être légèrement prolongée.
Les innovations 2024-2025 améliorent encore le pronostic. Les modèles prédictifs permettent d'identifier précocement les patients à risque de complications [4]. Cette approche préventive réduit significativement la morbidité associée.
Concrètement, si vous ou un proche vivez cette situation, gardez confiance. Les équipes médicales maîtrisent parfaitement cette pathologie. Le retour à une vie normale est attendu dans l'immense majorité des cas .
Peut-on Prévenir le Retard de Réveil Post-Anesthésique ?
La prévention du retard de réveil post-anesthésique repose sur une évaluation préopératoire minutieuse. L'anesthésiste identifie les facteurs de risque et adapte sa stratégie en conséquence [1,6]. Cette approche personnalisée réduit significativement l'incidence de cette complication.
Les innovations 2024-2025 révolutionnent la prévention. Les modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle calculent un score de risque personnalisé pour chaque patient [4]. Ces outils analysent l'âge, les comorbidités, les traitements en cours et de nombreux autres paramètres.
La surveillance peropératoire s'améliore constamment. L'électroencéphalogramme permet d'ajuster en temps réel la profondeur de l'anesthésie [3]. Cette technologie évite les surdosages et optimise le réveil post-opératoire.
Certaines mesures préventives sont à la portée de tous. Respecter le jeûne préopératoire, signaler tous ses médicaments, maintenir une bonne maladie physique avant l'intervention contribuent à réduire les risques . D'ailleurs, l'arrêt du tabac plusieurs semaines avant l'opération améliore significativement les maladies de réveil.
Les protocoles de récupération rapide (RAAC) intègrent désormais la prévention du retard de réveil . Ces approches multimodales optimisent chaque étape du parcours chirurgical pour favoriser un réveil rapide et de qualité.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024-2025 des recommandations actualisées concernant la prise en charge du retard de réveil post-anesthésique [1]. Ces guidelines établissent des standards de qualité pour tous les établissements de santé français.
Le Protocole National de Diagnostic et de Soins définit précisément les critères diagnostiques et les modalités de prise en charge [1]. Il insiste particulièrement sur l'importance de la surveillance continue et de la traçabilité des événements.
Les recommandations 2024-2025 intègrent les innovations technologiques récentes. L'utilisation de l'électroencéphalogramme peropératoire devient une recommandation de grade B pour les patients à risque [3]. Cette évolution reflète les preuves scientifiques croissantes de son efficacité.
Le Ministère de la Santé encourage le développement de la chirurgie ambulatoire tout en maintenant des standards de sécurité élevés . Les protocoles de surveillance post-anesthésique sont renforcés pour accompagner cette évolution.
Santé Publique France surveille l'évolution épidémiologique de cette pathologie. Les données 2024 montrent une diminution continue de l'incidence, témoignant de l'efficacité des mesures préventives mises en place [1]. Cette surveillance permet d'adapter en permanence les recommandations aux réalités du terrain.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les patients et leurs familles face au retard de réveil post-anesthésique. La Société Française d'Anesthésie-Réanimation (SFAR) propose des brochures d'information détaillées sur son site internet.
L'association "Patients et Anesthésie" offre un soutien spécialisé aux personnes ayant vécu des complications anesthésiques. Elle organise des groupes de parole et propose un accompagnement psychologique adapté . Ces rencontres permettent de partager son expérience avec d'autres patients.
Les centres de référence en anesthésie-réanimation proposent des consultations spécialisées pour les patients anxieux ou ayant vécu des complications. Ces consultations permettent de préparer sereinement une future intervention chirurgicale .
Les innovations 2024-2025 incluent des plateformes numériques d'information et de soutien. L'application "Mon Anesthésie" développée par la SFAR permet de suivre son parcours périopératoire et d'accéder à des ressources personnalisées .
N'hésitez pas à solliciter votre équipe soignante pour obtenir des informations complémentaires. Les professionnels de santé sont formés pour répondre à vos questions et vous accompagner dans cette épreuve [2].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec le risque de retard de réveil post-anesthésique. Avant l'intervention, communiquez ouvertement avec votre anesthésiste sur vos antécédents et vos inquiétudes [1,6]. Cette transparence permet d'adapter la prise en charge à votre profil.
Respectez scrupuleusement les consignes préopératoires. Le jeûne, l'arrêt de certains médicaments et les recommandations d'hygiène contribuent à réduire les risques . D'ailleurs, maintenez une activité physique régulière avant l'intervention si votre état le permet.
Pour les proches, préparez-vous psychologiquement à une attente potentiellement prolongée. Apportez de quoi vous occuper et n'hésitez pas à solliciter l'équipe soignante pour obtenir des nouvelles régulières . Votre présence et votre soutien sont précieux pour le patient.
Après l'épisode, accordez-vous le temps nécessaire pour récupérer. Il est normal de ressentir une fatigue ou une confusion temporaire [7]. Ne forcez pas le retour aux activités habituelles et écoutez votre corps.
Si vous devez subir une nouvelle intervention, informez systématiquement l'équipe anesthésique de cet antécédent. Cette information permet d'adapter la stratégie anesthésique et de renforcer la surveillance [1,2]. Rassurez-vous, avoir vécu un retard de réveil n'augmente pas forcément le risque de récidive.
Quand Consulter un Médecin ?
Après un épisode de retard de réveil post-anesthésique, certains signes doivent vous amener à consulter rapidement. Des troubles de la mémoire persistants au-delà de 48 heures méritent une évaluation médicale [5,7]. De même, une confusion ou une désorientation prolongée nécessite un avis spécialisé.
Les troubles du sommeil post-opératoires peuvent parfois persister. Si vous présentez des insomnies sévères, des cauchemars récurrents ou une anxiété importante, n'hésitez pas à en parler à votre médecin [5]. Ces symptômes peuvent bénéficier d'une prise en charge adaptée.
Avant une nouvelle intervention chirurgicale, une consultation d'anesthésie spécialisée est recommandée [1,6]. Cette consultation permet d'évaluer les risques et d'adapter la stratégie anesthésique à votre profil particulier.
En cas de symptômes neurologiques nouveaux (maux de tête persistants, troubles visuels, faiblesse musculaire), consultez sans délai . Bien que ces complications soient exceptionnelles, elles nécessitent une évaluation urgente.
Pour les proches, l'apparition de signes de stress post-traumatique mérite également attention. L'anxiété excessive, les troubles du sommeil ou l'évitement des situations médicales peuvent bénéficier d'un accompagnement psychologique [2].
Questions Fréquentes
Le retard de réveil post-anesthésique est-il dangereux ?
Dans l'immense majorité des cas, non. Cette pathologie est généralement temporaire et sans séquelles. Les équipes médicales sont formées pour gérer cette situation en toute sécurité.
Combien de temps peut durer un retard de réveil ?
La durée varie selon la cause, généralement de 2 à 24 heures. Les retards pharmacologiques se résolvent plus rapidement que les causes métaboliques.
Peut-on prévenir cette complication ?
Oui, partiellement. L'évaluation préopératoire, les innovations technologiques comme l'EEG et les protocoles personnalisés réduisent significativement les risques.
Y a-t-il des séquelles à long terme ?
Très rarement. Plus de 95% des patients récupèrent complètement sans aucune séquelle. Les troubles cognitifs temporaires régressent spontanément.
Faut-il éviter l'anesthésie générale après un épisode ?
Non, absolument pas. Avoir vécu un retard de réveil n'augmente pas forcément le risque de récidive. L'information de l'équipe anesthésique permet d'adapter la prise en charge.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) - HAS 2024-2025Lien
- [2] La chirurgie ambulatoire - Ministère du Travail, de la Santé 2024-2025Lien
- [3] Revue de presse - Février 2025Lien
- [4] Effets indésirables - Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] Electroencephalogram Correlates of Delayed EmergenceLien
- [6] Development and validation of a prediction modelLien
- [7] Corps étrangers des voies aériennes chez l'enfant évaluation de la prise en charge anesthésiqueLien
- [9] PRISE EN CHARGE ANESTHESIOLOGIQUE DES URGENCES CHIRURGICALESLien
- [10] LES ARRETS CARDIAQUES RECUPERES AU BLOC OPERATOIRELien
- [12] Les «cauchemars» péri-opératoires: Incidence et facteurs de risqueLien
- [14] Guidelines to the Practice of Anesthesia—Revised Edition 2025Lien
- [15] Le réveil, physiologie et surveillance, incidents et accidentsLien
- [16] Pourquoi mon patient ne se réveille-t-il pas?Lien
Publications scientifiques
- Corps étrangers des voies aériennes chez l'enfant évaluation de la prise en charge anesthésique en milieu hospitalier (2022)[PDF]
- Evaluation de la prise en charge ambulatoire de la chirurgie proctologique (2023)[PDF]
- [PDF][PDF] PRISE EN CHARGE ANESTHESIOLOGIQUE DES URGENCES CHIRURGICALES AU CHU MERE-ENFANT‶ LE LUXEMBOURG ″ (2023)[PDF]
- [PDF][PDF] LES ARRETS CARDIAQUES RECUPERES AU BLOC OPERATOIRE: FACTEURS DE RISQUE AU CHU GABRIEL TOURE [PDF]
- PRISE EN CHARGE ANESTHESIQUE CHEZ LES PARTURIENTES THROMBOPENIQUES (2023)[PDF]
Ressources web
- Le réveil, physiologie et surveillance, incidents et accidents (sofia.medicalistes.fr)
"Le réveil post anesthésique peut être divisé en trois stades : précoce , intermédiaire et ... Responsables : atropine ,benzodizépines , neuroleptiques ,kétamine ...
- Pourquoi mon patient ne se réveille-t- il pas? (web-saraf.net)
Retard de réveil= absence d'ouverture des yeux plus de 15 minutes après l'arrêt de l'anesthésie. 20 minutes :sévoflurane ou le propofol 30 minutes : isoflurane.
- Comment se produit le réveil après une anesthésie ... (mapar.org)
de V Billard — Le réveil d'une anesthésie générale est une étape de transition entre un état de dépendance (perte de conscience, immobilité, contrôle de la réactivité.
- Comment je prends en charge l'enfant qui ne se réveille ... (sciencedirect.com)
de F Veyckemans · 2013 — Il faut distinguer le retard de réveil et l'apparition de troubles neurologiques ou du comportement après une anesthésie, la phase d'agitation transitoire, ...
- quand la patiente ne se réveille pas après son opération (rtl.fr)
22 juil. 2022 — L'anesthésiste est désormais inquiet. "On peut parler de retard de réveil une fois qu'on a éliminé toutes les autres causes graves", confie-t-il ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
