Choc (Shock) : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements et Innovations
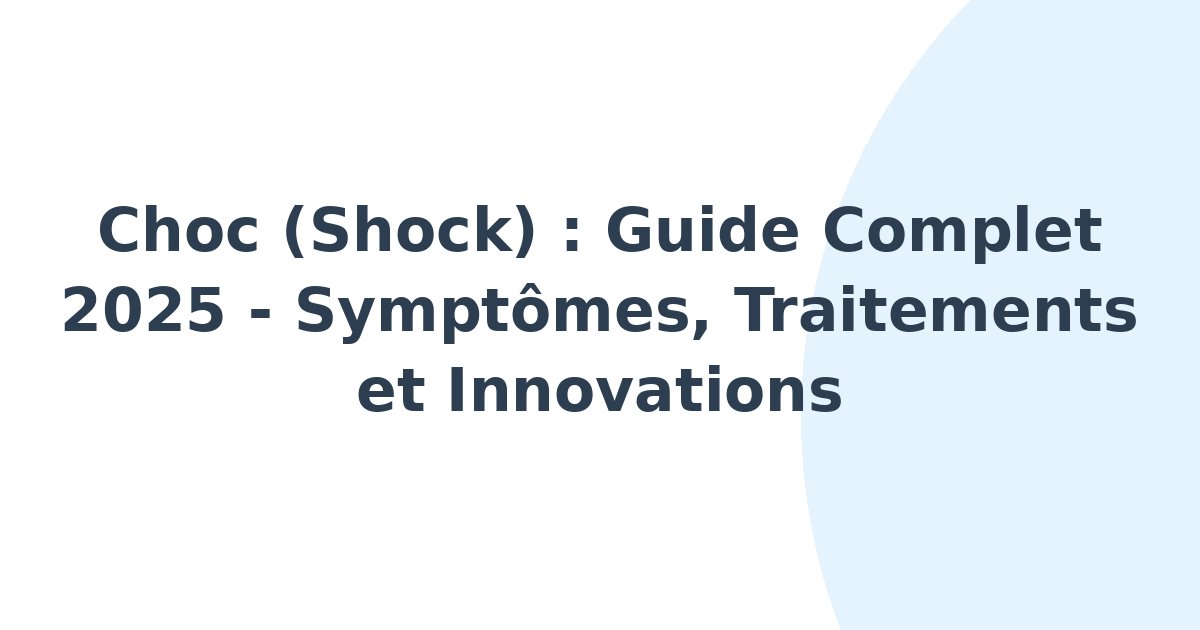
Le choc médical représente une urgence vitale absolue qui touche des milliers de personnes chaque année en France. Cette pathologie complexe, caractérisée par une défaillance circulatoire aiguë, nécessite une prise en charge immédiate et spécialisée. Comprendre ses mécanismes, reconnaître ses signes et connaître les traitements disponibles peut littéralement sauver des vies.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Choc : Définition et Vue d'Ensemble
Le choc médical correspond à un état pathologique grave où l'organisme ne parvient plus à maintenir une perfusion tissulaire adéquate [19,20]. Concrètement, vos organes vitaux ne reçoivent plus suffisamment d'oxygène et de nutriments pour fonctionner normalement.
Cette pathologie se caractérise par une chute brutale de la pression artérielle, associée à des signes de défaillance circulatoire. Mais attention, le choc ne se résume pas à une simple baisse de tension ! Il s'agit d'un véritable cercle vicieux où la diminution du débit cardiaque entraîne une hypoperfusion des organes, qui elle-même aggrave l'état général du patient [21].
D'ailleurs, il existe plusieurs types de choc selon leur mécanisme : le choc cardiogénique (problème de pompe cardiaque), le choc hypovolémique (perte de volume sanguin), le choc distributif (problème de distribution du sang) et le choc obstructif (obstacle à la circulation). Chaque forme nécessite une approche thérapeutique spécifique, ce qui rend le diagnostic différentiel crucial.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes de Santé Publique France révèlent une réalité préoccupante concernant les états de choc en France [1,2]. L'incidence annuelle des chocs cardiogéniques atteint environ 50 000 cas par an, avec une mortalité hospitalière qui reste élevée malgré les progrès thérapeutiques.
En effet, les statistiques 2024-2025 montrent que le choc cardiogénique complique 5 à 10% des infarctus du myocarde, représentant la première cause de décès dans cette pathologie [1,4]. La mortalité à 30 jours oscille entre 40 et 60% selon les centres, malgré l'amélioration des techniques de revascularisation et de support circulatoire.
Concernant les autres formes de choc, les données du programme de surveillance des maladies révèlent des variations régionales significatives [3]. Les régions avec une densité hospitalière plus faible présentent des taux de mortalité supérieurs, soulignant l'importance de l'accessibilité aux soins spécialisés. D'un autre côté, l'âge moyen des patients en choc cardiogénique a augmenté de 5 ans en une décennie, reflétant le vieillissement de la population et l'amélioration de la prise en charge des pathologies cardiovasculaires chroniques.
Il est intéressant de noter que les recommandations sanitaires aux voyageurs intègrent désormais des conseils spécifiques pour les patients à risque de choc, notamment en cas de pathologies cardiovasculaires préexistantes [5]. Cette évolution témoigne de la prise de conscience croissante de cette problématique de santé publique.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes du choc médical sont multiples et varient selon le type de choc rencontré. Le choc cardiogénique résulte principalement d'un infarctus du myocarde massif, mais peut aussi être causé par une myocardite fulminante, une rupture de cordage mitral ou une embolie pulmonaire massive [19].
Le choc hypovolémique trouve son origine dans une perte importante de volume sanguin. Hémorragies digestives, traumatismes graves, déshydratation sévère ou pertes plasmatiques importantes constituent les principales étiologies. Chez les personnes âgées, une simple gastro-entérite peut parfois déclencher un choc hypovolémique si elle n'est pas prise en charge rapidement.
Quant au choc distributif, il englobe principalement le choc septique (infection généralisée), le choc anaphylactique (réaction allergique sévère) et le choc neurogène (lésion médullaire haute). Le choc septique représente la forme la plus fréquente, avec une incidence croissante liée au vieillissement de la population et à l'augmentation des gestes invasifs [21].
Certains facteurs de risque augmentent la probabilité de développer un choc. L'âge avancé, les antécédents cardiovasculaires, le diabète, l'insuffisance rénale chronique et l'immunodépression constituent les principaux facteurs prédisposants. Il faut savoir que la prise de certains médicaments (bêtabloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peut masquer les signes précoces de choc ou en aggraver l'évolution.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les signes de choc peut sauver une vie. Les symptômes varient selon le type et la sévérité, mais certains signes d'alarme doivent vous alerter immédiatement [20,21].
Les signes cardiovasculaires constituent les premiers indicateurs : pouls rapide et filant, chute de la tension artérielle, extrémités froides et marbrures cutanées. Vous pourriez observer une pâleur intense, des sueurs froides et un temps de recoloration cutanée allongé (plus de 3 secondes après pression sur l'ongle).
Les signes neurologiques apparaissent rapidement : confusion, agitation, somnolence progressive pouvant évoluer vers le coma. La personne peut sembler désorientée, avoir des difficultés à parler ou présenter des troubles de la conscience. Ces symptômes reflètent la diminution de l'oxygénation cérébrale.
D'autres signes peuvent accompagner le tableau clinique : diminution de la production d'urine (oligurie), essoufflement, douleurs thoraciques ou abdominales selon la cause. Dans le choc septique, la fièvre peut être présente, mais attention, elle peut aussi être absente chez les personnes âgées ou immunodéprimées.
Bon à savoir : les signes de choc peuvent être trompeurs au début. Une tension artérielle encore normale n'exclut pas un état de choc débutant, surtout chez les patients hypertendus habituels. C'est pourquoi l'évaluation globale du patient reste primordiale.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de choc repose sur une évaluation clinique rapide et des examens complémentaires ciblés. Chaque minute compte dans cette course contre la montre [19,20].
L'examen clinique constitue la première étape cruciale. Le médecin évalue les constantes vitales (tension artérielle, fréquence cardiaque, température, saturation en oxygène), recherche les signes de choc décrits précédemment et tente d'identifier la cause sous-jacente. L'interrogatoire, quand il est possible, permet de préciser les circonstances de survenue et les antécédents du patient.
Les examens biologiques sont réalisés en urgence : numération formule sanguine, ionogramme, fonction rénale, bilan hépatique, gaz du sang artériel et lactates sériques. Ces derniers constituent un marqueur pronostic important : un taux de lactates élevé témoigne d'une hypoperfusion tissulaire sévère. D'ailleurs, la clairance des lactates sous traitement constitue un excellent indicateur de l'efficacité thérapeutique.
L'échocardiographie représente un examen clé, réalisable au lit du patient. Elle permet d'évaluer la fonction cardiaque, de rechercher des anomalies valvulaires, un épanchement péricardique ou des signes d'embolie pulmonaire. Cet examen guide souvent le choix thérapeutique initial.
Selon le contexte, d'autres examens peuvent être nécessaires : radiographie thoracique, scanner thoraco-abdomino-pelvien, hémocultures en cas de suspicion d'infection. L'important est de ne pas retarder la prise en charge thérapeutique pour des examens non indispensables à la décision immédiate.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement du choc nécessite une approche multidisciplinaire en unité de soins intensifs. Les stratégies thérapeutiques varient selon le type de choc, mais certains principes généraux s'appliquent [20,21].
Le remplissage vasculaire constitue souvent la première mesure thérapeutique. L'administration de solutés cristalloïdes ou colloïdes vise à restaurer la volémie et améliorer le retour veineux. Cependant, ce remplissage doit être prudent et guidé par l'échocardiographie pour éviter l'œdème pulmonaire, particulièrement dans le choc cardiogénique.
Les médicaments vasoactifs représentent un pilier du traitement. La noradrénaline reste le vasopresseur de première intention dans la plupart des situations. Elle permet de restaurer une pression artérielle suffisante pour maintenir la perfusion des organes vitaux. D'autres molécules comme l'adrénaline, la dobutamine ou la vasopressine peuvent être utilisées selon le contexte.
Dans le choc cardiogénique sévère, les dispositifs d'assistance circulatoire peuvent être nécessaires. La contre-pulsion par ballon intra-aortique, l'ECMO (oxygénation extracorporelle) ou les pompes centrifuges permettent de suppléer temporairement la fonction cardiaque défaillante. Ces techniques, de plus en plus utilisées, améliorent significativement le pronostic des patients les plus graves.
Le traitement étiologique reste fondamental : revascularisation coronaire en urgence pour l'infarctus, antibiothérapie pour le choc septique, chirurgie d'hémostase pour les hémorragies. Sans traitement de la cause, les mesures symptomatiques restent insuffisantes.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2025 marque un tournant dans la prise en charge du choc avec plusieurs innovations prometteuses. Les recherches actuelles se concentrent sur l'amélioration du pronostic et la réduction de la mortalité [9,10].
L'étude SEISMiC C, initiée par Windtree Therapeutics, évalue l'istaroxime dans le choc cardiogénique de stade C selon la classification SCAI [9]. Ce médicament innovant combine des propriétés inotropes positives et lusitropes, permettant d'améliorer la contractilité cardiaque tout en facilitant la relaxation ventriculaire. Les résultats préliminaires sont encourageants et pourraient révolutionner la prise en charge du choc cardiogénique.
Les nouvelles approches thérapeutiques bénéficient également des avancées technologiques [6,7]. L'intelligence artificielle commence à être intégrée dans les protocoles de soins, permettant une personnalisation du traitement basée sur les caractéristiques individuelles du patient. Ces outils d'aide à la décision pourraient améliorer significativement les délais de prise en charge et l'efficacité thérapeutique.
Concernant l'optimisation des essais cliniques, de nouvelles méthodologies sont développées pour accélérer l'évaluation des traitements [10]. Ces approches innovantes permettent d'obtenir des résultats plus rapidement tout en maintenant la rigueur scientifique nécessaire. L'objectif est de raccourcir le délai entre la découverte d'un traitement prometteur et son utilisation clinique.
Les propositions du PLFSS 2025 incluent des mesures spécifiques pour garantir l'accès aux innovations thérapeutiques [7,8]. Ces dispositions visent à faciliter l'accès précoce aux traitements innovants pour les patients en situation critique, tout en maîtrisant les coûts pour le système de santé.
Vivre au Quotidien avec les Séquelles de Choc
Survivre à un épisode de choc représente souvent le début d'un nouveau chapitre de vie. Les séquelles peuvent être multiples et nécessitent un accompagnement spécialisé à long terme [21].
Les séquelles cardiovasculaires constituent la principale préoccupation. Une insuffisance cardiaque peut persister après un choc cardiogénique, nécessitant un traitement médicamenteux optimal et un suivi cardiologique régulier. Certains patients peuvent bénéficier de dispositifs implantables comme les défibrillateurs ou les resynchronisateurs cardiaques.
Les séquelles neurologiques résultent de l'hypoxie cérébrale subie pendant l'épisode aigu. Troubles de la mémoire, difficultés de concentration, changements de personnalité peuvent impacter significativement la qualité de vie. Une rééducation neuropsychologique peut être nécessaire, accompagnée d'un soutien psychologique pour le patient et sa famille.
D'un point de vue pratique, l'adaptation du domicile peut s'avérer nécessaire. Installation d'équipements de sécurité, aménagement pour faciliter les déplacements, mise en place d'un système d'alerte en cas de problème. L'ergothérapeute joue un rôle clé dans cette adaptation.
Le retour à l'activité professionnelle nécessite souvent une approche progressive. Temps partiel thérapeutique, aménagement du poste de travail, reconversion professionnelle parfois. La médecine du travail accompagne cette démarche en collaboration avec l'équipe soignante. Il est important de ne pas précipiter ce retour et de respecter le rythme de récupération de chacun.
Les Complications Possibles
Les complications du choc peuvent survenir pendant la phase aiguë ou à distance de l'épisode initial. Leur prévention et leur prise en charge maladienent largement le pronostic [20,21].
Les complications cardiovasculaires dominent le tableau. L'insuffisance cardiaque aiguë peut nécessiter une assistance circulatoire temporaire ou définitive. Les troubles du rythme, fréquents dans ce contexte, peuvent mettre en jeu le pronostic vital et nécessiter une surveillance continue en unité spécialisée.
L'insuffisance rénale aiguë complique fréquemment les états de choc. Elle résulte de l'hypoperfusion rénale prolongée et peut nécessiter une épuration extrarénale temporaire. Dans certains cas, des séquelles rénales définitives peuvent persister, nécessitant un suivi néphrologique à long terme.
Les complications neurologiques sont particulièrement redoutées. L'encéphalopathie anoxique peut laisser des séquelles cognitives importantes, allant de troubles mnésiques discrets à un état végétatif persistant dans les cas les plus sévères. La neuropathie de réanimation, liée à l'immobilisation prolongée et aux traitements, peut retarder significativement la récupération.
D'autres complications peuvent survenir : infections nosocomiales favorisées par l'immunodépression et les gestes invasifs, complications thromboemboliques liées à l'alitement prolongé, escarres chez les patients inconscients. La prévention de ces complications fait partie intégrante de la prise en charge en réanimation.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du choc dépend de nombreux facteurs : type de choc, rapidité de prise en charge, âge du patient, comorbidités associées et réponse au traitement initial [19,20].
La mortalité hospitalière reste élevée malgré les progrès thérapeutiques. Elle varie de 20% pour les chocs hypovolémiques pris en charge précocement à plus de 60% pour les chocs cardiogéniques sévères. Le choc septique présente une mortalité intermédiaire, autour de 30-40%, mais qui peut atteindre 80% en cas de choc septique réfractaire.
Plusieurs facteurs pronostiques ont été identifiés. L'âge avancé, la présence de comorbidités multiples, un délai de prise en charge prolongé et la nécessité de recourir à des doses élevées de vasopresseurs constituent des facteurs de mauvais pronostic. À l'inverse, une réponse rapide au remplissage vasculaire et la normalisation précoce des lactates sont de bon augure.
Pour les survivants, le pronostic à long terme dépend largement des séquelles laissées par l'épisode aigu. Une récupération complète est possible, particulièrement chez les patients jeunes sans comorbidités. Cependant, beaucoup gardent des séquelles fonctionnelles nécessitant une adaptation du mode de vie.
Il est important de souligner que les scores pronostiques, bien qu'utiles pour guider les décisions thérapeutiques, ne peuvent prédire avec certitude l'évolution individuelle. Chaque patient est unique, et des récupérations surprenantes sont parfois observées même dans les situations les plus critiques.
Peut-on Prévenir le Choc ?
La prévention du choc repose sur l'identification et la prise en charge des facteurs de risque, ainsi que sur la reconnaissance précoce des signes d'alarme [5,21].
La prévention primaire vise à réduire le risque de survenue des pathologies pouvant conduire au choc. Contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire (hypertension, diabète, dyslipidémie, tabagisme), vaccination contre les infections, prévention des accidents domestiques et de la route constituent les mesures de base. Les recommandations sanitaires aux voyageurs intègrent désormais ces aspects préventifs [5].
La prévention secondaire concerne les patients à risque élevé. Suivi cardiologique régulier pour les patients coronariens, surveillance biologique des patients sous chimiothérapie, éducation des patients diabétiques sur la prévention des complications aiguës. L'objectif est de détecter précocement les signes de décompensation.
L'éducation du patient et de l'entourage joue un rôle crucial. Reconnaître les signes d'alarme, savoir quand consulter en urgence, connaître les gestes de premiers secours peuvent faire la différence. Les associations de patients organisent régulièrement des sessions d'information sur ces sujets.
Dans le milieu hospitalier, la prévention du choc iatrogène fait l'objet d'une attention particulière. Surveillance rapprochée des patients à risque, protocoles de prévention des infections nosocomiales, formation du personnel aux signes précoces de choc constituent des mesures essentielles. Les équipes mobiles d'urgence intra-hospitalière permettent une intervention rapide dès les premiers signes de détérioration clinique.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont émis des recommandations précises concernant la prise en charge du choc, régulièrement mises à jour selon les dernières données scientifiques [1,2,3].
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une approche standardisée de la prise en charge du choc. Les protocoles recommandés insistent sur la rapidité d'intervention, l'évaluation hémodynamique précoce et l'adaptation thérapeutique selon la réponse clinique. Ces recommandations sont régulièrement actualisées pour intégrer les innovations thérapeutiques validées.
Santé Publique France a développé un programme de surveillance spécifique des états de choc [3]. Ce programme permet de suivre l'évolution épidémiologique, d'identifier les facteurs de risque émergents et d'évaluer l'efficacité des mesures préventives. Les données collectées alimentent les recommandations nationales et internationales.
Les recommandations pour les voyageurs ont été renforcées, particulièrement pour les patients à risque cardiovasculaire élevé [5]. Ces mesures incluent des conseils sur l'adaptation des traitements, la reconnaissance des signes d'alarme et les conduites à tenir en cas d'urgence à l'étranger.
Au niveau européen, la France participe activement aux groupes de travail sur l'harmonisation des pratiques. L'objectif est de garantir une qualité de soins homogène sur l'ensemble du territoire européen, particulièrement importante pour les patients en déplacement. Ces collaborations permettent également de mutualiser les coûts de recherche et développement des nouvelles thérapeutiques.
Ressources et Associations de Patients
De nombreuses ressources sont disponibles pour accompagner les patients et leurs familles dans cette épreuve. Ces structures offrent soutien, information et entraide [21].
Les associations de patients jouent un rôle fondamental dans l'accompagnement. Elles proposent des groupes de parole, des sessions d'information, des activités de réadaptation et un soutien psychologique. Ces associations organisent également des événements pour sensibiliser le grand public et collecter des fonds pour la recherche.
Les centres de rééducation cardiaque constituent une ressource essentielle pour les survivants de choc cardiogénique. Ces structures spécialisées proposent un programme complet incluant réentraînement à l'effort, éducation thérapeutique, soutien psychologique et accompagnement social. La participation à ces programmes améliore significativement le pronostic à long terme.
Les plateformes d'information en ligne offrent des ressources fiables et actualisées. Sites institutionnels, forums modérés par des professionnels de santé, applications mobiles d'aide au suivi constituent autant d'outils utiles. Attention cependant à vérifier la fiabilité des sources et à ne pas remplacer l'avis médical par l'information trouvée sur internet.
Les services sociaux hospitaliers accompagnent les patients dans leurs démarches administratives. Reconnaissance de handicap, aménagement du poste de travail, aides financières, ces professionnels connaissent les dispositifs disponibles et facilitent les démarches souvent complexes.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations pratiques pour mieux vivre avec les séquelles de choc ou pour prévenir sa survenue chez les personnes à risque.
Pour la prévention : Adoptez une hygiène de vie saine avec une alimentation équilibrée, une activité physique régulière adaptée à vos capacités, et l'arrêt du tabac. Respectez scrupuleusement vos traitements médicamenteux et n'hésitez pas à poser des questions à votre médecin en cas de doute.
Reconnaître les signes d'alarme : Douleur thoracique intense, essoufflement soudain, malaise avec sueurs froides, confusion inexpliquée doivent vous amener à consulter immédiatement. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent, appelez le 15 sans hésiter.
Pour les survivants : Respectez les phases de récupération, ne forcez pas le rythme. Entourez-vous de votre famille et de vos amis, leur soutien est précieux. Participez aux programmes de rééducation proposés, ils améliorent réellement la qualité de vie à long terme.
Organisation du quotidien : Préparez une trousse d'urgence avec vos médicaments et les coordonnées de vos médecins. Informez votre entourage de votre pathologie et des gestes à effectuer en cas de problème. Aménagez votre domicile pour éviter les chutes et faciliter vos déplacements.
Quand Consulter un Médecin ?
Certaines situations nécessitent une consultation médicale immédiate, d'autres peuvent attendre un rendez-vous programmé. Savoir faire la différence peut sauver une vie [19,21].
Consultez immédiatement (appelez le 15) : Douleur thoracique intense et prolongée, essoufflement soudain et important, malaise avec perte de connaissance, confusion brutale, fièvre élevée avec frissons chez une personne fragile, saignement important non contrôlable.
Consultez dans les 24 heures : Fatigue inhabituelle et progressive, essoufflement à l'effort inhabituel, palpitations répétées, œdèmes des membres inférieurs qui s'aggravent, diminution importante de la quantité d'urines.
Consultez dans la semaine : Modification de votre état général, questions sur vos traitements, besoin d'adaptation de votre suivi médical, difficultés psychologiques liées à votre pathologie.
Pour les patients à risque élevé, n'hésitez jamais à contacter votre médecin en cas de doute. Il vaut mieux une consultation "pour rien" qu'un retard de prise en charge aux conséquences dramatiques. Votre médecin traitant connaît votre dossier et peut vous orienter rapidement vers les spécialistes appropriés si nécessaire.
Gardez toujours sur vous les coordonnées de vos médecins et la liste de vos médicaments. En cas d'urgence, ces informations peuvent être vitales pour les équipes de secours.
Questions Fréquentes
Le choc est-il toujours mortel ?Non, heureusement ! Bien que le pronostic reste sérieux, de nombreux patients survivent et récupèrent une qualité de vie satisfaisante. La rapidité de prise en charge et les progrès thérapeutiques améliorent constamment les chances de survie.
Peut-on faire plusieurs épisodes de choc ?
Malheureusement oui, particulièrement chez les patients avec des pathologies chroniques. C'est pourquoi le suivi médical régulier et la prévention sont si importants après un premier épisode.
Les séquelles sont-elles toujours définitives ?
Pas nécessairement. Certaines séquelles peuvent s'améliorer avec le temps et la rééducation. La récupération peut se poursuivre pendant plusieurs mois, voire années après l'épisode aigu.
Peut-on reprendre une activité physique normale ?
Cela dépend des séquelles laissées par l'épisode. Beaucoup de patients peuvent reprendre une activité physique adaptée, souvent après un programme de rééducation. L'important est de respecter les recommandations médicales et de progresser graduellement.
Comment expliquer sa pathologie à son entourage ?
Soyez honnête sur vos limitations tout en restant positif sur vos capacités. Expliquez les signes d'alarme à surveiller et les gestes à effectuer en cas de problème. Votre entourage sera rassuré de savoir comment vous aider.
Questions Fréquentes
Le choc est-il toujours mortel ?
Non, heureusement ! Bien que le pronostic reste sérieux, de nombreux patients survivent et récupèrent une qualité de vie satisfaisante. La rapidité de prise en charge et les progrès thérapeutiques améliorent constamment les chances de survie.
Peut-on faire plusieurs épisodes de choc ?
Malheureusement oui, particulièrement chez les patients avec des pathologies chroniques. C'est pourquoi le suivi médical régulier et la prévention sont si importants après un premier épisode.
Les séquelles sont-elles toujours définitives ?
Pas nécessairement. Certaines séquelles peuvent s'améliorer avec le temps et la rééducation. La récupération peut se poursuivre pendant plusieurs mois, voire années après l'épisode aigu.
Peut-on reprendre une activité physique normale ?
Cela dépend des séquelles laissées par l'épisode. Beaucoup de patients peuvent reprendre une activité physique adaptée, souvent après un programme de rééducation.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémiologie des cardiopathies ischémiques en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] DESCRIPTION DES PERSONNES ÉCROUÉES .... Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Programme de surveillance des maladies à caractère .... Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [4] Épidémiologie des cardiopathies ischémiques en France. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [5] RECOMMANDATIONS SANITAIRES AUX VOYAGEURS. sante.gouv.fr. 2024-2025.Lien
- [6] Thyroïdite de Hashimoto : les nouveaux traitements en 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] PLFSS 2025 : Les propositions des entreprises du .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] « TROP OU PAS ASSEZ CHERS : LE PRIX DES ME .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] Windtree Therapeutics Initiates SEISMiC C Study of .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [10] Optimising trial design for cardiogenic shock: insights from .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [19] Choc - Troubles cardiaques et vasculaires. www.msdmanuals.com.Lien
- [20] Choc - Réanimation - Édition professionnelle du Manuel .... www.msdmanuals.com.Lien
- [21] État de choc | Guides médicaux MSF. medicalguidelines.msf.org.Lien
Publications scientifiques
- [LIVRE][B] Un choc de circulations: la puissance navale française face au choléra en Méditerranée, 1831-1856 (2025)11 citations
- [LIVRE][B] La guerre des mondes: le retour de la géopolitique et le choc des empires (2023)11 citations
- Évaluation du choc d'approvisionnement (2022)6 citations
- L'agriculture biologique et les produits animaux bio en France: après l'essor, le choc de l'inflation (2024)7 citations
- A tale of ChatGPT: revue de la littérature sur la place des bêtabloquants dans le choc septique par intelligence artificielle générative (ChatGPT) (2024)1 citations[PDF]
Ressources web
- Choc - Troubles cardiaques et vasculaires (msdmanuals.com)
Symptômes du choc · Le trouble peut commencer par une léthargie, une somnolence et une confusion. · La peau devient froide et moite, et souvent bleuâtre, pâle ou ...
- Choc - Réanimation - Édition professionnelle du Manuel ... (msdmanuals.com)
Les symptômes comprennent une confusion mentale, une tachycardie, une hypotension et une oligurie. Le diagnostic est principalement clinique, basé sur une ...
- État de choc | Guides médicaux MSF (medicalguidelines.msf.org)
Signes cliniques · Choc septique : signes d'infection, fièvre ou hypothermie, altération de la conscience, dyspnée, hypotension persistante malgré le remplissage ...
- ITEM 332 – État de choc. Principales étiologies (ce-mir.fr)
- Etat de choc : approche diagnostique aux urgences (revmed.ch)

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
