Plaie Opératoire : Guide Complet 2025 - Cicatrisation, Soins et Prévention
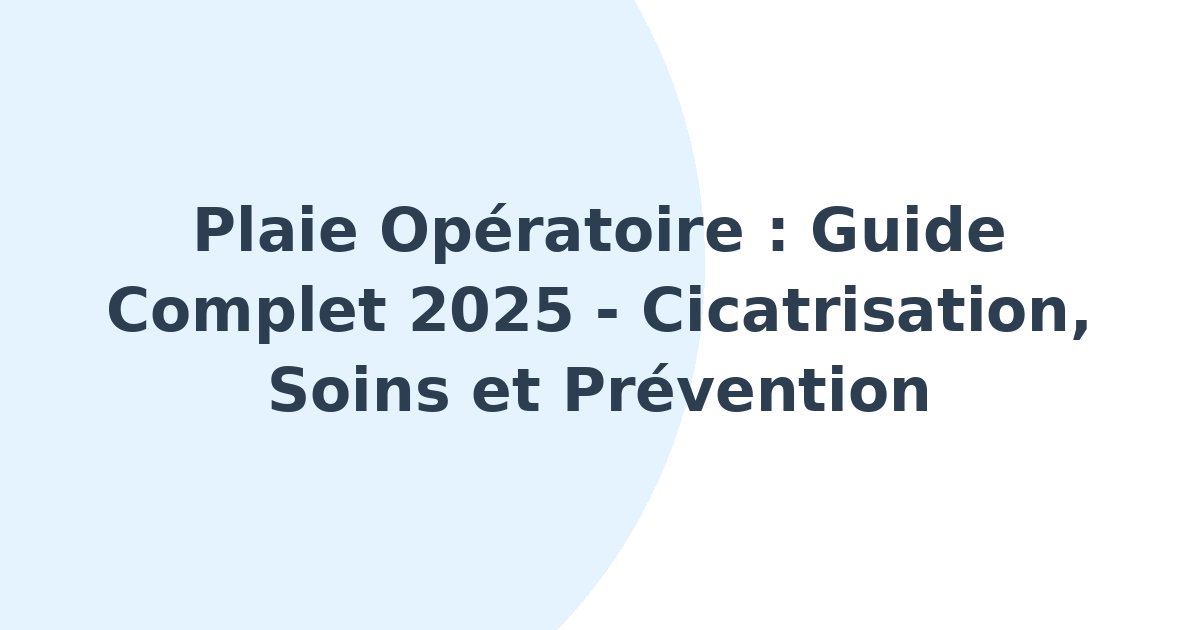
Une plaie opératoire est une incision chirurgicale réalisée lors d'une intervention médicale. Sa cicatrisation normale prend généralement 7 à 14 jours, mais peut parfois se compliquer d'infections ou de retards de guérison. En France, environ 5% des plaies opératoires développent des complications post-chirurgicales [14]. Heureusement, les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouvelles perspectives pour optimiser la cicatrisation et prévenir les infections du site opératoire.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Plaie Opératoire : Définition et Vue d'Ensemble
Une plaie opératoire correspond à toute incision cutanée réalisée lors d'une intervention chirurgicale. Elle constitue une porte d'entrée temporaire dans l'organisme, nécessitant des soins spécifiques pour assurer une cicatrisation optimale [15].
Contrairement aux plaies accidentelles, les plaies chirurgicales sont réalisées dans des maladies stériles contrôlées. Elles présentent généralement des bords nets et réguliers, facilitant le processus de guérison. Cependant, leur localisation et leur profondeur varient selon le type d'intervention pratiquée [16].
La cicatrisation d'une plaie opératoire suit un processus physiologique en trois phases : l'inflammation (0-3 jours), la prolifération (3-21 jours) et la maturation (21 jours à 2 ans). Chaque étape est cruciale pour obtenir une guérison complète et éviter les complications [2].
Il faut savoir que toutes les plaies opératoires ne se ressemblent pas. Certaines sont superficielles, ne touchant que la peau et les tissus sous-cutanés. D'autres sont profondes, impliquant muscles, fascias et parfois organes internes. Cette classification influence directement les modalités de soins et le temps de récupération [3].
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, les infections du site opératoire (ISO) touchent entre 2 à 5% des patients opérés selon les données de Santé Publique France 2024 [9,13]. Cette prévalence varie considérablement selon le type de chirurgie : 1% pour la chirurgie propre, jusqu'à 15% pour la chirurgie contaminée [6].
L'incidence annuelle des complications de plaies opératoires représente environ 150 000 cas en France, générant un coût estimé à 1,5 milliard d'euros pour le système de santé [11]. Ces chiffres placent notre pays dans la moyenne européenne, légèrement en dessous de l'Allemagne (6%) mais au-dessus des pays nordiques (3%) [1].
Les données épidémiologiques révèlent des disparités régionales significatives. Les régions PACA et Île-de-France présentent des taux d'ISO supérieurs à la moyenne nationale (6-7%), probablement liés à la densité hospitalière et à la complexité des interventions pratiquées [13]. À l'inverse, les régions Bretagne et Pays de la Loire affichent des taux inférieurs (3-4%) [9].
Concernant la répartition par âge et sexe, les patients de plus de 65 ans représentent 45% des complications de plaies opératoires, avec une légère prédominance féminine (52% vs 48%) [11]. Cette tendance s'explique par l'augmentation des comorbidités avec l'âge et la fréquence accrue de certaines interventions chez les femmes.
Les projections pour 2025-2030 anticipent une stabilisation, voire une diminution des taux d'ISO grâce aux innovations thérapeutiques et aux protocoles de prévention renforcés [1,2]. L'objectif national fixé par la HAS vise une réduction de 20% des infections du site opératoire d'ici 2027.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les infections du site opératoire résultent d'une contamination bactérienne lors de l'intervention ou pendant la période post-opératoire. Les germes les plus fréquemment impliqués sont Staphylococcus aureus (30%), Escherichia coli (15%) et Enterococcus (12%) [14].
Plusieurs facteurs de risque patient augmentent la probabilité de complications. Le diabète multiplie par 2 à 3 le risque d'ISO, l'obésité (IMC >30) par 1,5 à 2, et l'immunodépression par 3 à 5 [6,9]. L'âge avancé, le tabagisme et la dénutrition constituent également des facteurs prédisposants majeurs.
Les facteurs liés à l'intervention elle-même jouent un rôle crucial. La durée opératoire prolongée (>3 heures), la contamination per-opératoire et l'urgence de l'intervention augmentent significativement les risques [11,13]. D'ailleurs, la qualité de la préparation cutanée et le respect des protocoles d'asepsie restent déterminants.
L'environnement hospitalier influence également l'incidence des complications. La surcharge des services, le turn-over du personnel soignant et les défaillances dans l'application des protocoles d'hygiène constituent autant de facteurs de risque institutionnels [12]. Heureusement, ces éléments sont modifiables par des actions ciblées de prévention.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les signes d'une cicatrisation normale incluent une légère rougeur péri-cicatricielle les premiers jours, un œdème modéré et l'absence d'écoulement purulent. La douleur diminue progressivement et la plaie se referme sans déhiscence [15].
Mais attention aux signaux d'alarme ! Une infection du site opératoire se manifeste par plusieurs symptômes caractéristiques. La rougeur s'étend au-delà de la cicatrice, la chaleur locale augmente et un écoulement purulent peut apparaître [14]. La douleur, au lieu de diminuer, s'intensifie après le 3ème jour post-opératoire.
L'apparition de fièvre (>38°C) constitue un signe d'alerte majeur, surtout si elle survient après une période d'apyrexie. Elle peut s'accompagner de frissons, de malaise général et d'une altération de l'état général [9]. Ces symptômes nécessitent une consultation médicale urgente.
Certains signes plus subtils méritent également votre attention. Un retard de cicatrisation, une déhiscence partielle des berges ou l'apparition de zones nécrotiques doivent vous alerter [16]. De même, une odeur désagréable émanant de la plaie constitue souvent un signe précoce d'infection.
Il est important de noter que les symptômes peuvent varier selon la localisation de la plaie et le terrain du patient. Chez les personnes immunodéprimées ou diabétiques, les signes peuvent être atténués, rendant le diagnostic plus difficile [6].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic d'une complication de plaie opératoire repose d'abord sur l'examen clinique minutieux. Votre médecin inspecte la cicatrice, évalue les signes inflammatoires et recherche d'éventuels écoulements [14]. Cette première étape permet d'orienter rapidement la prise en charge.
En cas de suspicion d'infection, des prélèvements bactériologiques sont systématiquement réalisés. L'écouvillonnage de la plaie ou la ponction d'une collection permettent d'identifier le germe responsable et de tester sa sensibilité aux antibiotiques [9]. Ces résultats guident le choix du traitement antimicrobien.
Les examens biologiques complètent l'évaluation diagnostique. La numération formule sanguine recherche une hyperleucocytose, tandis que la CRP et la procalcitonine évaluent l'intensité de la réaction inflammatoire [11]. Ces marqueurs aident à différencier une infection locale d'une septicémie.
L'imagerie médicale s'avère parfois nécessaire pour évaluer l'extension en profondeur. L'échographie détecte les collections liquidiennes, tandis que le scanner ou l'IRM précisent l'atteinte des structures profondes [13]. Ces examens orientent les décisions thérapeutiques, notamment chirurgicales.
Bon à savoir : le diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic. N'hésitez pas à consulter rapidement en cas de doute, même si les symptômes vous paraissent mineurs [16].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement des plaies opératoires varie selon leur évolution et la présence éventuelle de complications. Pour une cicatrisation normale, les soins locaux consistent en un nettoyage quotidien au sérum physiologique et l'application d'un pansement adapté [15].
En cas d'infection superficielle, l'antibiothérapie locale peut suffire. Les pommades à base de mupirocine ou d'acide fusidique montrent une efficacité prouvée sur les germes gram-positifs [14]. Cependant, l'antibiothérapie systémique devient nécessaire en cas d'extension ou de signes généraux [9].
Les infections profondes nécessitent souvent une prise en charge chirurgicale. Le débridement des tissus nécrotiques, le lavage abondant et parfois le drainage constituent les piliers du traitement [11]. Cette approche peut nécessiter plusieurs interventions selon l'évolution.
Les pansements spécialisés jouent un rôle croissant dans la prise en charge moderne. Les hydrocolloïdes maintiennent un environnement humide favorable à la cicatrisation, tandis que les pansements à l'argent exercent une action antimicrobienne [3]. Les mousses et alginates gèrent efficacement les exsudats.
La thérapie par pression négative (TPN) révolutionne le traitement des plaies complexes. Cette technique favorise la granulation, réduit l'œdème et accélère la cicatrisation [4]. Elle trouve particulièrement son indication dans les plaies profondes ou les déhiscences importantes.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge des plaies opératoires avec l'émergence de technologies révolutionnaires. Les pansements intelligents intégrant des capteurs de pH et de température permettent un monitoring continu de la cicatrisation [1,2].
La thérapie cellulaire représente l'une des avancées les plus prometteuses. L'utilisation de cellules souches mésenchymateuses et de facteurs de croissance accélère significativement la régénération tissulaire [2]. Ces traitements, encore en phase d'évaluation, montrent des résultats encourageants dans les essais cliniques.
Les biomatériaux de nouvelle génération transforment également l'approche thérapeutique. Les matrices de collagène bioactives et les scaffolds résorbables favorisent la reconstruction tissulaire tout en prévenant les infections [3]. Ces innovations réduisent considérablement les temps de cicatrisation.
L'intelligence artificielle s'invite dans le suivi des plaies opératoires. Des applications mobiles analysent les photos de cicatrices et détectent précocement les signes de complications [1]. Cette technologie permet un suivi à distance et une intervention rapide si nécessaire.
Particulièrement innovant, le développement du PRF-110, un anesthésique local à libération prolongée, révolutionne la gestion de la douleur post-opératoire [5]. Les premiers résultats de phase 3 montrent une réduction significative de la consommation d'opioïdes et une amélioration du confort patient.
Vivre au Quotidien avec une Plaie Opératoire
La période de cicatrisation d'une plaie opératoire impose certaines adaptations dans votre quotidien. Les premiers jours, il est normal de ressentir une gêne et une limitation des mouvements, particulièrement si la plaie se situe au niveau d'une articulation [15].
L'hygiène corporelle nécessite des précautions spécifiques. Évitez les bains prolongés et privilégiez les douches courtes en protégeant la cicatrice avec un film plastique étanche [16]. Le séchage doit être délicat, par tamponnement plutôt que par frottement.
Votre alimentation joue un rôle crucial dans la cicatrisation. Privilégiez les aliments riches en protéines (viandes, poissons, légumineuses), en vitamine C (agrumes, kiwis) et en zinc (fruits de mer, graines) [14]. Une hydratation suffisante (1,5 à 2 litres par jour) favorise également la guérison.
L'activité physique doit être adaptée selon la localisation et l'importance de l'intervention. Généralement, la reprise progressive des activités est encouragée dès que possible, en évitant les efforts intenses les premières semaines [15]. Votre chirurgien vous donnera des consignes précises selon votre situation.
Il est important de surveiller l'évolution de votre cicatrice et de signaler rapidement tout changement inquiétant. Tenez un carnet de suivi avec photos si possible, cela aide votre médecin à évaluer la progression de la guérison [16].
Les Complications Possibles
Les complications de plaies opératoires peuvent survenir à différents moments de la cicatrisation. L'infection superficielle, la plus fréquente, touche 2 à 5% des patients et se manifeste généralement dans les 30 premiers jours [9,14].
L'infection profonde constitue une complication plus grave, atteignant les tissus sous-cutanés, les fascias ou les organes. Elle peut survenir jusqu'à un an après l'intervention et nécessite souvent une prise en charge chirurgicale [11]. Le risque de septicémie impose une surveillance étroite.
La déhiscence correspond à l'ouverture spontanée de la plaie, partielle ou complète. Elle survient généralement entre le 5ème et le 10ème jour post-opératoire, favorisée par l'infection, l'obésité ou les efforts prématurés [13]. Cette complication peut nécessiter une nouvelle suture.
Les troubles de cicatrisation incluent les cicatrices hypertrophiques, chéloïdes ou atrophiques. Ces complications esthétiques et fonctionnelles peuvent apparaître plusieurs mois après l'intervention [15]. Certains patients présentent une prédisposition génétique à ces troubles.
Plus rarement, des complications systémiques peuvent survenir. La septicémie, l'embolie pulmonaire ou les troubles de coagulation représentent des urgences vitales nécessitant une prise en charge immédiate en réanimation [9]. Heureusement, ces complications restent exceptionnelles avec les protocoles actuels.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic des plaies opératoires est généralement excellent lorsque la cicatrisation se déroule normalement. Plus de 95% des interventions chirurgicales guérissent sans complication majeure, avec une cicatrisation complète en 2 à 4 semaines [15,16].
En cas d'infection superficielle, le pronostic reste favorable avec un traitement adapté. La guérison survient généralement en 4 à 6 semaines, sans séquelle fonctionnelle significative [14]. Cependant, le risque de récidive existe, particulièrement chez les patients à risque.
Les infections profondes présentent un pronostic plus réservé. Bien que la guérison soit obtenue dans 85 à 90% des cas, elle peut nécessiter plusieurs mois et laisser des séquelles esthétiques ou fonctionnelles [11]. Le risque de complications systémiques impose une surveillance prolongée.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge du patient, ses comorbidités (diabète, immunodépression), la localisation de la plaie et la précocité de la prise en charge constituent les éléments déterminants [9,13]. Un diagnostic et un traitement précoces améliorent considérablement les chances de guérison.
L'important à retenir : même en cas de complication, les techniques actuelles permettent d'obtenir une guérison dans la grande majorité des cas. Votre collaboration active dans le suivi et le respect des consignes médicales constituent des facteurs pronostiques majeurs [16].
Peut-on Prévenir les Complications de Plaie Opératoire ?
La prévention des complications de plaies opératoires repose sur une approche multidisciplinaire débutant avant l'intervention. L'optimisation de votre état général (contrôle glycémique, arrêt du tabac, correction de l'anémie) réduit significativement les risques [6,12].
La préparation cutanée constitue une étape cruciale. La douche pré-opératoire avec un antiseptique, la dépilation par tondeuse (jamais rasoir) et la désinfection per-opératoire suivent des protocoles stricts [12]. Ces mesures réduisent la charge bactérienne cutanée.
L'antibioprophylaxie péri-opératoire, administrée dans l'heure précédant l'incision, prévient efficacement les infections du site opératoire. Le choix de l'antibiotique et la durée du traitement suivent des recommandations précises selon le type d'intervention [13].
Les innovations récentes apportent de nouveaux outils préventifs. L'utilisation d'anneaux rétracteurs lors des urgences chirurgicales digestives réduit de 40% le risque d'infection selon une étude récente [6]. Cette technique protège les berges de la plaie de la contamination per-opératoire.
Après l'intervention, le respect des protocoles de soins reste primordial. Le maintien de la stérilité lors des pansements, l'éducation du patient et de sa famille, ainsi que la surveillance régulière constituent les piliers de la prévention secondaire [16]. Votre participation active à ces mesures est essentielle.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées pour la prévention des infections du site opératoire. Ces guidelines intègrent les dernières données scientifiques et les innovations technologiques [1].
Les mesures pré-opératoires recommandées incluent l'arrêt du tabac au moins 6 semaines avant l'intervention, l'optimisation du contrôle glycémique (HbA1c <7%) et la correction des carences nutritionnelles [12]. La HAS insiste particulièrement sur l'éducation du patient.
Concernant la préparation cutanée, les recommandations privilégient la chlorhexidine alcoolique pour la désinfection per-opératoire. L'utilisation de champs adhésifs imprégnés d'iode est désormais déconseillée en raison du risque de dermatite de contact [12].
La Société Française d'Hygiène Hospitalière (SF2H) préconise une surveillance post-opératoire standardisée pendant 30 jours minimum. Cette surveillance doit inclure l'évaluation clinique, la formation du patient aux signes d'alerte et la traçabilité des soins [13].
L'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) a également émis des recommandations spécifiques concernant l'usage des nouveaux pansements bioactifs. Ces dispositifs médicaux doivent faire l'objet d'une évaluation rigoureuse avant leur utilisation en routine [3]. La formation des équipes soignantes constitue un prérequis indispensable.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients dans leur parcours de soins post-chirurgical. L'Association Française de Chirurgie (AFC) propose des brochures d'information et des permanences téléphoniques pour répondre aux questions des patients [14].
La Ligue contre le Cancer offre un soutien spécifique aux patients ayant subi une chirurgie oncologique. Leurs équipes psycho-sociales aident à gérer l'anxiété liée aux complications de cicatrisation et proposent des ateliers de bien-être [15].
Les réseaux de soins régionaux constituent également des ressources précieuses. Ils coordonnent la prise en charge entre l'hôpital et la ville, assurent la continuité des soins et proposent des formations aux aidants familiaux [16].
Sur internet, plusieurs plateformes fiables fournissent des informations validées. Le site de l'Assurance Maladie (ameli.fr) propose des fiches pratiques sur les soins de plaies, tandis que le portail santé du gouvernement diffuse les recommandations officielles.
N'hésitez pas à solliciter votre médecin traitant qui reste votre interlocuteur privilégié. Il peut vous orienter vers les ressources locales adaptées à votre situation et coordonner votre suivi avec les spécialistes [14]. La communication reste la clé d'une prise en charge optimale.
Nos Conseils Pratiques
Pour optimiser la cicatrisation de votre plaie opératoire, respectez scrupuleusement les consignes de votre chirurgien. Chaque intervention est unique et nécessite des soins adaptés [15]. N'hésitez jamais à poser des questions si quelque chose vous semble flou.
Maintenez une hygiène rigoureuse sans être obsessionnel. Lavez-vous les mains avant et après chaque soin, utilisez du matériel stérile et changez régulièrement vos pansements selon les recommandations [16]. Un environnement propre favorise la guérison.
Surveillez attentivement l'évolution de votre cicatrice. Prenez des photos quotidiennes si possible, cela aide votre médecin à évaluer la progression. Notez également vos sensations : douleur, démangeaisons, sensation de tension [14].
Adoptez un mode de vie sain pendant la période de cicatrisation. Évitez l'alcool et le tabac qui retardent la guérison, privilégiez une alimentation équilibrée riche en protéines et vitamines, et respectez vos heures de sommeil [15].
En cas de doute, consultez rapidement. Il vaut mieux une consultation de trop qu'une complication négligée. Votre équipe soignante préfère être sollicitée pour rien plutôt que de découvrir tardivement un problème [16]. Votre santé n'a pas de prix.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alerte nécessitent une consultation médicale immédiate. L'apparition de fièvre supérieure à 38°C, surtout si elle s'accompagne de frissons, doit vous amener aux urgences [9,14]. Ces symptômes peuvent signaler une infection systémique.
L'évolution de votre cicatrice doit également vous alerter. Une rougeur qui s'étend, un écoulement purulent, une odeur désagréable ou une ouverture de la plaie imposent une consultation rapide [15]. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent.
La douleur constitue un indicateur important. Si elle augmente après le 3ème jour post-opératoire au lieu de diminuer, ou si elle devient insupportable malgré les antalgiques prescrits, consultez votre médecin [16]. Une douleur anormale peut révéler une complication.
Certains signes généraux doivent également vous inquiéter : malaise, nausées persistantes, troubles du transit ou difficultés respiratoires. Ces symptômes peuvent être liés à votre intervention ou révéler une complication [9].
En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre chirurgien ou votre médecin traitant. La plupart des équipes proposent une permanence téléphonique pour répondre à vos questions [14]. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir.
Questions Fréquentes
Combien de temps faut-il pour qu'une plaie opératoire cicatrise ?La cicatrisation complète d'une plaie opératoire prend généralement 2 à 4 semaines pour les tissus superficiels, et jusqu'à 6 mois pour la consolidation profonde [15]. Cependant, chaque patient est unique et plusieurs facteurs influencent ce délai.
Puis-je prendre une douche avec ma plaie opératoire ?
Oui, généralement après 48 heures si votre chirurgien l'autorise. Protégez la cicatrice avec un film plastique étanche et évitez les bains prolongés [16]. Séchez délicatement par tamponnement.
Quand puis-je reprendre le sport après mon opération ?
La reprise sportive dépend du type d'intervention et de votre récupération. Généralement, les activités douces peuvent être reprises après 2-3 semaines, les sports intensifs après 6-8 semaines [15]. Demandez l'avis de votre chirurgien.
Ma cicatrice restera-t-elle visible ?
L'aspect final d'une cicatrice évolue pendant 12 à 18 mois. Elle s'estompe progressivement et devient généralement peu visible [14]. Des soins spécifiques (crèmes, massages, protection solaire) peuvent améliorer le résultat esthétique.
Que faire si ma plaie s'ouvre ?
En cas d'ouverture de votre plaie, consultez immédiatement votre médecin ou rendez-vous aux urgences. En attendant, protégez la zone avec un pansement stérile et évitez tout effort [9]. Ne tentez pas de refermer vous-même la plaie.
Questions Fréquentes
Combien de temps faut-il pour qu'une plaie opératoire cicatrise ?
La cicatrisation complète d'une plaie opératoire prend généralement 2 à 4 semaines pour les tissus superficiels, et jusqu'à 6 mois pour la consolidation profonde. Cependant, chaque patient est unique et plusieurs facteurs influencent ce délai.
Puis-je prendre une douche avec ma plaie opératoire ?
Oui, généralement après 48 heures si votre chirurgien l'autorise. Protégez la cicatrice avec un film plastique étanche et évitez les bains prolongés. Séchez délicatement par tamponnement.
Quand puis-je reprendre le sport après mon opération ?
La reprise sportive dépend du type d'intervention et de votre récupération. Généralement, les activités douces peuvent être reprises après 2-3 semaines, les sports intensifs après 6-8 semaines. Demandez l'avis de votre chirurgien.
Ma cicatrice restera-t-elle visible ?
L'aspect final d'une cicatrice évolue pendant 12 à 18 mois. Elle s'estompe progressivement et devient généralement peu visible. Des soins spécifiques peuvent améliorer le résultat esthétique.
Que faire si ma plaie s'ouvre ?
En cas d'ouverture de votre plaie, consultez immédiatement votre médecin ou rendez-vous aux urgences. En attendant, protégez la zone avec un pansement stérile et évitez tout effort.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] PROGRAMME FINAL. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Innovations dans le traitement des plaies - Futura-Sciences. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] Soins avancés des plaies. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [4] Negative Pressure Dressings to Prevent Surgical Site Infection. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [5] PainReform Announces Initial Topline Data for PRF-110 Phase 3 Clinical TrialLien
- [6] Efficacité de l'Anneau Rétracteur de Plaies dans la Prévention des Infections du Site Opératoire dans les Urgences Chirurgicales DigestivesLien
- [9] Infections du site opératoire en neurochirurgie: Etude d'une série de 9 cas au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de ConakryLien
- [11] Est-ce que la fermeture du péritoine pariétal pourrait prévenir les infections du site opératoire?Lien
- [12] Tenue vestimentaire au bloc opératoire 2021Lien
- [13] Évaluation des stratégies préventives appliquées pour réduire le risque d'Infection du Site Opératoire (ISO)Lien
- [14] Les infections post-opératoires : risques, prévention et traitementLien
- [15] Plaies - symptômes, causes, traitements et préventionLien
- [16] La plaie chirurgicale - Urgo Medical vous en dit plusLien
Publications scientifiques
- Efficacité de l'Anneau Rétracteur de Plaies dans la Prévention des Infections du Site Opératoire dans les Urgences Chirurgicales Digestives: Effectiveness of the … (2022)4 citations
- Etude comparative de césarienne avec pansement conventionnel et absence de pansement sur la plaie post opératoire à la maternité de l'hôpital de district de … (2024)[PDF]
- PLAIE URÉTÉRALE PAR ARME À FEU DE DÉCOUVERTE PER OPÉRATOIRE: À PROPOS D'UN CAS URETERAL WOUND BY FIREARM DISCOVERED …
- Infections du site opératoire en neurochirurgie: Etude d'une série de 9 cas au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Conakry (2023)
- Risque chimique au bloc opératoire: Faut-il s'y préparer? Comment décontaminer une urgence absolue? (2023)
Ressources web
- Les infections post-opératoires : risques, prévention et traitement (chirurgie-gynecologie.fr)
7 juin 2024 — La présence d'une rougeur autour de la plaie chirurgicale peut indiquer une inflammation locale, souvent accompagnée d'une sensation de chaleur ...
- Plaies - symptômes, causes, traitements et prévention (vidal.fr)
5 sept. 2023 — L'infection, qui apparaît dans les jours qui suivent le traumatisme, se manifeste par une rougeur, une douleur et la présence éventuelle de pus.
- La plaie chirurgicale - Urgo Medical vous en dit plus (urgomedical.fr)
Le traitement de cette plaie consiste à la fois à limiter les risques d'infection et à obtenir rapidement une cicatrice esthétiquement acceptable. Les soins ...
- LA PLAIE (chuv.ch)
A ce stade la plaie comporte tous les signes caractéristiques de l'inflammation : rougeur, tuméfaction, chaleur, douleur. La dilatation des capillaires ...
- Infection du site chirurgical : facteurs de risque, prévention, ... (revmed.ch)
9 oct. 2013 — En cas de signes de gravité systémique (fièvre, tachycardie ou autres signes de sepsis) ou locale (érythème > 5 cm), le choix de l'antibiotique ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
