Phénomène de Non Reperfusion : Guide Complet 2025 | Symptômes, Traitements
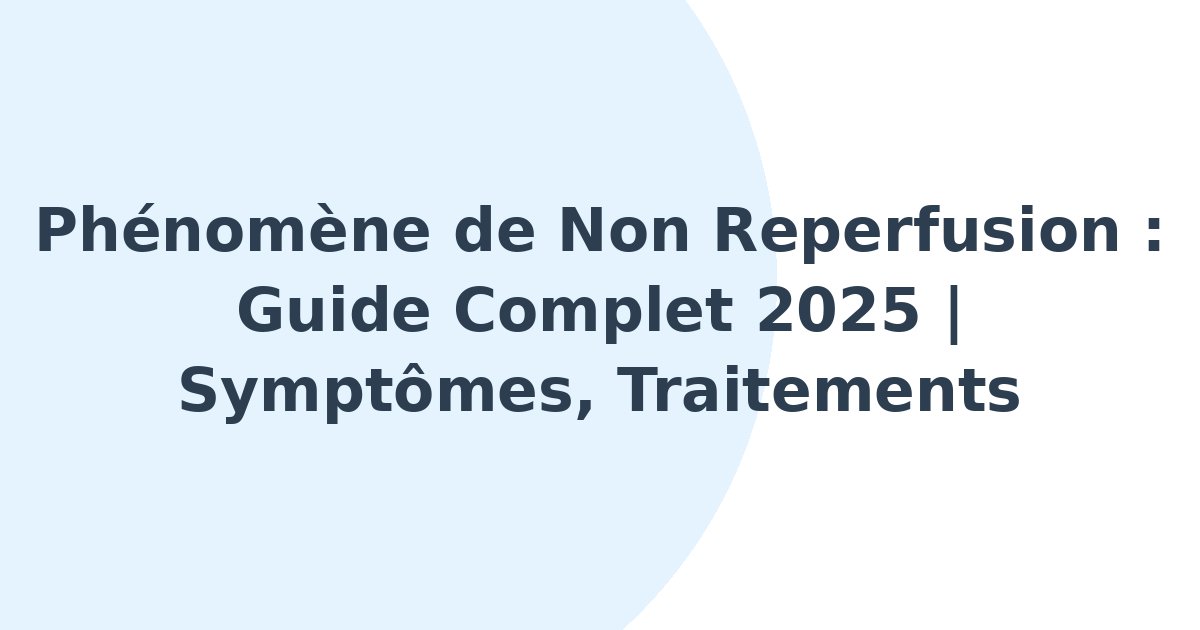
Le phénomène de non reperfusion représente une complication redoutable qui survient paradoxalement après la réouverture d'une artère obstruée. Malgré le rétablissement du flux sanguin, les tissus ne retrouvent pas leur irrigation normale, créant un véritable défi thérapeutique. Cette pathologie touche principalement le cœur et le cerveau lors d'infarctus, mais peut également affecter d'autres organes. Comprendre ce mécanisme complexe est essentiel pour optimiser les traitements et améliorer le pronostic des patients.
Téléconsultation et Phénomène de non reperfusion
Téléconsultation non recommandéeLe phénomène de non reperfusion est une complication grave survenant généralement après revascularisation cardiaque ou cérébrale, nécessitant une surveillance hospitalière immédiate et des examens spécialisés (échocardiographie, angiographie, IRM). Cette pathologie requiert impérativement une prise en charge médicale urgente en milieu spécialisé avec plateau technique adapté.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique de la procédure de revascularisation récente, description des symptômes actuels (douleur thoracique, essoufflement, troubles neurologiques), évaluation de l'évolution clinique post-procédure, analyse des traitements en cours et de leur observance, orientation vers une prise en charge urgente adaptée.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Réalisation d'un électrocardiogramme urgent, échocardiographie pour évaluer la fonction cardiaque, angiographie de contrôle, imagerie cérébrale si suspicion d'AVC, surveillance hémodynamique continue, ajustement thérapeutique spécialisé en milieu hospitalier.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de récidive ischémique après revascularisation nécessitant une réévaluation angiographique urgente, apparition de nouveaux symptômes cardiaques ou neurologiques post-procédure, signes d'insuffisance cardiaque aiguë, troubles du rythme cardiaque, nécessité d'ajustement thérapeutique complexe en milieu spécialisé.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Douleur thoracique intense récidivante après revascularisation coronaire, déficit neurologique brutal après thrombolyse cérébrale, signes d'œdème pulmonaire aigu, troubles hémodynamiques majeurs nécessitant une prise en charge en unité de soins intensifs.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Douleur thoracique intense et persistante après une procédure de revascularisation coronaire
- Apparition brutale de déficit neurologique (faiblesse, troubles de la parole, troubles visuels) après thrombolyse
- Essoufflement majeur avec impossibilité de rester allongé, sueurs froides
- Perte de conscience, malaise grave, palpitations avec pouls irrégulier ou très rapide
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Cardiologue — consultation en présentiel indispensable
Le phénomène de non reperfusion nécessite impérativement une évaluation cardiologique spécialisée avec plateau technique adapté (échocardiographie, coronarographie). Une consultation en présentiel est obligatoire pour la surveillance clinique, l'interprétation des examens complémentaires et l'adaptation thérapeutique urgente.
Phénomène de non reperfusion : Définition et Vue d'Ensemble
Le phénomène de non reperfusion désigne l'absence de restauration efficace de la circulation sanguine dans un tissu, malgré la réouverture réussie de l'artère qui l'irrigue [11,12]. Cette situation paradoxale survient principalement lors des syndromes coronariens aigus et des accidents vasculaires cérébraux.
Concrètement, imaginez une autoroute qui vient d'être débloquée après un accident majeur. Bien que la voie soit libre, les véhicules n'arrivent pas à circuler normalement à cause des embouteillages secondaires et des dégâts collatéraux. C'est exactement ce qui se passe au niveau microscopique dans vos vaisseaux sanguins [13].
Cette pathologie affecte la microcirculation, c'est-à-dire les plus petits vaisseaux sanguins qui irriguent directement les cellules. Les mécanismes impliqués sont multiples : spasme des petites artères, formation de micro-caillots, gonflement des cellules qui compriment les capillaires, et dysfonctionnement de la paroi vasculaire [3,5].
L'important à retenir, c'est que ce phénomène peut survenir même après une intervention réussie comme une angioplastie coronaire ou une thrombectomie cérébrale. D'ailleurs, il représente l'une des principales causes d'échec thérapeutique dans ces situations d'urgence.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, le phénomène de non reperfusion complique environ 15 à 30% des interventions de revascularisation coronaire selon les données de la HAS . Cette proportion varie considérablement selon le délai d'intervention et la gravité initiale de l'infarctus.
Les chiffres récents montrent une incidence annuelle d'environ 8 000 à 12 000 cas en France, principalement dans le contexte des syndromes coronariens aigus . Mais attention, ces données sous-estiment probablement la réalité car le diagnostic n'est pas toujours posé de manière systématique.
Au niveau européen, les études révèlent des variations importantes entre pays. L'Allemagne et les Pays-Bas rapportent des taux légèrement inférieurs (12-25%), tandis que certains pays d'Europe de l'Est affichent des pourcentages plus élevés, probablement liés aux délais de prise en charge .
Concernant la répartition par âge, les patients de plus de 70 ans présentent un risque multiplié par 2,5 par rapport aux plus jeunes. Les hommes sont légèrement plus touchés que les femmes (ratio 1,3:1), mais cette différence tend à s'estomper après la ménopause .
Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation, voire une légère diminution de l'incidence grâce aux progrès thérapeutiques récents et à l'amélioration des délais de prise en charge . L'impact économique est considérable : chaque cas coûte en moyenne 15 000 à 25 000 euros supplémentaires au système de santé français.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes du phénomène de non reperfusion sont multifactorielles et souvent intriquées. Le délai d'ischémie constitue le facteur le plus déterminant : plus l'artère reste obstruée longtemps, plus le risque augmente exponentiellement [3,4].
Parmi les mécanismes physiopathologiques, l'œdème cellulaire joue un rôle central. Lors de l'ischémie, les cellules gonflent et compriment les capillaires environnants. Même après réouverture de l'artère principale, ces micro-compressions persistent et empêchent la circulation normale [5,8].
Les facteurs de risque individuels incluent le diabète, l'hypertension artérielle, l'âge avancé et les antécédents cardiovasculaires. Le diabète, en particulier, multiplie le risque par 2 à 3 en raison de ses effets sur la microcirculation [3]. D'ailleurs, l'hyperglycémie au moment de l'intervention constitue un facteur prédictif indépendant.
Certains facteurs techniques influencent également le risque : la taille du territoire ischémique, la présence de circulation collatérale, et paradoxalement, la rapidité de la reperfusion. En effet, une restauration trop brutale du flux sanguin peut aggraver les lésions par un phénomène appelé "lésions de reperfusion" [6,9].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître le phénomène de non reperfusion n'est pas toujours évident car il survient dans un contexte déjà complexe d'urgence médicale. Les signes cliniques varient selon l'organe concerné, mais certains éléments doivent alerter.
Dans le contexte cardiaque, vous pourriez ressentir une persistance ou une récidive des douleurs thoraciques malgré l'intervention. Cette douleur peut être différente de celle initiale : moins intense mais plus sourde et persistante [11,12]. L'essoufflement peut également persister ou s'aggraver paradoxalement.
Au niveau cérébral, après une thrombectomie, l'absence d'amélioration neurologique dans les heures suivantes doit faire suspecter ce phénomène. Les déficits peuvent même parfois s'aggraver temporairement [2,6].
Il est important de comprendre que ces symptômes ne sont pas spécifiques et peuvent être masqués par les traitements antidouleur ou sédatifs administrés. C'est pourquoi le diagnostic repose principalement sur des examens complémentaires plutôt que sur les seuls signes cliniques.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic du phénomène de non reperfusion repose sur une combinaison d'examens cliniques et paracliniques réalisés en urgence. La coronarographie reste l'examen de référence dans le contexte cardiaque, permettant d'évaluer le flux sanguin selon la classification TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) [11,12].
L'échocardiographie apporte des informations cruciales sur la contractilité du muscle cardiaque. Elle peut révéler des zones akinétiques (qui ne se contractent plus) malgré la réouverture artérielle. Cet examen peut être répété plusieurs fois pour suivre l'évolution .
Dans le contexte neurologique, l'angiographie cérébrale per-procédurale permet d'évaluer immédiatement la qualité de la reperfusion. Les nouvelles techniques d'imagerie de perfusion par scanner ou IRM offrent une évaluation plus précise du territoire encore en souffrance [2,6].
Les biomarqueurs sanguins jouent également un rôle important. L'élévation persistante ou la ré-ascension des troponines cardiaques peut suggérer une nécrose tissulaire continue malgré la revascularisation. D'autres marqueurs comme les peptides natriurétiques peuvent également être utiles [13].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement du phénomène de non reperfusion reste un défi thérapeutique majeur. L'approche est principalement préventive et repose sur l'optimisation des techniques de revascularisation [11,12,13].
Les agents pharmacologiques utilisés incluent les vasodilatateurs comme l'adénosine ou le vérapamil, injectés directement dans l'artère concernée. Ces médicaments visent à dilater la microcirculation et à améliorer le flux sanguin distal. Leur efficacité reste cependant modeste et variable selon les patients [1].
Les techniques de protection distale se développent rapidement. Elles consistent à aspirer les débris et micro-emboles pendant la procédure de revascularisation, réduisant ainsi le risque d'obstruction des petits vaisseaux . Ces dispositifs montrent des résultats prometteurs, particulièrement dans certaines situations à haut risque.
Le maladienement ischémique représente une approche innovante. Il s'agit de réaliser de brèves occlusions-reperfusions contrôlées pour "préparer" le tissu à la reperfusion définitive. Cette technique, encore expérimentale, pourrait réduire les lésions de reperfusion [3,5].
Enfin, les traitements de support restent essentiels : contrôle strict de la glycémie, maintien d'une pression artérielle optimale, et prévention des complications thrombotiques par une anticoagulation adaptée [7,9].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge du phénomène de non reperfusion avec plusieurs innovations prometteuses. Les thérapies cellulaires font l'objet d'essais cliniques avancés, notamment l'injection de cellules souches mésenchymateuses pour favoriser la régénération vasculaire .
Une approche révolutionnaire concerne l'utilisation de nanoparticules thérapeutiques capables de cibler spécifiquement la microcirculation endommagée. Ces vecteurs peuvent délivrer des agents vasodilatateurs ou anti-inflammatoires directement au niveau des capillaires obstrués [1].
Les techniques d'imagerie avancée permettent désormais une évaluation en temps réel de la microcirculation. La microscopie intravitale et l'imagerie par fluorescence offrent une visualisation directe des phénomènes de non reperfusion, ouvrant la voie à des interventions plus ciblées [2].
D'ailleurs, les essais cliniques récents sur les agents fibrinolytiques intra-artériels après thrombectomie montrent des résultats encourageants. Cette approche combinée pourrait améliorer significativement les taux de reperfusion complète [2].
La recherche fondamentale progresse également avec une meilleure compréhension du rôle des mitochondries dans les lésions de reperfusion. Les thérapies ciblant la dysfonction mitochondriale représentent une voie d'avenir particulièrement prometteuse [3,5,8].
Vivre au Quotidien avec le Phénomène de non reperfusion
Vivre avec les séquelles d'un phénomène de non reperfusion nécessite des adaptations importantes dans votre quotidien. La fatigue constitue souvent le symptôme le plus handicapant, résultant de la diminution de la fonction cardiaque ou des séquelles neurologiques [7,9].
L'adaptation de l'activité physique est cruciale. Votre cardiologue ou votre médecin rééducateur vous proposera un programme personnalisé, généralement débuté en milieu hospitalier puis poursuivi à domicile. Il est important de respecter ces recommandations pour éviter le démaladienement tout en préservant votre cœur [11,12].
Sur le plan psychologique, il est normal de ressentir de l'anxiété ou une certaine appréhension. Beaucoup de patients développent une "peur de l'effort" compréhensible mais qu'il faut surmonter progressivement. N'hésitez pas à en parler avec votre équipe soignante ou à rejoindre des groupes de parole [10].
La gestion des traitements médicamenteux demande une attention particulière. Vous devrez probablement prendre plusieurs médicaments : antiagrégants plaquettaires, statines, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, et parfois des diurétiques. L'observance thérapeutique est essentielle pour prévenir les récidives.
Les Complications Possibles
Le phénomène de non reperfusion peut entraîner plusieurs complications à court et long terme qu'il est important de connaître. L'insuffisance cardiaque représente la complication la plus fréquente dans le contexte coronarien, touchant environ 30 à 40% des patients [11].
Les troubles du rythme cardiaque constituent également une préoccupation majeure. Les zones de myocarde mal perfusées peuvent devenir des foyers d'arythmies, parfois graves comme la fibrillation ventriculaire. C'est pourquoi une surveillance électrocardiographique prolongée est souvent nécessaire [12,13].
Dans le contexte neurologique, les complications incluent l'aggravation des déficits neurologiques initiaux et l'apparition de nouveaux symptômes. L'œdème cérébral peut se développer dans les heures suivant l'intervention, nécessitant parfois des traitements spécifiques [2,6].
Les complications rénales ne sont pas rares, particulièrement chez les patients diabétiques ou âgés. La néphropathie de contraste peut être aggravée par les phénomènes de non reperfusion rénale [7,9]. Une surveillance de la fonction rénale est donc indispensable.
Enfin, il faut mentionner les complications psychologiques souvent sous-estimées : anxiété, dépression, et syndrome de stress post-traumatique peuvent affecter significativement la qualité de vie [10].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du phénomène de non reperfusion dépend de nombreux facteurs, mais il s'est considérablement amélioré ces dernières années grâce aux progrès thérapeutiques . Dans le contexte cardiaque, la mortalité à 30 jours varie de 8 à 15% selon les séries, contre 3 à 5% en cas de reperfusion normale [11,12].
À long terme, environ 60 à 70% des patients retrouvent une qualité de vie satisfaisante, même si elle reste souvent inférieure à celle d'avant l'événement. La fonction cardiaque peut s'améliorer partiellement dans les mois suivants grâce aux phénomènes de remodelage et à l'optimisation thérapeutique [13].
Les facteurs pronostiques favorables incluent un âge jeune, l'absence de diabète, un délai d'ischémie court, et une prise en charge précoce et optimale. À l'inverse, l'âge avancé, les comorbidités multiples, et l'étendue importante de la zone concernée assombrissent le pronostic [3,5].
Il est important de savoir que le pronostic continue de s'améliorer. Les innovations thérapeutiques récentes et une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques laissent espérer des progrès significatifs dans les années à venir [1].
Peut-on Prévenir le Phénomène de non reperfusion ?
La prévention du phénomène de non reperfusion repose principalement sur l'optimisation de la prise en charge initiale et la réduction des facteurs de risque [11,12]. Le délai d'intervention reste le facteur le plus important : chaque minute compte dans la course contre la montre de l'ischémie.
Au niveau individuel, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire constitue la meilleure prévention primaire. Cela inclut l'arrêt du tabac, l'équilibre du diabète, le traitement de l'hypertension artérielle, et la correction des dyslipidémies [3,4]. Un mode de vie sain avec une activité physique régulière et une alimentation équilibrée reste fondamental.
Les techniques préventives per-procédurales se développent rapidement. L'utilisation systématique de dispositifs d'aspiration, l'injection préventive de vasodilatateurs, et l'optimisation des techniques d'angioplastie permettent de réduire significativement le risque .
La préparation médicamenteuse avant l'intervention joue également un rôle. L'administration précoce d'antiagrégants plaquettaires, de statines à haute dose, et parfois d'anti-inflammatoires peut limiter les phénomènes inflammatoires et thrombotiques [13].
Enfin, l'éducation des patients et du grand public sur les signes d'alerte permet une prise en charge plus précoce, réduisant ainsi le risque de complications [10].
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées concernant la prise en charge du phénomène de non reperfusion . Ces guidelines insistent sur l'importance d'une approche multidisciplinaire impliquant cardiologues interventionnels, réanimateurs, et équipes de rééducation.
Les recommandations européennes, alignées sur celles de la Société Européenne de Cardiologie, préconisent une évaluation systématique de la microcirculation après toute procédure de revascularisation. Cette évaluation doit être réalisée par coronarographie avec mesure du flux TIMI et, si possible, par des techniques d'imagerie complémentaires .
Concernant les traitements, les autorités recommandent une approche personnalisée tenant compte des caractéristiques individuelles du patient. L'utilisation d'agents vasodilatateurs intra-coronaires est recommandée en cas de suspicion de phénomène de non reperfusion, avec une préférence pour l'adénosine ou le vérapamil [1].
Les recommandations insistent également sur l'importance du suivi à long terme. Une évaluation de la fonction cardiaque par échocardiographie est recommandée à 1 mois, 3 mois, puis annuellement. L'optimisation thérapeutique doit être poursuivie avec un objectif de LDL-cholestérol inférieur à 0,55 g/L .
Enfin, les autorités soulignent l'importance de la recherche clinique dans ce domaine et encouragent la participation des centres aux registres nationaux et internationaux pour améliorer les connaissances [2].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations et ressources peuvent vous accompagner dans votre parcours avec le phénomène de non reperfusion. La Fédération Française de Cardiologie propose des programmes d'éducation thérapeutique et des groupes de parole dans toute la France. Leurs clubs cœur et santé offrent des activités physiques adaptées encadrées par des professionnels.
L'Association de Cardiologie du Nord et l'Alliance du Cœur organisent régulièrement des conférences d'information et des ateliers pratiques sur la gestion des maladies cardiovasculaires. Ces événements permettent de rencontrer d'autres patients et d'échanger sur les expériences vécues.
Au niveau digital, plusieurs plateformes proposent des ressources fiables : le site de l'Assurance Maladie (ameli.fr) contient des fiches pratiques détaillées, et le portail de la HAS offre l'accès aux recommandations officielles. L'application "Mon espace santé" permet de centraliser vos informations médicales.
Pour le soutien psychologique, n'hésitez pas à contacter votre CPAM qui peut vous orienter vers des psychologues spécialisés dans l'accompagnement des patients cardiaques. Certaines mutuelles proposent également des services de téléconsultation psychologique.
Enfin, les centres de réadaptation cardiaque constituent une ressource précieuse. Ils proposent des programmes complets associant réentraînement à l'effort, éducation thérapeutique, et soutien psychologique. Votre cardiologue peut vous y orienter si nécessaire.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec les conséquences d'un phénomène de non reperfusion. Tout d'abord, respectez scrupuleusement votre traitement médicamenteux. Utilisez un pilulier hebdomadaire et programmez des rappels sur votre téléphone si nécessaire. N'arrêtez jamais un traitement sans avis médical.
Concernant l'activité physique, commencez très progressivement et écoutez votre corps. Une marche de 10 minutes par jour peut être un bon début, à augmenter graduellement selon vos capacités. Évitez les efforts intenses et les activités par temps très chaud ou très froid.
Surveillez votre poids quotidiennement et notez-le dans un carnet. Une prise de poids rapide (plus de 2 kg en 3 jours) peut signaler une rétention d'eau et nécessite une consultation rapide. De même, surveillez l'apparition d'œdèmes aux chevilles ou d'essoufflement inhabituel.
Adoptez une alimentation cardio-protectrice : réduisez le sel (moins de 6g par jour), privilégiez les fruits et légumes, les poissons gras, et limitez les graisses saturées. L'alcool doit être consommé avec modération (maximum 2 verres par jour pour les hommes, 1 pour les femmes).
Enfin, n'hésitez pas à communiquer avec votre équipe soignante. Préparez vos questions avant les consultations et n'hésitez pas à demander des explications si quelque chose n'est pas clair. Votre participation active à votre prise en charge est essentielle.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement, voire à appeler les secours. Les douleurs thoraciques nouvelles ou différentes de celles habituelles constituent un motif de consultation urgente, même si elles semblent moins intenses que lors de l'épisode initial.
Un essoufflement inhabituel au repos ou pour des efforts habituellement bien tolérés doit également vous alerter. De même, l'apparition d'œdèmes aux chevilles, aux jambes, ou une prise de poids rapide peuvent signaler une décompensation cardiaque nécessitant un ajustement thérapeutique.
Les palpitations intenses, prolongées, ou accompagnées de malaise doivent faire l'objet d'une consultation rapide. N'hésitez pas à vous rendre aux urgences si ces symptômes s'accompagnent de douleurs thoraciques ou de difficultés respiratoires.
D'autres signes moins spécifiques méritent attention : fatigue inhabituelle et persistante, vertiges répétés, nausées inexpliquées, ou sensation de "tête qui tourne". Ces symptômes peuvent révéler des troubles du rythme ou une hypotension.
En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter. Votre médecin traitant ou votre cardiologue préfèrent être consultés "pour rien" plutôt que de passer à côté d'une complication. N'hésitez pas non plus à utiliser les services de téléconsultation si votre état ne nécessite pas d'examen physique immédiat.
Questions Fréquentes
Le phénomène de non reperfusion peut-il récidiver ?
Oui, malheureusement, il peut survenir lors d'un nouvel épisode ischémique. C'est pourquoi la prévention des récidives par le contrôle des facteurs de risque et l'observance thérapeutique est cruciale.
Combien de temps dure la récupération ?
La récupération varie énormément d'un patient à l'autre. Certains retrouvent une fonction normale en quelques semaines, d'autres gardent des séquelles permanentes. En général, l'amélioration se poursuit pendant 6 à 12 mois.
Puis-je reprendre une activité professionnelle normale ?
Cela dépend de votre état de santé et de votre profession. Les métiers sédentaires peuvent souvent être repris après quelques semaines, tandis que les activités physiques intenses nécessitent une évaluation cardiologique approfondie.
Les traitements ont-ils des effets secondaires importants ?
Comme tous les médicaments, ceux utilisés dans cette pathologie peuvent avoir des effets indésirables. Cependant, leurs bénéfices dépassent largement les risques. N'arrêtez jamais un traitement sans avis médical.
Existe-t-il des traitements naturels efficaces ?
Aucun traitement naturel n'a prouvé son efficacité dans cette pathologie. Méfiez-vous des promesses miraculeuses et privilégiez toujours les traitements validés scientifiquement.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] YUKON CHROME PC. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] LE MAGAZINE ANNUEL DE LA RECHERCHE À L'UA. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Programme Déroulé Complet. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Palmarès 2024. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] The No-Reflow Paradox: Unblocking the Vessel, Not .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Two Trials Boost Intra-arterial Lytics After Stroke .... Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] M Dubois. Impact de l'hyperglycémie sur la sensibilité du cœur à l'ischémie-reperfusion: interaction complexe entre dynamique mitochondriale, homéostasie calcique et …. 2023.Lien
- [8] E Rigal. … à long terme de la programmation nutritionnelle postnatale sur le risque cardio-métabolisme et sur la sensibilité aux lésions d'ischémie-reperfusion in vivo chez la …. 2023.Lien
- [9] S Leick. Rôle du couple TSPO-STAR dans l'accumulation du cholestérol dans la mitochondrie au cours de l'ischémie-reperfusion myocardique.. 2022.Lien
- [10] G Herpe. Ischémie-reperfusion cérébrale post-thrombectomie mécanique: modélisation probabiliste en artériographie à la phase hyper aigue et modélisation réaliste …. 2022.Lien
- [11] P Erpicum, TP Coelho. Delayed graft function: an ongoing clinical challenge. 2023.Lien
- [12] A Kheyar. Identification d'un nouvel inhibiteur de cyclophilines et caractérisation de ses effets mito-et hépatoprotecteurs dans le contexte de l'ischémie reperfusion hépatique. 2023.Lien
- [13] M Schleef. Ischémie-reperfusion rénale: dépistage précoce de lésions rénales et stratégies de néphroprotection. 2023.Lien
- [14] C Hocine, J Coutureau. Colite ischémique: physiopathologie, formes cliniques et signes pronostiques en imagerie. 2024.Lien
- [15] Revue générale des syndromes coronariens aigus. www.msdmanuals.com.Lien
- [16] Chapitre 05 - Item 339 : Syndromes coronariens aigus. www.sfcardio.fr.Lien
- [17] Une stratégie efficace pour limiter le no-reflow et la taille de .... www.medecinesciences.org.Lien
Publications scientifiques
- Impact de l'hyperglycémie sur la sensibilité du cœur à l'ischémie-reperfusion: interaction complexe entre dynamique mitochondriale, homéostasie calcique et … (2023)
- … à long terme de la programmation nutritionnelle postnatale sur le risque cardio-métabolisme et sur la sensibilité aux lésions d'ischémie-reperfusion in vivo chez la … (2023)[PDF]
- Rôle du couple TSPO-STAR dans l'accumulation du cholestérol dans la mitochondrie au cours de l'ischémie-reperfusion myocardique. (2022)
- Ischémie-reperfusion cérébrale post-thrombectomie mécanique: modélisation probabiliste en artériographie à la phase hyper aigue et modélisation réaliste … (2022)[PDF]
- Delayed graft function: an ongoing clinical challenge (2023)2 citations
Ressources web
- Revue générale des syndromes coronariens aigus (msdmanuals.com)
28 juil. 2022 — Le traitement comprend des médicaments antiplaquettaires, des anticoagulants, des dérivés nitrés, des bêta-bloqueurs, et, pour les infarctus du ...
- Chapitre 05 - Item 339 : Syndromes coronariens aigus (sfcardio.fr)
L'IDM est défini par une nécrose des cardiomyocytes secondaire à une ischémie myocardique aiguë. Le diagnostic repose sur l'association d'une élévation suivie d ...
- Une stratégie efficace pour limiter le no-reflow et la taille de ... (medecinesciences.org)
de A Galaup · 2012 · Cité 1 fois — Tous ces phénomènes participent au phénomène de non-reperfusion (no-reflow) qui survient dans 20 à 40 % des cas et qui est associé à un mauvais pronostic ...
- Angor instable - Troubles cardiovasculaires (msdmanuals.com)
Les symptômes comprennent une gêne thoracique avec ou sans dyspnée, nausées et transpiration. Le diagnostic repose sur l'ECG et sur l'éventuelle présence de ...
- Prise en charge de l'infarctus du myocarde à la phase ... (has-sante.fr)
23 mars 2012 — La stratégie thérapeutique repose sur le traitement étiologique associé au traitement symptomatique et comporte une désobstruction coronaire ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
