Peste : Symptômes, Traitement et Prévention - Guide Complet 2025
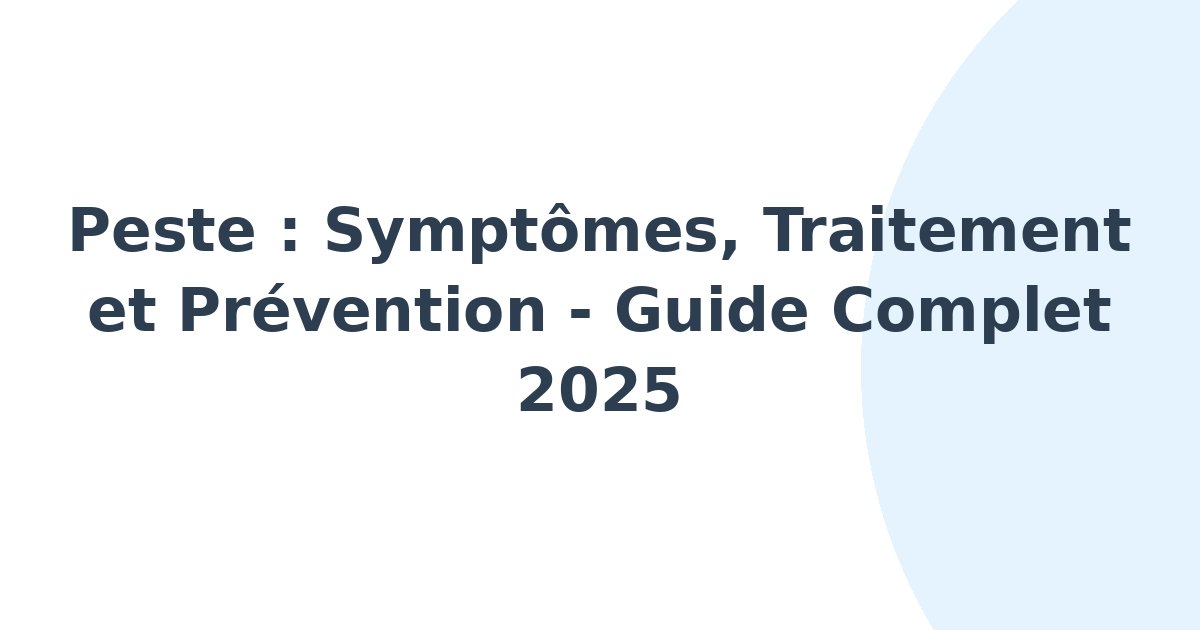
La peste reste une maladie infectieuse grave causée par la bactérie Yersinia pestis. Bien que rare aujourd'hui, elle nécessite une prise en charge médicale urgente. Cette pathologie, qui a marqué l'histoire de l'humanité, continue de préoccuper les autorités sanitaires mondiales. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie : symptômes, diagnostic, traitements actuels et mesures de prévention efficaces.
Téléconsultation et Peste
Téléconsultation non recommandéeLa peste est une maladie infectieuse grave nécessitant un diagnostic biologique urgent et une prise en charge hospitalière immédiate avec isolement. Le diagnostic repose sur des examens complémentaires spécialisés et la gravité potentielle de cette pathologie rend indispensable une évaluation clinique directe et une surveillance étroite.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation de l'exposition récente (voyage en zone endémique, contact avec rongeurs), description des symptômes initiaux (fièvre, frissons, céphalées), orientation vers une prise en charge d'urgence, suivi post-hospitalisation après traitement antibiotique.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Diagnostic biologique par prélèvements (hémocultures, ponction ganglionnaire), examen clinique des adénopathies, évaluation de l'état hémodynamique, mise en place d'un isolement approprié et d'un traitement antibiotique urgent.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion clinique de peste nécessitant des prélèvements bactériologiques urgents, présence d'adénopathies suspectes nécessitant un examen physique, signes de sepsis ou de choc nécessitant une évaluation hémodynamique, nécessité d'isolement et de déclaration obligatoire.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Fièvre élevée avec frissons intenses chez un patient ayant voyagé en zone endémique, adénopathies douloureuses et inflammatoires rapidement évolutives, signes de détresse respiratoire évoquant une forme pulmonaire.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Fièvre élevée (>39°C) avec frissons intenses après exposition en zone endémique
- Adénopathies volumineuses, douloureuses et inflammatoires d'évolution rapide
- Difficultés respiratoires, toux avec expectoration sanglante (forme pulmonaire)
- Signes de choc (hypotension, tachycardie, marbrures cutanées)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Infectiologue — consultation en présentiel indispensable
La peste nécessite impérativement une prise en charge hospitalière spécialisée en infectiologie avec isolement, diagnostic biologique urgent et traitement antibiotique intraveineux. Cette pathologie fait l'objet d'une déclaration obligatoire et nécessite des mesures de santé publique.
Peste : Définition et Vue d'Ensemble
La peste est une maladie infectieuse causée par la bactérie Yersinia pestis. Cette pathologie zoonotique se transmet principalement par les puces infectées des rongeurs sauvages [2,8]. Mais elle peut aussi se propager d'homme à homme dans sa forme pulmonaire.
Il existe trois formes principales de peste. La peste bubonique représente la forme la plus courante, caractérisée par des ganglions lymphatiques enflés appelés bubons. La peste septicémique survient quand la bactérie envahit la circulation sanguine. Enfin, la peste pulmonaire affecte les poumons et constitue la forme la plus grave [3,8].
Contrairement aux idées reçues, la peste n'a pas disparu. L'Organisation mondiale de la santé recense encore 1 000 à 3 000 cas par an dans le monde [2]. Cette maladie reste endémique dans certaines régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. D'ailleurs, des cas sporadiques continuent d'être signalés aux États-Unis [5].
La peste a façonné l'histoire humaine à travers plusieurs pandémies dévastatrices. La plus célèbre, la "Mort Noire" du XIVe siècle, a tué environ un tiers de la population européenne [6,7]. Ces épidémies historiques nous rappellent l'importance de maintenir une surveillance épidémiologique constante.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la peste a pratiquement disparu depuis le début du XXe siècle. Santé Publique France ne recense aucun cas autochtone depuis plusieurs décennies [1]. Cependant, la surveillance épidémiologique reste active, notamment dans le cadre des recommandations sanitaires aux voyageurs .
Les données historiques montrent que les épidémies de peste ont entraîné une surmortalité considérable en France [1]. Ces analyses rétrospectives permettent aujourd'hui de mieux comprendre la dynamique de propagation de cette pathologie. D'ailleurs, elles contribuent aux modèles prédictifs développés dans le cadre de la stratégie France 2030 [4].
À l'échelle mondiale, la situation épidémiologique varie considérablement selon les régions. Madagascar reste le pays le plus touché avec environ 400 cas annuels [2]. La République démocratique du Congo et le Pérou signalent également des cas réguliers. Aux États-Unis, 1 à 17 cas sont rapportés chaque année, principalement dans les États de l'Ouest [5].
L'évolution épidémiologique récente montre une stabilisation du nombre de cas mondiaux. Néanmoins, les changements climatiques et l'urbanisation croissante pourraient modifier cette dynamique . C'est pourquoi les autorités sanitaires maintiennent une vigilance constante, comme le souligne le rapport annuel 2023 de Santé Publique France .
Les Causes et Facteurs de Risque
La bactérie Yersinia pestis constitue l'agent causal unique de la peste. Cette bactérie gram-négative survit dans l'organisme de nombreux mammifères, principalement les rongeurs sauvages [8]. Les puces jouent le rôle de vecteur en se nourrissant du sang d'animaux infectés.
Plusieurs facteurs augmentent le risque d'exposition à cette pathologie. Les activités professionnelles en contact avec les rongeurs sauvages représentent un facteur de risque majeur. Les vétérinaires, les chasseurs et les campeurs dans les zones endémiques sont particulièrement exposés [3,8]. De plus, les maladies d'hygiène précaires favorisent la prolifération des puces vectrices.
Les voyages dans les régions endémiques constituent un autre facteur de risque important. C'est pourquoi les recommandations sanitaires aux voyageurs incluent des mesures préventives spécifiques . Les zones rurales d'Afrique subsaharienne, de Madagascar et de certaines régions d'Asie nécessitent une vigilance particulière.
Certaines populations présentent une vulnérabilité accrue. Les personnes immunodéprimées, les enfants et les personnes âgées développent plus facilement les formes graves de la maladie [8]. L'état nutritionnel et les comorbidités influencent également l'évolution clinique de cette pathologie.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la peste varient selon la forme clinique de la maladie. Mais toutes les formes débutent généralement par un syndrome fébrile brutal avec fièvre élevée, frissons et malaise général [8]. Ces signes apparaissent 1 à 7 jours après l'exposition à la bactérie.
La peste bubonique se caractérise par l'apparition de ganglions lymphatiques très douloureux et enflés, appelés bubons. Ces bubons mesurent généralement 1 à 10 centimètres de diamètre et siègent le plus souvent au niveau de l'aine, des aisselles ou du cou [8]. La peau recouvrant le bubon devient rouge et chaude au toucher.
Dans la forme septicémique, les symptômes incluent des troubles digestifs sévères. Vous pourriez ressentir des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales intenses. Des hémorragies cutanées sous forme de petites taches violacées peuvent également apparaître [3,8]. Cette forme évolue rapidement vers un état de choc si elle n'est pas traitée.
La peste pulmonaire présente des symptômes respiratoires alarmants. Une toux productive avec des crachats sanglants constitue le signe le plus caractéristique. L'essoufflement, les douleurs thoraciques et la détresse respiratoire s'installent rapidement [8]. Cette forme représente une urgence médicale absolue car elle peut être fatale en 24 à 48 heures sans traitement.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la peste repose sur un faisceau d'arguments cliniques, épidémiologiques et biologiques. L'interrogatoire médical recherche systématiquement les facteurs d'exposition : voyage récent en zone endémique, contact avec des rongeurs ou activité à risque [8]. Cette étape est cruciale car elle oriente immédiatement la suspicion diagnostique.
L'examen clinique permet d'identifier la forme de peste. La palpation des aires ganglionnaires révèle la présence éventuelle de bubons caractéristiques. L'auscultation pulmonaire recherche des signes de pneumonie dans les formes respiratoires [3,8]. Mais attention, l'absence de bubon n'élimine pas le diagnostic de peste septicémique.
Les examens biologiques confirment le diagnostic. La culture bactérienne reste l'examen de référence, réalisée sur différents prélèvements selon la forme clinique. Pour la peste bubonique, on prélève le contenu du bubon par ponction. Dans les formes pulmonaires, l'analyse des crachats ou du liquide de lavage broncho-alvéolaire est nécessaire [8].
Les techniques de diagnostic rapide se sont considérablement améliorées. La PCR (réaction en chaîne par polymérase) permet une détection rapide de l'ADN bactérien en quelques heures. Les tests antigéniques rapides offrent également des résultats préliminaires en moins d'une heure [8]. Ces innovations diagnostiques s'inscrivent dans la stratégie France 2030 pour les maladies infectieuses émergentes [4].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la peste repose sur une antibiothérapie précoce et adaptée. La rapidité de mise en œuvre maladiene directement le pronostic de cette pathologie. D'ailleurs, un traitement débuté dans les 24 premières heures améliore considérablement les chances de guérison [8].
La streptomycine reste l'antibiotique de référence pour traiter la peste. Elle s'administre par voie intramusculaire à la dose de 1 gramme toutes les 12 heures chez l'adulte. Cependant, sa disponibilité limitée dans certains pays a conduit au développement d'alternatives thérapeutiques [3,8]. Les fluoroquinolones comme la ciprofloxacine constituent une option de première ligne.
D'autres antibiotiques montrent une efficacité prouvée contre Yersinia pestis. La doxycycline peut être utilisée par voie orale dans les formes moins sévères. Le chloramphénicol reste indiqué dans les formes méningées de la maladie. Ces alternatives permettent d'adapter le traitement selon la forme clinique et les contre-indications [8].
Le traitement symptomatique accompagne systématiquement l'antibiothérapie. La prise en charge de la fièvre, de la douleur et des troubles hydro-électrolytiques est essentielle. Dans les formes graves, une hospitalisation en réanimation peut s'avérer nécessaire [8]. Les mesures d'isolement respiratoire sont obligatoires pour les formes pulmonaires contagieuses.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
La recherche sur la peste bénéficie d'un nouvel élan grâce à la stratégie France 2030 sur les maladies infectieuses émergentes [4]. Cette initiative vise à développer de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques pour faire face aux menaces biologiques. Les investissements portent notamment sur les technologies de diagnostic rapide et les traitements innovants.
Les recherches récentes explorent les mécanismes de la mort cellulaire induite par Yersinia pestis. Ces travaux, soutenus par des programmes européens, pourraient déboucher sur de nouvelles approches thérapeutiques . L'objectif est de développer des traitements ciblant spécifiquement les voies de signalisation impliquées dans la pathogenèse.
L'Institut Pasteur de Lille contribue activement à ces recherches dans le cadre de sa mission "Santé pour tous" . Les équipes travaillent sur l'amélioration des vaccins existants et le développement de nouvelles stratégies préventives. Ces travaux s'inscrivent dans une approche globale de lutte contre les maladies infectieuses négligées.
Les innovations en matière de diagnostic moléculaire révolutionnent la prise en charge de la peste. Les nouvelles plateformes de PCR multiplex permettent une détection simultanée de plusieurs agents pathogènes [4]. Cette approche s'avère particulièrement utile dans les contextes épidémiques où plusieurs maladies peuvent coexister.
Vivre au Quotidien avec Peste
Heureusement, la peste se guérit complètement avec un traitement antibiotique approprié. La plupart des patients récupèrent totalement sans séquelles à long terme [8]. Cependant, la période de convalescence nécessite quelques précautions et un suivi médical régulier.
Pendant la phase de traitement, il est normal de ressentir une fatigue importante. Votre organisme mobilise toutes ses ressources pour lutter contre l'infection. Le repos est donc essentiel pour favoriser la guérison. D'ailleurs, la reprise progressive des activités habituelles doit se faire en accord avec votre médecin [8].
Les formes pulmonaires de la peste nécessitent des mesures d'isolement temporaires. Ces précautions protègent votre entourage du risque de transmission. Rassurez-vous, l'isolement ne dure que 48 à 72 heures après le début du traitement antibiotique efficace [3]. Votre famille peut ensuite reprendre un contact normal avec vous.
Le suivi médical post-traitement permet de s'assurer de la guérison complète. Des examens de contrôle vérifient l'absence de complications et la normalisation des paramètres biologiques. Cette surveillance est particulièrement importante chez les patients ayant présenté une forme grave de la maladie [8].
Les Complications Possibles
Bien que rare avec un traitement précoce, la peste peut entraîner des complications graves. La septicémie représente la complication la plus redoutable, pouvant évoluer vers un choc septique [8]. Cette situation d'urgence nécessite une prise en charge en réanimation avec support des fonctions vitales.
Les complications pulmonaires surviennent principalement dans les formes respiratoires non traitées. L'œdème pulmonaire aigu et le syndrome de détresse respiratoire aiguë peuvent se développer rapidement. Ces complications expliquent la mortalité élevée de la peste pulmonaire en l'absence de traitement [3,8].
Plus rarement, la peste peut se compliquer de méningite. Cette forme neurologique se manifeste par des maux de tête intenses, une raideur de la nuque et des troubles de la conscience. Le diagnostic repose sur l'analyse du liquide céphalo-rachidien qui révèle la présence de la bactérie [8].
Les complications hémorragiques constituent une autre manifestation grave de la peste. Elles résultent de troubles de la coagulation induits par la septicémie. Ces hémorragies peuvent toucher différents organes et nécessitent une correction des troubles de l'hémostase [8]. Heureusement, ces complications restent exceptionnelles avec les traitements modernes.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la peste dépend essentiellement de la précocité du traitement. Avec une antibiothérapie débutée dans les premières 24 heures, le taux de guérison dépasse 95% pour la peste bubonique [8]. Cette forme présente généralement le meilleur pronostic parmi les trois types de peste.
La peste septicémique non traitée présente un pronostic plus sombre avec une mortalité pouvant atteindre 100%. Cependant, un traitement antibiotique précoce ramène cette mortalité à moins de 15% [8]. L'état général du patient et la présence de comorbidités influencent également l'évolution.
La forme pulmonaire reste la plus préoccupante en termes de pronostic. Sans traitement, elle est pratiquement toujours fatale en 2 à 4 jours. Même avec un traitement approprié, la mortalité reste élevée, autour de 50% [3,8]. Cette gravité explique l'importance cruciale du diagnostic précoce et de l'isolement des patients.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic de cette pathologie. L'âge du patient, son état immunitaire et la rapidité de prise en charge constituent les éléments déterminants. Les innovations diagnostiques récentes permettent heureusement une détection plus rapide [4]. Cela améliore considérablement les chances de guérison pour tous les patients.
Peut-on Prévenir Peste ?
La prévention de la peste repose principalement sur l'évitement de l'exposition aux vecteurs et réservoirs. La lutte contre les rongeurs et leurs puces constitue la mesure préventive la plus efficace [8]. Cette approche s'avère particulièrement importante dans les zones d'endémie où la surveillance des populations de rongeurs est essentielle.
Pour les voyageurs se rendant dans les régions à risque, plusieurs précautions s'imposent. Les recommandations sanitaires aux voyageurs insistent sur l'importance d'éviter le contact avec les rongeurs morts ou malades . Il est également conseillé d'utiliser des répulsifs contre les puces et de porter des vêtements longs dans les zones rurales.
La vaccination contre la peste existe mais son utilisation reste limitée. Elle est réservée aux personnes à très haut risque d'exposition professionnelle, comme certains chercheurs ou militaires [8]. L'efficacité de ce vaccin n'est que partielle et temporaire, nécessitant des rappels réguliers.
L'éducation sanitaire joue un rôle crucial dans la prévention. Les populations vivant dans les zones endémiques doivent être informées des signes d'alerte et des mesures préventives. Cette sensibilisation s'inscrit dans les programmes de santé publique soutenus par l'initiative "Santé pour tous" . La détection précoce des cas permet d'éviter la propagation de la maladie.
Recommandations des Autorités de Santé
Santé Publique France maintient une surveillance épidémiologique active de la peste, bien qu'aucun cas autochtone ne soit recensé sur le territoire . Cette vigilance s'inscrit dans le cadre plus large de la surveillance des maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes. Les données sont régulièrement publiées dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire .
Les recommandations sanitaires aux voyageurs sont mises à jour annuellement par les autorités françaises . Ces guidelines précisent les zones à risque et les mesures préventives à adopter. Madagascar, certaines régions d'Afrique subsaharienne et quelques États américains font l'objet d'une attention particulière. Les professionnels de santé sont invités à questionner systématiquement leurs patients sur leurs voyages récents.
La stratégie France 2030 pour les maladies infectieuses émergentes inclut la peste parmi les pathologies prioritaires [4]. Cette approche vise à renforcer les capacités de diagnostic, de traitement et de surveillance. L'objectif est de maintenir la France à la pointe de la lutte contre les menaces biologiques émergentes.
L'Organisation mondiale de la santé coordonne la surveillance internationale de la peste [2]. Les pays endémiques sont tenus de déclarer les cas à l'OMS dans le cadre du Règlement sanitaire international. Cette coopération permet une réponse coordonnée en cas d'épidémie et facilite le partage des bonnes pratiques entre les pays.
Ressources et Associations de Patients
Bien que la peste soit rare en France, plusieurs ressources sont disponibles pour les patients et leurs familles. L'Institut Pasteur propose des informations détaillées sur cette pathologie à travers ses fiches maladies [8]. Ces documents, régulièrement mis à jour, constituent une source fiable d'information médicale pour le grand public.
Les centres de référence des maladies infectieuses rares peuvent être consultés en cas de besoin. Ces structures spécialisées disposent de l'expertise nécessaire pour la prise en charge des cas complexes. Elles participent également à la formation des professionnels de santé et à la recherche clinique .
Pour les voyageurs, les centres de vaccinations internationales constituent des ressources précieuses. Ces structures délivrent les conseils personnalisés selon la destination et le profil du voyageur. Elles sont également habilitées à prescrire les traitements préventifs si nécessaire .
Les associations de patients atteints de maladies infectieuses rares peuvent apporter un soutien psychologique et social. Bien que spécifiquement dédiées à la peste, ces organisations offrent un accompagnement aux personnes confrontées à des pathologies graves et méconnues. Le partage d'expériences entre patients constitue souvent une aide précieuse.
Nos Conseils Pratiques
Si vous voyagez dans une zone où la peste est endémique, quelques précautions simples peuvent considérablement réduire votre risque d'exposition. Évitez tout contact avec les rongeurs morts ou malades que vous pourriez rencontrer [8]. Cette règle s'applique particulièrement lors de randonnées ou de camping dans les zones rurales.
Protégez-vous efficacement contre les puces en utilisant des répulsifs adaptés. Appliquez ces produits sur la peau exposée et sur les vêtements. Portez des pantalons longs et des chaussures fermées, surtout dans les zones herbeuses ou broussailleuses . Ces mesures simples constituent votre première ligne de défense.
En cas de fièvre ou de symptômes suspects après un voyage en zone à risque, consultez rapidement un médecin. Mentionnez systématiquement votre voyage et les activités pratiquées. Cette information est cruciale pour orienter le diagnostic [8]. N'hésitez pas à vous rendre aux urgences si les symptômes s'aggravent rapidement.
Pour les professionnels exposés, le respect des mesures de biosécurité est essentiel. Le port d'équipements de protection individuelle et la vaccination peuvent être recommandés selon le niveau d'exposition [8]. La formation régulière aux bonnes pratiques constitue également un élément clé de la prévention professionnelle.
Quand Consulter un Médecin ?
Consultez immédiatement un médecin si vous développez une fièvre élevée après un voyage dans une zone où la peste est présente. Cette consultation devient urgente si la fièvre s'accompagne de frissons intenses, de maux de tête sévères ou de malaise général [8]. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent car la précocité du traitement maladiene le pronostic.
L'apparition d'un ganglion douloureux et enflé doit vous alerter, surtout après une exposition potentielle. Ces bubons caractéristiques de la peste bubonique nécessitent une évaluation médicale immédiate [8]. Même si d'autres causes sont possibles, seul un médecin peut établir le diagnostic différentiel approprié.
Les symptômes respiratoires associés à la fièvre constituent une urgence absolue. Une toux avec des crachats sanglants, un essoufflement ou des douleurs thoraciques doivent vous conduire aux urgences sans délai [3,8]. La peste pulmonaire évolue très rapidement et nécessite une prise en charge immédiate.
En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter par excès de prudence. Les professionnels de santé sont formés pour évaluer le risque et orienter les examens si nécessaire. D'ailleurs, mentionnez toujours vos voyages récents et vos activités à risque lors de la consultation . Cette information guide le médecin dans sa démarche diagnostique.
Questions Fréquentes
La peste peut-elle réapparaître en France ?
Bien que très improbable, la réapparition de la peste en France n'est pas impossible. Les autorités sanitaires maintiennent une surveillance active pour détecter rapidement tout cas importé. Les mesures de contrôle aux frontières et la surveillance des rongeurs contribuent à prévenir ce risque.
Existe-t-il un vaccin efficace contre la peste ?
Un vaccin contre la peste existe mais son utilisation reste très limitée. Il est réservé aux personnes à très haut risque d'exposition professionnelle. Son efficacité n'est que partielle et nécessite des rappels réguliers. La prévention repose donc principalement sur l'évitement de l'exposition.
La peste se transmet-elle d'homme à homme ?
Seule la forme pulmonaire de la peste peut se transmettre directement d'homme à homme par voie respiratoire. Les formes bubonique et septicémique ne sont pas contagieuses entre humains. C'est pourquoi l'isolement n'est nécessaire que pour les patients atteints de peste pulmonaire.
Combien de temps dure le traitement de la peste ?
Le traitement antibiotique de la peste dure généralement 10 à 14 jours selon la forme clinique et la réponse au traitement. L'amélioration clinique survient habituellement dans les 48 à 72 heures suivant le début du traitement.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID ...). Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] BEH – Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Les épidémies de peste ont entraîné une surmortalité des .... Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [4] Santé publique France publie son rapport annuel 2023. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [5] Peste. Organisation mondiale de la santé.Lien
- [6] LA PESTE. Santé Publique France.Lien
- [7] RECOMMANDATIONS SANITAIRES AUX VOYAGEURS. Ministère de la Santé. 2024-2025.Lien
- [8] France 2030 - Stratégie "Maladies infectieuses émergentes". Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] SANTÉ pour tous. Institut Pasteur de Lille. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [10] Les secrets de la mort cellulaire pourraient améliorer les traitements des maladies inflammatoires. CORDIS. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [12] A Case of the Plague Confirmed in the US. Contagion Live. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [13] Documents inédits sur la grande peste de 1348. J Michon. 2023.Lien
- [14] Image et événement: l'art sans la peste (c. 1348-c. 1400)?. J Baschet. Images Re-vues. 2023.Lien
- [21] Peste : symptômes, traitement, prévention. Institut Pasteur.Lien
Publications scientifiques
- [LIVRE][B] Documents inédits sur la grande peste de 1348 (2023)18 citations
- Image et événement: l'art sans la peste (c. 1348-c. 1400)? (2023)13 citations
- Recapitulation of Peste des Petits Ruminants (PPR) prevalence in small ruminant populations of Pakistan from 2004 to 2023: a systematic review and meta-analysis (2024)5 citations
- Peste Des Petits Ruminants in the Middle East: Epidemiological Situation and Status of Control and Eradication Activities after the First Phase of the PPR Global … (2023)22 citations
- La peste équine: une maladie ancienne pour une menace actuelle (2022)4 citations
Ressources web
- Peste : symptômes, traitement, prévention (pasteur.fr)
Le diagnostic clinique de la peste se fait en présence des symptômes et d'une notion de voyage en zone d'endémie ou de contact avec un malade de la peste. Il ...
- Peste (who.int)
7 juil. 2022 — Les sujets infectés présentent en général un état fébrile aigu et d'autres symptômes systémiques non spécifiques après une période d'incubation ...
- LA PESTE (santepubliquefrance.fr)
Manifestations : apparition brutale d'une forte fièvre, de frissons, d'une altération parfois grave de l'état général, et d'un (parfois plusieurs) ganglions ...
- Peste et autres infections à Yersinia (msdmanuals.com)
Le diagnostic est confirmé par l'identification de la bactérie dans des échantillons de sang, d'expectorations ou de pus prélevé dans les ganglions lymphatiques ...
- Faut-il encore craindre la peste aujourd'hui (medecinesciences.org)
de F Guinet · 2008 — Lorsqu'un être humain est piqué par une puce de rongeur infecté, il développe un syndrome infectieux sévère accompagné d'une adénopathie volumineuse et ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
