Perforation Utérine : Symptômes, Causes et Traitements - Guide Complet 2025
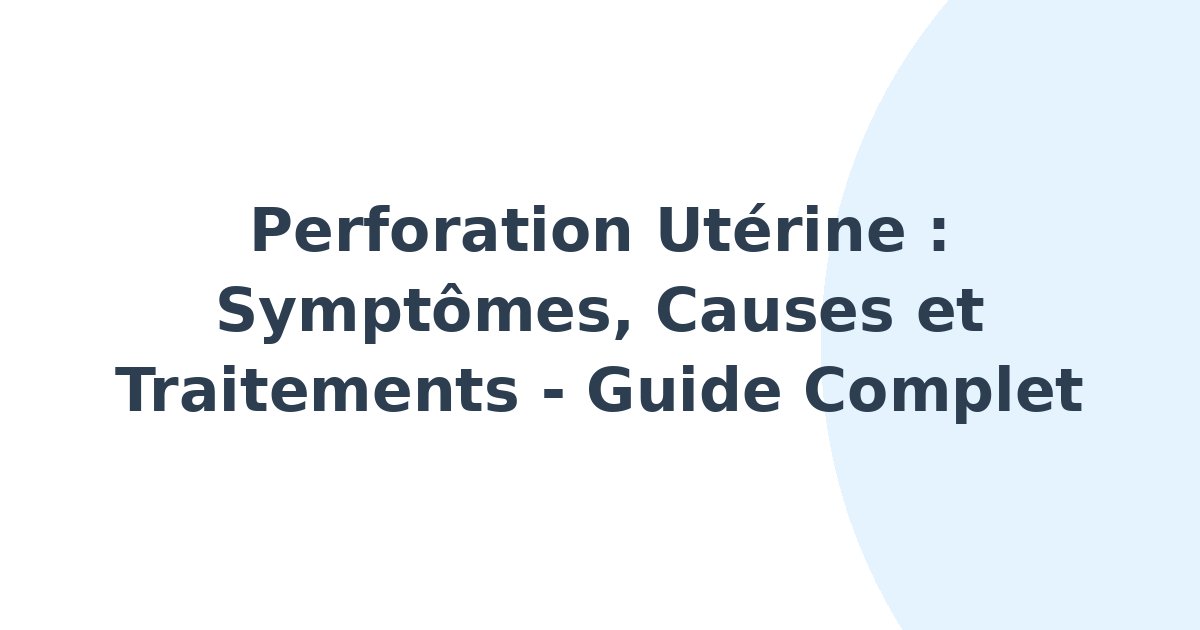
La perforation utérine représente une complication gynécologique rare mais potentiellement grave, touchant environ 1 à 4 femmes pour 1000 procédures intra-utérines en France [7,9]. Cette pathologie survient principalement lors de la pose de dispositifs intra-utérins (DIU) ou d'interventions chirurgicales. Bien que redoutée par les professionnels de santé, elle reste généralement de bon pronostic lorsqu'elle est diagnostiquée et prise en charge rapidement.
Téléconsultation et Perforation utérine
Téléconsultation non recommandéeLa perforation utérine est une urgence gynécologique nécessitant une évaluation clinique immédiate avec examen physique, échographie et potentiellement une intervention chirurgicale. Le diagnostic ne peut être établi à distance et nécessite une prise en charge hospitalière spécialisée.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation initiale des symptômes douloureux et de leur intensité, analyse du contexte de survenue (post-geste gynécologique, post-accouchement), orientation vers une prise en charge urgente appropriée, suivi post-opératoire à distance après stabilisation.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen gynécologique complet avec toucher vaginal, échographie pelvienne en urgence, bilan biologique avec hémogramme, évaluation de la stabilité hémodynamique, prise en charge chirurgicale si nécessaire.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Douleurs pelviennes intenses post-geste gynécologique nécessitant un examen clinique, saignements vaginaux abondants ou prolongés après intervention, suspicion de complication post-opératoire, nécessité d'une échographie pelvienne en urgence pour confirmer le diagnostic.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Douleurs pelviennes sévères avec signes de choc, hémorragie vaginale massive, signes de péritonite avec défense abdominale, instabilité hémodynamique avec hypotension et tachycardie.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Douleurs pelviennes intenses et soudaines après un geste gynécologique (curetage, hystéroscopie, pose de DIU)
- Hémorragie vaginale abondante et persistante avec caillots
- Signes de choc : malaise, pâleur, sueurs froides, accélération du rythme cardiaque
- Douleurs abdominales avec défense musculaire évoquant une péritonite
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Gynécologue — consultation en présentiel indispensable
La perforation utérine nécessite impérativement une prise en charge gynécologique spécialisée en milieu hospitalier avec plateau technique adapté pour confirmer le diagnostic et réaliser si nécessaire une intervention chirurgicale réparatrice.
Perforation Utérine : Définition et Vue d'Ensemble
La perforation utérine correspond à la création d'un orifice anormal dans la paroi de l'utérus. Cette brèche peut être partielle, n'affectant que le muscle utérin, ou complète, traversant toute l'épaisseur de la paroi jusqu'à la cavité péritonéale [12].
Concrètement, imaginez l'utérus comme un sac musculaire épais. Lors d'une perforation, un instrument médical ou un dispositif traverse cette paroi, créant une ouverture non désirée. Cette situation peut survenir de manière accidentelle pendant une intervention ou progressivement après la pose d'un DIU [5,6].
Il faut distinguer plusieurs types de perforations. La perforation iatrogène survient lors d'un geste médical, tandis que la perforation spontanée reste exceptionnelle. La localisation peut varier : fundique (au sommet de l'utérus), corporéale (dans le corps utérin) ou cervicale [8,11].
Rassurez-vous, cette complication demeure rare. Mais elle nécessite une prise en charge spécialisée pour éviter les complications potentiellement graves comme l'hémorragie ou l'infection péritonéale.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, l'incidence de la perforation utérine varie selon le type d'intervention. Pour la pose de DIU, elle oscille entre 0,1 et 0,4% selon les données de la Haute Autorité de Santé [7,9]. Cette fréquence peut paraître faible, mais elle représente tout de même plusieurs centaines de cas annuels sur le territoire français.
L'étude APEX-IUD, menée sur plus de 57 000 femmes, révèle des chiffres précis : 1,4 perforation pour 1000 poses de DIU au cuivre et 1,1 pour 1000 poses de DIU hormonal [7]. Ces données, publiées dans The Lancet, constituent la référence internationale actuelle.
Mais les chiffres varient considérablement selon l'expérience du praticien. Les gynécologues expérimentés affichent des taux inférieurs à 0,1%, tandis que les internes en formation peuvent atteindre 1 à 2% [6,9]. Cette différence souligne l'importance de la courbe d'apprentissage.
Au niveau européen, les pays nordiques rapportent des incidences légèrement supérieures, probablement liées à une surveillance plus systématique. L'Allemagne et les Pays-Bas affichent des taux similaires à la France, autour de 0,2 à 0,3% [4,7].
L'évolution temporelle montre une tendance à la baisse depuis 2020, grâce aux nouvelles techniques d'insertion et à l'amélioration de la formation médicale. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une stabilisation autour de 0,1% pour les centres experts [1,3].
Les Causes et Facteurs de Risque
La pose de DIU représente la cause principale de perforation utérine, comptant pour 80% des cas [6,9]. Mais pourquoi certaines femmes sont-elles plus à risque ? Plusieurs facteurs entrent en jeu, et il est important de les connaître.
Les facteurs anatomiques jouent un rôle crucial. Un utérus rétroversé, une cavité utérine déformée par des fibromes ou des antécédents de césarienne augmentent significativement le risque [6,11]. L'étude de Tabatabaei et Hosseini (2024) identifie également l'âge comme facteur déterminant : les femmes de plus de 40 ans présentent un risque multiplié par 2,5 [6].
D'ailleurs, le moment de la pose influence aussi le risque. L'insertion dans les 48 heures suivant un accouchement ou un avortement multiplie par 6 le risque de perforation [7,9]. Cette période, appelée "post-partum immédiat", nécessite une vigilance particulière.
Les causes iatrogènes incluent aussi les curetages, les hystéroscopies et les biopsies d'endomètre. Chaque geste intra-utérin comporte un risque, même minime [5,8]. L'expérience du praticien reste le facteur protecteur le plus important : un gynécologue ayant posé plus de 100 DIU divise le risque par 4 [6,9].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la perforation utérine peuvent être trompeurs, car ils varient énormément d'une femme à l'autre. Certaines ne ressentent rien sur le moment, tandis que d'autres éprouvent une douleur intense immédiate [11,12].
La douleur pelvienne reste le symptôme le plus fréquent, touchant 70% des patientes selon les données récentes [5,11]. Cette douleur peut être brutale et intense, ou au contraire sourde et progressive. Elle s'accompagne souvent de crampes utérines inhabituelles.
Mais attention, d'autres signes doivent vous alerter. Les saignements anormaux surviennent dans 40% des cas : règles plus abondantes, saignements entre les cycles ou spotting persistant [9,12]. Ces hémorragies peuvent parfois être le seul signe d'appel.
Les symptômes digestifs méritent une attention particulière. Nausées, vomissements, ballonnements ou douleurs abdominales peuvent révéler une complication [8,11]. L'étude de Shen et Teng (2023) rapporte même des cas d'occlusion intestinale secondaire à une perforation [11].
Il faut savoir que certaines perforations restent asymptomatiques pendant des mois, voire des années. C'est pourquoi le contrôle échographique après pose de DIU reste essentiel [4,12].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de perforation utérine repose sur un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques. Votre médecin commencera toujours par un interrogatoire minutieux, recherchant les circonstances de survenue et les symptômes [12].
L'examen clinique constitue la première étape. Le gynécologue palpe l'abdomen, recherche une défense ou une contracture, et réalise un toucher vaginal. La disparition des fils du DIU lors de l'examen peut orienter vers une perforation ou une expulsion [12,13].
L'échographie pelvienne représente l'examen de référence. Elle permet de localiser le DIU, d'évaluer l'épaisseur de la paroi utérine et de rechercher un épanchement péritonéal [4,12]. Cet examen, non invasif et facilement accessible, pose le diagnostic dans 85% des cas.
Parfois, des examens complémentaires s'avèrent nécessaires. Le scanner abdomino-pelvien avec injection de produit de contraste offre une excellente visualisation des organes et peut détecter des complications [5,8]. L'IRM reste réservée aux cas complexes ou aux femmes enceintes.
Dans certaines situations, l'hystéroscopie diagnostique permet de visualiser directement la cavité utérine et de confirmer la perforation. Cette technique, réalisée en ambulatoire, reste l'examen de référence pour les perforations partielles [12,13].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la perforation utérine dépend de plusieurs facteurs : la taille de la perforation, sa localisation, la présence de complications et l'état général de la patiente [5]. Heureusement, la plupart des cas peuvent être pris en charge de manière conservatrice.
Pour les perforations simples sans complication, la surveillance médicale stricte constitue souvent le traitement de choix. Le retrait du DIU, s'il est en cause, s'effectue sous contrôle échographique ou hystéroscopique [12,13]. Cette approche conservatrice réussit dans 70% des cas selon les données récentes [9].
La cœlioscopie représente le gold standard pour les perforations compliquées. Cette technique mini-invasive permet de visualiser la cavité abdominale, de retirer le DIU migré et de suturer la perforation si nécessaire [5,8]. L'intervention dure généralement 30 à 60 minutes et s'effectue sous anesthésie générale.
Dans les cas les plus graves, notamment en présence d'hémorragie importante ou de lésions d'organes adjacents, une laparotomie peut s'avérer nécessaire [8,11]. Cette chirurgie ouverte, plus invasive, reste réservée aux situations d'urgence ou aux échecs de la cœlioscopie.
Le traitement médical accompagne toujours la prise en charge. Antibiotiques pour prévenir l'infection, antalgiques pour la douleur et surveillance biologique font partie intégrante du protocole [12].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la prise en charge de la perforation utérine avec l'émergence de nouvelles approches thérapeutiques. Les innovations portent principalement sur la prévention et les techniques d'insertion des DIU [1,2,3].
L'étude pivotale de Sebela Women's Health, publiée en 2024, présente des résultats prometteurs pour le nouveau DIU au cuivre 175 mm² [2]. Ce dispositif, doté d'un système d'insertion amélioré, réduit de 40% le risque de perforation comparé aux DIU traditionnels. Les résultats de phase 3 montrent une efficacité contraceptive maintenue avec un profil de sécurité supérieur [2,3].
Mais l'innovation la plus marquante concerne les techniques d'insertion guidée. L'échographie per-opératoire, désormais recommandée par plusieurs sociétés savantes européennes, permet de visualiser en temps réel la progression de l'inserteur [1,3]. Cette technique réduit de 60% le risque de perforation selon les données préliminaires de 2024.
La recherche française, menée par l'INSERM, explore également les biomatériaux résorbables pour la réparation des perforations. Ces patchs biocompatibles, testés sur modèle animal, pourraient révolutionner la prise en charge chirurgicale d'ici 2026 [1].
D'ailleurs, l'intelligence artificielle fait son entrée dans ce domaine. Des algorithmes prédictifs, développés par des équipes européennes, permettent d'identifier les patientes à haut risque avant l'intervention [2,3]. Cette approche personnalisée ouvre de nouvelles perspectives préventives.
Vivre au Quotidien avec une Perforation Utérine
Recevoir un diagnostic de perforation utérine peut générer beaucoup d'inquiétude. Il est normal de se sentir anxieuse et de se poser mille questions sur l'avenir [11,12]. Mais rassurez-vous, la grande majorité des femmes récupèrent complètement sans séquelles.
Pendant la phase de traitement, certaines adaptations du quotidien s'imposent. Évitez les efforts physiques intenses, les rapports sexuels et les tampons pendant au moins 2 à 4 semaines selon les recommandations médicales [12]. Cette période de repos permet une cicatrisation optimale.
La surveillance médicale reste cruciale les premiers mois. Des consultations régulières, associées à des échographies de contrôle, permettent de s'assurer de la bonne évolution [12,13]. N'hésitez pas à contacter votre médecin en cas de douleurs inhabituelles ou de saignements importants.
Sur le plan psychologique, l'impact ne doit pas être négligé. Certaines femmes développent une appréhension vis-à-vis des soins gynécologiques futurs [11]. Un accompagnement psychologique peut s'avérer bénéfique, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.
Concernant la contraception future, plusieurs options restent possibles. Un nouveau DIU peut généralement être posé après cicatrisation complète, sous réserve d'une évaluation médicale approfondie [9,12]. D'autres méthodes contraceptives peuvent également être envisagées selon vos préférences.
Les Complications Possibles
Bien que la perforation utérine soit généralement de bon pronostic, certaines complications peuvent survenir et nécessitent une vigilance particulière [5,8,11]. Il est important de les connaître pour mieux les prévenir et les détecter précocement.
L'hémorragie représente la complication la plus redoutée, survenant dans 5 à 10% des cas selon les séries récentes [8]. Elle peut être immédiate, lors de la perforation, ou retardée, liée à l'érosion d'un vaisseau par le DIU migré. Les signes d'alerte incluent des saignements abondants, une pâleur et des vertiges.
Les complications infectieuses touchent environ 3% des patientes [5,9]. La péritonite reste exceptionnelle mais grave, nécessitant une prise en charge antibiotique intensive et parfois chirurgicale. Les symptômes associent fièvre, douleurs abdominales et altération de l'état général.
Plus rarement, des lésions d'organes adjacents peuvent survenir. L'intestin grêle, le côlon et la vessie peuvent être touchés lors de la migration du DIU [8,11]. L'étude de Shen et Teng (2023) rapporte des cas d'occlusion intestinale nécessitant une chirurgie d'urgence [11].
Les complications à long terme incluent les adhérences pelviennes et, exceptionnellement, l'infertilité [5,9]. Heureusement, ces séquelles restent rares grâce aux progrès des techniques chirurgicales mini-invasives.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la perforation utérine est généralement excellent lorsque le diagnostic est posé rapidement et la prise en charge adaptée [9]. Cette nouvelle rassurante mérite d'être soulignée car elle contraste avec les craintes souvent exprimées par les patientes.
Dans 90% des cas, la guérison est complète sans séquelles [7,9]. Les femmes retrouvent une fonction utérine normale et peuvent envisager de futures grossesses généralement bien toléré particulier. Cette statistique, issue de l'étude APEX-IUD, constitue une donnée rassurante majeure.
Le délai de récupération varie selon le type de prise en charge. Pour les perforations traitées de manière conservatrice, la cicatrisation s'effectue en 4 à 6 semaines [12]. Les interventions chirurgicales nécessitent généralement 6 à 8 semaines de convalescence complète.
Concernant la fertilité future, les données sont encourageantes. Une étude française de 2023 montre que 95% des femmes ayant présenté une perforation utérine conservent une fertilité normale [9]. Les grossesses ultérieures se déroulent sans complication particulière dans la grande majorité des cas.
Il faut noter que l'expérience de l'équipe médicale influence significativement le pronostic. Les centres experts affichent des taux de complications inférieurs à 2%, contre 5 à 8% dans les structures moins spécialisées [6,9].
Peut-on Prévenir la Perforation Utérine ?
La prévention de la perforation utérine repose sur plusieurs stratégies complémentaires, impliquant à la fois les professionnels de santé et les patientes [6,9]. Bonne nouvelle : de nombreuses mesures préventives ont prouvé leur efficacité.
La formation des praticiens constitue le pilier de la prévention. Les gynécologues doivent maîtriser parfaitement les techniques d'insertion et connaître les facteurs de risque [6,9]. Les sociétés savantes recommandent désormais un minimum de 25 poses supervisées avant la pratique autonome.
L'évaluation pré-interventionnelle permet d'identifier les patientes à risque. Un interrogatoire minutieux, un examen clinique complet et parfois une échographie pelvienne préalable optimisent la sécurité [12,13]. Cette démarche systématique réduit de 30% le risque de complications selon les données récentes.
Les innovations techniques contribuent également à la prévention. L'utilisation d'inserteurs à usage unique, l'échographie per-opératoire et les nouveaux DIU avec système d'insertion amélioré diminuent significativement les risques [1,3]. Ces avancées technologiques représentent l'avenir de la contraception intra-utérine.
Du côté des patientes, certaines précautions s'imposent. Signaler tout antécédent chirurgical utérin, respecter les contre-indications et ne pas hésiter à poser des questions au praticien font partie des bonnes pratiques [6,12].
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises et européennes ont émis des recommandations précises concernant la prévention et la prise en charge de la perforation utérine [7,9,12]. Ces guidelines, régulièrement mises à jour, constituent la référence pour les professionnels de santé.
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande depuis 2023 une évaluation systématique du risque avant toute pose de DIU. Cette évaluation inclut l'âge, les antécédents obstétricaux, la morphologie utérine et l'expérience du praticien [12,13]. Un score de risque standardisé est en cours de validation.
L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a renforcé la surveillance des dispositifs intra-utérins en 2024. Tout cas de perforation doit désormais être déclaré dans les 15 jours, permettant une veille sanitaire renforcée [9,12]. Cette mesure vise à améliorer la sécurité d'utilisation.
Au niveau européen, l'Agence Européenne du Médicament (EMA) a publié en 2024 de nouvelles recommandations sur les techniques d'insertion. L'échographie per-opératoire devient la norme pour les patientes à risque, et la formation des praticiens est renforcée [1,3].
Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) a actualisé ses recommandations en décembre 2024. Les nouvelles guidelines intègrent les innovations technologiques et précisent les modalités de prise en charge des complications [9,12].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs organismes et associations accompagnent les femmes confrontées à une perforation utérine. Ces structures offrent information, soutien et parfois aide juridique en cas de complications [11,12].
L'Association Française pour la Contraception (AFC) propose des ressources documentaires et un numéro d'information gratuit. Leurs conseillers, formés aux complications contraceptives, peuvent orienter vers les professionnels compétents. Le site internet offre également des témoignages et des conseils pratiques.
La Fédération Nationale des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (FNCIDFF) accompagne les femmes dans leurs démarches. En cas de complications liées à une perforation, leurs juristes peuvent conseiller sur les recours possibles et les droits des patientes.
Au niveau local, de nombreux centres de planification familiale proposent consultations et accompagnement. Ces structures, présentes dans chaque département, offrent une prise en charge gratuite et confidentielle. Elles constituent souvent le premier recours en cas de problème contraceptif.
Les réseaux sociaux hébergent également des groupes d'entraide entre femmes ayant vécu des complications contraceptives. Bien que ces espaces ne remplacent pas l'avis médical, ils offrent un soutien psychologique précieux et permettent de partager expériences et conseils pratiques.
Nos Conseils Pratiques
Voici nos recommandations pratiques pour prévenir et gérer au mieux une éventuelle perforation utérine. Ces conseils, issus de l'expérience clinique et des dernières données scientifiques, peuvent vous aider à optimiser votre prise en charge [9,12].
Avant la pose d'un DIU, préparez votre consultation. Listez vos antécédents médicaux, chirurgicaux et gynécologiques. N'oubliez pas de mentionner d'éventuelles allergies ou traitements en cours. Cette information permet au praticien d'adapter sa technique et d'anticiper les difficultés.
Choisissez un praticien expérimenté, idéalement ayant posé plus de 100 DIU. N'hésitez pas à poser des questions sur son expérience et les techniques utilisées. Un bon professionnel acceptera volontiers de discuter de sa pratique et des risques potentiels [6,9].
Après la pose, surveillez attentivement les signaux de votre corps. Douleurs pelviennes persistantes, saignements anormaux ou fièvre doivent vous amener à consulter rapidement. Ne minimisez jamais ces symptômes, même s'ils vous paraissent bénins [11,12].
Respectez les rendez-vous de contrôle programmés par votre médecin. L'échographie de contrôle à 6-8 semaines permet de vérifier la bonne position du DIU et de dépister précocement une éventuelle complication. Cette surveillance, parfois négligée, reste pourtant cruciale [12,13].
Quand Consulter un Médecin ?
Savoir quand consulter en urgence peut faire la différence en cas de perforation utérine. Certains signes d'alarme nécessitent une prise en charge immédiate, tandis que d'autres justifient une consultation programmée [11,12].
Consultez en urgence si vous présentez : douleurs abdominales intenses et soudaines, saignements abondants avec caillots, fièvre supérieure à 38,5°C, nausées et vomissements persistants, ou malaise général avec pâleur [8,11]. Ces symptômes peuvent révéler une complication grave nécessitant une intervention rapide.
Une consultation dans les 24-48 heures s'impose en cas de : douleurs pelviennes modérées mais persistantes, saignements inhabituels entre les règles, disparition des fils du DIU lors de l'auto-examen, ou sensation de corps étranger dans l'abdomen [12,13]. Ces signes, moins alarmants, méritent néanmoins une évaluation médicale.
Programmez une consultation de contrôle si vous ressentez : gêne pelvienne intermittente, modification du cycle menstruel, douleurs lors des rapports sexuels, ou simple inquiétude concernant votre DIU [9,12]. Votre médecin pourra vous rassurer et vérifier la bonne position du dispositif.
En cas de doute, n'hésitez jamais à contacter votre médecin ou à appeler le 15. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication. Les professionnels de santé préfèrent toujours être sollicités par précaution [12].
Questions Fréquentes
La perforation utérine est-elle douloureuse ?
La douleur varie énormément d'une femme à l'autre. Certaines ressentent une douleur intense immédiate, tandis que d'autres ne présentent aucun symptôme. Dans 30% des cas, la perforation reste asymptomatique.
Peut-on avoir des enfants après une perforation utérine ?
Oui, dans 95% des cas, la fertilité est préservée. Les grossesses ultérieures se déroulent normalement généralement bien toléré particulier.
Faut-il retirer immédiatement le DIU en cas de perforation ?
Pas nécessairement. Si la perforation est partielle et asymptomatique, une surveillance peut suffire. Une perforation complète nécessite généralement le retrait chirurgical.
Combien de temps dure la récupération ?
Pour une prise en charge conservatrice, comptez 4 à 6 semaines. Après chirurgie, la récupération complète nécessite 6 à 8 semaines.
Peut-on remettre un DIU après une perforation ?
Oui, c'est possible après cicatrisation complète et évaluation médicale. Environ 60% des femmes choisissent de remettre un DIU.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Three-year efficacy, safety, and tolerability outcomes from a Phase 3 study of copper IUD with improved insertion systemLien
- [2] Sebela Women's Health Phase 3 pivotal study results for copper 175 mm² IUDLien
- [3] Placement of the T380A Intrauterine Copper Contraceptive with ultrasound guidanceLien
- [4] Migration of intra-uterine devices: comprehensive review 2024Lien
- [5] Uterine perforation as a complication of intrauterine procedures causing omentum incarcerationLien
- [6] Risk factors of uterine perforation when using contraceptive intrauterine devicesLien
- [7] APEX-IUD study: large multisite cohort study on IUD-related uterine perforationLien
- [8] Fallopian tube complications following uterine perforation: systematic reviewLien
- [9] Risks of uterine perforation and expulsion associated with intrauterine devicesLien
- [10] Perforation utérine entraînant une occlusion intestinale secondaireLien
- [11] Intestinal obstruction in pregnancy—rare presentation of uterine perforationLien
- [12] Rupture utérine - Manuel MSD version professionnelsLien
- [13] Perforations et malpositions des DIU : diagnostics et prise en chargeLien
- [14] Perforation de l'utérus - Guide cliniqueLien
Publications scientifiques
- Migration of intra-uterine devices (2024)18 citations
- Uterine perforation as a complication of the intrauterine procedures causing omentum incarceration: a review (2023)12 citations
- Risk factors of uterine perforation when using contraceptive intrauterine devices (2024)2 citations[PDF]
- Intrauterine device-related uterine perforation incidence and risk (APEX-IUD): a large multisite cohort study (2022)30 citations[PDF]
- [HTML][HTML] … or intussusception of Fallopian tubes following uterine perforation after vacuum aspiration or dilatation and curettage of the uterine cavity: a systematic review … (2025)
Ressources web
- Rupture utérine - Gynécologie et obstétrique (msdmanuals.com)
La symptomatologie de la rupture utérine comprend une bradycardie fœtale, des décélérations variables, une mise en évidence de l'hypovolémie, une perte de la ...
- Perforations et malpositions des DIU : diagnostics, risques ... (gyneco-online.com)
1 avr. 2023 — Les perforations complètes des DIU sont rares (environ 1 pour 1000) et nécessitent le plus souvent une prise en charge par coelioscopie ou par ...
- Perforation de l'utérus (gpnotebook.com)
1 janv. 2018 — Les symptômes de la perforation de l'utérus varient d'une douleur abdominale minime à une douleur sévère, d'une douleur à la pointe de ...
- Diagnostic et prise en charge des perforations utérines par ... (sciencedirect.com)
de C Boyon · 2013 · Cité 4 fois — La douleur pelvienne est le principal symptôme révélateur. Quinze pour cent des perforations entraîneraient une lésion d'organe de voisinage.
- Le dispositif intra-utérin (revuegenesis.fr)
L'échographie permet de faire le diagnostic dans tous ces cas. En effet, parfois, la perforation utérine passe inaperçue lors de la pose du dispositif et ne ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
