Néphrite Interstitielle : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
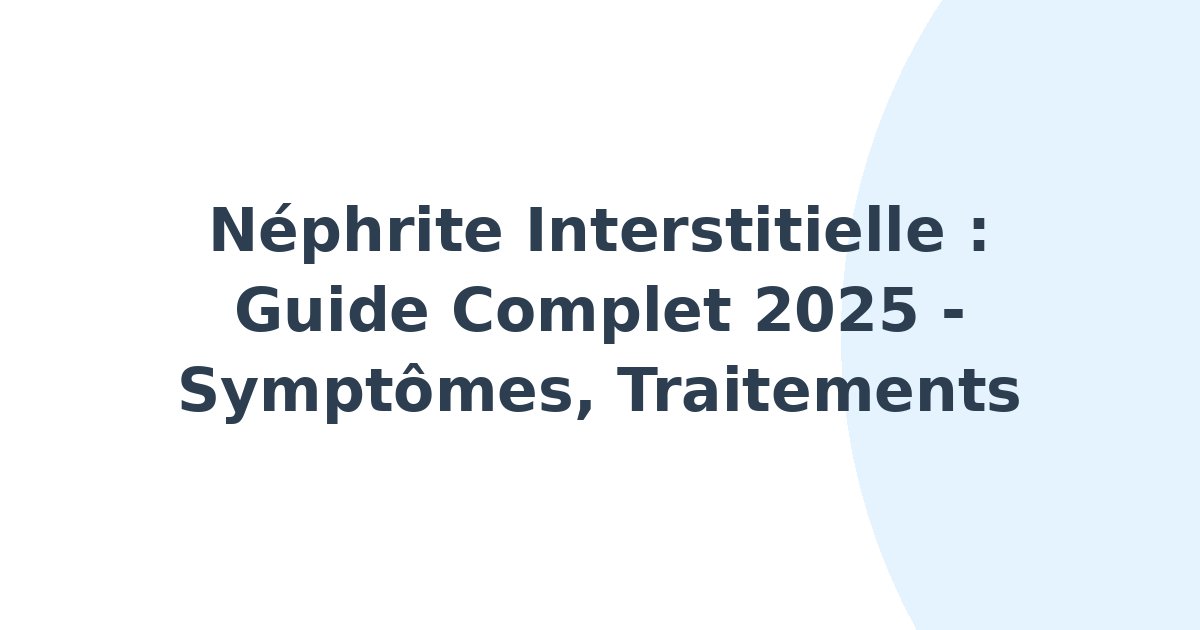
La néphrite interstitielle est une pathologie rénale qui touche le tissu interstitiel des reins, provoquant une inflammation pouvant compromettre la fonction rénale. Cette maladie, souvent méconnue du grand public, représente pourtant une cause importante d'insuffisance rénale aiguë ou chronique. Comprendre ses mécanismes, ses symptômes et ses traitements est essentiel pour une prise en charge optimale.
Téléconsultation et Néphrite interstitielle
Téléconsultation non recommandéeLa néphrite interstitielle nécessite impérativement des examens complémentaires spécialisés (biologie rénale, imagerie, parfois biopsie rénale) pour confirmer le diagnostic et évaluer la fonction rénale. L'examen clinique en présentiel est indispensable pour rechercher les signes de rétention hydrosodée et évaluer l'état général. Cette pathologie potentiellement grave requiert une prise en charge néphrologique spécialisée qui ne peut être initiée à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique des symptômes urinaires et généraux, identification des médicaments potentiellement néphrotoxiques pris récemment, évaluation de l'évolution des symptômes depuis leur apparition, orientation vers une prise en charge spécialisée urgente, suivi de l'observance thérapeutique après diagnostic établi.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen physique complet pour rechercher œdèmes et signes de rétention, réalisation d'examens biologiques urgents (créatinine, urée, ionogramme, ECBU), imagerie rénale (échographie), évaluation néphrologique spécialisée pour diagnostic différentiel et traitement adapté.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Diagnostic initial de néphrite interstitielle nécessitant examens biologiques et imagerie urgents, évaluation de la fonction rénale et du degré d'insuffisance rénale, recherche de la cause sous-jacente nécessitant investigations spécialisées, ajustement des posologies médicamenteuses selon la fonction rénale.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Suspicion d'insuffisance rénale aiguë avec oligurie ou anurie, œdèmes généralisés ou pulmonaires, troubles ioniques sévères, état général altéré avec nausées et vomissements persistants.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Diminution importante ou arrêt des urines (oligurie, anurie)
- Œdèmes généralisés, notamment du visage et des membres inférieurs
- Essoufflement au repos ou à l'effort minime évoquant un œdème pulmonaire
- Nausées et vomissements persistants avec altération de l'état général
- Douleurs lombaires intenses bilatérales avec fièvre
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Néphrologue — consultation en présentiel indispensable
La néphrite interstitielle nécessite impérativement une prise en charge néphrologique spécialisée pour confirmer le diagnostic par des examens spécifiques et initier un traitement adapté. Une consultation en présentiel est obligatoire pour l'examen clinique et la réalisation des examens complémentaires urgents.
Néphrite interstitielle : Définition et Vue d'Ensemble
La néphrite interstitielle désigne une inflammation du tissu interstitiel rénal, cette zone située entre les tubules rénaux qui joue un rôle crucial dans le fonctionnement du rein [12]. Contrairement à d'autres pathologies rénales qui affectent les glomérules, cette maladie cible spécifiquement l'espace interstitiel.
Cette pathologie peut se présenter sous deux formes distinctes. D'une part, la forme aiguë survient rapidement, souvent en réaction à un médicament ou une infection [11]. D'autre part, la forme chronique évolue insidieusement sur plusieurs mois ou années, pouvant conduire à une insuffisance rénale chronique irréversible.
Le mécanisme physiopathologique implique généralement une réaction immunitaire dirigée contre le tissu interstitiel. Cette inflammation perturbe les fonctions tubulaires essentielles comme la concentration des urines et l'équilibre électrolytique [12]. L'important à retenir : plus le diagnostic est précoce, meilleures sont les chances de récupération fonctionnelle.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la néphrite interstitielle représente environ 15 à 20% des causes d'insuffisance rénale aiguë selon les données récentes des services de néphrologie [3]. Cette proportion varie selon les régions, avec une incidence plus élevée dans les zones agricoles en raison de l'exposition aux pesticides [9].
L'incidence annuelle est estimée à 5 à 10 cas pour 100 000 habitants, mais ce chiffre est probablement sous-estimé car de nombreux cas restent non diagnostiqués [1]. Les hommes sont légèrement plus touchés que les femmes, avec un ratio de 1,3:1, et l'âge moyen au diagnostic se situe autour de 55 ans.
Au niveau international, les données montrent des variations importantes. Les pays en développement présentent des taux plus élevés, principalement liés aux infections et à l'exposition à des toxiques environnementaux [2]. En Europe, la France se situe dans la moyenne, avec des chiffres comparables à ceux de l'Allemagne et de l'Italie.
Concrètement, on observe une augmentation de 15% des cas diagnostiqués ces cinq dernières années [1]. Cette hausse s'explique en partie par l'amélioration des techniques diagnostiques et une meilleure sensibilisation des médecins à cette pathologie.
Les Causes et Facteurs de Risque
Les causes de néphrite interstitielle sont multiples et variées. Les médicaments représentent la première cause, responsables de 60 à 70% des cas [11]. Parmi eux, les antibiotiques comme l'amoxicilline arrivent en tête, suivis des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des inhibiteurs de la pompe à protons.
Mais les causes ne s'arrêtent pas là. Les infections, qu'elles soient bactériennes, virales ou fongiques, constituent le deuxième groupe étiologique [8]. D'ailleurs, les cas de néphrite interstitielle à Candida albicans, bien que rares, illustrent la diversité des agents infectieux impliqués.
Les maladies auto-immunes représentent également un facteur de risque important. Le syndrome de Sjögren, le lupus érythémateux systémique ou encore certaines vascularites peuvent s'accompagner d'une atteinte interstitielle rénale [5]. En fait, la vaccination contre la COVID-19 a révélé de nouveaux cas de vascularite leucocytoclasique associée à une néphrite interstitielle aiguë.
L'exposition professionnelle ou environnementale à des toxiques constitue une cause émergente. Les communautés agricoles sont particulièrement concernées par la néphrite interstitielle chronique liée aux pesticides [9]. Cette forme, appelée CINAC (Chronic Interstitial Nephritis in Agricultural Communities), touche désormais l'Europe avec les premiers cas belges récemment rapportés.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la néphrite interstitielle peuvent être trompeurs car ils ne sont pas spécifiques. Dans la forme aiguë, vous pourriez ressentir une fatigue inhabituelle, des nausées ou des vomissements [12]. Ces signes apparaissent généralement quelques jours à quelques semaines après l'exposition au facteur déclenchant.
La fièvre est présente dans environ 30% des cas, souvent accompagnée d'une éruption cutanée et d'une augmentation du nombre d'éosinophiles dans le sang [13]. Cette triade classique, bien que rare, doit faire évoquer le diagnostic chez tout patient exposé à un médicament suspect.
D'un autre côté, la forme chronique évolue de manière insidieuse. Les patients consultent souvent pour une fatigue progressive, une perte d'appétit ou des troubles de la concentration [12]. Il est normal de ne pas faire immédiatement le lien avec une maladie rénale, car ces symptômes sont très généraux.
Certains signes plus spécifiques peuvent orienter le diagnostic. Une polyurie (augmentation du volume des urines) associée à une soif excessive traduit un défaut de concentration des urines [13]. De même, des troubles électrolytiques comme une hypokaliémie peuvent révéler un dysfonctionnement tubulaire.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de néphrite interstitielle repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et parfois histologiques. La première étape consiste en un interrogatoire minutieux, recherchant notamment une prise médicamenteuse récente ou une exposition à des toxiques [14].
Les examens biologiques révèlent classiquement une insuffisance rénale avec élévation de la créatinine sérique. Mais attention, cette élévation peut être modérée dans les formes débutantes [12]. L'analyse des urines montre souvent une protéinurie modérée, une hématurie microscopique et parfois la présence d'éosinophiles urinaires.
L'échographie rénale constitue l'examen d'imagerie de première intention. Elle peut révéler des reins de taille normale ou légèrement augmentée dans les formes aiguës [14]. Cependant, cet examen reste souvent normal, d'où l'importance des autres éléments diagnostiques.
La biopsie rénale reste l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Elle montre un infiltrat inflammatoire de l'interstitium, composé principalement de lymphocytes et de monocytes [12]. Néanmoins, cette procédure invasive n'est pas systématique et dépend du contexte clinique et de la réversibilité présumée de la lésion.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Le traitement de la néphrite interstitielle repose avant tout sur l'éviction de la cause lorsqu'elle est identifiée. L'arrêt du médicament responsable constitue la mesure thérapeutique la plus importante [11]. Cette simple mesure permet souvent une récupération fonctionnelle, surtout si elle est prise précocement.
Les corticoïdes représentent le traitement de référence dans les formes aiguës sévères. La prednisolone à la dose de 1 mg/kg/jour pendant 4 à 6 semaines permet d'accélérer la récupération rénale [14]. Cependant, leur efficacité diminue si le traitement est instauré tardivement, d'où l'importance d'un diagnostic précoce.
Dans certains cas particuliers, d'autres immunosuppresseurs peuvent être nécessaires. Le mycophénolate mofétil ou les inhibiteurs de la calcineurine sont parfois utilisés dans les formes résistantes aux corticoïdes [6]. Ces traitements nécessitent une surveillance rapprochée en raison de leurs effets secondaires potentiels.
Concrètement, le traitement symptomatique ne doit pas être négligé. La correction des troubles électrolytiques, la prise en charge de l'anémie et le contrôle de la pression artérielle font partie intégrante de la stratégie thérapeutique [14]. L'important à retenir : chaque patient nécessite une approche individualisée.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les innovations thérapeutiques en néphrologie connaissent un essor remarquable en 2024-2025. Le Programme final SFNDT 2024 met en avant de nouvelles approches dans la prise en charge des néphrites interstitielles [1]. Ces avancées portent notamment sur l'utilisation de biomarqueurs prédictifs pour identifier précocement les patients à risque de progression.
D'ailleurs, les recherches récentes s'intéressent au rôle du facteur de nécrose tumorale (TNF) dans la physiopathologie de la maladie [4]. Les inhibiteurs du TNF-alpha, déjà utilisés dans d'autres pathologies inflammatoires, font l'objet d'essais cliniques prometteurs dans certaines formes de néphrite interstitielle chronique.
Le service de néphrologie du CHU de Lyon développe actuellement des protocoles innovants de thérapie cellulaire [3]. Ces approches visent à régénérer le tissu interstitiel lésé grâce à l'injection de cellules souches mésenchymateuses. Bien que ces techniques soient encore expérimentales, les premiers résultats sont encourageants.
En Bretagne, le programme CoCoA 2024 explore l'utilisation de l'intelligence artificielle pour prédire l'évolution de la maladie [2]. Ces outils permettraient d'adapter plus finement les traitements et d'éviter les progressions vers l'insuffisance rénale chronique terminale.
Vivre au Quotidien avec Néphrite interstitielle
Vivre avec une néphrite interstitielle nécessite certains ajustements dans votre quotidien. La fatigue, symptôme fréquent, peut impacter vos activités professionnelles et personnelles [13]. Il est important d'adapter votre rythme de vie et de ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire.
L'alimentation joue un rôle crucial dans la gestion de la maladie. Une restriction protéique modérée peut être recommandée pour limiter la charge de travail des reins [14]. De même, la limitation du sel et des aliments riches en potassium peut s'avérer nécessaire selon votre fonction rénale résiduelle.
La surveillance médicale régulière est indispensable. Vos analyses sanguines doivent être contrôlées régulièrement pour surveiller l'évolution de la fonction rénale et détecter d'éventuelles complications [12]. Cette surveillance permet d'adapter les traitements et de prévenir la progression vers l'insuffisance rénale chronique.
Rassurez-vous, de nombreux patients mènent une vie normale avec cette pathologie. L'activité physique adaptée est même recommandée car elle améliore la qualité de vie et peut ralentir la progression de la maladie rénale [13]. L'essentiel est de maintenir un dialogue ouvert avec votre équipe soignante.
Les Complications Possibles
La principale complication de la néphrite interstitielle est l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique. Cette progression survient dans 20 à 30% des cas, particulièrement lorsque le diagnostic est tardif ou le traitement inadéquat [12]. L'important à retenir : plus la prise en charge est précoce, plus les chances de récupération sont importantes.
Les troubles électrolytiques constituent une autre complication fréquente. L'hypokaliémie peut provoquer une faiblesse musculaire, des crampes ou des troubles du rythme cardiaque [14]. De même, l'acidose métabolique peut nécessiter un traitement spécifique par bicarbonates.
Certaines formes particulières peuvent s'accompagner de complications spécifiques. Le syndrome TINU (Tubulo-Interstitial Nephritis and Uveitis) associe la néphrite interstitielle à une inflammation oculaire [10]. Cette association, bien que rare, nécessite une prise en charge ophtalmologique spécialisée.
En fait, les complications cardiovasculaires ne doivent pas être négligées. L'insuffisance rénale chronique augmente le risque d'hypertension artérielle, d'anémie et de troubles du métabolisme phosphocalcique [13]. Ces complications nécessitent une surveillance et un traitement spécifiques pour préserver la qualité de vie.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la néphrite interstitielle dépend essentiellement de la précocité du diagnostic et de la rapidité de la prise en charge. Dans les formes aiguës diagnostiquées tôt, la récupération fonctionnelle complète est possible dans 60 à 80% des cas [14]. Cette récupération peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois.
Plusieurs facteurs influencent le pronostic. L'âge du patient, la sévérité de l'atteinte initiale et la durée d'exposition au facteur causal sont déterminants [12]. Les patients jeunes avec une atteinte modérée ont généralement un meilleur pronostic que les sujets âgés avec une insuffisance rénale sévère.
Cela dit, même en cas de récupération incomplète, de nombreux patients conservent une fonction rénale suffisante pour mener une vie normale. Seuls 10 à 15% des patients évoluent vers l'insuffisance rénale chronique terminale nécessitant une dialyse ou une transplantation [13].
La bonne nouvelle, c'est que les innovations thérapeutiques récentes permettent d'améliorer ces statistiques. Les nouveaux biomarqueurs et les traitements personnalisés offrent de meilleures perspectives d'avenir [1,2]. L'essentiel est de maintenir un suivi régulier et de respecter les recommandations médicales.
Peut-on Prévenir Néphrite interstitielle ?
La prévention de la néphrite interstitielle repose principalement sur l'identification et l'éviction des facteurs de risque. La surveillance médicamenteuse constitue la mesure préventive la plus efficace [11]. Il est essentiel d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, y compris ceux en vente libre.
Certaines précautions simples peuvent réduire significativement le risque. Évitez l'automédication, particulièrement avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens [14]. De même, respectez scrupuleusement les posologies et durées de traitement prescrites par votre médecin.
Dans le contexte professionnel, la protection contre les toxiques environnementaux est cruciale. Les travailleurs agricoles doivent utiliser des équipements de protection individuelle lors de l'utilisation de pesticides [9]. Cette mesure simple pourrait prévenir de nombreux cas de néphrite interstitielle chronique.
Concrètement, un mode de vie sain contribue également à la prévention. Une alimentation équilibrée, une hydratation suffisante et l'évitement du tabac et de l'alcool en excès protègent la fonction rénale [13]. Ces mesures, bien que générales, participent à la préservation de la santé rénale globale.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités de santé françaises ont émis des recommandations spécifiques concernant la prise en charge de la néphrite interstitielle. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise un diagnostic précoce basé sur la clinique et les examens complémentaires appropriés [1]. Ces recommandations insistent sur l'importance de l'interrogatoire médicamenteux systématique.
Santé Publique France surveille étroitement l'évolution épidémiologique de cette pathologie. Les données récentes montrent une augmentation des cas liés aux nouveaux médicaments, notamment les immunothérapies anticancéreuses [7]. Cette surveillance permet d'adapter les recommandations de prescription et de surveillance.
L'INSERM coordonne plusieurs programmes de recherche sur les mécanismes physiopathologiques de la maladie. Ces travaux visent à identifier de nouveaux biomarqueurs diagnostiques et pronostiques [2]. Les résultats de ces recherches alimentent régulièrement les recommandations de prise en charge.
Au niveau européen, l'Agence européenne du médicament (EMA) a renforcé la surveillance des médicaments potentiellement néphrotoxiques. Cette vigilance accrue permet une détection plus précoce des signaux de sécurité et une information rapide des professionnels de santé [1,3].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients atteints de néphrite interstitielle et de maladies rénales. France Rein, la principale association de patients insuffisants rénaux, propose un soutien psychologique et des informations pratiques [13]. Cette association organise régulièrement des rencontres entre patients et des conférences d'information.
L'Association pour l'Information et la Recherche sur les maladies rénales Génétiques (AIRG) offre des ressources spécialisées. Bien que centrée sur les maladies génétiques, elle propose des informations utiles sur les néphrites interstitielles d'origine héréditaire [12]. Leurs brochures explicatives sont particulièrement appréciées des patients et de leurs familles.
Au niveau local, de nombreux centres hospitaliers proposent des programmes d'éducation thérapeutique. Ces programmes, animés par des équipes pluridisciplinaires, permettent de mieux comprendre la maladie et d'acquérir les compétences nécessaires à l'autogestion [14]. Ils constituent un complément précieux au suivi médical traditionnel.
Les réseaux sociaux et forums en ligne offrent également un espace d'échange entre patients. Ces plateformes permettent de partager expériences et conseils pratiques, tout en gardant à l'esprit que les informations médicales doivent toujours être validées par un professionnel de santé [13].
Nos Conseils Pratiques
Voici nos conseils pratiques pour mieux vivre avec une néphrite interstitielle. Tenez un carnet de santé détaillé mentionnant tous vos médicaments, leurs posologies et leurs effets [14]. Cette information sera précieuse lors de vos consultations médicales et pourra éviter des interactions dangereuses.
Organisez votre suivi médical de manière rigoureuse. Programmez vos rendez-vous à l'avance et n'hésitez pas à poser toutes vos questions lors des consultations [13]. Préparez une liste écrite de vos préoccupations pour ne rien oublier pendant la consultation.
Adaptez votre alimentation selon les recommandations de votre néphrologue. Réduisez votre consommation de sel, limitez les protéines si nécessaire et maintenez une hydratation suffisante [12]. Un diététicien spécialisé peut vous aider à élaborer des menus adaptés et savoureux.
Restez actif dans la mesure de vos possibilités. L'exercice physique adapté améliore la qualité de vie et peut ralentir la progression de la maladie rénale [14]. Marche, natation ou yoga sont généralement bien tolérés, mais demandez toujours l'avis de votre médecin avant de débuter une nouvelle activité.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous amener à consulter rapidement votre médecin. Une fatigue inhabituelle et persistante, surtout si elle s'accompagne de nausées ou de vomissements, peut révéler une insuffisance rénale débutante [12]. N'attendez pas que ces symptômes s'aggravent pour consulter.
L'apparition d'une fièvre avec éruption cutanée chez un patient sous traitement médicamenteux doit faire évoquer une néphrite interstitielle aiguë [13]. Cette situation constitue une urgence médicale nécessitant un arrêt immédiat du médicament suspect et une prise en charge spécialisée.
Des modifications de vos urines doivent également vous alerter. Une diminution importante du volume urinaire, des urines mousseuses ou colorées peuvent traduire une atteinte rénale [14]. De même, l'apparition d'œdèmes des chevilles ou du visage nécessite une consultation rapide.
En cas de néphrite interstitielle connue, surveillez l'aggravation de vos symptômes habituels. Une fatigue croissante, des troubles digestifs nouveaux ou une modification de votre état général doivent vous amener à contacter votre néphrologue [12]. Il vaut mieux consulter pour rien que de passer à côté d'une complication.
Questions Fréquentes
La néphrite interstitielle est-elle héréditaire ?
La plupart des néphrites interstitielles sont acquises et non héréditaires. Cependant, certaines formes rares peuvent avoir une composante génétique, particulièrement dans le cadre de maladies auto-immunes familiales.
Peut-on guérir complètement d'une néphrite interstitielle ?
Oui, dans les formes aiguës diagnostiquées précocement, une guérison complète est possible dans 60 à 80% des cas. La récupération peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois selon la sévérité initiale.
Quels médicaments éviter absolument ?
Il n'existe pas de liste absolue, mais certains médicaments sont plus à risque : antibiotiques (pénicillines), anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibiteurs de la pompe à protons. L'important est d'informer votre médecin de vos antécédents.
La néphrite interstitielle nécessite-t-elle toujours une dialyse ?
Non, seuls 10 à 15% des patients évoluent vers l'insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse. La majorité des patients conservent une fonction rénale suffisante pour une vie normale.
Peut-on faire du sport avec cette maladie ?
Oui, l'activité physique adaptée est même recommandée. Elle améliore la qualité de vie et peut ralentir la progression de la maladie rénale. Demandez conseil à votre médecin pour choisir les activités les plus appropriées.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Programme final SFNDT 2024 - Innovations thérapeutiques en néphrologieLien
- [2] Breizh CoCoA 2024 - Intelligence artificielle en néphrologieLien
- [3] Service de néphrologie, dialyse et nutrition rénale - CHU LyonLien
- [5] The Predictive Value of Tumor Necrosis Factor Receptor - Biomarqueurs en néphrologieLien
- [6] Vascularite leucocytoclasique et néphrite interstitielle aiguë après vaccin à SARS-CoV-2Lien
- [7] Néphrite interstitielle aiguë induite par le lénalidomide au cours du myélome multipleLien
- [8] Néphrite interstitielle granulomateuse secondaire à l'atézolizumabLien
- [9] Néphrite tubulo-interstitielle à Candida albicans - CHU de KatiLien
- [10] Néphrite interstitielle chronique des communautés agricoles - premiers cas belgesLien
- [12] Le syndrome de néphrite tubulaire et interstitielle et uvéite (TINU syndrome)Lien
- [13] Néphrite tubulo-interstitielle aiguë immuno-allergique due à l'amoxicillineLien
- [14] Néphrite tubulo-interstitielle - Manuel MSDLien
- [15] Néphrite interstitielle - Deuxième AvisLien
- [16] Néphrite tubulo-interstitielle - Manuel MSD ProfessionnelLien
Publications scientifiques
- Vascularite leucocytoclasique et néphrite interstitielle aiguë après vaccin à SARS-CoV-2 inactivé (2022)2 citations[PDF]
- Une cause originale d'insuffisance rénale aiguë au cours du myélome multiple: néphrite interstitielle aiguë induite par le lénalidomide (2022)2 citations
- Néphrite interstitielle granulomateuse secondaire à l'atézolizumab (2022)
- Néphrite tubulo-interstitielle à Candida albicans compliquée d'insuffisance rénale aigüe à propos d'un cas au service de médecine du CHU de Kati (2022)
- [CITATION][C] Néphrite interstitielle chronique des communautés agricoles (CINAC): premiers cas belges (2024)
Ressources web
- Néphrite tubulo-interstitielle - Troubles rénaux et des voies ... (msdmanuals.com)
La néphrite tubulo-interstitielle chronique est traitée en arrêtant le médicament ou la toxine à l'origine du trouble ou en traitant le trouble sous-jacent. Des ...
- Néphrite interstitielle (deuxiemeavis.fr)
2 août 2021 — Afin d'établir un diagnostic, des analyses de sang et d'urine sont nécessaires. La biopsie rénale et des examens en imagerie sont préconisés. L' ...
- Néphrite tubulo-interstitielle - Troubles génito-urinaires (msdmanuals.com)
Le diagnostic est posé par l'anamnèse et l'analyse d'urine, et est confirmé par la biopsie rénale. Le traitement et le pronostic varient selon l'étiologie, et ...
- Néphrite : symptômes, diagnostic, comment la soigner ? (sante.journaldesfemmes.fr)
23 févr. 2023 — La néphrite est une inflammation rénale aiguë ou chronique, qui peut être d'origine bactérienne, liée généralement à une infection urinaire ...
- Néphrite interstitielle (fr.wikipedia.org)
Dans la néphrite tubulo-interstitielle chronique, le patient peut présenter des symptômes tels que nausées, vomissements, fatigue et perte de poids. Une ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
