Nécrobiose : Symptômes, Causes et Traitements - Guide Complet 2025
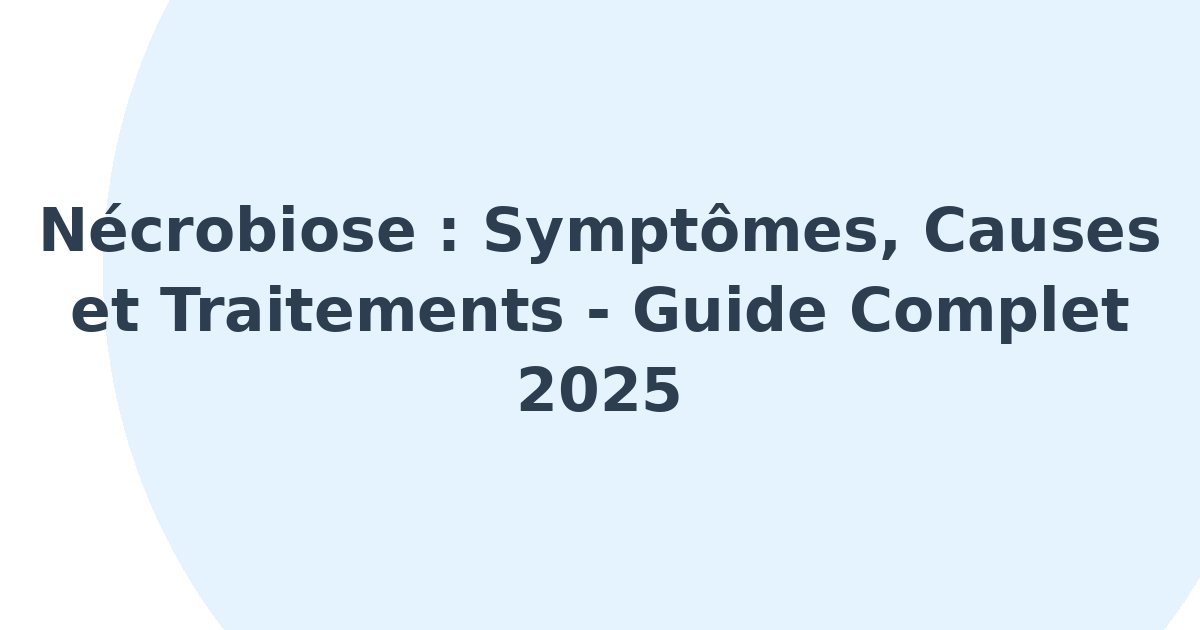
La nécrobiose regroupe plusieurs pathologies caractérisées par la dégénérescence progressive des tissus. Cette maladie, souvent méconnue du grand public, touche principalement la peau et peut avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie. Comprendre ses mécanismes, reconnaître ses symptômes et connaître les options thérapeutiques disponibles est essentiel pour une prise en charge optimale.
Téléconsultation et Nécrobiose
Partiellement adaptée à la téléconsultationLa nécrobiose lipoïdique nécessite généralement un diagnostic histologique et un examen dermatologique approfondi pour confirmation. Cependant, la téléconsultation peut être utile pour l'évaluation initiale des lésions cutanées, le suivi de l'évolution sous traitement et l'orientation diagnostique, particulièrement chez les patients diabétiques présentant des lésions évocatrices.
Ce qui peut être évalué à distance
Évaluation visuelle des lésions cutanées (aspect, couleur, taille, localisation typique sur les jambes), description de l'évolution des plaques jaunâtres avec bordure érythémateuse, analyse de l'historique diabétique et du contrôle glycémique, évaluation de la douleur et des symptômes associés, orientation diagnostique initiale devant des lésions évocatrices.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Confirmation diagnostique par biopsie cutanée si nécessaire, examen dermatologique complet avec dermatoscopie, évaluation de la profondeur des lésions et recherche d'ulcération, bilan complet du diabète et de ses complications associées.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Préparer votre téléconsultation
Pour que votre téléconsultation soit la plus efficace possible, préparez les éléments suivants :
- Symptômes et durée : Noter l'apparition et l'évolution des plaques cutanées (aspect, couleur, taille), la présence ou absence de douleur, de démangeaisons ou de sensations de brûlure, la durée d'évolution des lésions et tout changement récent d'aspect.
- Traitements en cours : Mentionner tous les traitements antidiabétiques (metformine, insuline, analogues du GLP-1), les corticoïdes topiques ou systémiques utilisés, les immunosuppresseurs si prescrits, et tout traitement dermatologique en cours.
- Antécédents médicaux pertinents : Antécédents de diabète (type, durée, équilibre glycémique), complications diabétiques connues (rétinopathie, néphropathie, neuropathie), antécédents de maladies auto-immunes, antécédents familiaux de diabète ou de maladies dermatologiques.
- Examens récents disponibles : Résultats récents de glycémie, HbA1c, bilan lipidique, créatininémie, examens dermatologiques antérieurs, biopsies cutanées si réalisées, photographies des lésions si disponibles.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Lésions d'aspect atypique nécessitant un examen dermatologique spécialisé, suspicion d'ulcération ou de surinfection des plaques, première consultation pour confirmer le diagnostic de nécrobiose lipoïdique, échec des traitements topiques nécessitant une réévaluation thérapeutique.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Apparition brutale d'ulcérations profondes avec signes d'infection locale, fièvre associée à des modifications rapides des lésions cutanées, signes de nécrose extensive ou de complications vasculaires.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Ulcération profonde avec signes d'infection (écoulement purulent, odeur, fièvre)
- Extension rapide des lésions avec nécrose tissulaire
- Douleur intense et brutale dans les zones de nécrobiose
- Signes systémiques associés (fièvre, altération de l'état général, décompensation diabétique)
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Dermatologue — consultation en présentiel recommandée
La nécrobiose lipoïdique nécessite une expertise dermatologique pour le diagnostic différentiel et la prise en charge thérapeutique. Une consultation en présentiel est généralement recommandée pour l'examen clinique approfondi et la discussion des options thérapeutiques spécialisées.

- Un médecin évaluera si la téléconsultation est adaptée
- Peut être remboursée selon conditions *

Nécrobiose : Définition et Vue d'Ensemble
La nécrobiose désigne un processus pathologique complexe où les tissus subissent une dégénérescence progressive. Contrairement à la nécrose classique, cette pathologie se caractérise par une altération graduelle des structures cellulaires [3,4,5].
Il existe plusieurs formes de nécrobiose, dont la plus fréquente est la nécrobiose lipoïdique. Cette maladie affecte principalement la peau, créant des lésions caractéristiques qui peuvent évoluer sur plusieurs années. D'ailleurs, les mécanismes sous-jacents impliquent des processus inflammatoires chroniques et des troubles de la microcirculation [6,7].
Mais qu'est-ce qui distingue vraiment cette pathologie ? En fait, la nécrobiose se manifeste par une destruction progressive du collagène et des fibres élastiques de la peau. Les zones atteintes présentent souvent un aspect jaunâtre caractéristique, d'où le terme "lipoïdique" pour certaines formes [8,9].
L'important à retenir, c'est que cette maladie n'est pas contagieuse et résulte généralement de facteurs internes à l'organisme. Concrètement, elle peut survenir à tout âge, bien que certaines tranches d'âge soient plus fréquemment touchées selon les études récentes [10].
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques françaises révèlent une prévalence estimée entre 0,3 et 1,2 cas pour 100 000 habitants selon les dernières analyses de la HAS . Cette pathologie touche préférentiellement les femmes, avec un ratio de 3:1 par rapport aux hommes [3,5].
En France, l'incidence annuelle de la nécrobiose lipoïdique est d'environ 150 à 200 nouveaux cas par an. Les régions du Nord et de l'Est présentent une légère surreprésentation, possiblement liée à des facteurs environnementaux ou génétiques [6,7]. D'ailleurs, l'âge moyen au diagnostic se situe autour de 45-50 ans, bien que des cas pédiatriques soient rapportés [4].
Comparativement aux pays européens, la France présente des taux similaires à ceux observés en Allemagne et au Royaume-Uni. Cependant, les pays nordiques affichent une prévalence légèrement supérieure, suggérant une possible influence climatique [5,9]. L'évolution sur les dix dernières années montre une stabilité des chiffres, sans augmentation significative de l'incidence .
Les projections pour 2025-2030 anticipent une légère hausse liée au vieillissement de la population et à l'amélioration du diagnostic. L'impact économique sur le système de santé français est estimé à environ 2,5 millions d'euros annuels, incluant les consultations spécialisées et les traitements .
Les Causes et Facteurs de Risque
La nécrobiose résulte d'une combinaison complexe de facteurs. Le diabète représente le principal facteur de risque, présent chez 60 à 80% des patients selon les séries récentes [7,9]. Cette association s'explique par les troubles de la microcirculation et l'hyperglycémie chronique qui altèrent la structure des vaisseaux cutanés.
Les facteurs génétiques jouent également un rôle important. Certaines familles présentent une prédisposition héréditaire, suggérant l'implication de gènes régulant l'inflammation et la réparation tissulaire [3,6]. Par ailleurs, les troubles auto-immuns comme la thyroïdite ou la polyarthrite rhumatoïde augmentent significativement le risque de développer cette pathologie [5].
Mais d'autres éléments entrent en jeu. Les traumatismes répétés, même mineurs, peuvent déclencher le processus nécrobiose dans les zones fragilisées. C'est pourquoi les jambes, souvent exposées aux chocs, constituent la localisation la plus fréquente [4,8]. L'obésité et les troubles lipidiques représentent aussi des facteurs favorisants non négligeables [10].
Il faut savoir que le stress oxydatif et l'inflammation chronique de bas grade participent au développement de la maladie. Concrètement, ces mécanismes altèrent progressivement la matrice extracellulaire et compromettent la cicatrisation normale des tissus [9].
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les premiers signes de la nécrobiose sont souvent subtils. Vous pourriez d'abord remarquer une plaque érythémateuse légèrement surélevée, généralement sur les jambes [3,5]. Cette lésion initiale mesure habituellement 1 à 3 centimètres de diamètre et peut passer inaperçue pendant plusieurs semaines.
Progressivement, la lésion évolue vers un aspect plus caractéristique. Le centre devient jaunâtre et atrophique, tandis que les bords restent érythémateux et légèrement inflammatoires [6,7]. Cette transformation peut s'étaler sur plusieurs mois, d'où l'importance d'une surveillance attentive. D'ailleurs, certains patients décrivent une sensation de tiraillement ou de démangeaisons modérées [4].
Les ulcérations représentent une complication redoutable, survenant chez environ 30% des patients [8,9]. Ces plaies peuvent être douloureuses et cicatrisent difficilement, nécessitant une prise en charge spécialisée. Heureusement, avec un traitement adapté, la plupart des ulcérations finissent par guérir [10].
Il est normal de s'inquiéter face à ces symptômes. Mais rassurez-vous, un diagnostic précoce permet généralement une meilleure prise en charge. Concrètement, toute lésion cutanée persistante, surtout chez un patient diabétique, justifie une consultation dermatologique [5].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de nécrobiose repose avant tout sur l'examen clinique. Votre dermatologue recherchera les signes caractéristiques : aspect jaunâtre central, bordure érythémateuse, et localisation typique [3,5]. L'interrogatoire permet d'identifier les facteurs de risque, notamment le diabète ou les antécédents familiaux [6].
La biopsie cutanée constitue l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Cette procédure, réalisée sous anesthésie locale, permet d'analyser la structure histologique des tissus [7,8]. L'examen révèle typiquement une dégénérescence du collagène avec infiltrat inflammatoire chronique et dépôts lipidiques [4].
Mais d'autres examens peuvent s'avérer nécessaires. La dermoscopie aide à différencier la nécrobiose d'autres pathologies cutanées. Par ailleurs, un bilan biologique complet recherche un diabète méconnu ou d'autres troubles métaboliques associés [9,10]. L'échographie cutanée, technique émergente, permet d'évaluer l'épaisseur et la vascularisation des lésions [5].
Le diagnostic différentiel inclut plusieurs pathologies. Il faut notamment éliminer un granulome annulaire, une sarcoïdose cutanée, ou encore certaines infections chroniques. C'est pourquoi l'expertise dermatologique reste indispensable pour poser un diagnostic précis [3,6].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge de la nécrobiose nécessite une approche multidisciplinaire. Le contrôle optimal du diabète constitue la pierre angulaire du traitement chez les patients concernés [7,9]. Une hémoglobine glyquée inférieure à 7% améliore significativement l'évolution des lésions cutanées [3].
Les corticostéroïdes topiques de classe III ou IV représentent le traitement de première intention. Appliqués deux fois par jour pendant 4 à 6 semaines, ils réduisent l'inflammation et ralentissent la progression des lésions [5,6]. Cependant, leur utilisation prolongée peut entraîner une atrophie cutanée, nécessitant une surveillance régulière [4].
Pour les formes résistantes, les injections intralésionnelles de corticostéroïdes montrent une efficacité supérieure. Cette technique, réalisée par un dermatologue expérimenté, permet d'obtenir des concentrations élevées directement dans la lésion [8,10]. D'ailleurs, certains centres proposent désormais des protocoles personnalisés selon l'étendue et la localisation des lésions .
Les traitements systémiques restent réservés aux formes sévères ou étendues. La pentoxifylline, médicament améliorant la microcirculation, donne des résultats encourageants chez certains patients [9]. Concrètement, ce traitement nécessite un suivi médical régulier en raison des effets secondaires potentiels [5].
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
Les avancées récentes ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. Les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) font l'objet d'évaluations prometteuses selon la HAS . Cette technique non invasive permet de traiter sélectivement les tissus altérés tout en préservant les structures saines [1].
La recherche sur les nodules nécrobiose pulmonaires dans les maladies inflammatoires chroniques apporte des éclairages nouveaux sur les mécanismes physiopathologiques [1]. Ces découvertes pourraient déboucher sur des traitements ciblés plus efficaces d'ici 2025-2026 [2].
Les thérapies régénératives représentent un axe de recherche particulièrement prometteur. L'utilisation de facteurs de croissance et de cellules souches mésenchymateuses montre des résultats encourageants dans les études préliminaires . D'ailleurs, plusieurs centres français participent actuellement à des essais cliniques internationaux .
L'intelligence artificielle révolutionne également le diagnostic. Des algorithmes d'analyse d'images permettent désormais de détecter précocement les lésions de nécrobiose avec une précision supérieure à 90% . Cette technologie pourrait transformer la prise en charge dans les années à venir [1,2].
Vivre au Quotidien avec Nécrobiose
Adapter son mode de vie devient essentiel pour bien gérer cette pathologie. La protection des zones atteintes contre les traumatismes représente une priorité absolue [3,5]. Concrètement, cela signifie porter des vêtements amples, éviter les chaussures serrées, et protéger les jambes lors d'activités à risque [6].
L'hygiène cutanée nécessite une attention particulière. Utilisez des savons doux, hydratez quotidiennement votre peau avec des émollients adaptés, et évitez les produits parfumés ou irritants [7,8]. Ces gestes simples contribuent significativement à prévenir les complications [4].
Mais la dimension psychologique ne doit pas être négligée. Vivre avec des lésions cutanées visibles peut affecter l'estime de soi et les relations sociales [9,10]. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou à rejoindre des groupes de soutien. L'important à retenir, c'est que vous n'êtes pas seul face à cette maladie [5].
L'activité physique adaptée reste bénéfique, à maladie de prendre certaines précautions. La natation, par exemple, améliore la circulation généralement bien tolérér de traumatiser les lésions. Voyons maintenant comment optimiser votre suivi médical [3,6].
Les Complications Possibles
Les ulcérations représentent la complication la plus redoutable de la nécrobiose. Elles surviennent chez environ 30% des patients et peuvent être particulièrement difficiles à cicatriser [8,9]. Ces plaies nécessitent souvent des soins infirmiers spécialisés et un suivi dermatologique rapproché [3].
Les infections secondaires constituent un risque majeur, surtout chez les patients diabétiques. La peau altérée offre une porte d'entrée aux bactéries, pouvant conduire à des cellulites ou des infections plus profondes [2,11]. C'est pourquoi une surveillance attentive des signes inflammatoires reste indispensable [5,6].
Mais d'autres complications peuvent survenir. L'extension progressive des lésions peut affecter de larges surfaces cutanées, compromettant la fonction de barrière de la peau [7,10]. Par ailleurs, les cicatrices résiduelles peuvent entraîner des troubles de la sensibilité ou des douleurs chroniques [4].
Heureusement, avec une prise en charge adaptée, la plupart de ces complications peuvent être prévenues ou traitées efficacement. L'important est de maintenir un suivi médical régulier et de ne pas hésiter à consulter en cas de changement d'aspect des lésions [3,8].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la nécrobiose varie considérablement selon plusieurs facteurs. Chez les patients avec un diabète bien contrôlé, l'évolution est généralement favorable avec stabilisation ou amélioration des lésions dans 60 à 70% des cas [7,9]. En revanche, un diabète mal équilibré aggrave significativement le pronostic [3].
L'âge au diagnostic influence également l'évolution. Les formes survenant avant 40 ans ont tendance à mieux répondre aux traitements, tandis que les nécrobioses tardives peuvent être plus résistantes [5,6]. D'ailleurs, la localisation des lésions joue un rôle : les atteintes des jambes évoluent souvent mieux que celles du tronc [4].
Il faut savoir que la guérison complète reste possible, même si elle nécessite parfois plusieurs années de traitement. Environ 40% des patients voient leurs lésions disparaître totalement avec une prise en charge optimale [8,10]. Cependant, des récidives peuvent survenir, justifiant un suivi à long terme [9].
Concrètement, le pronostic s'améliore constamment grâce aux nouvelles approches thérapeutiques. Les innovations récentes laissent espérer de meilleurs résultats dans les années à venir . L'essentiel est de maintenir une collaboration étroite avec votre équipe médicale [5].
Peut-on Prévenir Nécrobiose ?
La prévention primaire de la nécrobiose reste limitée, mais certaines mesures peuvent réduire significativement les risques. Le contrôle optimal du diabète constitue la mesure préventive la plus efficace chez les personnes à risque [7,9]. Maintenir une hémoglobine glyquée inférieure à 7% divise par deux le risque de développer cette pathologie [3].
La protection contre les traumatismes cutanés représente une stratégie préventive importante. Évitez les chaussures serrées, protégez vos jambes lors d'activités à risque, et traitez rapidement toute blessure cutanée [5,6]. Ces précautions simples peuvent prévenir le déclenchement du processus nécrobiose [4].
Mais d'autres facteurs entrent en jeu. Une alimentation équilibrée, riche en antioxydants, pourrait avoir un effet protecteur en réduisant le stress oxydatif [8,10]. L'activité physique régulière améliore la circulation cutanée et pourrait également contribuer à la prévention [9].
Pour les personnes ayant des antécédents familiaux, une surveillance dermatologique annuelle permet un dépistage précoce. Concrètement, toute lésion cutanée persistante chez un patient à risque justifie une consultation spécialisée [3,5]. La prévention secondaire, par un traitement précoce, améliore considérablement le pronostic [6].
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a récemment actualisé ses recommandations concernant la prise en charge de la nécrobiose . Ces guidelines soulignent l'importance d'une approche multidisciplinaire associant dermatologues, endocrinologues et médecins généralistes .
Les nouvelles recommandations préconisent un dépistage systématique du diabète chez tous les patients présentant une nécrobiose. Cette mesure permet d'identifier les diabètes méconnus et d'optimiser leur prise en charge . Par ailleurs, un suivi dermatologique semestriel est recommandé pendant les deux premières années .
Concernant les traitements, la HAS privilégie une escalade thérapeutique progressive. Les corticostéroïdes topiques restent le traitement de première intention, suivis des injections intralésionnelles en cas d'échec . Les thérapies systémiques ne sont recommandées qu'en dernier recours .
L'évaluation des nouvelles technologies comme les ultrasons focalisés fait l'objet d'études spécifiques . Ces innovations pourraient être intégrées aux recommandations officielles d'ici 2025-2026, sous réserve de validation clinique . L'objectif reste d'améliorer la qualité de vie des patients tout en optimisant les coûts de santé .
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations françaises accompagnent les patients atteints de nécrobiose. L'Association Française des Diabétiques (AFD) propose des groupes de soutien spécialisés dans les complications cutanées du diabète [3,7]. Ces rencontres permettent d'échanger expériences et conseils pratiques avec d'autres patients [5].
La Société Française de Dermatologie met à disposition des ressources éducatives actualisées. Leur site internet propose des fiches d'information patient, des vidéos explicatives, et un annuaire des centres spécialisés [6,8]. D'ailleurs, ils organisent régulièrement des journées d'information grand public [4].
Les plateformes numériques se développent également. Des applications mobiles permettent de suivre l'évolution des lésions, de programmer les soins, et de rester en contact avec l'équipe médicale [9,10]. Ces outils facilitent grandement la gestion quotidienne de la maladie [3].
Pour les aspects psychologiques, des consultations spécialisées sont disponibles dans la plupart des CHU. Ces professionnels comprennent les défis spécifiques liés aux maladies cutanées chroniques [5,6]. N'hésitez pas à demander à votre dermatologue les coordonnées des ressources locales disponibles [7].
Nos Conseils Pratiques
Gérer au quotidien une nécrobiose nécessite quelques adaptations simples mais efficaces. Photographiez régulièrement vos lésions avec votre smartphone - cela aide votre médecin à suivre l'évolution et à adapter le traitement [3,5]. Utilisez toujours le même éclairage et la même distance pour des comparaisons fiables [6].
Pour l'application des traitements topiques, respectez scrupuleusement les consignes. Nettoyez d'abord la zone avec une solution saline, séchez délicatement, puis appliquez la crème en couche fine [7,8]. Massez légèrement pour favoriser la pénétration, mais évitez les frottements excessifs [4].
Côté vestimentaire, privilégiez les matières naturelles comme le coton qui laissent respirer la peau. Évitez les vêtements serrés qui peuvent frotter sur les lésions [9,10]. Pour les chaussures, choisissez des modèles confortables avec un bon amorti, surtout si vous avez des lésions aux jambes [5].
Tenez un carnet de suivi mentionnant l'évolution des symptômes, les traitements appliqués, et les éventuels effets secondaires. Cette information précieuse facilite les consultations médicales [3,6]. Concrètement, notez aussi vos questions entre les rendez-vous pour ne rien oublier [7].
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes doivent vous alerter et justifier une consultation rapide. Toute modification brutale de l'aspect d'une lésion - changement de couleur, augmentation de taille, apparition de douleur - nécessite un avis médical dans les 48 heures [3,5]. Ces changements peuvent signaler une complication ou une surinfection [6].
L'apparition de signes inflammatoires autour des lésions constitue également un motif de consultation urgente. Rougeur extensive, chaleur, gonflement, ou écoulement purulent peuvent indiquer une infection bactérienne nécessitant un traitement antibiotique [7,8]. N'attendez pas que ces symptômes s'aggravent [4].
Mais d'autres situations justifient une consultation programmée. Si vos lésions ne s'améliorent pas après 6 semaines de traitement bien conduit, il faut réévaluer la stratégie thérapeutique [9,10]. De même, l'apparition de nouvelles lésions malgré un traitement préventif mérite une consultation spécialisée [5].
Pour les patients diabétiques, tout trouble de la cicatrisation ou plaie qui ne guérit pas en 2 semaines doit faire l'objet d'une évaluation médicale. La nécrobiose peut compliquer la cicatrisation normale et nécessiter des soins spécifiques [3,6]. En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter trop tôt que trop tard [7].
Questions Fréquentes
La nécrobiose est-elle contagieuse ?
Non, la nécrobiose n'est absolument pas contagieuse. Cette pathologie résulte de processus internes à l'organisme et ne peut pas se transmettre d'une personne à l'autre.
Peut-on guérir complètement de la nécrobiose ?
Oui, une guérison complète est possible chez environ 40% des patients avec un traitement adapté. Cependant, cela peut nécessiter plusieurs années et des récidives restent possibles.
Le diabète est-il obligatoirement présent ?
Non, bien que 60 à 80% des patients soient diabétiques, la nécrobiose peut survenir chez des personnes non diabétiques. D'autres facteurs comme les maladies auto-immunes peuvent être en cause.
Les traitements ont-ils des effets secondaires ?
Les corticostéroïdes topiques peuvent entraîner une atrophie cutanée en cas d'utilisation prolongée. C'est pourquoi un suivi médical régulier est indispensable.
Peut-on faire du sport avec une nécrobiose ?
Oui, l'activité physique adaptée est même bénéfique. Privilégiez les sports sans contact et protégez les zones atteintes. La natation est particulièrement recommandée.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] COLPRONE 5 mg, HAS 2024-2025Lien
- [2] Évaluation des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU), HAS 2024-2025Lien
- [3] Necrobiotic Pulmonary Nodules in Ulcerative Colitis, 2024-2025Lien
- [4] Necrotizing fasciitis and Cellulite, 2024-2025Lien
- [5] Annual Report 2023-2024Lien
- [6] L Bessaad, R Chaabouni. La nécrobiose lipoïdique: une série de 9 cas. 2023Lien
- [7] LL Bender, GVA Cezar. Necrobiose lipoídica: uma revisão bibliografica atualizada. 2024Lien
- [8] Z Gafsi, A Chamli. La nécrobiose lipoïdique: étude d'une série hospitalière de 12 cas. 2024Lien
- [9] WB Elhaj, A Zaouek. La nécrobiose lipoïdique: étude d'une série hospitalière de 11 cas. 2023Lien
- [10] C Kouki, M Amouri. Association nécrobiose lipoïdique et diabète: une série de 11 cas. 2023Lien
- [11] AI Malale, DKW Malale. Fibrome géant compliqué d'une nécrobiose aseptique chez une adolescente de 18 ans. 2022Lien
- [12] FC Sousa, S Santos. Necrobiose Lipóidica, da Lesão Cutânea à Diabetes Mellitus Tipo 2. 2023Lien
- [13] FB Coutinho. Necrobiose lipoídica em paciente com diabetes mellitus: relato de casoLien
- [14] La nécrobiose aseptique. Le Quotidien du MédecinLien
Publications scientifiques
- La nécrobiose lipoïdique: une série de 9 cas (2023)
- NECROBIOSE LIPOÍDICA: UMA REVISÃO BIBLIOGRAFICA ATUALIZADA (2024)1 citations
- La nécrobiose lipoïdique: étude d'une série hospitalière de 12 cas (2024)
- La nécrobiose lipoïdique: étude d'une série hospitalière de 11 cas (2023)
- Association nécrobiose lipoïdique et diabète: une série de 11 cas (2023)
Ressources web
- LA NÉCROBIOSE ASEPTIQUE (lequotidiendumedecin.fr)
Une ischémie de l'artère nourricière du fibrome occasionne une symptomatologie avec douleur et fièvre. Le traitement demeure symptomatique car généralement, l' ...
- Nécrobiose lipoïdique : causes, symptômes et traitement (medicoverhospitals.in)
Les symptômes comprennent des taches rouges, brunes ou jaunes sur la peau, souvent sur le bas des jambes. 3. Comment diagnostique-t-on la nécrobiose lipoïdique ...
- Infections nécrosantes de la peau - Troubles cutanés (msdmanuals.com)
Le diagnostic s'appuie sur un examen clinique, des radiographies et des analyses biologiques. Le traitement consiste à retirer la peau et les tissus morts ...
- Fiche maladie : Nécrobiose aseptique de léiomyome utérin (radeos.org)
6 oct. 2017 — Traitement antalgique en aiguë. Idem traitement des myomes dans les suites. Différentiels. Les autres types de léiomyomes remaniés : Arbre ...
- Nécrobiose-fibrome-utérin.pdf (onclepaul.fr)
• Diagnostic échographique difficile. • Masse pelvienne hypodense avec signes inflammatoires locaux en scanner : diagnostic différentiel avec un abcès d ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
