Myélinolyse Centropontine : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements
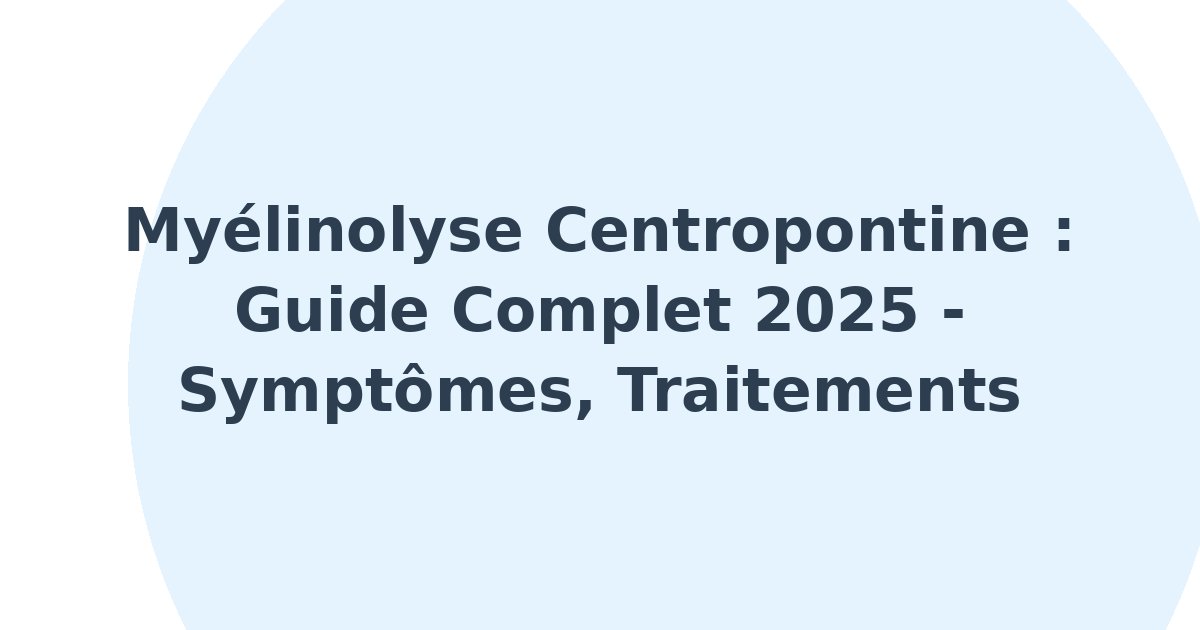
La myélinolyse centropontine est une pathologie neurologique rare qui touche la substance blanche du tronc cérébral. Cette maladie, souvent liée à des troubles électrolytiques, peut avoir des conséquences importantes sur la qualité de vie. Comprendre ses mécanismes, ses symptômes et les options thérapeutiques disponibles est essentiel pour les patients et leurs proches.
Téléconsultation et Myélinolyse centropontine
Téléconsultation non recommandéeLa myélinolyse centropontine est une pathologie neurologique grave nécessitant une prise en charge hospitalière spécialisée avec imagerie cérébrale et surveillance neurologique étroite. Le diagnostic repose sur l'IRM cérébrale et l'évaluation clinique neurologique approfondie qui ne peuvent être réalisés à distance.
Ce qui peut être évalué à distance
Recueil de l'historique des troubles hydroélectrolytiques récents, évaluation de l'évolution des symptômes neurologiques décrits par le patient ou l'entourage, analyse des traitements en cours et des facteurs de risque, orientation vers une prise en charge hospitalière urgente.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation des fonctions cognitives et motrices, réalisation d'une IRM cérébrale en urgence pour confirmer le diagnostic, bilan biologique approfondi des électrolytes, prise en charge hospitalière spécialisée en neurologie.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Suspicion de myélinolyse centropontine nécessitant une IRM cérébrale en urgence, évaluation neurologique fine des troubles de déglutition et de la dysarthrie, surveillance de l'aggravation des déficits neurologiques, adaptation thérapeutique nécessitant une hospitalisation spécialisée.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
Troubles de la conscience progressifs, difficultés respiratoires par atteinte du tronc cérébral, convulsions, syndrome pseudobulbaire avec troubles de déglutition majeurs.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Troubles de la conscience ou confusion progressive
- Difficultés de déglutition avec risque de fausse route
- Troubles respiratoires ou modification du rythme respiratoire
- Convulsions ou mouvements anormaux
- Paralysie ou faiblesse musculaire brutale des membres
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
La myélinolyse centropontine nécessite impérativement une prise en charge neurologique spécialisée en milieu hospitalier avec imagerie cérébrale et surveillance neurologique continue. Une consultation en présentiel est indispensable pour le diagnostic et la prise en charge.
Myélinolyse Centropontine : Définition et Vue d'Ensemble
La myélinolyse centropontine est une pathologie neurologique caractérisée par la destruction de la myéline dans la région centrale du pont, une structure située dans le tronc cérébral [1]. Cette maladie fait partie du syndrome de démyélinisation osmotique, un ensemble de troubles liés aux variations brutales de l'osmolarité sanguine.
Concrètement, la myéline est cette gaine protectrice qui entoure les fibres nerveuses, un peu comme l'isolant autour d'un câble électrique. Quand elle se détériore, la transmission des signaux nerveux devient défaillante [2,3]. Le pont joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions : il contrôle les mouvements oculaires, la déglutition, l'équilibre et participe à la régulation de la conscience.
Cette pathologie a été décrite pour la première fois dans les années 1950. Mais c'est seulement avec l'avènement de l'IRM que nous avons pu mieux comprendre ses mécanismes [4]. D'ailleurs, les innovations en imagerie médicale de 2024-2025 permettent aujourd'hui un diagnostic plus précoce et plus précis [1].
Il faut savoir que la myélinolyse centropontine peut s'accompagner de lésions extrapontines, touchant d'autres régions du cerveau. Dans ce cas, on parle de syndrome de démyélinisation osmotique [5,6]. Cette forme étendue concerne environ 30% des cas selon les données récentes.
Épidémiologie en France et dans le Monde
La myélinolyse centropontine reste une pathologie rare, mais sa prévalence exacte est difficile à établir. En France, on estime qu'elle touche environ 0,5 à 2 cas pour 100 000 habitants par an [7]. Ces chiffres sont probablement sous-estimés car de nombreux cas légers passent inaperçus ou sont mal diagnostiqués.
Les données épidémiologiques montrent une prédominance masculine avec un ratio de 1,5 homme pour 1 femme [8]. L'âge moyen de survenue se situe autour de 50-60 ans, mais la maladie peut affecter tous les groupes d'âge, y compris les enfants dans des contextes particuliers [3]. D'ailleurs, les cas pédiatriques représentent moins de 5% de l'ensemble des diagnostics.
Au niveau européen, l'incidence varie selon les pays. L'Allemagne et les Pays-Bas rapportent des taux légèrement supérieurs, probablement en raison de systèmes de surveillance plus développés [9]. Les projections pour 2025-2030 suggèrent une augmentation des cas diagnostiqués, principalement due à l'amélioration des techniques d'imagerie et à une meilleure sensibilisation médicale [1].
L'impact économique sur le système de santé français est estimé à environ 15-20 millions d'euros annuels, incluant les coûts d'hospitalisation, de rééducation et de prise en charge à long terme [10]. Cette pathologie représente donc un enjeu de santé publique non négligeable, malgré sa rareté relative.
Les Causes et Facteurs de Risque
La cause principale de la myélinolyse centropontine est la correction trop rapide d'une hyponatrémie (taux de sodium sanguin trop bas) [4,5]. Cette situation survient typiquement lors d'une hospitalisation où l'on tente de normaliser rapidement les électrolytes. Mais attention, ce n'est pas la seule cause possible.
L'alcoolisme chronique représente un facteur de risque majeur. Les personnes souffrant d'addiction à l'alcool présentent souvent des déséquilibres électrolytiques et nutritionnels qui fragilisent le système nerveux [6,11]. De même, la malnutrition sévère, qu'elle soit liée à des troubles alimentaires ou à des pathologies digestives, peut prédisposer à cette maladie.
Certaines situations médicales augmentent également le risque. Les transplantations d'organes, les brûlures étendues, les interventions chirurgicales majeures ou encore les traitements de chimiothérapie peuvent créer des maladies favorables [3,8]. Il est intéressant de noter que des cas sans hyponatrémie ont été rapportés, notamment en lien avec l'hyperglycémie sévère [2].
Les innovations de recherche 2024-2025 ont permis d'identifier de nouveaux facteurs génétiques de susceptibilité [1]. Ces découvertes ouvrent la voie à une médecine plus personnalisée et à une meilleure prévention chez les patients à risque.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la myélinolyse centropontine peuvent être très variables et parfois trompeurs. Ils apparaissent généralement 2 à 6 jours après l'événement déclencheur, ce qui peut compliquer le diagnostic [4,6]. Les premiers signes sont souvent discrets : fatigue inhabituelle, confusion légère ou troubles de l'équilibre.
Les troubles neurologiques constituent le cœur du tableau clinique. Vous pourriez observer des difficultés à parler (dysarthrie), des problèmes de déglutition ou une faiblesse des membres [5,9]. Dans les formes sévères, une paralysie des quatre membres peut survenir, réalisant le redoutable "locked-in syndrome" où la conscience est préservée mais la communication devient impossible.
Les troubles oculaires sont également fréquents. Des mouvements anormaux des yeux, une vision double ou des difficultés à fixer le regard peuvent apparaître [10,11]. Ces symptômes résultent de l'atteinte des noyaux des nerfs crâniens situés dans le pont.
Il faut savoir que l'évolution peut être biphasique. Après une amélioration initiale, certains patients voient leurs symptômes s'aggraver secondairement [6]. Cette particularité rend le suivi médical d'autant plus important. Heureusement, les nouvelles techniques d'imagerie permettent aujourd'hui de détecter les lésions plus précocement [1].
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de myélinolyse centropontine repose avant tout sur l'imagerie par résonance magnétique (IRM) [7]. Cet examen révèle des lésions caractéristiques en forme de "trident" ou de "chauve-souris" au centre du pont. Ces images sont pathognomoniques, c'est-à-dire qu'elles permettent un diagnostic de certitude.
Mais l'IRM n'est pas toujours positive dès les premiers jours. Il faut parfois attendre 1 à 2 semaines pour voir apparaître les lésions typiques [8,9]. C'est pourquoi votre médecin pourra demander un contrôle à distance si les premiers examens sont normaux mais que le contexte clinique est évocateur.
Les examens biologiques complètent le bilan diagnostique. On recherche systématiquement les troubles électrolytiques, en particulier l'hyponatrémie [4,5]. Un bilan hépatique, rénal et nutritionnel est également réalisé pour identifier les facteurs de risque. Les innovations 2024-2025 incluent de nouveaux biomarqueurs sanguins qui pourraient permettre un diagnostic plus précoce [1].
Le diagnostic différentiel est important car d'autres pathologies peuvent donner des symptômes similaires. L'accident vasculaire cérébral, l'encéphalite ou certaines tumeurs doivent être écartés [10,11]. L'expertise du neurologue est donc essentielle pour interpréter correctement l'ensemble des données cliniques et paracliniques.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Il faut être honnête : il n'existe pas de traitement spécifique pour réparer les lésions de myélinolyse centropontine une fois qu'elles sont constituées [6]. La prise en charge repose donc principalement sur des mesures de soutien et de rééducation. Mais ne perdez pas espoir, car de nombreux patients récupèrent partiellement ou totalement leurs fonctions.
Le traitement symptomatique vise à maintenir les fonctions vitales et à prévenir les complications. En phase aiguë, une surveillance en réanimation peut être nécessaire, notamment pour assister la respiration ou l'alimentation [7,8]. Les troubles de la déglutition nécessitent souvent une nutrition entérale temporaire.
La rééducation joue un rôle central dans la récupération. Kinésithérapie, orthophonie et ergothérapie sont les piliers de cette approche [9,10]. Plus elle est précoce et intensive, meilleurs sont les résultats. Certains centres spécialisés proposent des programmes de rééducation spécifiquement adaptés aux patients atteints de myélinolyse centropontine.
Les innovations thérapeutiques 2024-2025 explorent de nouvelles pistes prometteuses. Des essais cliniques testent l'efficacité de facteurs de croissance neuronaux et de thérapies cellulaires [1]. Ces approches pourraient révolutionner la prise en charge dans les années à venir, même si elles restent encore expérimentales.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant dans la recherche sur la myélinolyse centropontine. Les thérapies de remyélinisation font l'objet d'études cliniques prometteuses . Ces traitements visent à stimuler la régénération de la myéline endommagée grâce à des facteurs de croissance spécifiques ou des cellules souches.
Les innovations en imagerie révolutionnent également le diagnostic et le suivi. Les nouvelles séquences IRM permettent de détecter les lésions plus précocement et de mieux évaluer leur évolution [1]. Cette avancée est cruciale car elle ouvre la voie à des interventions thérapeutiques plus précoces et donc potentiellement plus efficaces.
La recherche génétique a identifié plusieurs variants associés à une susceptibilité accrue à la myélinolyse centropontine [1]. Ces découvertes permettent d'envisager une médecine personnalisée, avec des stratégies de prévention adaptées au profil génétique de chaque patient. Concrètement, cela pourrait permettre d'identifier les personnes à risque avant même qu'elles ne développent la maladie.
Les essais cliniques en cours testent également l'efficacité de neuroprotecteurs et d'anti-inflammatoires spécifiques . Bien que ces recherches soient encore préliminaires, elles suscitent beaucoup d'espoir dans la communauté médicale et chez les patients.
Vivre au Quotidien avec la Myélinolyse Centropontine
Vivre avec une myélinolyse centropontine demande des adaptations importantes, mais beaucoup de patients parviennent à retrouver une qualité de vie satisfaisante [9,10]. L'important est de ne pas rester isolé et de s'entourer d'une équipe médicale compétente et bienveillante.
Les troubles de la mobilité constituent souvent le défi principal. Des aides techniques comme les cannes, déambulateurs ou fauteuils roulants peuvent être nécessaires temporairement ou définitivement [11]. L'adaptation du domicile (barres d'appui, rampes d'accès) améliore considérablement l'autonomie et la sécurité.
La communication peut également être affectée. Les troubles de la parole nécessitent un suivi orthophonique régulier et parfois l'utilisation d'outils de communication alternative [8,9]. Heureusement, les nouvelles technologies offrent des solutions innovantes : applications mobiles, synthèses vocales ou tablettes spécialisées.
Le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Cette maladie peut générer anxiété, dépression et sentiment d'isolement [10]. Les groupes de parole, les associations de patients et l'accompagnement psychologique professionnel sont des ressources précieuses. D'ailleurs, de nombreux patients témoignent que le soutien de leurs proches a été déterminant dans leur parcours de récupération.
Les Complications Possibles
La myélinolyse centropontine peut entraîner diverses complications, dont la gravité dépend de l'étendue des lésions et de la rapidité de la prise en charge [6]. Il est important de les connaître pour mieux les prévenir et les traiter.
Le locked-in syndrome représente la complication la plus redoutable. Dans cette situation, le patient conserve sa conscience et ses fonctions cognitives mais ne peut plus bouger ni parler [7,8]. Seuls les mouvements oculaires verticaux restent possibles, permettant une communication rudimentaire. Heureusement, cette forme extrême reste rare et peut parfois s'améliorer avec le temps.
Les troubles respiratoires constituent une urgence vitale. L'atteinte des centres respiratoires du tronc cérébral peut nécessiter une ventilation assistée [9]. De même, les troubles de la déglutition exposent au risque de fausses routes et d'infections pulmonaires. Une surveillance étroite et des mesures préventives sont donc essentielles.
À long terme, certains patients développent des séquelles permanentes : spasticité, troubles de l'équilibre ou difficultés de communication [10,11]. Ces complications peuvent néanmoins être atténuées par une rééducation adaptée et un suivi médical régulier. Les innovations thérapeutiques 2024-2025 offrent de nouveaux espoirs pour limiter ces séquelles [1].
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la myélinolyse centropontine est très variable et dépend de nombreux facteurs [7]. Rassurez-vous, de nombreux patients récupèrent partiellement ou totalement leurs fonctions, surtout quand la prise en charge est précoce et adaptée.
Plusieurs éléments influencent l'évolution. L'étendue des lésions visibles à l'IRM constitue un facteur pronostique majeur [8,9]. Les formes localisées au pont central ont généralement un meilleur pronostic que celles avec atteinte extrapontine. L'âge du patient et son état de santé général jouent également un rôle important.
Les données récentes montrent qu'environ 60% des patients récupèrent de façon significative dans les 6 à 12 mois suivant l'épisode aigu [10,11]. Cette récupération peut se poursuivre pendant plusieurs années, d'où l'importance de maintenir les efforts de rééducation sur le long terme. Certains patients retrouvent même une autonomie complète.
Il faut savoir que le pronostic s'améliore grâce aux progrès de la prise en charge. Les nouvelles approches thérapeutiques développées en 2024-2025 pourraient encore améliorer ces perspectives [1]. L'important est de garder espoir et de s'investir activement dans le processus de récupération.
Peut-on Prévenir la Myélinolyse Centropontine ?
La prévention de la myélinolyse centropontine repose essentiellement sur la correction prudente des troubles électrolytiques [4,5]. Cette responsabilité incombe principalement aux équipes médicales, mais vous pouvez aussi jouer un rôle actif dans votre prise en charge.
En milieu hospitalier, les protocoles de correction de l'hyponatrémie ont été considérablement améliorés ces dernières années [6,11]. Les médecins savent maintenant qu'il ne faut pas augmenter le sodium sanguin de plus de 8-10 mmol/L par 24 heures. Cette approche progressive réduit considérablement le risque de myélinolyse centropontine.
Si vous souffrez d'alcoolisme chronique ou de malnutrition, un suivi médical régulier est essentiel [7]. La supplémentation en vitamines et minéraux, l'équilibrage nutritionnel et la prise en charge de l'addiction constituent des mesures préventives importantes. N'hésitez pas à parler ouvertement de ces problèmes avec votre médecin.
Les innovations 2024-2025 incluent le développement de tests génétiques pour identifier les personnes à risque [1]. Cette approche personnalisée pourrait permettre une surveillance renforcée chez les patients prédisposés. Cependant, ces outils restent encore en cours d'évaluation et ne sont pas disponibles en routine.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont émis des recommandations spécifiques concernant la prévention et la prise en charge de la myélinolyse centropontine [8,9]. Ces guidelines, régulièrement mises à jour, constituent la référence pour les professionnels de santé.
La Haute Autorité de Santé (HAS) insiste sur l'importance de la formation des équipes médicales à la gestion des troubles électrolytiques [10]. Des protocoles stricts de correction de l'hyponatrémie ont été établis, avec des seuils de sécurité à ne pas dépasser. Ces mesures ont permis de réduire significativement l'incidence de la maladie dans les hôpitaux français.
L'INSERM coordonne plusieurs programmes de recherche sur cette pathologie [11]. Les données épidémiologiques collectées permettent de mieux comprendre les facteurs de risque et d'adapter les stratégies de prévention. Ces travaux contribuent également au développement de nouvelles approches thérapeutiques.
Au niveau européen, la France participe activement aux réseaux de surveillance des maladies rares [1]. Cette collaboration internationale favorise les échanges d'expertise et accélère le développement de traitements innovants. Les recommandations sont régulièrement actualisées en fonction des dernières avancées scientifiques.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations et ressources peuvent vous accompagner dans votre parcours avec la myélinolyse centropontine. Ces structures offrent soutien, information et entraide entre patients et familles [9,10].
L'Association française contre les myopathies (AFM-Téléthon) dispose d'un réseau de conseillers en génétique et de services d'accompagnement. Bien qu'elle ne soit pas spécifiquement dédiée à la myélinolyse centropontine, elle peut orienter vers des ressources adaptées. Leur plateforme téléphonique offre une écoute et des conseils pratiques.
Les centres de référence des maladies rares constituent des ressources expertes incontournables [11]. Ils proposent des consultations spécialisées, des bilans complets et peuvent vous orienter vers des essais cliniques. Le centre de référence le plus proche de votre domicile peut être identifié via le site de la filière de santé maladies rares.
Les forums en ligne et groupes de soutien permettent d'échanger avec d'autres patients [8]. Ces espaces de partage sont précieux pour obtenir des conseils pratiques, partager ses expériences et rompre l'isolement. Attention cependant à vérifier la fiabilité des informations médicales partagées et à toujours consulter votre médecin.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec une myélinolyse centropontine nécessite quelques adaptations pratiques qui peuvent grandement améliorer votre quotidien [7]. Ces conseils, issus de l'expérience de nombreux patients, peuvent vous aider à mieux gérer votre pathologie.
Pour les troubles de la mobilité, pensez à sécuriser votre domicile. Retirez les tapis glissants, installez des barres d'appui dans la salle de bain et assurez-vous que l'éclairage soit suffisant [8]. Un ergothérapeute peut vous conseiller sur les aménagements les plus adaptés à votre situation.
Si vous avez des difficultés de déglutition, adaptez la texture de vos aliments. Les liquides épaissis et les aliments mixés peuvent être plus sûrs [9,10]. Mangez lentement, en position assise bien droite, et évitez de parler en mangeant. N'hésitez pas à consulter un diététicien spécialisé.
Pour maintenir votre moral, gardez des activités qui vous plaisent, même adaptées [11]. La lecture, la musique, les jeux de société ou les activités créatives peuvent être très bénéfiques. L'important est de rester actif intellectuellement et socialement. Les nouvelles technologies peuvent aussi vous aider : applications de communication, domotique ou outils d'assistance [1].
Quand Consulter un Médecin ?
Il est crucial de savoir reconnaître les signes qui doivent vous amener à consulter rapidement [6]. Certains symptômes nécessitent une prise en charge médicale urgente, surtout si vous avez des facteurs de risque de myélinolyse centropontine.
Consultez immédiatement si vous développez des troubles de la parole, de la déglutition ou de l'équilibre dans les jours suivant une hospitalisation ou une correction d'hyponatrémie [7,8]. Ces symptômes, même s'ils semblent bénins, peuvent être les premiers signes de la maladie.
Les troubles de la conscience, la faiblesse des membres ou les mouvements anormaux des yeux constituent également des signaux d'alarme [9,10]. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent : plus la prise en charge est précoce, meilleur est le pronostic.
Si vous êtes suivi pour alcoolisme chronique, malnutrition ou maladie chronique, parlez de vos symptômes neurologiques à votre médecin traitant [11]. Il pourra évaluer la nécessité d'examens complémentaires ou d'une consultation spécialisée. Les innovations diagnostiques 2024-2025 permettent une détection plus précoce, d'où l'importance de ne pas minimiser les symptômes [1].
Questions Fréquentes
La myélinolyse centropontine est-elle héréditaire ?
Non, cette pathologie n'est pas héréditaire au sens classique. Cependant, des facteurs génétiques de susceptibilité ont été identifiés récemment. Ces variants génétiques peuvent augmenter le risque de développer la maladie en cas d'exposition aux facteurs déclenchants.
Peut-on guérir complètement de cette maladie ?
Il n'existe pas de traitement curatif, mais de nombreux patients récupèrent partiellement ou totalement leurs fonctions. La récupération dépend de l'étendue des lésions et de la précocité de la prise en charge.
Combien de temps dure la récupération ?
La récupération peut s'étaler sur plusieurs mois à plusieurs années. Les premiers signes d'amélioration apparaissent généralement dans les 3 à 6 premiers mois.
Cette maladie peut-elle récidiver ?
La récidive est possible mais rare si les facteurs de risque sont bien contrôlés. Une surveillance médicale régulière et la prévention des déséquilibres électrolytiques réduisent considérablement ce risque.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Archives Case Report. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [2] Hyperintense lesions of the middle cerebellar peduncle. Innovation thérapeutique 2024-2025Lien
- [3] A El Ouati, V Ndayishimiye. Une myelinolyse centropontine sans rapport avec la natrémie: role de l'hyperglycemie? 2022Lien
- [4] M Hbibi, S Benmiloud. Myélinolyse centropontine réversible sans hyponatrémie chez un enfant. 2023Lien
- [5] H Joulal, J Yousfi. Syndrome de démyélinisation osmotique: quand la correction rapide fait perdre la tête. 2024Lien
- [6] S Toujani, I Jebari. Syndrome de démyélinisation osmotique après correction d'une hyponatrémie. 2023Lien
- [7] HEL Mouden, G Lembarki. Syndrome de démyélinisation osmotique: à propos de deux cas. 2023Lien
- [8] AB de Agua Reis. Syndrome de TURPLien
- [9] CHU CONSTANTINE. PATHOLOGIE DE LA SUBSTANCE BLANCHELien
- [10] M Dhoisne, L Sermet. Un traitement salé. 2023Lien
- [11] Myélinolyse pontique centrale : causes, symptômesLien
- [12] Syndrome de démyélinisation osmotique compliquant la correctionLien
- [13] Myélinolyse centropontine et extrapontineLien
Publications scientifiques
- Une myelinolyse centropontine sans rapport avec la natrémie: role de l'hyperglycemie? A propos d'un cas et revue de la litterature (2022)
- Myélinolyse centropontine réversible sans hyponatrémie chez un enfant atteint de leucémie aigüe lymphoblastique: à propos d´ un cas (2023)
- Syndrome de démyélinisation osmotique: quand la correction rapide fait perdre la tête (2024)
- Syndrome de démyélinisation osmotique après correction d'une hyponatrémie (2023)
- Syndrome de démyélinisation osmotique: à propos de deux cas (typique et moins typique) et revue de la littérature (2023)1 citations[PDF]
Ressources web
- Myélinolyse pontique centrale : causes, symptômes et ... (medicoverhospitals.in)
3. Comment diagnostique-t-on la myélinolyse centropontine ? Le diagnostic est réalisé par IRM, qui montre des lésions caractéristiques du tronc cérébral.
- Syndrome de démyélinisation osmotique compliquant la ... (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
de Z Ghoummid · 2019 · Cité 1 fois — Le diagnostic de myélinolyse centropontine et extrapontine a été confirmé par une imagerie par résonance magnétique cérébrale faite 20 jours ...
- Myélinolyse centropontine et extrapontine (aturea.org)
Le diagnostic du syndrome de démyélinisation osmotique est essentiellement clinique,il peut associer une quadriparésie,une dysarthrie,un syndrome ...
- Fiche maladie : Myélinolyse centropontine (radeos.org)
26 sept. 2017 — Signes RETARDES : IRM initiale souvent négative, à recontrôler devant un tableau clinique évocateur. Myélinolyse centropontine : -hyposignal ...
- Hyponatrémie sévère et myélinolyse centropontine (sciencedirect.com)
de S Ruiz · 2009 · Cité 7 fois — Le diagnostic de myélinolyse centropontine a été porté formellement grâce à une IRM centrée sur le tronc cérébral. Dans le cas rapporté, la correction de l ...
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
