Maladie d'Alexander : Symptômes, Diagnostic et Traitements 2025
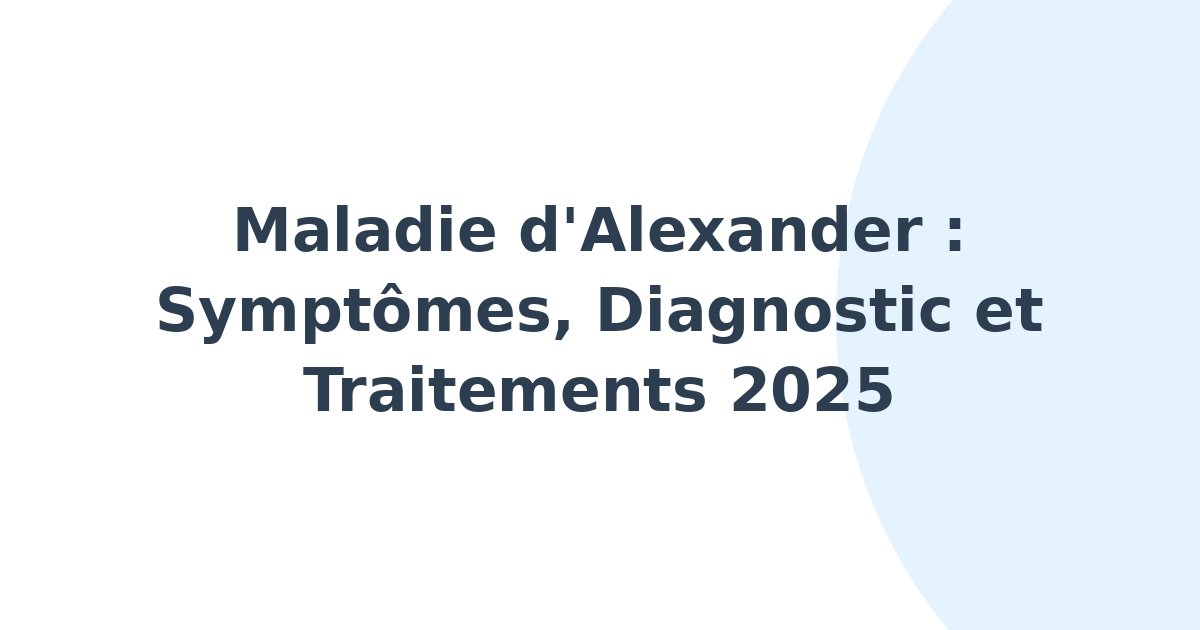
La maladie d'Alexander est une leucodystrophie rare qui affecte le système nerveux central. Cette pathologie génétique touche principalement la substance blanche du cerveau et provoque des symptômes neurologiques progressifs. Bien que rare, elle nécessite une prise en charge spécialisée et un diagnostic précoce pour optimiser la qualité de vie des patients.
Téléconsultation et Maladie d'Alexander
Téléconsultation non recommandéeLa maladie d'Alexander est une leucodystrophie rare nécessitant un diagnostic spécialisé par IRM cérébrale et analyses génétiques. L'évaluation neurologique clinique approfondie et les examens complémentaires spécialisés sont indispensables pour le diagnostic et le suivi de cette pathologie complexe.
Ce qui peut être évalué à distance
Description des symptômes neurologiques et de leur évolution dans le temps, évaluation de l'impact fonctionnel au quotidien, analyse de l'historique des crises épileptiques éventuelles, coordination entre les différents spécialistes impliqués dans la prise en charge, suivi de l'observance thérapeutique.
Ce qui nécessite une consultation en présentiel
Examen neurologique complet avec évaluation des fonctions motrices et cognitives, réalisation d'IRM cérébrale pour surveiller la progression des lésions de la substance blanche, analyses génétiques spécialisées, électroencéphalogramme en cas de crises épileptiques.
La téléconsultation ne remplace pas une prise en charge urgente. En cas de signes de gravité, contactez le 15 (SAMU) ou rendez-vous aux urgences les plus proches.
Limites de la téléconsultation
Situations nécessitant une consultation en présentiel :
Aggravation rapide des symptômes neurologiques nécessitant une réévaluation complète, apparition de nouvelles crises épileptiques difficiles à contrôler, détérioration cognitive significative nécessitant des tests spécialisés, besoin d'ajustement thérapeutique complexe nécessitant un examen neurologique approfondi.
Situations nécessitant une prise en charge en urgence :
État de mal épileptique ou crises répétées, troubles de la déglutition avec risque de fausse route, détérioration neurologique brutale, troubles respiratoires ou de la conscience.
Quand appeler le 15 (SAMU)
Signes de gravité nécessitant un appel immédiat :
- Crises épileptiques prolongées ou répétées sans récupération complète entre les crises
- Troubles de la déglutition avec difficultés alimentaires importantes ou fausses routes répétées
- Détérioration neurologique brutale avec perte de fonctions motrices ou cognitives
- Troubles respiratoires ou de la conscience nécessitant une surveillance médicale immédiate
La téléconsultation ne remplace jamais l'urgence. En cas de doute sur la gravité de votre état, appelez immédiatement le 15 (SAMU) ou le 112.
Spécialité recommandée
Neurologue — consultation en présentiel indispensable
La maladie d'Alexander nécessite une prise en charge neurologique spécialisée avec examens cliniques approfondis et imagerie cérébrale régulière. La consultation en présentiel est indispensable pour l'évaluation neurologique complète et le suivi de cette pathologie rare et complexe.
Maladie d'Alexander : Définition et Vue d'Ensemble
La maladie d'Alexander appartient à la famille des leucodystrophies, des pathologies qui détruisent progressivement la myéline du système nerveux [5]. Cette substance blanche protège les fibres nerveuses et permet la transmission rapide des signaux électriques.
Mais qu'est-ce qui rend cette maladie si particulière ? Elle se caractérise par l'accumulation anormale d'une protéine appelée GFAP (protéine acide fibrillaire gliale) dans les astrocytes, des cellules du cerveau [6]. Cette accumulation forme des inclusions caractéristiques appelées fibres de Rosenthal.
D'ailleurs, la pathologie se manifeste sous trois formes principales selon l'âge d'apparition. La forme infantile débute avant 2 ans, la forme juvénile entre 2 et 12 ans, et la forme adulte après 12 ans [7]. Chaque forme présente des symptômes et une évolution différents.
L'important à retenir : cette maladie génétique rare nécessite une approche multidisciplinaire pour sa prise en charge. Les progrès récents en thérapie génique ouvrent de nouvelles perspectives d'espoir pour les patients et leurs familles.
Épidémiologie en France et dans le Monde
Les données épidémiologiques récentes révèlent que la maladie d'Alexander touche environ 1 personne sur 2,7 millions dans la population générale [1]. En France, on estime qu'environ 25 à 30 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année selon les dernières données du Protocole National de Diagnostic et de Soins [1].
Concrètement, cela représente une prévalence d'environ 0,4 cas pour 100 000 habitants en France. Cette pathologie ne présente pas de prédominance géographique particulière, touchant toutes les régions de manière équivalente. Cependant, certaines variations peuvent s'observer selon les centres de référence et leur expertise diagnostique.
Et au niveau international ? Les études européennes montrent des chiffres similaires, avec une légère variation selon les pays. L'Allemagne et le Royaume-Uni rapportent des prévalences comparables à la France [1]. Les États-Unis estiment quant à eux environ 200 à 300 cas diagnostiqués sur l'ensemble du territoire.
Bon à savoir : la forme infantile représente 60% des cas, la forme juvénile 25%, et la forme adulte 15% [6]. Cette répartition influence directement les stratégies de dépistage et de prise en charge mises en place par les autorités sanitaires françaises.
Les Causes et Facteurs de Risque
La maladie d'Alexander résulte de mutations dans le gène GFAP, situé sur le chromosome 17 [5]. Ce gène code pour une protéine essentielle au bon fonctionnement des astrocytes, ces cellules qui soutiennent et nourrissent les neurones.
Dans la majorité des cas, il s'agit de mutations spontanées, c'est-à-dire non héritées des parents. Environ 90% des patients présentent des mutations de novo [7]. Cela signifie que vous pouvez développer cette pathologie même sans antécédents familiaux.
Cependant, dans 10% des cas, la transmission peut être héréditaire selon un mode autosomique dominant. Si l'un des parents est porteur de la mutation, chaque enfant a 50% de risque de développer la maladie [6]. Cette information est cruciale pour le conseil génétique des familles.
Il faut savoir que plus de 70 mutations différentes du gène GFAP ont été identifiées à ce jour. Certaines mutations sont associées à des formes plus sévères, tandis que d'autres entraînent des symptômes plus modérés. Cette variabilité génétique explique en partie la diversité des manifestations cliniques observées chez les patients.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Les symptômes de la maladie d'Alexander varient considérablement selon la forme et l'âge d'apparition [7]. Dans la forme infantile, les premiers signes apparaissent généralement avant l'âge de 2 ans et incluent un retard de développement psychomoteur marqué.
Concrètement, vous pourriez observer chez un enfant atteint : une macrocéphalie (augmentation du périmètre crânien), des troubles de la déglutition, et des crises d'épilepsie [6]. Les difficultés alimentaires sont souvent précoces et nécessitent une attention particulière.
La forme juvénile se manifeste différemment. Les enfants développent progressivement des troubles de la marche, une spasticité des membres, et des difficultés scolaires [5]. Les troubles du langage et de la coordination peuvent également apparaître.
Chez l'adulte, les symptômes sont plus subtils au début. On observe souvent des troubles de l'équilibre, une faiblesse musculaire progressive, et parfois des troubles de la déglutition [7]. Certains patients rapportent également des changements de personnalité ou des difficultés cognitives légères.
L'important à retenir : ces symptômes évoluent généralement de manière progressive. Il est normal de s'inquiéter face à ces manifestations, mais un diagnostic précoce permet une meilleure prise en charge.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de la maladie d'Alexander repose sur plusieurs examens complémentaires [1]. La première étape consiste en un examen clinique approfondi par un neurologue spécialisé dans les maladies rares.
L'IRM cérébrale constitue l'examen de référence pour identifier les anomalies caractéristiques [5]. Elle révèle des lésions spécifiques de la substance blanche, particulièrement visibles dans les régions frontales et périventriculaires. Ces images permettent souvent d'orienter fortement le diagnostic.
Mais l'examen décisif reste l'analyse génétique. Le séquençage du gène GFAP confirme définitivement le diagnostic en identifiant la mutation responsable [6]. Cette analyse peut prendre plusieurs semaines, mais elle est indispensable pour établir un diagnostic de certitude.
D'autres examens peuvent être nécessaires selon les cas : électroencéphalogramme en cas de crises d'épilepsie, examens ophtalmologiques, ou encore évaluations neuropsychologiques [7]. Le bilan complet permet d'évaluer l'étendue des atteintes et d'adapter la prise en charge.
Bon à savoir : le diagnostic peut parfois prendre plusieurs mois, surtout dans les formes atypiques. Il est important de rester patient et de faire confiance à l'équipe médicale spécialisée.
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
Actuellement, il n'existe pas de traitement curatif spécifique pour la maladie d'Alexander [1]. Cependant, une prise en charge symptomatique bien coordonnée peut considérablement améliorer la qualité de vie des patients.
La kinésithérapie joue un rôle central dans le maintien des capacités motrices. Des séances régulières permettent de lutter contre la spasticité et de préserver la mobilité le plus longtemps possible [5]. L'ergothérapie complète cette approche en adaptant l'environnement aux besoins du patient.
Pour les troubles de la déglutition, une prise en charge orthophonique précoce est essentielle. Dans certains cas, une gastrostomie peut être nécessaire pour assurer une nutrition adéquate [6]. Cette intervention, bien qu'impressionnante, améliore significativement le confort des patients.
Les crises d'épilepsie, fréquentes dans la forme infantile, nécessitent un traitement antiépileptique adapté. Les neurologues utilisent généralement des médicaments comme le lévétiracétam ou l'acide valproïque [7]. Le choix dépend de l'âge du patient et du type de crises.
D'ailleurs, la prise en charge de la douleur ne doit pas être négligée. Certains patients développent des douleurs neuropathiques qui peuvent être soulagées par des traitements spécifiques comme la gabapentine.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024 marque un tournant majeur dans la recherche sur la maladie d'Alexander avec l'annonce d'essais cliniques prometteurs . La thérapie antisens représente l'approche la plus avancée actuellement en développement.
Zilganersen, développé par Ionis Pharmaceuticals, a obtenu la désignation Fast Track de la FDA américaine en 2024 [3,4]. Ce médicament innovant vise à réduire la production de la protéine GFAP mutée en ciblant directement l'ARN messager. Les premiers résultats précliniques sont encourageants.
En France, l'horizon scanning 2024-2025 identifie plusieurs pistes thérapeutiques prometteuses . Les thérapies ciblées et l'immunothérapie font l'objet d'investigations approfondies . Ces approches pourraient révolutionner la prise en charge dans les années à venir.
Ionis a également annoncé la conception d'un essai pivot de phase 3 pour évaluer l'efficacité du zilganersen [2]. Cet essai, prévu pour débuter en 2025, pourrait ouvrir la voie à la première thérapie spécifique de la maladie d'Alexander.
Parallèlement, les recherches sur la thérapie génique progressent. Plusieurs équipes travaillent sur des vecteurs viraux capables de corriger la mutation du gène GFAP directement dans les cellules cérébrales. Ces approches, bien qu'encore expérimentales, représentent un espoir considérable pour l'avenir.
Vivre au Quotidien avec la Maladie d'Alexander
Vivre avec la maladie d'Alexander nécessite des adaptations importantes, mais une vie épanouie reste possible [5]. L'organisation du quotidien devient cruciale pour maintenir l'autonomie le plus longtemps possible.
L'aménagement du domicile constitue souvent la première étape. Des barres d'appui dans la salle de bain, l'élimination des obstacles au sol, et l'installation d'un monte-escalier peuvent considérablement faciliter les déplacements [6]. Ces modifications, bien que coûteuses, améliorent significativement la sécurité.
Pour les enfants scolarisés, la mise en place d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) ou d'un Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS) est indispensable. Ces dispositifs permettent d'adapter les maladies d'apprentissage aux besoins spécifiques de l'enfant [7].
La gestion de la fatigue représente un défi quotidien. Il est important d'apprendre à économiser son énergie et à planifier les activités. Certains patients trouvent bénéfique de fractionner leurs tâches et de prévoir des temps de repos réguliers.
D'ailleurs, le soutien psychologique ne doit pas être négligé. Accepter le diagnostic et s'adapter aux limitations progressives peut être difficile. Un accompagnement par un psychologue spécialisé dans les maladies chroniques peut s'avérer très utile.
Les Complications Possibles
La maladie d'Alexander peut entraîner diverses complications selon sa forme et son évolution [6]. Les troubles respiratoires représentent l'une des préoccupations majeures, particulièrement dans les formes sévères.
Les infections pulmonaires récurrentes constituent un risque important. La faiblesse des muscles respiratoires et les troubles de la déglutition favorisent les fausses routes alimentaires [7]. Une surveillance régulière de la fonction respiratoire est donc indispensable.
Les complications nutritionnelles sont également fréquentes. La dysphagie progressive peut conduire à une dénutrition si elle n'est pas prise en charge rapidement [5]. Dans certains cas, une alimentation entérale par gastrostomie devient nécessaire pour maintenir un état nutritionnel correct.
D'un point de vue neurologique, l'épilepsie peut se compliquer d'un état de mal épileptique, situation d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate. Heureusement, cette complication reste rare avec un traitement antiépileptique bien conduit [6].
Enfin, les complications orthopédiques comme les rétractions tendineuses ou les déformations articulaires peuvent apparaître. Une kinésithérapie préventive et des étirements réguliers permettent de limiter ces risques.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic de la maladie d'Alexander varie considérablement selon la forme et l'âge d'apparition [1]. Cette variabilité rend difficile l'établissement de prédictions précises pour chaque patient.
La forme infantile présente généralement l'évolution la plus sévère. L'espérance de vie peut être réduite, avec une progression rapide des symptômes dans les premières années de vie [6]. Cependant, certains enfants peuvent vivre plusieurs années avec une qualité de vie acceptable grâce aux soins appropriés.
Pour la forme juvénile, le pronostic est intermédiaire. Les patients peuvent maintenir une certaine autonomie pendant de nombreuses années, bien que des limitations progressives apparaissent [7]. L'évolution est généralement plus lente que dans la forme infantile.
La forme adulte offre souvent le meilleur pronostic. Certains patients conservent une autonomie relative pendant des décennies [5]. L'évolution peut être très lente, permettant une adaptation progressive aux limitations.
Il est important de souligner que chaque personne est différente. Certains facteurs peuvent influencer positivement l'évolution : une prise en charge précoce, un bon état nutritionnel, et l'absence de complications infectieuses. Les progrès thérapeutiques récents laissent également espérer une amélioration du pronostic dans les années à venir.
Peut-on Prévenir la Maladie d'Alexander ?
La prévention primaire de la maladie d'Alexander n'est actuellement pas possible, car il s'agit d'une pathologie génétique [5]. Cependant, le conseil génétique joue un rôle crucial pour les familles concernées.
Dans les rares cas de transmission héréditaire, un diagnostic prénatal peut être proposé aux couples à risque [6]. Cette démarche nécessite une consultation spécialisée en génétique médicale pour évaluer les options disponibles et leurs implications.
Le diagnostic préimplantatoire (DPI) représente une alternative pour les couples souhaitant éviter la transmission de la maladie. Cette technique, réalisée dans le cadre d'une fécondation in vitro, permet de sélectionner les embryons non porteurs de la mutation [7].
Mais la prévention peut aussi concerner les complications. Un suivi médical régulier permet de détecter précocement les signes d'aggravation et d'adapter la prise en charge. La vaccination contre les infections respiratoires (grippe, pneumocoque) est particulièrement recommandée.
D'ailleurs, maintenir une bonne hygiène de vie reste bénéfique : alimentation équilibrée, activité physique adaptée, et évitement des facteurs de stress inutiles. Ces mesures, bien qu'elles ne préviennent pas la maladie, peuvent contribuer à ralentir sa progression.
Recommandations des Autorités de Santé
Les autorités sanitaires françaises ont établi des recommandations spécifiques pour la prise en charge de la maladie d'Alexander [1]. Le Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) constitue le référentiel officiel pour les professionnels de santé.
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une prise en charge multidisciplinaire coordonnée par un centre de référence des leucodystrophies [1]. Cette approche attendut une expertise spécialisée et une continuité des soins optimale.
Concernant le diagnostic, les recommandations insistent sur l'importance de l'IRM cérébrale et de l'analyse génétique [1]. Ces examens doivent être réalisés dans des centres disposant de l'expertise technique nécessaire pour interpréter correctement les résultats.
Pour le suivi, un bilan annuel complet est recommandé, incluant une évaluation neurologique, nutritionnelle, et respiratoire [1]. Cette surveillance permet d'adapter la prise en charge aux besoins évolutifs du patient.
Les autorités soulignent également l'importance de l'accompagnement social et psychologique. L'accès aux dispositifs d'aide (ALD, MDPH, prestations sociales) doit être facilité pour les patients et leurs familles [1].
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients atteints de maladie d'Alexander et leurs familles [5]. ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies) constitue la référence principale en France pour toutes les leucodystrophies.
Cette association propose de nombreux services : information médicale actualisée, soutien psychologique, aide financière pour l'aménagement du domicile, et organisation de rencontres entre familles [5]. Son site internet constitue une mine d'informations fiables et régulièrement mises à jour.
Au niveau international, plusieurs organisations offrent des ressources complémentaires. La United Leukodystrophy Foundation aux États-Unis propose des webinaires éducatifs et finance la recherche. En Europe, le réseau EURORDIS coordonne les actions pour les maladies rares.
Les centres de référence constituent également des ressources essentielles. En France, le centre de référence des leucodystrophies de l'hôpital Bicêtre coordonne la prise en charge et la recherche [6]. Ces centres disposent d'équipes spécialisées et de consultations dédiées.
N'hésitez pas à contacter ces structures : elles peuvent vous orienter vers les professionnels compétents et vous mettre en relation avec d'autres familles. Le partage d'expériences s'avère souvent très bénéfique pour mieux vivre avec la maladie.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec la maladie d'Alexander nécessite une organisation particulière, mais quelques conseils pratiques peuvent considérablement améliorer le quotidien [7]. La planification devient votre meilleure alliée pour gérer l'énergie disponible.
Organisez votre journée en fonction de vos pics de forme. Beaucoup de patients rapportent être plus en forme le matin. Profitez de ces moments pour les activités les plus exigeantes. Gardez l'après-midi pour les tâches plus légères ou le repos.
Pour les déplacements, n'hésitez pas à utiliser les aides techniques disponibles : canne, déambulateur, ou fauteuil roulant selon vos besoins [5]. Ces outils ne sont pas un signe de faiblesse, mais des moyens de préserver votre autonomie plus longtemps.
Côté alimentation, privilégiez des textures adaptées si vous avez des troubles de la déglutition. Les compléments nutritionnels peuvent être utiles pour maintenir un bon état nutritionnel [6]. N'hésitez pas à consulter une diététicienne spécialisée.
Enfin, restez connecté avec vos proches et votre réseau social. L'isolement peut aggraver les difficultés psychologiques. Les nouvelles technologies permettent de maintenir le lien même quand les déplacements deviennent difficiles.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains signes d'alarme nécessitent une consultation médicale urgente chez les patients atteints de maladie d'Alexander [6]. Il est important de les connaître pour réagir rapidement si nécessaire.
Les troubles respiratoires aigus constituent une urgence absolue. Si vous ressentez une gêne respiratoire inhabituelle, une toux persistante avec fièvre, ou des difficultés à expectorer, consultez immédiatement [7]. Ces symptômes peuvent signaler une infection pulmonaire nécessitant un traitement antibiotique.
Les crises d'épilepsie prolongées (plus de 5 minutes) ou répétées nécessitent également une prise en charge urgente. N'hésitez pas à appeler le SAMU si vous ou votre proche présentez ce type de crise [5].
Une aggravation brutale des troubles de la déglutition, avec épisodes de fausses routes répétés, justifie une consultation rapide. Le risque d'inhalation alimentaire peut être grave et nécessiter des mesures préventives immédiates [6].
Pour le suivi habituel, une consultation tous les 3 à 6 mois avec votre neurologue référent est généralement recommandée. Cette fréquence peut être adaptée selon l'évolution de votre état et les recommandations de votre équipe médicale [7].
Questions Fréquentes
La maladie d'Alexander est-elle héréditaire ?
Dans 90% des cas, il s'agit de mutations spontanées non héritées des parents. Seuls 10% des cas présentent une transmission héréditaire selon un mode autosomique dominant.
Peut-on guérir de cette maladie ?
Actuellement, il n'existe pas de traitement curatif spécifique. Cependant, les recherches en cours, notamment sur le zilganersen qui a obtenu la désignation Fast Track de la FDA en 2024, offrent des perspectives encourageantes.
L'espérance de vie est-elle réduite ?
Cela dépend de la forme de la maladie. La forme adulte permet souvent une espérance de vie proche de la normale, contrairement aux formes infantiles qui présentent généralement une évolution plus sévère.
Peut-on avoir des enfants quand on a cette maladie ?
Oui, mais un conseil génétique est fortement recommandé. Dans les rares cas de transmission héréditaire, un diagnostic prénatal ou préimplantatoire peut être proposé aux couples à risque.
La maladie évolue-t-elle toujours de la même façon ?
Non, l'évolution est très variable d'un patient à l'autre. Certains patients gardent une autonomie pendant des années, d'autres évoluent plus rapidement selon la forme de la maladie et les facteurs individuels.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) - Maladie d'Alexander. HAS. 2024-2025.Lien
- [2] Horizon scanning. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [3] Ionis annonce la conception d'un essai pivot de phase 3. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [4] Thérapies ciblées et immunothérapie : positionnement. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [5] Zilganersen granted U.S. FDA Fast Track designation. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Zilganersen Gains FDA Fast Track for Alexander Disease. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [15] Maladie d'Alexander. ELA International.Lien
- [16] Maladie d'Alexander type II. Orphanet.Lien
- [17] Maladie d'Alexandre : causes et symptômes. Medicover Hospitals.Lien
Publications scientifiques
- [HTML][HTML] Neurophysiologie des troubles psychiatriques: construction d'une plateforme nationale d'électroencéphalographie à haute densité (2025)
- Endocardite gonococcique chez un homme de 54 ans atteint d'arthrite aiguë (2022)[PDF]
- Agression ou adaptation. La querelle du conformisme et la question du Mal dans la réflexion d'Alexander et Margarete Mitscherlich (2025)
- Neurophysiology of psychiatric disorders: building a national high-density electroencephalography platform (2025)
- [PDF][PDF] Le cosmos et le cosmopolitisme d'Alexander von Humboldt 2 citations[PDF]
Ressources web
- Maladie d'Alexander (elainternational.eu)
Les symptômes comprennent un retard mental, l'épilepsie, une raideur musculaire, et leur progression conduit au décès du patient. Elle est caractérisée par une ...
- Maladie d'Alexander type II (orpha.net)
Elle se manifeste le plus souvent par des signes bulbaires (dysarthrie, dysphonie, dysphagie) et pyramidaux, ainsi que des troubles de la marche dus à une ...
- Maladie d'Alexandre : causes et symptômes (medicoverhospitals.in)
Les symptômes peuvent inclure une ataxie (perte de coordination), une dysarthrie (difficulté à parler) et un déclin cognitif.
- Maladie d'Alexander type I (orpha.net)
Elle se manifeste avant l'âge de quatre ans et se caractérise par des convulsions, une mégalencéphalie et un retard de développement avec détérioration ...
- Maladie d'Alexander (fr.wikipedia.org)
Les signes comprennent des signes bulbaires incluant difficultés d'élocution, vomissements fréquents et des troubles de déglutition.
Besoin d'un avis médical ?
Consulter un médecin en ligneConsultation remboursable* lorsque le parcours de soins est respecté
Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
