Mort Subite : Causes, Prévention et Prise en Charge - Guide Complet 2025
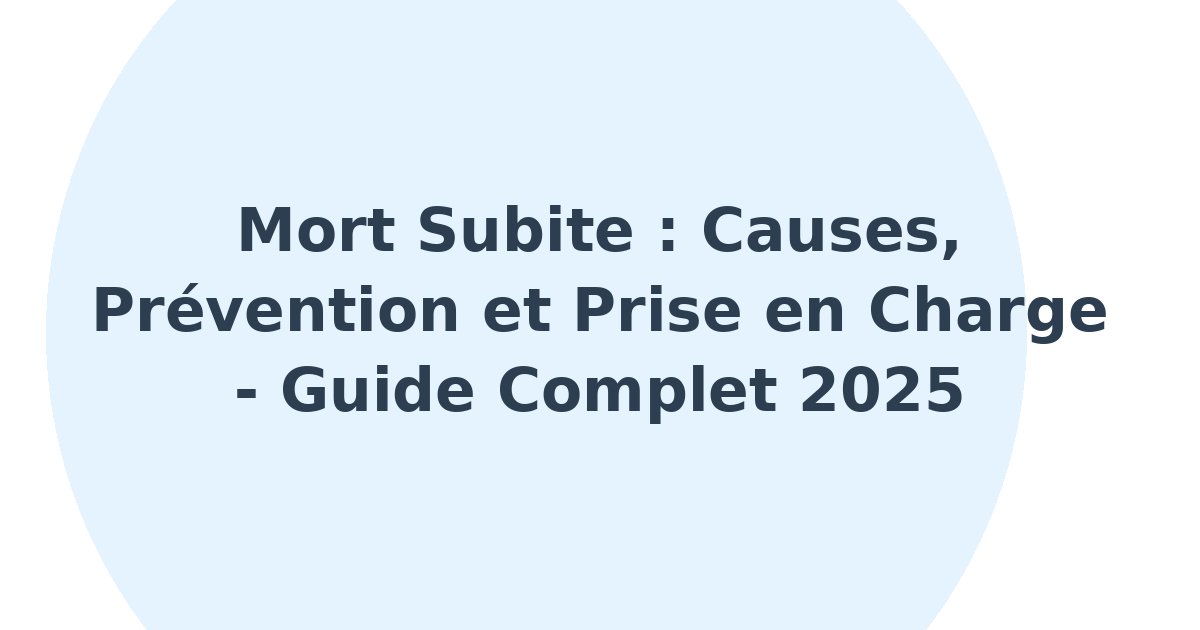
La mort subite représente un décès inattendu survenant dans l'heure suivant l'apparition des premiers symptômes. En France, cette pathologie touche environ 50 000 personnes chaque année [1,2]. Bien que dramatique, des progrès considérables en prévention et prise en charge émergent en 2024-2025. Comprendre les mécanismes, reconnaître les signes d'alerte et connaître les gestes qui sauvent peut faire la différence.

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Mort Subite : Définition et Vue d'Ensemble
La mort subite se définit comme un décès naturel, inattendu et rapide, survenant dans l'heure suivant l'apparition des premiers symptômes chez une personne en apparente bonne santé [3]. Cette définition médicale précise distingue la mort subite des autres formes de décès.
Mais qu'est-ce qui rend cette pathologie si particulière ? D'abord, son caractère imprévisible. La personne peut vaquer à ses occupations normalement quelques minutes avant l'événement. Ensuite, sa rapidité : le processus se déroule généralement en moins de 60 minutes [11].
La mort subite cardiaque représente 80 à 90% des cas de mort subite chez l'adulte [15]. Elle résulte d'un arrêt cardiaque brutal, souvent lié à des troubles du rythme cardiaque appelés arythmies malignes. Ces dernières empêchent le cœur de pomper efficacement le sang vers les organes vitaux.
Concrètement, que se passe-t-il dans l'organisme ? Le cœur entre en fibrillation ventriculaire ou présente une tachycardie ventriculaire sans pouls. Ces rythmes anormaux rendent le cœur inefficace, provoquant un arrêt circulatoire immédiat. Sans intervention rapide, le décès survient en quelques minutes.
Épidémiologie en France et dans le Monde
En France, la mort subite touche environ 50 000 personnes chaque année, soit une incidence de 75 cas pour 100 000 habitants [1,2]. Ces chiffres placent notre pays dans la moyenne européenne, légèrement en dessous des pays nordiques où l'incidence atteint 100 pour 100 000 habitants.
L'analyse des données de Santé Publique France révèle des disparités importantes selon l'âge et le sexe [1]. Chez les hommes, l'incidence augmente drastiquement après 45 ans, passant de 10 pour 100 000 avant 40 ans à 200 pour 100 000 après 65 ans. Les femmes présentent un risque plus faible jusqu'à la ménopause, puis rattrapent progressivement les hommes.
D'ailleurs, les variations régionales sont significatives. Les régions du Nord et de l'Est affichent des taux supérieurs à la moyenne nationale, probablement liés aux facteurs socio-économiques et aux habitudes de vie [4]. À l'inverse, les régions méditerranéennes présentent des taux plus faibles.
Les projections pour 2025-2030 sont préoccupantes. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire, les experts estiment une hausse de 15 à 20% des cas de mort subite d'ici 2030 [2]. Cette évolution représente un défi majeur pour notre système de santé.
Les Causes et Facteurs de Risque
La maladie coronarienne représente la cause principale de mort subite, responsable de 70% des cas chez l'adulte [18]. Cette pathologie se caractérise par un rétrécissement des artères qui alimentent le muscle cardiaque. Quand une plaque d'athérome se rompt brutalement, elle peut déclencher un infarctus du myocarde foudroyant.
Mais d'autres causes cardiaques existent. Les cardiomyopathies (maladies du muscle cardiaque) touchent particulièrement les sujets jeunes [10,14]. La cardiomyopathie hypertrophique, souvent héréditaire, peut provoquer une mort subite lors d'efforts intenses. C'est pourquoi le dépistage chez les sportifs est crucial.
Les facteurs de risque cardiovasculaire classiques augmentent considérablement le risque [1,4]. Le tabagisme multiplie le risque par 3, l'hypertension artérielle par 2,5, et le diabète par 2. L'obésité, la sédentarité et le stress chronique s'ajoutent à cette liste.
Chez les sujets jeunes, les causes diffèrent. Les canalopathies (anomalies des canaux ioniques cardiaques) comme le syndrome de Brugada ou le syndrome du QT long peuvent être responsables [3]. Ces maladies génétiques rares nécessitent un dépistage familial systématique.
Comment Reconnaître les Symptômes ?
Reconnaître les signes avant-coureurs de la mort subite peut sauver des vies. Malheureusement, dans 50% des cas, aucun symptôme précurseur n'est identifiable [11]. Cependant, quand ils existent, certains signaux d'alarme doivent alerter.
Les douleurs thoraciques représentent le symptôme le plus fréquent. Elles peuvent être intenses, en étau, irradiant vers le bras gauche, la mâchoire ou le dos. Mais attention : chez la femme et le diabétique, la douleur peut être atypique, voire absente.
D'autres symptômes doivent inquiéter : l'essoufflement brutal et inexpliqué, les palpitations intenses, les malaises répétés ou la syncope (perte de connaissance brève). Chez le sportif, tout malaise à l'effort impose un arrêt immédiat et une consultation cardiologique [10,12].
L'important à retenir : face à ces symptômes, chaque minute compte. N'hésitez jamais à appeler le 15 (SAMU) devant une douleur thoracique intense ou un malaise inexpliqué. Le déni et l'attentisme sont les pires ennemis dans ces situations d'urgence.
Le Parcours Diagnostic Étape par Étape
Le diagnostic de risque de mort subite repose sur une approche méthodique et des examens spécialisés. Tout commence par un interrogatoire minutieux explorant les antécédents personnels et familiaux. Le médecin recherche notamment les antécédents de syncope, de palpitations ou de mort subite familiale [3].
L'électrocardiogramme (ECG) constitue l'examen de première intention. Il peut révéler des anomalies évocatrices : syndrome de Brugada, QT long, ou signes d'hypertrophie ventriculaire. Cet examen simple et rapide oriente déjà le diagnostic.
L'échocardiographie complète le bilan en visualisant la structure et la fonction cardiaque. Elle détecte les cardiomyopathies, les valvulopathies ou les anomalies de la contractilité. Chez le sportif, cet examen est systématique dans le cadre du dépistage [12,14].
Pour certains patients, des examens plus poussés s'avèrent nécessaires. L'IRM cardiaque précise la nature des anomalies détectées. Le Holter ECG (enregistrement sur 24-48h) capture les troubles du rythme intermittents. L'épreuve d'effort démasque les arythmies induites par l'exercice.
En cas de suspicion de maladie génétique, une enquête familiale s'impose. Elle permet de dépister d'autres membres de la famille à risque et d'adapter la prise en charge [3].
Les Traitements Disponibles Aujourd'hui
La prise en charge du risque de mort subite s'articule autour de plusieurs stratégies thérapeutiques. Le traitement varie selon la cause identifiée et le niveau de risque évalué. L'objectif principal reste la prévention de l'arrêt cardiaque fatal.
Les médicaments antiarythmiques constituent souvent la première ligne de traitement. Les bêta-bloquants réduisent significativement le risque chez les patients avec cardiomyopathie ou syndrome du QT long. L'amiodarone, plus puissante, est réservée aux cas complexes en raison de ses effets secondaires.
Pour les patients à haut risque, le défibrillateur automatique implantable (DAI) représente une révolution thérapeutique [13]. Cet appareil, implanté sous la peau, surveille en permanence le rythme cardiaque. En cas d'arythmie maligne, il délivre automatiquement un choc électrique salvateur.
Le gilet défibrillateur portable constitue une innovation récente particulièrement intéressante [13]. Porté temporairement, il protège les patients en attente d'implantation ou lors de périodes à risque accru. Cette technologie offre une protection immédiate sans intervention chirurgicale.
Dans certains cas, la chirurgie cardiaque s'avère nécessaire. La correction d'une valvulopathie sévère ou la revascularisation coronarienne peuvent éliminer le substrat arythmogène. Chez les jeunes avec cardiomyopathie hypertrophique, la myomectomie chirurgicale réduit l'obstruction.
Innovations Thérapeutiques et Recherche 2024-2025
L'année 2024-2025 marque un tournant dans la prise en charge de la mort subite avec l'émergence de technologies révolutionnaires. Les réseaux d'investigations cliniques développent de nouveaux dispositifs médicaux de diagnostic et de surveillance [6].
L'intelligence artificielle transforme le dépistage précoce. Les algorithmes d'apprentissage automatique analysent désormais les ECG avec une précision supérieure à l'œil humain [5]. Ces outils détectent des anomalies subtiles invisibles lors d'une lecture conventionnelle, permettant un dépistage plus précoce.
Les dispositifs connectés révolutionnent la surveillance ambulatoire. Les montres intelligentes équipées d'ECG détectent automatiquement les arythmies et alertent les services d'urgence [8]. Cette technologie démocratise la surveillance cardiaque continue.
En recherche fondamentale, la thérapie génique ouvre des perspectives prometteuses [7]. Les premiers essais cliniques testent la correction des mutations responsables de canalopathies. Bien qu'encore expérimentale, cette approche pourrait révolutionner le traitement des formes héréditaires.
Les nouvelles recommandations ACC/AHA 2025 intègrent ces innovations dans les algorithmes de prise en charge [9]. Elles préconisent l'utilisation systématique de l'IA pour l'interprétation des ECG de dépistage et encouragent le développement de la télémédecine cardiologique.
Vivre au Quotidien avec le Risque de Mort Subite
Apprendre qu'on présente un risque de mort subite bouleverse profondément la vie quotidienne. Cette annonce génère souvent une anxiété majeure et nécessite un accompagnement psychologique adapté. Il est normal de ressentir de l'angoisse face à cette épée de Damoclès.
L'adaptation du mode de vie devient primordiale. L'arrêt du tabac s'impose absolument, de même que la limitation de l'alcool. L'activité physique doit être adaptée selon les recommandations cardiologiques. Contrairement aux idées reçues, l'exercice modéré et régulier reste bénéfique sous surveillance médicale.
La gestion du stress joue un rôle crucial. Les techniques de relaxation, la méditation ou le yoga peuvent aider à mieux gérer l'anxiété. Certains patients bénéficient d'un suivi psychologique pour accepter leur nouvelle réalité et retrouver une qualité de vie satisfaisante.
L'entourage familial nécessite également une information et un soutien. Les proches doivent connaître les gestes de premiers secours et savoir utiliser un défibrillateur. Cette formation rassure le patient et peut sauver des vies en cas d'urgence.
Concrètement, il faut organiser son environnement. Avoir toujours son téléphone à portée, informer ses collègues de sa pathologie, éviter les situations isolées prolongées. Ces précautions simples permettent de concilier sécurité et autonomie.
Les Complications Possibles
Les complications liées au risque de mort subite concernent à la fois les conséquences de la pathologie sous-jacente et les effets des traitements. Comprendre ces risques permet une meilleure prise en charge et une surveillance adaptée.
L'insuffisance cardiaque représente la complication la plus fréquente des cardiomyopathies. Le muscle cardiaque affaibli ne parvient plus à assurer un débit sanguin suffisant. Cette évolution progressive nécessite un traitement médical spécifique et peut conduire à la transplantation cardiaque.
Les accidents thromboemboliques constituent un autre risque majeur. Certaines arythmies favorisent la formation de caillots dans les cavités cardiaques. Ces caillots peuvent migrer et provoquer un AVC ou une embolie pulmonaire. Un traitement anticoagulant préventif s'avère souvent nécessaire.
Concernant les traitements, le défibrillateur implantable peut présenter des dysfonctionnements. Les chocs inappropriés, bien que rares, génèrent une anxiété majeure. Les infections du boîtier nécessitent parfois une explantation temporaire. La surveillance régulière en consultation spécialisée permet de détecter précocement ces complications.
Les médicaments antiarythmiques exposent à des effets secondaires spécifiques. L'amiodarone peut affecter la thyroïde, les poumons ou la peau. Une surveillance biologique régulière s'impose pour détecter ces complications potentiellement graves.
Quel est le Pronostic ?
Le pronostic du risque de mort subite varie considérablement selon la cause sous-jacente, l'âge du patient et la rapidité de la prise en charge. Les avancées thérapeutiques récentes ont considérablement amélioré l'espérance de vie des patients à risque.
Pour les patients porteurs d'un défibrillateur implantable, le pronostic s'est nettement amélioré. Les études montrent une réduction de 50 à 70% du risque de mort subite [13]. L'espérance de vie se rapproche de celle de la population générale, particulièrement chez les sujets jeunes.
Les cardiomyopathies héréditaires présentent un pronostic variable. La cardiomyopathie hypertrophique, bien prise en charge, permet souvent une vie normale. En revanche, certaines formes de cardiomyopathie dilatée évoluent vers l'insuffisance cardiaque terminale nécessitant une transplantation.
L'âge au moment du diagnostic influence fortement le pronostic. Les sujets jeunes bénéficient généralement d'une meilleure adaptation aux traitements et d'une évolution plus favorable. Après 70 ans, les comorbidités compliquent la prise en charge et assombrissent le pronostic.
L'important à retenir : un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée transforment radicalement le pronostic. Les patients bien suivis peuvent espérer une qualité de vie satisfaisante et une espérance de vie proche de la normale.
Peut-on Prévenir la Mort Subite ?
La prévention de la mort subite repose sur une approche à plusieurs niveaux : prévention primaire chez les sujets à risque et prévention secondaire après un premier épisode. Les stratégies préventives ont considérablement évolué ces dernières années.
Le dépistage cardiovasculaire constitue la pierre angulaire de la prévention primaire. Chez le sportif, l'électrocardiogramme de repos est recommandé avant toute pratique intensive [12,14]. Cette mesure simple permet de détecter les anomalies électriques prédisposant aux arythmies malignes.
La prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire réduit significativement l'incidence de mort subite [1,4]. Le contrôle de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'hypercholestérolémie diminue le risque coronarien. L'arrêt du tabac divise par trois le risque de mort subite.
L'enquête familiale joue un rôle crucial dans les formes héréditaires [3]. Le dépistage des apparentés permet d'identifier précocement les porteurs de mutations et d'adapter leur surveillance. Cette approche préventive peut sauver plusieurs vies au sein d'une même famille.
La formation du grand public aux gestes de premiers secours améliore le pronostic des arrêts cardiaques. La généralisation des défibrillateurs automatiques externes dans les lieux publics augmente les chances de survie. Chaque minute gagnée améliore le pronostic neurologique.
Recommandations des Autorités de Santé
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en 2024 des recommandations actualisées concernant la prise en charge de la mort subite du sujet jeune [3]. Ces guidelines intègrent les dernières avancées diagnostiques et thérapeutiques pour optimiser la prise en charge.
Le protocole de dépistage chez le sportif a été renforcé. La HAS recommande désormais un ECG systématique avant 35 ans pour toute pratique sportive intensive. Cette mesure vise à détecter précocement les anomalies électriques prédisposant aux arythmies d'effort [3].
Concernant l'implantation de défibrillateurs, les indications se sont élargies. Les nouvelles recommandations abaissent le seuil d'implantation chez les patients jeunes avec cardiomyopathie hypertrophique. Cette évolution reflète l'amélioration du rapport bénéfice-risque de ces dispositifs.
Le Ministère de la Santé a lancé un plan national de prévention des maladies cardiovasculaires incluant la mort subite [4]. Ce programme prévoit le renforcement du dépistage, la formation des professionnels et l'amélioration de l'accès aux soins spécialisés.
Les réseaux de soins se structurent autour de centres de référence. Ces centres d'expertise coordonnent la prise en charge complexe et assurent la formation des équipes locales. Cette organisation améliore l'homogénéité des pratiques sur le territoire national.
Ressources et Associations de Patients
Plusieurs associations accompagnent les patients confrontés au risque de mort subite et leurs familles. Ces structures offrent un soutien précieux, des informations actualisées et facilitent les échanges entre patients.
L'Association pour la Lutte contre les Maladies Cardiovasculaires propose des groupes de parole, des conférences médicales et un accompagnement personnalisé. Leurs bénévoles, souvent d'anciens patients, comprennent parfaitement les difficultés rencontrées.
La Fédération Française de Cardiologie développe des programmes d'éducation thérapeutique spécifiquement adaptés aux patients à risque de mort subite. Ces programmes abordent la gestion du stress, l'adaptation de l'activité physique et l'observance thérapeutique.
Pour les familles touchées par des formes héréditaires, l'Association Française contre les Myopathies propose un accompagnement génétique. Leurs conseillers aident à comprendre la transmission héréditaire et organisent le dépistage familial.
Les plateformes numériques se développent également. Des applications mobiles permettent de suivre ses symptômes, de gérer ses traitements et de rester en contact avec l'équipe soignante. Ces outils modernes complètent l'accompagnement traditionnel.
N'hésitez pas à contacter ces associations. Leur soutien peut faire la différence dans l'acceptation de la maladie et l'amélioration de la qualité de vie.
Nos Conseils Pratiques
Vivre avec un risque de mort subite nécessite quelques adaptations pratiques simples mais essentielles. Ces conseils, issus de l'expérience des patients et des recommandations médicales, facilitent le quotidien.
Organisez votre environnement pour optimiser la sécurité. Gardez toujours votre téléphone à portée de main, même la nuit. Informez vos proches de votre pathologie et de la conduite à tenir en cas d'urgence. Affichez les numéros d'urgence (15, 112) bien visiblement.Concernant l'activité physique, respectez scrupuleusement les recommandations cardiologiques. Évitez les efforts intenses non supervisés. Préférez les activités d'endurance modérée aux sports de compétition. Arrêtez immédiatement l'exercice en cas de symptômes.
La gestion du stress améliore significativement la qualité de vie. Pratiquez régulièrement des techniques de relaxation. Organisez votre travail pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à consulter un psychologue si l'anxiété devient envahissante.
Pour les voyages, quelques précautions s'imposent. Emportez toujours vos médicaments en quantité suffisante. Gardez sur vous un résumé médical traduit en anglais. Vérifiez la disponibilité de soins cardiologiques à destination.
Enfin, maintenez un suivi médical régulier. Respectez scrupuleusement les rendez-vous de contrôle. Signalez immédiatement tout nouveau symptôme. Cette surveillance rapprochée optimise votre sécurité.
Quand Consulter un Médecin ?
Certains symptômes imposent une consultation médicale urgente, voire un appel immédiat au SAMU (15). Connaître ces signaux d'alarme peut sauver votre vie ou celle de vos proches.
Les douleurs thoraciques intenses, en étau, irradiant vers le bras gauche ou la mâchoire nécessitent un appel immédiat au 15. N'attendez jamais que la douleur passe d'elle-même. Même si elle disparaît rapidement, une consultation s'impose dans les heures qui suivent.
Tout malaise avec perte de connaissance, même brève, justifie une évaluation cardiologique urgente. Ces syncopes peuvent révéler des troubles du rythme dangereux. Ne minimisez jamais ces épisodes, particulièrement s'ils surviennent à l'effort.
Les palpitations intenses et prolongées, accompagnées d'essoufflement ou de douleur thoracique, imposent une consultation rapide. Si elles durent plus de quelques minutes ou s'accompagnent de malaise, appelez les secours.
Chez les patients déjà suivis, certains signes doivent alerter : aggravation de l'essoufflement, œdèmes des chevilles, fatigue inhabituelle. Ces symptômes peuvent révéler une décompensation cardiaque nécessitant un ajustement thérapeutique.
En cas de doute, n'hésitez jamais à consulter. Il vaut mieux une consultation "pour rien" qu'un retard de prise en charge potentiellement fatal. Votre cardiologue préfère être sollicité inutilement que de découvrir une complication évitable.
Questions Fréquentes
Puis-je faire du sport avec un risque de mort subite ?L'activité physique reste possible mais doit être adaptée selon les recommandations cardiologiques. Les sports d'endurance modérée sont généralement autorisés, contrairement aux sports de compétition intense [12,14]. Le défibrillateur implantable est-il douloureux ?
L'implantation se fait sous anesthésie locale. Les chocs thérapeutiques peuvent être ressentis mais restent brefs. La plupart des patients s'adaptent bien à leur dispositif [13]. Puis-je prendre l'avion avec un défibrillateur ?
Oui, mais informez la compagnie aérienne et les contrôles de sécurité. Emportez votre carte de porteur de dispositif médical. Les détecteurs de métaux peuvent déclencher l'alarme sans danger. La mort subite est-elle toujours héréditaire ?
Non, seules certaines formes sont héréditaires, principalement les cardiomyopathies et canalopathies. La majorité des cas résulte de maladies coronariennes acquises [3]. Que faire si je ressens des palpitations ?
Arrêtez toute activité, asseyez-vous et respirez calmement. Si les palpitations persistent plus de quelques minutes ou s'accompagnent d'autres symptômes, appelez le 15. Puis-je conduire avec un risque de mort subite ?
La conduite est généralement autorisée après évaluation cardiologique. Certaines restrictions peuvent s'appliquer selon le type de véhicule et l'activité professionnelle.
Questions Fréquentes
Puis-je faire du sport avec un risque de mort subite ?
L'activité physique reste possible mais doit être adaptée selon les recommandations cardiologiques. Les sports d'endurance modérée sont généralement autorisés, contrairement aux sports de compétition intense.
Le défibrillateur implantable est-il douloureux ?
L'implantation se fait sous anesthésie locale. Les chocs thérapeutiques peuvent être ressentis mais restent brefs. La plupart des patients s'adaptent bien à leur dispositif.
Puis-je prendre l'avion avec un défibrillateur ?
Oui, mais informez la compagnie aérienne et les contrôles de sécurité. Emportez votre carte de porteur de dispositif médical. Les détecteurs de métaux peuvent déclencher l'alarme sans danger.
La mort subite est-elle toujours héréditaire ?
Non, seules certaines formes sont héréditaires, principalement les cardiomyopathies et canalopathies. La majorité des cas résulte de maladies coronariennes acquises.
Que faire si je ressens des palpitations ?
Arrêtez toute activité, asseyez-vous et respirez calmement. Si les palpitations persistent plus de quelques minutes ou s'accompagnent d'autres symptômes, appelez le 15.
Puis-je conduire avec un risque de mort subite ?
La conduite est généralement autorisée après évaluation cardiologique. Certaines restrictions peuvent s'appliquer selon le type de véhicule et l'activité professionnelle.
Spécialités médicales concernées
Sources et références
Références
- [1] Épidémiologie des facteurs de risque cardiovasculaire. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [2] Épidémiologie des facteurs de risque cardiovasculaire. Santé Publique France. 2024-2025.Lien
- [3] Prise en charge d'une mort subite du sujet jeune. HAS.Lien
- [4] Maladies cardiovasculaires - Ministère du Travail, de la Santé. 2024-2025.Lien
- [5] Futurapolis Santé : le futur de la santé est en direct. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [6] Innovation réseaux d'investigations cliniques, dispositifs médicaux. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [7] Brochure Colloque 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [8] Definitions of clinical study outcome measures. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [9] ACC/AHA/ASE/HFSA/HRS/SCAI/SCCT/SCMR 2025. Innovation thérapeutique 2024-2025.Lien
- [10] Un malaise du jeune sportif inaugural de mort subite. Ben-Haddour M, Levesque T. Annales françaises de médecine d'urgence. 2024.Lien
- [11] Peut-ton prédire la mort subite d'origine cardiaque? Spaulding C. Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine. 2023.Lien
- [12] Prévention de la mort subite d'origine cardiaque chez l'athlète: une revue narrative. Gautier E, Deldicque L.Lien
- [13] Le gilet défibrillateur portable en prévention de la mort subite cardiaque. Faure N. L'Aide-Soignante. 2023.Lien
- [14] Course contre la mort subite. IDUDCA UNE, C SPORTIVE. Rev Med Liege. 2024.Lien
- [15] La mort subite de l'adulte: les 10 ans du Centre d'Expertise Mort Subite (CEMS) de Paris. Anys S, Marijon E. 2022.Lien
- [18] Mort subite de l'adulte. Coeur et Recherche.Lien
Publications scientifiques
- Un malaise du jeune sportif inaugural de mort subite (2024)1 citations
- Peut-ton prédire la mort subite d'origine cardiaque? (2023)
- [PDF][PDF] Prévention de la mort subite d'origine cardiaque chez l'athlète: une revue narrative
- Le gilet défibrillateur portable en prévention de la mort subite cardiaque (2023)
- [PDF][PDF] COURSE CONTRE LA MORT SUBITE (2024)[PDF]
Ressources web
- MORT SUBITE DE L'ADULTE (coeur-recherche.fr)
La mort subite cardiaque se définit comme une mort naturelle avec perte brutale de conscience dans l'heure qui suit le début des symptômes, chez un sujet ...
- Mort subite cardiaque, une fatalité ? | Actualité (chu-lyon.fr)
7 sept. 2022 — Le pouls s'arrête et le cœur cesse de battre. Le cerveau et les poumons ne sont plus alimentés par l'oxygène du sang. En dix secondes, la ...
- Prise en charge d'une mort subite du sujet jeune (has-sante.fr)
Pour être efficace, ce dépistage devra être complet incluant un ECG, une échographie cardiaque, une épreuve d'effort, un examen Holter, un ECG avec les ...
- Arrêt cardiaque soudain | Institut de cardiologie de l' ... (ottawaheart.ca)
Symptômes · des étourdissements · des palpitations cardiaques (pouvant être annonciatrices d'arythmie) · des douleurs à la poitrine.
- Mort subite. Que dois-je savoir ? - Cardiologie de l ... - uicar (uicardiologia.com)
La mort subite est caractérisée par un collapsus ou un arrêt cardiaque secondaire à des arythmies, chez les personnes avec ou sans maladie cardiaque, qui, ...

- Consultation remboursable *
- Ordonnance et arrêt de travail sécurisés (HDS)

Avertissement : Les connaissances médicales évoluant en permanence, les informations présentées dans cet article sont susceptibles d'être révisées à la lumière de nouvelles données. Pour des conseils adaptés à chaque situation individuelle, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.
